Francesco Careri, Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, Éditions Jacqueline Chambon, Rayon Art, 2013, 221p., traduit de l’italien par Jérôme Orsoni.
Francesco Careri, architecte et chercheur (Université de
Rome III), nous propose un essai dont l’objectif est de donner à l’architecture
une ressource nouvelle, un moyen de s’ouvrir par la marche à ce qu’il nomme, en
référence aux surréalistes, l’inconscient des villes. Sa démarche s’inscrit
dans le cadre d’un travail initié en 1995 par la création du groupe « Stalker »
avec d’autres chercheurs architectes, mais aussi des artistes, des urbanistes,
etc. Pour autant, il ne s’agit pas d’un texte dont l’intérêt serait réservé aux
spécialistes du genre. Ce dont il est question, c’est de la marche, chose que
nous connaissons tous, mais que nous avons sans doute laissé s’enfermer dans
les trajets convenus, habituels, balisés. La marche nous est ici présentée
comme un outil critique, à la fois génératrice d’architecture et comme moyen
d’explorer cet inconscient des villes, ce que notre monde, notre ville génère
en sa périphérie, dans les « zones », là où la société se débarrasse
de ses déchets, comme pour les refouler dans ce « vide » urbain qui,
loin d’être aussi vide qu’on le pense, regorge de vie et de créativité libre.
Ainsi, la société ignore encore que ces zones vivent, deviennent. S’aventurer
dans la zone, par la marche, est donc un moyen de rencontrer cet autre qui est
nôtre. C’est renouer avec un dialogue entre le plein (la ville), nous pourrions
dire le saturé, et le vide, et découvrir par la rencontre la genèse d’une ville
nouvelle. L’ouvrage s’inscrit donc dans une perspective qui touche autant
l’esthétique que l’anthropologie.

 Hervé Touboul, Marx avec Hegel, Presses universitaires du Mirail, Philosophica.
Hervé Touboul, Marx avec Hegel, Presses universitaires du Mirail, Philosophica.  « Pourquoi
s’inquiéter à l’idée que nous vivrons de plus en plus dans une société où tout
sera à vendre » ? M. Sandel invoque deux raisons. La première se
rapporte à l’inégalité des revenus et à la question de la justice, la seconde à
l’effet corrupteur du marché sur certains biens.
« Pourquoi
s’inquiéter à l’idée que nous vivrons de plus en plus dans une société où tout
sera à vendre » ? M. Sandel invoque deux raisons. La première se
rapporte à l’inégalité des revenus et à la question de la justice, la seconde à
l’effet corrupteur du marché sur certains biens.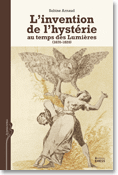 Comment
s’invente une maladie ? Une telle question peut heurter, non pas seulement
les adversaires opposés à toute lecture constructiviste de l’histoire des
maladies et de la médecine plus généralement, mais un sens commun qui veut que
la maladie désigne un état, et sa désignation un discours.
Comment
s’invente une maladie ? Une telle question peut heurter, non pas seulement
les adversaires opposés à toute lecture constructiviste de l’histoire des
maladies et de la médecine plus généralement, mais un sens commun qui veut que
la maladie désigne un état, et sa désignation un discours. Les
contradictions de la doxa contemporaine à l’égard de la
philosophie – celle-ci serait aussi bien nécessaire et
irremplaçable que stérile, aussi bien omniprésente et capable de
parler de tout que réservée à une élite et éloignée du monde –
sont pour Guillaume Carron un signe que le lien entre philosophie et
réel a perdu de sa consistance, et invitent ainsi à réinterroger
ce lien. Là où il pourrait sembler que cette interrogation a
toujours déjà été le sens-même de la philosophie et de toute
l’histoire de l’ontologie, Guillaume Carron insiste sur
l’historicité du terme « le réel », en soulignant la
rareté et la caractère tardif de son occurrence dans le vocable
philosophique et ce jusqu’au 20e siècle, où il prendra
au contraire une place prépondérante. Il faut alors remonter à son
apparition dans la pensée hégélienne pour comprendre pourquoi nous
avons tendance à avoir une foi spontanée dans la rationalité du
réel et à occulter la résistance du réel au concept. L’enjeu
revendiqué de l’ouvrage est de montrer la place particulière que
tient la pensée de Merleau-Ponty dans l’histoire de la
philosophie, dans la mesure où elle se confronte explicitement à
cette résistance du réel et au bouleversement méthodologique
qu’elle exige. Consciente des impasses de toute « pensée
objective », qu’elle soit réaliste ou idéaliste, la
philosophie qui interroge le réel et en accepte dès lors l’énigme
devra se déployer hors des concepts rationalistes traditionnels et
se faire « philosophie concrète (…) qui s’applique,
chaque instant, à garder le contact avec l’expérience du réel ».
Aussi l’ouvrage de Guillaume Carron insiste-t-il sur les dimensions
critique et éthique de la philosophie de Merleau-Ponty, en ce que
celle-ci montre les failles du réalisme et de l’intellectualisme,
au fond deux manifestations d’une même incapacité à s’étonner
devant le réel, à s’interroger sur la possibilité de son
évidence, et à remettre en question le critère de l’évidence
comme fondement premier du réel et de la vérité. Mais il s’agit
également pour l’auteur de souligner l’apport philosophique de
Merleau-Ponty par sa convocation du corps, de l’imaginaire et de la
structure pour appréhender de manière inédite l’expérience de
réel. A la faveur de l’exploration de la notion de réel, on suit
l’évolution de la pensée de Merleau-Ponty, confrontée à
diverses influences et forgeant peu à peu un nouveau type de
discours philosophique. Ainsi sa « philosophie concrète »
abordera d’abord le réel comme ce qui résiste à toute tentative
d’arraisonnement : ni donné brut ni stricte construction
subjective, il est une dimension originelle de l’expérience,
« plénitude insurpassable ». Puis l’exploration de la
possibilité de l’illusion l’amènera à réenvisager le réel et
à reconnaître son rapport chiasmatique avec l’imaginaire, et
enfin à l’inscrire « dans la structure charnelle si
particulière de la réversibilité ».
Les
contradictions de la doxa contemporaine à l’égard de la
philosophie – celle-ci serait aussi bien nécessaire et
irremplaçable que stérile, aussi bien omniprésente et capable de
parler de tout que réservée à une élite et éloignée du monde –
sont pour Guillaume Carron un signe que le lien entre philosophie et
réel a perdu de sa consistance, et invitent ainsi à réinterroger
ce lien. Là où il pourrait sembler que cette interrogation a
toujours déjà été le sens-même de la philosophie et de toute
l’histoire de l’ontologie, Guillaume Carron insiste sur
l’historicité du terme « le réel », en soulignant la
rareté et la caractère tardif de son occurrence dans le vocable
philosophique et ce jusqu’au 20e siècle, où il prendra
au contraire une place prépondérante. Il faut alors remonter à son
apparition dans la pensée hégélienne pour comprendre pourquoi nous
avons tendance à avoir une foi spontanée dans la rationalité du
réel et à occulter la résistance du réel au concept. L’enjeu
revendiqué de l’ouvrage est de montrer la place particulière que
tient la pensée de Merleau-Ponty dans l’histoire de la
philosophie, dans la mesure où elle se confronte explicitement à
cette résistance du réel et au bouleversement méthodologique
qu’elle exige. Consciente des impasses de toute « pensée
objective », qu’elle soit réaliste ou idéaliste, la
philosophie qui interroge le réel et en accepte dès lors l’énigme
devra se déployer hors des concepts rationalistes traditionnels et
se faire « philosophie concrète (…) qui s’applique,
chaque instant, à garder le contact avec l’expérience du réel ».
Aussi l’ouvrage de Guillaume Carron insiste-t-il sur les dimensions
critique et éthique de la philosophie de Merleau-Ponty, en ce que
celle-ci montre les failles du réalisme et de l’intellectualisme,
au fond deux manifestations d’une même incapacité à s’étonner
devant le réel, à s’interroger sur la possibilité de son
évidence, et à remettre en question le critère de l’évidence
comme fondement premier du réel et de la vérité. Mais il s’agit
également pour l’auteur de souligner l’apport philosophique de
Merleau-Ponty par sa convocation du corps, de l’imaginaire et de la
structure pour appréhender de manière inédite l’expérience de
réel. A la faveur de l’exploration de la notion de réel, on suit
l’évolution de la pensée de Merleau-Ponty, confrontée à
diverses influences et forgeant peu à peu un nouveau type de
discours philosophique. Ainsi sa « philosophie concrète »
abordera d’abord le réel comme ce qui résiste à toute tentative
d’arraisonnement : ni donné brut ni stricte construction
subjective, il est une dimension originelle de l’expérience,
« plénitude insurpassable ». Puis l’exploration de la
possibilité de l’illusion l’amènera à réenvisager le réel et
à reconnaître son rapport chiasmatique avec l’imaginaire, et
enfin à l’inscrire « dans la structure charnelle si
particulière de la réversibilité ».
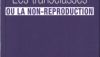 Chantal Jaquet, Les Transclasses, ou la non-reproduction, PUF, 2014.
Chantal Jaquet, Les Transclasses, ou la non-reproduction, PUF, 2014.  C’est dans le contexte agité de
la publication des Carnets Noirs que
paraît aux éditions Ad Solem le dernier ouvrage de Jean Vioulac qui semble
venir achever une trilogie commencée chez Epiméthée (PUF) par L’époque de la technique et La logique totalitaire. Si Apocalypse de la vérité peut très bien
se lire seul, il est clair cependant qu’il prendra toute sa mesure dans la
prolongation des deux premiers essais puisqu’il semble en constituer une sorte
de conclusion voire de récapitulation. C’est donc un parcours herméneutique
complet de la pensée de Heidegger qui finalement se dessine au fil de ces
livres.
C’est dans le contexte agité de
la publication des Carnets Noirs que
paraît aux éditions Ad Solem le dernier ouvrage de Jean Vioulac qui semble
venir achever une trilogie commencée chez Epiméthée (PUF) par L’époque de la technique et La logique totalitaire. Si Apocalypse de la vérité peut très bien
se lire seul, il est clair cependant qu’il prendra toute sa mesure dans la
prolongation des deux premiers essais puisqu’il semble en constituer une sorte
de conclusion voire de récapitulation. C’est donc un parcours herméneutique
complet de la pensée de Heidegger qui finalement se dessine au fil de ces
livres.  Alain Boyer, Chose promise. Etude sur la promesse à partir de Hobbes et de quelques autres, Puf, 2014.
Alain Boyer, Chose promise. Etude sur la promesse à partir de Hobbes et de quelques autres, Puf, 2014. 

 La Question
du mal. Ethique, politique, religion comparée
La Question
du mal. Ethique, politique, religion comparée Leibniz, Protogaea, traduction de B. de Saint-Germain, édition de J-M Barrande, Toulouse, P.U.M., 1993, 298 pages.
Leibniz, Protogaea, traduction de B. de Saint-Germain, édition de J-M Barrande, Toulouse, P.U.M., 1993, 298 pages.