Bonnes vacances à tous.
L'Œil de Minerve est de retour début septembre.
13 juillet 2016
Par hmuller le 13 juillet 2016, 14:28
Bonnes vacances à tous.
L'Œil de Minerve est de retour début septembre.
06 juillet 2016
Par Florence Benamou le 06 juillet 2016, 19:21 - Épistémologie
Hoquet et Merlin (dir.), Précis de philosophie de la biologie, Vuibert, 2014 Lu par Jonathan Racine
Après les très utiles Précis de philosophie des sciences et Précis de philosophie de la physique, les éditions Vuibert nous proposent ce Précis de philosophie de la biologie. Cet ouvrage collectif est publié sous la direction de T. Hoquet, à qui l’on doit notamment des études sur Darwin, Linné, et une anthologie de textes sur le sexe biologique, et F. Merlin, auteur d’un intéressant ouvrage sur Le hasard dans la théorie de l’évolution. Il réunit les contributions aussi bien de jeunes chercheurs que des noms bien connus de la philosophie de la biologie, tels ceux de J. Gayon, M. Morange, E. Fox Keller. On ne peut que saluer cette entreprise, qui contribue à donner un peu plus de visibilité à ce qui constitue un champ disciplinaire à part entière dans le monde philosophique anglo-saxon, et qui est en voie de s’établir solidement en France. Rappelons tout de même que le premier ouvrage de synthèse en français, le remarquable Philosophie de la biologie de F. Duchesneau, date de bientôt 20 ans (1997). Un nouvel état des lieux était nécessaire.
L’introduction s’attache à préciser le sujet, dans la mesure où la réflexion philosophique sur la vie est, en France, peut-être un peu trop vite réduite aux analyses de Canguilhem sur le normal et le pathologique et sur l’émergence de certains concepts importants dans le domaine des sciences de la vie. Même si l’approche historique n’est pas absente, il est clairement reconnu qu’ « un grand nombre des contributeurs […] se situent plutôt du côté de la ‘philosophie de la biologie’ anglo-saxonne ».
04 juillet 2016
Par Karim Oukaci le 04 juillet 2016, 06:00 - Philosophie générale
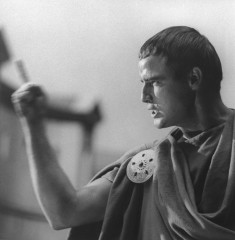
La préparation des concours est souvent l'occasion de publications pleines d'intérêt. Cyril Morana, Éric Oudin et Marianne Perruche ont dirigé un ouvrage collectif sur la parole - notion sur laquelle les candidats au concours d'entrée aux grandes écoles de commerce seront amenés à disserter en 2017.
01 juillet 2016
Par Romain Couderc le 01 juillet 2016, 06:00 - Philosophie générale
 Frédéric Laupies, La vérité, Leçon philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, 2014
Frédéric Laupies, La vérité, Leçon philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, 2014
L'ouvrage de M. Laupies, Professeur de philosophie au lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles, est un cours à destination des élèves de classes préparatoires économiques et commerciales. Il s'intéresse au statut de la vérité en tant qu'elle est objet de connaissance et principe de la grandeur morale.
24 juin 2016
Par Karim Oukaci le 24 juin 2016, 06:00 - Philosophie générale
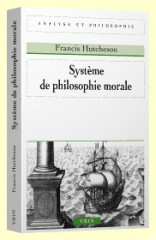
Il aura fallu attendre deux cent quarante-six ans pour lire dans une nouvelle traduction A System of Moral Philosophy, l'un des chefs-d'œuvre de l'enseignement de Hutcheson. L'attente fut excessivement longue pour ce qui reste l'un des textes essentiels des Lumières écossaises, un livre qui fut admiré tout aussi bien par Lessing que par Diderot, et dont la postérité, pour être discrète, n'en fut pas moins considérable.
22 juin 2016
Par Florence Benamou le 22 juin 2016, 06:00 - Philosophie générale
Jean-Frédéric Schaub Pour une histoire politique de la race , Seuil Collection Librairie du XXIe siècle, mars 2015, Lu par Nawal El Yadari
Dans cet ouvrage, J.-F. Schaub propose une histoire des constructions des catégories raciales : il s'agit d'exhumer des catégories qui fonctionnent parfois sans dire leur nom, et de dépasser le paradigme simpliste qui réduit le racisme à la seule idéologie raciste biologique. Des catégories imprègnent nos cadres de pensée et les cadres de l'action politique, et il s'agit d'en comprendre les racines. L'ouvrage est donc polémique, puisqu'il se propose de déceler la politique de la race et ses continuités sous différentes idéologies universalistes. Il convient de se rappeler des apports fondamentaux des pensées de Fanon et de De Beauvoir : la construction sociale de l'altérité, qu'elle soit raciale ou genrée, va de pair avec un processus de définition de soi. Assigner autrui à une place, c'est se définir soi-même. Ainsi on ne peut pas comprendre la racialisation sans y saisir en creux la construction de la blanchité. De même que le sexisme permet de construire une certaine masculinité.
L'ouvrage part d'un constat, à savoir celui d'une tension propre à nos sociétés contemporaines : la tension entre, d'une part la « plasticité individuelle des appartenances », autrement dit la possibilité pour tout un chacun d'échapper aux assignations identitaires, et d'autre part, la permanence du racisme dans les sociétés contemporaines – le racisme biologique fût-il disqualifié.
« Le triomphe de la plasticité des appartenances devrait favoriser une extinction des positions racistes dans les sociétés contemporaines. » (p. 18
17 juin 2016
Par Baptiste Klockenbring le 17 juin 2016, 06:00 - Sociologie
Un siècle après sa rédaction en langue allemande, cette première parution en français du livre La Domination de Max Weber (1864-1920) peut être considérée comme un événement majeur pour les sociologues, philosophes des religions, anthropologues et politicologues de langue française. Cette primeur est complétée à quelques mois d’intervalle par une autre parution dans la même collection, La ville, avec une maquette de couverture similaire. Période faste : les sociologues francophones sont comblés en découvrant coup sur coup deux «nouveaux» livres de Max Weber (1).
13 juin 2016
Par Michel Cardin le 13 juin 2016, 07:32 - Philosophie générale
C'est de la question de l'identité sexuelle que « se mêle » la philosophe Jeanne Larghero dans cet ouvrage animé d'un grand souci pédagogique. Dans un parcours en six chapitres, écrits avec humour, puisant dans des sources aussi variées que la physique aristotélicienne ou la phénoménologie d'un Merleau-Ponty, l'auteur, rompue aux « gender studies » et à l'histoire de la pensée féministe, se donne pour but de « poser un regard neuf sur l'identité sexuelle ».
10 juin 2016
Par Michel Cardin le 10 juin 2016, 07:03 - Philosophie générale
Au milieu du chaos des détonations des attentats du 13 novembre 2015, une seule certitude semblait pouvoir s’imposer : nous avions affaire à des « kamikazes ». C’est cette étrange notion que Laurent de Sutter prend comme point de départ de son nouvel essai paru aux PUF, Théorie du kamikaze, afin de mieux mettre au jour la façon dont elle dit quelque chose de notre présent en éclairant de manière crue ce qui tend pourtant à se dérober.
27 mai 2016
Par Baptiste Klockenbring le 27 mai 2016, 06:00 - Philosophie politique
Le livre de NADIA YALA KISUKIDI est issu d’une thèse de doctorat soutenue en décembre 2010 à l’université de Lille II sous la direction de Frédéric Worms, et dont le titre était : L’humanité créatrice. Essai sur la signification esthétique et politique de la métaphysique de Bergson. Mention « Très honorable avec Félicitations ».
L’auteure est actuellement assistante d’enseignement en éthique (Faculté autonome de théologie protestante/ Université de Genève).
25 mai 2016
Par Baptiste Klockenbring le 25 mai 2016, 06:00 - Psychanalyse
Gilles Ribault nous présente ici, associé à un collectif qu'il dirige, un recueil d'articles, constituant autant de lectures philosophiques de cas freudiens. Un peu à la manière de Ricoeur, les différents auteurs de cet ouvrage proposeront une analyse épistémologique et historique de textes directement tirés de la pratique.
23 mai 2016
Par Romain Couderc le 23 mai 2016, 06:00 - Éthique
 Fabrice Gzil, La maladie du temps. Sur la maladie d’Alzheimer, Paris, PUF, 2014.
Fabrice Gzil, La maladie du temps. Sur la maladie d’Alzheimer, Paris, PUF, 2014.
Presque inconnue du grand public avant les années 2000, la Maladie d’Alzheimer semble aujourd’hui omniprésente. Abordée en continuation par les journaux, elle est même devenue un topos cinématographique à part entière, comme le démontrent les nombreux films et séries télévisées où trouvent place des personnages atteints par ce particulier « handicap cognitif évolutif ». Pour Fabrice Gzil, auteur de La maladie du temps. Sur la maladie d’Alzheimer (PUF), cette exposition sans précédents, si elle n’est pas fortuite, ne serait cependant pas synonyme d’une pleine compréhension théorique de cette affection et de ses répercussions sur le vécu des personnes atteintes.
19 mai 2016
Par Romain Couderc le 19 mai 2016, 06:00 - Esthétique
 Stéphane Lambert, Mark Rothko. Rêver de ne pas être, éd. Arléa, 2014.
Stéphane Lambert, Mark Rothko. Rêver de ne pas être, éd. Arléa, 2014.
Cet ouvrage est la nouvelle édition, revue par l’auteur, d’un texte publié en 2011. Il est construit en deux parties. La première, intitulée « Allo Houston ? Ici, Daugavpils », est de nature biographique et retrace le parcours singulier - « la navigation d’une vie » - du peintre Mark Rothko, né Markus Rothkowitz le 25 septembre 1903 à Dvinsk dans l’Empire Russe (aujourd’hui Daugavpils en Lettonie) et mort suicidé à Houston le 25 février 1970. La deuxième partie, titrée « De l’effacement du lieu au lieu de l’effacement », s’attache quant à elle à décrire et commenter l’oeuvre, du moins quelques œuvres majeures mais tardives du peintre, plus particulièrement les Dark Paintings (de Four Darks in Red (1958) jusqu’aux Black on Grey (1969) en passant par les Seagrams (1958)). L’auteur s’efforce d’y verbaliser ses propres émotions devant ces œuvres contemplées tour à tour à Londres lors de l’exposition de l’hiver 2008-2009 à la Tate Gallery et à Houston à la Chapelle Rothko.
16 mai 2016
Par Romain Couderc le 16 mai 2016, 06:00 - Éthique
Roger-Pol Droit, La philosophie ne fait pas le bonheur, Paris, Flammarion, 2015.
Cet ouvrage part d’un constat, et même d’une colère : la philosophie aujourd’hui se préoccupe essentiellement de la question du bonheur, on ne compte plus les ouvrages qui prétendent que la philosophie peut conduire au bonheur. Pour Roger-Pol Droit, « cette rengaine de la philo-bonheur » (p.11) est tout à la fois fausse, dangereuse, et ridicule. Il s’oppose donc, dans cet ouvrage, à cette nouvelle conception de la philosophie, et précise bien que c’est cette image générale qui l’intéresse ; c’est pourquoi il laissera de côté les nuances, les points de détail, les petites divergences pour mieux percevoir un tableau d’ensemble.
13 mai 2016
Par Karim Oukaci le 13 mai 2016, 01:00 - Philosophie générale
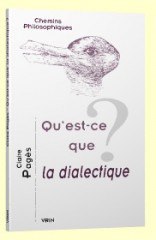
L'encyclopédie des "Chemins Philosophiques" s'est enrichie d'un article d'une centaine de pages sur la dialectique, l'un de ces concepts qui ont pu traverser la longue histoire de la philosophie grâce à la force de toutes leurs équivoques.
11 mai 2016
Par Romain Couderc le 11 mai 2016, 06:00 - Histoire de la philosophie
Jean-François Kervégan, La raison des normes. Essai sur Kant, Paris, Vrin, 2015.
L’ambition qui préside à cet essai consiste à étudier les transformations de la pensée kantienne tout en signalant les correspondances entre Kant et Hegel, invitant à cesser d’opposer systématiquement les deux auteurs dans le domaine éthique. La forme de l’essai n’est pas anodine : son souci d’exploiter les potentialités conceptuelles de la problématique de la normativité chez Kant, l’amène à dégager les lignes de force d’une pensée au-delà de son architecture explicite et des intentions prêtées à son auteur.
08 mai 2016
Par Karim Oukaci le 08 mai 2016, 06:00 - Histoire de la philosophie

« La plus extraordinaire des choses littéraires », disait Borges de la Divine Comédie. Jean-Louis Poirier vient de consacrer à l'un des plus sublimes passages de l'Enfer, qui forme le premier cantique de la Commedia, et le plus pittoresque, un commentaire à bien des égards très extraordinaire.
05 mai 2016
Par Florence Benamou le 05 mai 2016, 06:00 - Philosophie politique
Pierre-Yves Quiviger, Le secret du droit naturel ou après Villey, Classiques Garnier, Paris, 2012, 190 pages, Lu par V. Alain
Il est habituel d’opposer le droit positif au droit naturel. Le premier définit la loi par la volonté générale, le contrat, la convention ; le second soutient l’existence d’une loi naturelle fondée en raison. L’un fait de l’État l’instigateur de normes, l’autre affirme l’existence de valeurs transcendantes. Villey subvertit cette opposition en soutenant d’une part que le positivisme juridique n’est lui-même que la conséquence du jusnaturalisme et d’autre part que le droit naturel des modernes n’est, quant à lui, qu’un droit dénaturé. Villey déclare alors « ce que je recherche reste (…), à titre principal, le secret du droit naturel » .
Pierre-Yves Quiviger publie en 2012 aux éditions Classiques Garnier dans la bibliothèque de la pensée juridique un dense essai de 190 pages intitulé précisément Le secret du droit naturel ou Après Villey. Cette étude entend prolonger la critique villeyenne et cherche à révéler le secret du droit naturel. Deux convictions étayent alors cet essai. D’une part, le positivisme juridique en s’opposant à l’idée d’un droit naturel tend à défendre un « scepticisme plus ou moins agressif ou amusé, qui a pris acte de la relativité des formes positives du droit ». D’autre part, les amis du droit naturel loin d’en servir la cause l’enterrent en confondant la morale et le droit. Renvoyant ainsi dos à dos partisans et adversaires, cette étude souhaite décrire « les conditions de possibilité (…) » d’un jusnaturaliste cohérent. Cette position suppose avant tout le refus d’une norme transcendante s’appuyant sur une certaine idée d’humanité (Kant) et sur une « origine mythique de la société comme l’état de nature »(Rousseau). À l’école du jusnaturalisme est adressé le reproche de faire du sujet de droit un « empire dans un empire », donc de s’appuyer sur une certaine conception de la nature humaine. Cette nouvelle perspective subvertit alors l’opposition métaphysique du fait (sein) et du droit (sollen) et cherche à établir que le sollen (devoir) est en quelque sorte immanent au sein (affaires humaines). Ce droit naturel est dévoilé par le bon juge lorsqu’il interprète la loi. Ce réalisme s’appuie sur une phronêsis juridique déjà mise en évidence chez Aristote par Pierre Aubenque. Cette prudence se laisse saisir dans la « réalité grise du droit », la jurisprudence. Cette thèse se déploie en trois chapitres intitulés respectivement « le droit n’est pas la loi », « la question de la propriété », « l’obligation juridique ».
02 mai 2016
Par Cyril Morana le 02 mai 2016, 04:17 - Histoire de la philosophie
Lucien Jerphagnon, Portraits de l'antiquité, Platon, Plotin, Saint Augustin et les autres..., Champs-Flammarion, 2015
Cette œuvre a été publiée à titre posthume, puisque l'auteur est décédé en 2011 à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Elle a été éditée une première fois sous le titre « A l’école des anciens ». Christiane Rancé, journaliste et essayiste en assure la préface. Il s'agit plus précisément d'analyses érudites, écrites entre 1978 et 2005, et rassemblées en cinq parties. Le nouveau titre s’apparente à un clin d’œil à Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, certainement pour donner l’idée que Lucien Jerphagnon voit dans ces noms des compagnons ou des amis qu’il suit depuis ses premières années de philosophie.
19 avril 2016
Par Jérôme Jardry le 19 avril 2016, 06:00
L'Œil de Minerve prend quelques vacances. Retrouvons-nous le 2 mai pour de nouvelles recensions.
17 avril 2016
Par Jérôme Jardry le 17 avril 2016, 06:00
Danièle Linhart, La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Toulouse, éditions Érès, 2015.
La souffrance au travail et les risques psychosociaux (RPS) sont des problématiques finalement récentes. Toute la question est de savoir comment comprendre ce simple constat. Il serait facile – trop, sans doute, d’y voir la plainte d’ouvriers ou de salariés renâclant à supporter ce que les générations précédentes ont supporté.
15 avril 2016
Par Florence Benamou le 15 avril 2016, 10:59 - Philosophie politique
Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Seuil, 2015 lu par Bruno Hueber
Le terme de démocratie, on le sait, est un de ces signifiants flottants ou de ces termes qui donnent lieu depuis longtemps à une véritable guerre des mots. Un mot, donc, pour un idéal de société émancipatrice s'il en est, qui saurait conjoindre de façon satisfaisante les libertés publiques et individuelles, une certaine justice économique et sociale ainsi qu'une prospérité raisonnable, un mot aussi malheureusement trop souvent alibi, masque ou slogan de toutes les déclarations politiciennes les plus creuses ou les plus prudentes voire des décisions les plus cyniques, un mot enfin affirmant un principe, pour ne pas dire un paradigme, celui de la souveraineté du peuple, entérinant ainsi la même égalité de dignité et de droits fondamentaux pour tous ; la démocratie est bien un mot-valise, qui ne prend son sens véritable que par la connaissance de l'histoire dans laquelle il se déploie, et de celle qu'il contribue à construire en retour par sa valeur d'idéal régulateur, ou d'horizon de normalité des sociétés modernes.
Or, il se trouve que le terme lui-même, sinon la réalité incertaine qu'il peut prétendre désigner, semble faire désormais l'objet d'un inquiétant désenchantement, entérinant ou renforçant au demeurant ce qui semble bien être objectivement une véritable asphyxie ou asthénie de l'espace public.
Reste alors à savoir comment interpréter cette désaffection ou désillusion : soit comme conséquence de la nature nécessairement déceptive de la démocratie, s'expliquant par l'écart inévitable entre le rêve (activé par les campagnes électorales) et la réalité (des lendemains d'élection), soit par un étiage civique trop bas du citoyen ou du peuple démocratique rongé par l'envie, comme le pensait Tocqueville, cédant trop souvent uniquement à ses emportements, ses peurs ou préjugés, ses intérêts matériels ou ses projets à trop court-terme, soit enfin par des institutions insuffisantes, inadéquates, renforçant un sentiment de frustration ou d'un « inachèvement démocratique », sanctuarisant un statu quo qui n'ose s'avouer, au profit d'élites, d'oligarchies arguant, a contrario, de leurs vertus, de leurs compétences et de leur désintéressement pour imposer en fait à la société, la tyrannie de certaines minorités repliées sur leur quant-à-soi.
11 avril 2016
Par Baptiste Klockenbring le 11 avril 2016, 23:19 - Éthique
La philosophie impose de questionner et de prendre son temps. Un temps qui va bien au-delà de l’événement et au-delà de l’existence individuelle d’un homme. Elle sert la vie en la rendant moins étrange. Mais la vie est parfois si singulière qu’elle heurte la philosophie et la laisse sans voix ni raison. En particulier face au mal et à la violence. La maladie d’Alzheimer est dans notre société contemporaine une des manifestations du mal. Elle nous impose le devoir d’assister notre prochain. Mais il s’avère que nous sommes impuissants à aider, à enrayer le déclin ou à remédier à la décomposition de l’autre. Annie, l’épouse de Michel Malherbe, fut atteinte de la maladie d’Alzheimer à l’âge de soixante ans passés. Le mal qui touche son épouse est aussi son affaire. Une affaire d’expérience. Une expérience qui ne se partage pas car c’est chaque fois l’expérience d’un seul. Néanmoins, dans son livre, intitulé Alzheimer, M. Malherbe philosophe à la première personne et entend tirer un enseignement qui se tient dans les limites de son expérience. Présence de la mort au sein de la vie, la maladie d’Alzheimer est un mal qui défait et touche l’homme jusque dans son intégrité d’individu et sa dignité de personne responsable, de sorte qu’il est nécessaire de poser la question de la reconnaissance.
07 avril 2016
Par Romain Couderc le 07 avril 2016, 06:00 - Philosophie politique
Henri Pena-Ruiz, Dictionnaire amoureux de la laïcité, éd. Plon, Paris, 2015.
Henri Pena-Ruiz est l'un des spécialistes de la question de la laïcité. Parallèlement aux travaux de Catherine Kintzler, Jean Baubérot et plus récemment Abdenour Bidar, ses nombreux ouvrages explorent ce thème depuis son Dieu et Marianne publié en 1999. Nouvelle édition revue et augmentée, le Dictionnaire amoureux de la laïcité constitue à sa façon une somme et un outil extrêmement lumineux et utile pour tous ceux qui se soucient de ce principe fondateur de notre République.
04 avril 2016
Par Michel Cardin le 04 avril 2016, 12:52
C'est dans une toute jeune et dynamique maison d’édition numérique et papier, spécialisée dans les essais et les documents, qu’est parue, avant les attentats du 13 novembre 2015, cette esquisse d’une théorie des structures du fanatisme par le psychanalyste et essayiste Gérard Haddad.
« billets précédents - page 10 de 25 - billets suivants »