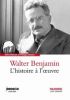 Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, Gilles Behnam et Philippe Quesne, collection « Philosophie en cours », SCERÉN CNDP-CRDP
Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, Gilles Behnam et Philippe Quesne, collection « Philosophie en cours », SCERÉN CNDP-CRDP
Gilles Benham et Philippe Quesne donnent une introduction générale à l’œuvre de Walter BENJAMIN dans la collection « Philosophie en cours » dont l’ambition consiste à provoquer des rencontres entre des auteurs et des « notions » ; notamment celles des programmes de Terminale. Sous le beau titre de « Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre », les auteurs proposent deux « parcours » complets et minutieux au sein d’une réflexion dont les entrées sont notoirement multiples et, en apparence, hétérogènes. Le premier parcours est celui de l’« histoire » : Philippe QUESNE y analyse la stratégie « matérialiste » revendiquée par Benjamin. Elle consiste, cela pourrait d’abord paraître incongru, à appliquer à l’histoire le traitement d’ordinaire réservé aux œuvres d’art. Gilles BENHAM prend le relais en renversant le sablier moderne : c’est le parcours de l’Art. C’est au tour des œuvres, d’être mises en histoires comme autant de « rêves » de la modernité que la tâche critique consiste à libérer de leur sens latent.
 Jean-François Robredo, Suis-je
libre ? Désir, nécessité et liberté chez Spinoza, Les Belles Lettres/Encre Marine, 2015, 17,50€
Jean-François Robredo, Suis-je
libre ? Désir, nécessité et liberté chez Spinoza, Les Belles Lettres/Encre Marine, 2015, 17,50€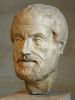 Aristote,
Œuvres complètes, publiées sous la
direction de Pierre Pellegrin, Flammarion, 2014, 79€
Aristote,
Œuvres complètes, publiées sous la
direction de Pierre Pellegrin, Flammarion, 2014, 79€
 Sandra Aube, Thierry Kouamé, Éric Vallet, Lumières de la sagesse, Écoles médiévales d'Orient et d'Occident, Publications de la Sorbonne, 2013.
Sandra Aube, Thierry Kouamé, Éric Vallet, Lumières de la sagesse, Écoles médiévales d'Orient et d'Occident, Publications de la Sorbonne, 2013. Le
philosophe Karl Löwith (1897-1973) demeure fort mal connu en France
alors qu’il est, en Allemagne, une personnalité philosophique
incontournable. Cela tient sans nul doute à l’histoire des
« transferts culturels » franco-allemands - pour parler
comme M. Espagne -, et, dans le cas de Löwith, à la forte réception
française de la philosophie de Heidegger. En effet, après avoir été
l’un de ses disciples les plus remarqués, Löwith est devenu
outre-Rhin une figure de l’anti-heideggérianisme, et c’est
probablement une des raisons pour lesquelles son œuvre souffre
jusqu’à présent d’un déficit de traduction.
Le
philosophe Karl Löwith (1897-1973) demeure fort mal connu en France
alors qu’il est, en Allemagne, une personnalité philosophique
incontournable. Cela tient sans nul doute à l’histoire des
« transferts culturels » franco-allemands - pour parler
comme M. Espagne -, et, dans le cas de Löwith, à la forte réception
française de la philosophie de Heidegger. En effet, après avoir été
l’un de ses disciples les plus remarqués, Löwith est devenu
outre-Rhin une figure de l’anti-heideggérianisme, et c’est
probablement une des raisons pour lesquelles son œuvre souffre
jusqu’à présent d’un déficit de traduction. Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale, deuxième édition, traduit de l’allemand par Janine de Bourgknecht, Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Préface de Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz éditions du Cerf.
Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale, deuxième édition, traduit de l’allemand par Janine de Bourgknecht, Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Préface de Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz éditions du Cerf. Laurent Bove, Albert Camus. De la transfiguration – Pour une expérimentation vitale de l’immanence,
Laurent Bove, Albert Camus. De la transfiguration – Pour une expérimentation vitale de l’immanence,  Theodor Gomperz, Les Atomistes, Manucius, 2014
Theodor Gomperz, Les Atomistes, Manucius, 2014 Les études héraclitéennes brûlent souvent du feu de la polémique. Lebedev et Mouraviev en ont réchauffé il y a peu encore le rude hiver moscovite. Mais ce livre sur les testimonia latins de l'Éphésien devrait pouvoir se prévaloir d'un assentiment général.
Les études héraclitéennes brûlent souvent du feu de la polémique. Lebedev et Mouraviev en ont réchauffé il y a peu encore le rude hiver moscovite. Mais ce livre sur les testimonia latins de l'Éphésien devrait pouvoir se prévaloir d'un assentiment général.  Erotisme païen. Erotisme biblique, Le
Banquet et le Cantique des cantiques
Erotisme païen. Erotisme biblique, Le
Banquet et le Cantique des cantiques À
l’interface de la littérature et de la philosophie, le présent essai nous
invite à une traversée et un examen des textes de Rousseau sous le rapport de
la langue, de l’affect, et de la mémoire.
À
l’interface de la littérature et de la philosophie, le présent essai nous
invite à une traversée et un examen des textes de Rousseau sous le rapport de
la langue, de l’affect, et de la mémoire. Jean-Marc Mandosio, Le Discours de la méthode de Denis Diderot, Editions de l’Eclat, Paris, 2013, lu par Alain Champseix
Jean-Marc Mandosio, Le Discours de la méthode de Denis Diderot, Editions de l’Eclat, Paris, 2013, lu par Alain Champseix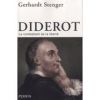 Gerhardt Stenger,
Gerhardt Stenger,  Publilius Syrus, Sentences, édition bilingue, préface de G. Flamerie de Lachapelle, Les Belles Lettres, 2011. Lu par Karim Oukaci
Publilius Syrus, Sentences, édition bilingue, préface de G. Flamerie de Lachapelle, Les Belles Lettres, 2011. Lu par Karim Oukaci Sartre, Situations, III, Paris, Gallimard, 2013
Sartre, Situations, III, Paris, Gallimard, 2013 Christian Destain, Jean-Jacques Rousseau, Le cavalier bleu, coll. « Idées reçues », 2007
Christian Destain, Jean-Jacques Rousseau, Le cavalier bleu, coll. « Idées reçues », 2007 Les Lumières : hier, aujourd'hui et demain
Les Lumières : hier, aujourd'hui et demain Pierre Charron, De la Sagesse, Slatkine Reprints 2013.
Pierre Charron, De la Sagesse, Slatkine Reprints 2013.  David Rabourdin, Pascal, Foi et conversion, PUF Philosophies, 2013.
David Rabourdin, Pascal, Foi et conversion, PUF Philosophies, 2013.