Sandra Aube, Thierry Kouamé, Éric Vallet, Lumières de la sagesse, Écoles médiévales d'Orient et d'Occident, lu par Maryse Emel
Par Jérôme Jardry le 05 novembre 2014, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Sandra Aube, Thierry Kouamé, Éric Vallet, Lumières de la sagesse, Écoles médiévales d'Orient et d'Occident, Publications de la Sorbonne, 2013.
Sandra Aube, Thierry Kouamé, Éric Vallet, Lumières de la sagesse, Écoles médiévales d'Orient et d'Occident, Publications de la Sorbonne, 2013.
« Le monde existe seulement à travers la respiration des écoliers » (phrase talmudique citée p.171)
C’est, entre autre à retracer le voyage dans le temps et l’espace, des savants, des manuscrits et des livres, de la figure du Maître, de la Grèce à l’Occident en passant par l’Orient que nous convie ce catalogue : « Lumières de la sagesse. Ecoles Médiévales d’Orient et d’Occident ». C’est à une véritable révolution intellectuelle, accompagnée d’une mutation sociologique, que nous assistons, légitimant encore plus les analyses de Jacques Le Goff affirmant que ceux que l’on désigne par le terme d’intellectuels en Occident, prennent conscience de leur originalité au sein de la société féodale. Ils vont, en effet, tenter de cohérer les savoirs grâce à la circulation des hommes, des héritages de la Grèce antique, le marché du livre et l’apparition des bibliothèques. Le Maître va devenir très vite une autorité à part entière dans la société, ainsi qu’une figure mémorielle et monumentale dont la sculpture des tympans de cathédrale ou les stèles funéraires portent la trace. A l’aube de la Renaissance, c’est une université ouverte à la circulation des savoirs et des modèles de sa transmission qui est en place. La Renaissance au contraire, cherchera la rupture avec cette institutionnalisation du savoir « dans la volonté de diversifier les lieux de légitimation du savoir, au profit des cours princières ou de structures scolaires plus souples » (p.201). Cette circulation remet en question toute supposition d’opposition entre ces deux mondes que sont l’Orient et l’Occident.
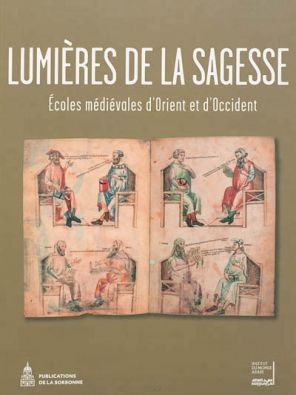
La disparition de l’Ecole d’Alexandrie fut l’occasion de la diversification des écoles en Orient et Occident, une reprise et une rupture avec l’école antique et le modèle grec, avec toutefois des différences notables, mais des enjeux communs à toutes ces écoles: l’apparition de la figure du Maître, l’autorité complémentaire et concurrente des livres et l’apparition de lieux de formation et de transmission du savoir. C’est à partir de leurs différences que les deux mondes dialoguent, dans une mobilité propre à une période que l’on n’a jamais cessé de réduire à des clichés.
Les Publications de la Sorbonne et l’Institut du Monde Arabe se sont rapprochés pour organiser une exposition en septembre 2013, « Lumières de la sagesse. Ecoles Médiévales d’Orient et d’Occident » et en publier le catalogue. Ce dialogue entre les deux grandes institutions est à l’image de celui qui eut lieu entre les deux mondes …
Composé de 28 articles de synthèse, 23 encarts et 70 notices des objets présentés dans l’exposition, l’ouvrage explore les différentes facettes de l’enseignement médiéval en quatre volets :
La première partie, De l’École aux écoles (IV-VIIe siècle), montre la diversité des écoles issues de l’Antiquité, notamment l’école grecque, mais revisitées par les religions monothéistes. Ainsi passe-t-on de l’Ecole à une diversité d’écoles.
L’originalité de cette période est un foisonnement d’expériences.
Constantinople devint un centre culturel important grâce aux intellectuels qui avaient commencé à rassembler les œuvres de littérature et de philosophie grecque ancienne et les copiaient, dans un souci de conservation. Des calligraphes furent ainsi subventionnés par l’Etat pour sauver les livres. Cependant, en 425 apparaît une réorganisation de l’enseignement supérieur sous l’Empereur Théodose II. Une distinction entre école privée et école publique y est désormais de rigueur et il ne peut y avoir cumul des fonctions privé-public. Les enseignants doivent enseigner une seule spécialité. Il n’est plus permis à n’importe qui d’enseigner au sein du public. On organise aussi l’espace de la classe, ce qui laisse entendre que l’on enseignait dehors jusqu’alors ou dans d’autres lieux. Les fouilles du campus d’Alexandrie ont permis de visualiser l’organisation de l’espace du cours : le maître occupait une chaire et les élèves étaient sur des gradins. Du point de vue social, les enseignants étaient d’autant plus admirés que leurs études avaient été longues et qu’ils transmettent une seule discipline.
Un siècle plus tard tout s’effondre avec l’empereur Justinien qui refuse aux communautés non chrétiennes de rentrer dans l’Ecole, ce qui nuisit fortement à la diversité de l’enseignement. La prise d’Alexandrie en 641achève ce déclin de Byzance. Ce n’est qu’au IXe que la vie intellectuelle retrouvera un nouvel essor, pour cesser avec la prise de Constantinople en 1204. C’est donc ainsi qu’Alexandrie fut le modèle de référence. Un modèle qui finit par disparaître.
En Mésopotamie, c’est l’Ecole de Nisibe que l’on rencontre, une école syro-orientale, qui fera une synthèse du néoplatonisme. Elle apparaît après la fermeture de l’Ecole des Persans à Edesse en 489 par l’Evêque de la cité, Cyrus. Une partie du groupe s’éloigna de 200km environ, pour refonder le groupe à Nisibe. Manifestement les sources font souvent défaut et de nombreux commentateurs ont exagéré le poids de cette Ecole.
Du côté de l’Arménie, Anania de Shirak fera entrer les mathématiques dans son pays, afin de mieux fonder la philosophie. Il n’ira pas à la source mais cherchera simplement à en augmenter le nombre d’utilisateurs dans le pays.
Quant à l’Iran, il y a un syncrétisme culturel avec les grecs, un passage des médecins de cours entre la Perse et Byzance, puis l’implantation des Chrétiens d’Orient au Ve siècle qui expliquent un mouvement de traduction du grec vers le Moyen perse et le syriaque. Actuellement on dispose des traductions arabes mais ces intermédiaires sont perdus.
La transmission des savoirs religieux au plus grand nombre soutient la diffusion de nouveaux types d’institutions scolaires qui concernent, comme on le voit en Egypte, aussi bien les filles que les garçons. Les filles pouvaient aussi librement circuler pour avoir les connaissances. L’enseignement du grec instituera une différence entre ces écoles et celles de l’élite.
Ce premier moment montre un éparpillement des Ecoles qui sont souvent créées par des autorités en terme de connaissance.
La seconde partie, Le temps des madrasas, parcourt le monde foisonnant des écoles en terre d’Islam, examine le poids social des sciences et la portée d’un modèle de transmission des savoirs partagé aussi bien par les musulmans que par les juifs et les chrétiens
Le point commun de ces écoles est leur travail de mémoire du texte coranique à des fins humanistes, ce qui n’est pas toujours admis par d’autres religieux, mais aussi de transmission. C’est le Vizir Nizam-al-Mulk qui eut le geste spectaculaire d’établir en Iran et Iraq des madrasas, « lieux d’enseignement », traduction proposée, en lesquels on a vu bien trop vite le modèle de l’université médiévale. Ces madrasas rémunéraient les maîtres et subvenaient aux besoins des étudiants.
On note à cette même période, à partir du XIe siècle, le développement des écoles élémentaires. On y apprenait les sourates du Coran , mais peu, voire pas du tout l’écriture. Il était en effet interdit d’utiliser des crayons à proximité du Coran de peur de l’endommager. Mais ce que l’on reprochera aux maîtres d’école sera leur sévérité excessive qui vaudra de légiférer sur le contenu des châtiments corporels. Cette violence racontée des maîtres d’école montre aussi le peu d’estime dans lequel ils étaient tenus.
Priorité de l’oral sur l’écrit, même si le livre est valorisé, qu’Ibn Jama’a, par exemple, considérait comme nécessaire de réprimander les étudiants qui en faisaient un « écrase-punaises », ou que l’on recommandait comme nécessaire d’avoir toujours un encrier sur soi. Il n’y avait pas de lecture silencieuse, comme dans l’Europe des Manuscrits, du fait de la non-césure des mots. Seule la transmission orale par un Maître, dans une relation singulière avec l’élève, était légitime, d’autant plus que le maître disposait d’une notoriété dont dépendait le devenir de l’étudiant. L’absence de l’oralité aurait été responsable des fautes d’orthographe. Dans les Madrasas, le cours ne pouvait commencer sans un acte de purification du corps. Il y avait aussi des lectures publiques qui étaient l’occasion de sortir du travail de mémorisation (Riwaya) et donnaient ainsi lieu à des débats (dirago)
La communauté juive du Caire, la Genizah’, s’appuyait au contraire beaucoup plus sur l’écriture et la lecture de l’hébreu, afin de former les jeunes gens au commerce. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait aucun travail de lecture des textes religieux. Cette activité était le plus souvent le fait de l’élite ou de personnes soucieuses de respectabilité. Les enfants étant conçus comme des êtres dégradés, on leur faisait simplement faire un travail de mémorisation des textes sacrés afin de prendre part de façon active à l’Office de la Synagogue. Mais ceci faisait aussi écho à la phrase talmudique « Le monde existe seulement à travers la respiration des écoliers »
L’histoire des madrasas confirme, comme on va le voir, une différence essentielle avec l’Université, leur fondement non juridique.
La troisième partie, Le temps des universités, traite de la formation de ce nouveau modèle institutionnel dans l’Occident latin qu’est l’Université à partir du XIIe siècle dans un contexte méditerranéen élargi.
Le nom « universitas » signifiait non pas un lieu d’enseignement, comme les Madrasas, mais la communauté chargée d’administrer le Studium. L’université a un statut juridique. Elle obtient ainsi le droit d’attribuer un statut aux compétences des étudiants, qui ne se réduisent pas à la licence. C’est ainsi que le Baccalauréat mentionnait avant la licence les compétences de l’étudiant avancé, et la maîtrise couronnait l’intégration du licencié au rang des maîtres.
Ces savoirs universitaires et cette nouvelle institution donnèrent naissance à toute une imagerie du maître et de son autorité. C’est à une représentation mémorielle des maîtres les plus fameux que se prêta l’iconologie monumentale. Cette mutation fut ainsi inséparable d’une valorisation nouvelle de la figure des maîtres et de l’autorité du livre, avec la naissance des premières bibliothèques universitaires et de l’enseignement scolastique.
La circulation des œuvres traduites en arabe d’Aristote, aux XIIe-XIIIe siècles, influença cette méthode de connaissance« urbaine », différente de la monastique et conçue comme formulation et résolution raisonnée d’un doute.
Enfin le souci porte de plus en plus sur la lecture des œuvres dans leur intégralité, et non plus des extraits.
La quatrième partie, En quête d’autorités, pose les jalons d’une histoire des cultures scolaires médiévales, comme fondées sur des autorités (Galien, Aristote, Platon, Ptolémée, la Bible ou le Coran, etc.) parfois concurrentes, mais le plus souvent partagées au-delà de la barrière de la langue.
Difficile de résumer un tel ouvrage tant les références y sont nombreuses. Le choix d’un ordre d’exposition géographique et chronologique n’en facilite pas toujours la lecture. Ce livre retiendra l’attention de quiconque réfléchit sur les figures de l’autorité du savoir et ses formes de diffusion : du maître d’école au livre de bibliothèque, en passant par les voyages, les rencontres.
Il est de bon ton en ce moment de parler de « révolution » numérique…En terme de circulation des connaissances, il y a bien accélération, mais n’est-on pas toujours dans cette circulation du savoir ? le numérique, héritier de la pensée médiévale ?
Maryse Emel