Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale, lu par Simon Rochereau
Par hmuller le 15 octobre 2014, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale, deuxième édition, traduit de l’allemand par Janine de Bourgknecht, Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Préface de Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz éditions du Cerf.
Kurt Flasch, Introduction à la philosophie médiévale, deuxième édition, traduit de l’allemand par Janine de Bourgknecht, Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz, Préface de Ruedi Imbach, François-Xavier Putallaz éditions du Cerf.
Préface de
Ruedi Imbach et François-Xavier Putallaz
I – Citer et insérer : la Renaissance carolingienne
II – Délimiter les frontières : l’Occident latin contre la Rome orientale. La rationalité carolingienne face au culte byzantin des images
III – Autodétermination ou prédestination : Érigène contre Godescalc
IV – Chose ou signe : Béranger de Tours contre Lanfranc
V – Insensé ou empiriste : Anselme de Cantorbéry contre Gaunilon
VI – Liberté ou servitude à l’égard de la politique et de la culture : Manegold de Lautenbach contre Wolfhelm de Cologne
VII – Science traditionnelle ou renouveau : les traditionalistes contre Abélard
VIII – Scepticisme et piété ou métaphysique et science : Avérroès contre Al-Ghazali
IX – L’immortalité individuelle ou le retour à l’esprit universel : Albert le grand contre Avérroès
X – La cité de Dieu ou la paix sur terre : la réhabilitation de la philosophie politique dans sa lutte contre la suprématie politique de la papauté
XI – Conciliation ou critique : les objections de Lutterell contre Guillaume d’Ockham
XII – Semence du diable ou philosophie de la filiation divine : la défense de maître Eckhart devant le tribunal de l’Inquisition
XIII – Savoir ou docte ignorance : Jean Wenck contre Nicolas de Cues
Lecture
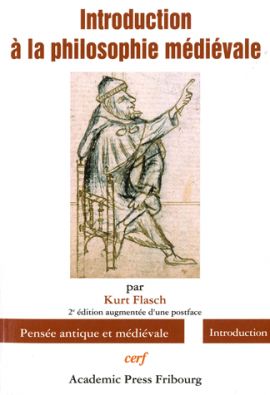 I
– Sous l’impulsion de Charlemagne, qui s’appuie notamment sur
Alcuin d’York, une culture carolingienne naît et se déploie dans
la deuxième moitié du VIIIe
siècle. La philosophie d’Alcuin cherche à donner une cohérence
et un fondement chrétien à l’Empire après une période de
troubles et d’affrontements. Le pouvoir (potestas)
requiert la sagesse (sapientia)
et c’est le rôle de la philosophie d’éclairer et de délimiter
la foi chrétienne qui doit unifier l’empire. En appliquant les
règles de la logique aux Écritures, Alcuin intègre l’héritage
grec des catégories et la théologie augustinienne.
I
– Sous l’impulsion de Charlemagne, qui s’appuie notamment sur
Alcuin d’York, une culture carolingienne naît et se déploie dans
la deuxième moitié du VIIIe
siècle. La philosophie d’Alcuin cherche à donner une cohérence
et un fondement chrétien à l’Empire après une période de
troubles et d’affrontements. Le pouvoir (potestas)
requiert la sagesse (sapientia)
et c’est le rôle de la philosophie d’éclairer et de délimiter
la foi chrétienne qui doit unifier l’empire. En appliquant les
règles de la logique aux Écritures, Alcuin intègre l’héritage
grec des catégories et la théologie augustinienne.
II – Du point de vue de la méthode, il convient d’étudier la philosophie médiévale, non comme l’anticipation incomplète d’une philosophie postérieure (thomiste ou kantienne) mais dans le contexte où elle est née. Ainsi, le projet philosophique d’Alcuin ne saurait être compris indépendamment du projet de consolidation de l’unité de l’Empire germanique dont la philosophie est un instrument. Il faut affirmer son identité et sa puissance non seulement par les armes mais aussi sur le plan doctrinal, par des arguments. C’est pourquoi Charlemagne encourage les Libri carolini à prendre position contre Byzance dans la querelle des images. L’Occident s’affirme ici – sur un fondement qu’elle veut rationnel - et revendique sa supériorité politique et intellectuelle, contre les supposées superstitions grecques et byzantines.
III – Lorsque la culture carolingienne se stabilise au IXe siècle, surgissent en son sein même les premières querelles doctrinales, à l’image de celle qui oppose Godescalc à Jean Scot Érigène à propos de la liberté individuelle et de la prédestination. Il convient (contre l’historiographie contemporaine) d’éclairer cette querelle dans son contexte même et d’unir la philosophie et l’histoire. La lecture attentive des textes tardifs d’Augustin par Godescalc conduit à fissurer le socle doctrinal établi depuis Alcuin. La condamnation de ses thèses par Jean Scot Érigène, loin d’éteindre l’incendie, installe une querelle durable et complexe dans laquelle s’affrontent des interprétations divergentes d’Augustin.
IV – Les querelles apparemment dogmatiques recouvrent de puissants enjeux éthiques et politiques. Au XIe siècle, sur l’Eucharistie, s’affrontent notamment Lanfranc (le pain est substance du Christ) et Béranger de Tours (le pain est signe du Christ et il faut maintenir la rationalité de la foi). Le Concile de Latran (1059) condamne Béranger, clos (provisoirement du moins) la querelle et contribue à affirmer la primauté de la papauté sur les pouvoirs régionaux et l’Empire.
V – A la fin du XIe siècle, Anselme de Cantorbéry, pourtant élève de Lanfranc, approfondit la dimension rationnelle de la foi, cherche à démontrer que la croyance est une nécessité de la raison, contrôlable par la logique et que l’on peut apporter des preuves de l’existence de Dieu. Le débat s’instaure avec Gaunilon pour qui l’insensé (l’athée) pourrait bien être un empiriste et les preuves, des mots qui ne correspondent pas à une connaissance réelle. Anselme oriente l’Église dans cette direction rationnelle et définit un nouveau rapport entre l’homme et Dieu.
VI – A côté d’Augustin de nombreux auteurs, moins connus, comme Macrobe, avaient tissé des liens avec les anciens (Platon, Cicéron). A la fin du XIe siècle, la philosophie reste un champ protéiforme qui va des sciences naturelles à la rhétorique en passant par la grammaire et les mathématiques. L’Empire et la papauté s’affrontent à travers des débats théoriques dans lesquels chaque partie veut asseoir sa suprématie. Manegold de Lautenbach - qui place le pape au dessus de l’empereur - prend ses distances avec le néoplatonisme et la philosophie car le Créateur « nous veut pauvres en esprit », il s’oppose à Wolfhelm de Cologne, fidèle à la tradition de Macrobe et soutien de l’empereur.
VII
– Esprit ouvert, Abélard déploie au XIIe
siècle une nouvelle conception de la science qui laisse place au
doute, à la recherche de la vérité par le débat et à une
interprétation des textes. Il engage un dialogue avec les juifs et
voue un examen attentif à l’Islam. Il se heurte aux
traditionalistes, notamment Bernard de Clairvaux, se voit reprocher
un rationalisme excessif qui dissipe tout mystère et une conception
hérétique de la Trinité. Il reçoit la condamnation de deux
conciles, mais participe à l’essor de la société bourgeoise et
commerçante du XIIe
siècle.
VIII – Le monde arabe, particulièrement avancé en mathématique et en astronomie, comme dans la connaissance d’Aristote, connaît lui-aussi ses querelles. Al-Ghalazi réfute Aristote, Al-Farabi et Avicenne. Il encourage un scepticisme propice à la piété contre la philosophie qui tend à transformer en objets réels ce qui relève de la subjectivité (le temps par exemple). Son approche est critiquée dans le courant du XIIe siècle, par Averroès qui cherche à rendre à la métaphysique sa fonction scientifique en poursuivant Aristote et à montrer la compatibilité de l’Islam et de la philosophie. Toutefois, la cosmologie d’Averroès, afin d’assurer l’intelligibilité du monde, place la rationalité dans ce qui est éternel et contribue à retarder le développement des sciences naturelles. Sa condamnation par le calife et le triomphe des théologiens ennemis de la philosophie, referme durablement un champ de recherche scientifique et philosophique dans le monde arabe.
IX – La condamnation d’Abélard n’avait pourtant pas eu les mêmes retombées en occident dont l’essor était trop avancé pour être stoppé. La pensée d’Aristote, laissée de côté à l’époque où elle était indissociable du savoir médical et philosophique du monde gréco-arabe, est réhabilitée. La science peut être pensée comme une activité humaine et non comme une révélation. Averroès publie un commentaire décisif pour la postérité du Traité de l’âme d’Aristote au début du XIIIe siècle. Les ordres mendiants reçoivent l’autorisation d’enseigner. Albert de Cologne lance une dispute sur l’âme et s’oppose à Averroès. Il adopte une structure scolastique, part des acquis d’Aristote et des arabes qu’il cherche à corriger de manière rationnelle. Son influence est considérable.
X –Aux XIIIe et XIVe siècles, l’héritage d’Aristote conduit à l’émergence d’une philosophie politique qui se fonde non sur la théologie mais sur l’État comme expression de la nature sociale de l’homme. Nature, société et politique se trouvent sécularisés. C’est la naissance du monde moderne. A la suite d’Aristote, Thomas d’Aquin donne un fondement biologique et anthropologique à la politique et à l’autorité politique, tout en cherchant à préserver l’autorité du pape. La politique, qui cherche le bonheur ici-bas, est ordonnée à la béatitude dans l’au-delà. Les hommes sont soumis au roi et les rois, au pape. Sans exclure une soumission spirituelle au pape, Dante prône une plus grande autonomie du champ politique et place la source de l’autorité politique au dessus du pape, en Dieu : il convient que l’Église renonce au projet d’instaurer une cité de Dieu sur terre pour espérer la paix que réclame l’humanité. A son tour, Marsile de Padoue, défenseur de la paix, s’efforce de libérer la politique de la tutelle de l’Église, de défendre la souveraineté populaire et l’autonomie de la philosophie.
XI – Au XIVe siècle, les ordres fixent des doctrines, ce qui n’empêche pas leur contestation. Franciscain, Guillaume d’Ockham ébranle l’édifice conceptuel de l’Église tout entière et s’oppose à la papauté. Se réclamant d’Aristote, Ockham critique les abstractions du langage. Il ouvre la voie d’une nouvelle rationalité et d’une nouvelle méthode : connaître ne consiste pas en une illumination, ni même à retrouver une nature universelle, mais à construire de manière rigoureuse et cohérente des concepts dont le point de départ est l’expérience de l’individu. La science n’est pas une copie du cosmos – livre visible écrit par Dieu - mais une production humaine qui collecte des faits. Les idées ne donnent pas accès à l’essence des choses.
XII – Maître Eckhart, qu’on ne saurait réduire à un mystique, entreprend d’expliquer la foi et les deux Testaments par « les raisons naturelles des philosophes » et d’unifier ainsi philosophie et théologie, à partir de la philosophie. Son affirmation de la filiation divine de tout homme, ainsi que la plupart de ses thèses sont condamnées.
XIII – Au XVe siècle, Jean Wenck de Heidelberg s’oppose à Nicolas de Cues, héritier de Jean Scot Origène et Maître Eckhart (tous deux condamnés en leur temps), sur la nature de la connaissance et l’héritage d’Aristote. Pour Nicolas de Cues, sans expérience directe et critique des degrés du savoir, « la science a perdu toute vie et est devenue inutile aux hommes ». Seul un savoir du non-savoir, une docte ignorance peut réformer la science.
POSTFACE – L’auteur répond aux critiques que la publication de l’ouvrage avait pu susciter et précise son intention et sa méthode. La dimension réflexive qui parcourt l’ouvrage se trouve ainsi isolée et thématisée.
Commentaire
L’approche originale de Kurt Flasch conduit à appréhender une histoire de la philosophie médiévale en mouvement qui rend compte des tensions, des divergences d’interprétations, des échecs, des ambiguïtés et des évolutions que la philosophie médiévale a rencontrés. Conscient de l’inconvénient d’aborder les grands auteurs, « par le côté qui se trouve précisément contesté », mais désireux, avant tout, de restituer une pensée vivante et mouvante, Kurt Flasch nous permet d’entrer de plein pied – sans connaissances préalables - dans quelques grands débats caractéristiques d’une époque qui se dessine progressivement sous nos yeux et dont on mesure l’importance pour les siècles à venir. Affranchi du souci d’exhaustivité, il parvient à éclairer les enjeux de débats qui sembleraient purement théoriques et stériles sans leur contexte. Nous voici en effet introduits, non dans un panthéon de doctrines figées, mais au cœur du déploiement d’une pensée médiévale multiple et protéiforme.