Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XII. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (1964-1965), J.-A. Miller éd., Champ Freudien & Seuil, 2025 (406 p.).
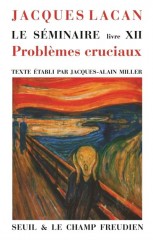 Séminaire de toutes les ruptures, le livre XI s’efforçait de rétablir les fondements de la psychanalyse en mobilisant les notions classiques d’inconscient, de répétition, de transfert et de pulsion. Séminaire de toutes les audaces, le livre XII veut la refonder par une formalisation plus conceptuelle, empruntée à la science topologique. Intitulé Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, ce livre est la transcription de seize séances tenues à l’École normale supérieure en 1964-1965.
Séminaire de toutes les ruptures, le livre XI s’efforçait de rétablir les fondements de la psychanalyse en mobilisant les notions classiques d’inconscient, de répétition, de transfert et de pulsion. Séminaire de toutes les audaces, le livre XII veut la refonder par une formalisation plus conceptuelle, empruntée à la science topologique. Intitulé Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, ce livre est la transcription de seize séances tenues à l’École normale supérieure en 1964-1965.
Partant du rapport du sujet au langage, se développant sur le rapport du sujet au réel et au symptôme, il se conclut sur le rapport au désir avec le concept d’objet a. « Le terme d’homme, résume Lacan (p. 109-110), comment ne serait-il pas ambigu ? – puisque le sujet n’en a point épuisé le sens, et que, plus que jamais en ce tournant historique où nous sommes, il vit ce sens en vacillant. Il lui faut donc suivre des chemins contournés sur eux-mêmes, passer par des tours et des retours, par l’expérience initiale du semblable, et par l’aliénation, et par l’inconnu de la demande, avant de conclure à l’identification du Je suis un homme ».
 « Si vraiment vous prenez au sérieux la recherche de la vérité dans le domaine religieux, c’est-à-dire la recherche de Dieu et non pas la recherche d’un document justificatif de l’expérience religieuse, nul doute que vous trouverez un chemin. Je ne peux que vous conseiller ce que je vous ai déjà écrit, de vous en tenir aux écrits des grands saints et mystiques ». Suivant à la lettre ce conseil qu’Edith Stein donna autrefois à Roman Ingarden, Emmanuel Cattin invite ses lecteurs à une relecture attentive des textes de Thérèse d’Avila – une lecture s’en tenant à la simplicité des descriptions que Thérèse fit elle-même de ses expériences les plus intimes.
« Si vraiment vous prenez au sérieux la recherche de la vérité dans le domaine religieux, c’est-à-dire la recherche de Dieu et non pas la recherche d’un document justificatif de l’expérience religieuse, nul doute que vous trouverez un chemin. Je ne peux que vous conseiller ce que je vous ai déjà écrit, de vous en tenir aux écrits des grands saints et mystiques ». Suivant à la lettre ce conseil qu’Edith Stein donna autrefois à Roman Ingarden, Emmanuel Cattin invite ses lecteurs à une relecture attentive des textes de Thérèse d’Avila – une lecture s’en tenant à la simplicité des descriptions que Thérèse fit elle-même de ses expériences les plus intimes.  Y a-t-il une pensée militaire française ? Ce travail collectif d’une vingtaine de contributeurs sur une vingtaine d’années s’efforce d’en montrer l’existence, les caractères et les causes. Il le fait en fournissant un florilège des textes fondateurs ou significatifs de cette pensée, de Brantôme à Raymond Aron, rassemblés dans les quatre périodes de son évolution, l’Ancien Régime, le XIXème, les Guerres mondiales et l’Après-1945.
Y a-t-il une pensée militaire française ? Ce travail collectif d’une vingtaine de contributeurs sur une vingtaine d’années s’efforce d’en montrer l’existence, les caractères et les causes. Il le fait en fournissant un florilège des textes fondateurs ou significatifs de cette pensée, de Brantôme à Raymond Aron, rassemblés dans les quatre périodes de son évolution, l’Ancien Régime, le XIXème, les Guerres mondiales et l’Après-1945. 
 Le cœur de l’ouvrage est une étude de Pascale Fautrier sur l’évolution du rapport de Badiou à la figure de Jean-Paul Sartre. Cette étude est encadrée par trois conférences de Badiou sur l'auteur qui le détermina à s'engager en philosophie, datant de 1981 (« Hommage à Sartre »), de 1990 (« Hommage à Sartre II ») et de 2013 (« Sartre et l’engagement ») et par l’extrait d’une séance de séminaire répondant à la question : « Qu’est-ce qu’une idée ? » (2023) qui sert de conclusion.
Le cœur de l’ouvrage est une étude de Pascale Fautrier sur l’évolution du rapport de Badiou à la figure de Jean-Paul Sartre. Cette étude est encadrée par trois conférences de Badiou sur l'auteur qui le détermina à s'engager en philosophie, datant de 1981 (« Hommage à Sartre »), de 1990 (« Hommage à Sartre II ») et de 2013 (« Sartre et l’engagement ») et par l’extrait d’une séance de séminaire répondant à la question : « Qu’est-ce qu’une idée ? » (2023) qui sert de conclusion. 
 Préface à la réédition : Penser la vulnérabilité au temps du COVID-19 et du reste.
Préface à la réédition : Penser la vulnérabilité au temps du COVID-19 et du reste.  Angélique Thébert est maîtresse de conférences à Nantes Université, spécialiste de philosophie britannique de la M
Angélique Thébert est maîtresse de conférences à Nantes Université, spécialiste de philosophie britannique de la M
 Laurent Jaffro, professeur de philosophie morale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vient de publier un livre sur la systématicité et sur la méthode d'Adam Smith à propos du problème de l'évaluation morale, tel qu'il le traite en particulier dans La Théorie des sentiments moraux.
Laurent Jaffro, professeur de philosophie morale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vient de publier un livre sur la systématicité et sur la méthode d'Adam Smith à propos du problème de l'évaluation morale, tel qu'il le traite en particulier dans La Théorie des sentiments moraux.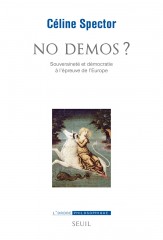 Traiter philosophiquement de l’Europe en tant que totalité, en questionnant la possibilité de décrocher la souveraineté démocratique de son territoire strictement national : telle est l’ambition du livre de Céline Spector. Pour ce faire, les six chapitres traitent de problèmes de philosophie politique classique – l’échelle de la démocratie (ch. 1), la souveraineté (ch. 3), la citoyenneté (ch. 4), le peuple (ch. 5), le développement des droits sociaux (ch. 6) –, en posant la question de leur application au niveau européen, dans une forme institutionnelle correspondant à une République fédérative européenne (ch. 2).
Traiter philosophiquement de l’Europe en tant que totalité, en questionnant la possibilité de décrocher la souveraineté démocratique de son territoire strictement national : telle est l’ambition du livre de Céline Spector. Pour ce faire, les six chapitres traitent de problèmes de philosophie politique classique – l’échelle de la démocratie (ch. 1), la souveraineté (ch. 3), la citoyenneté (ch. 4), le peuple (ch. 5), le développement des droits sociaux (ch. 6) –, en posant la question de leur application au niveau européen, dans une forme institutionnelle correspondant à une République fédérative européenne (ch. 2).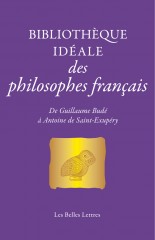 Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et l'un des meilleurs connaisseurs du monde de la philosophie française d'aujourd'hui, invite les lecteurs de cette Bibliothèque idéale à une suite de rencontres aussi merveilleuses qu'inattendues avec des philosophes français.
Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et l'un des meilleurs connaisseurs du monde de la philosophie française d'aujourd'hui, invite les lecteurs de cette Bibliothèque idéale à une suite de rencontres aussi merveilleuses qu'inattendues avec des philosophes français. Pierre-Luc Desjardins, spécialiste de philosophie médiévale, vient de publier un ouvrage sur Maître Eckhart et sur la centralité de son concept de Naissance du fils dans l’âme pour saisir l’unité d’une pensée à l’œuvre dans toute l’étendue de son corpus, aussi bien allemand que latin.
Pierre-Luc Desjardins, spécialiste de philosophie médiévale, vient de publier un ouvrage sur Maître Eckhart et sur la centralité de son concept de Naissance du fils dans l’âme pour saisir l’unité d’une pensée à l’œuvre dans toute l’étendue de son corpus, aussi bien allemand que latin.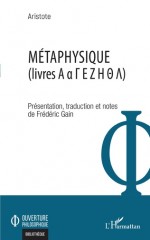
 Laurent Awono, professeur de philosophie dans l'Académie de Versailles, propose dans ce manuel de renouveler, par l'usage de la carte mentale, la méthode de la dissertation, c'est-à-dire du "traitement rigoureux, ordonné et argumenté d'un problème".
Laurent Awono, professeur de philosophie dans l'Académie de Versailles, propose dans ce manuel de renouveler, par l'usage de la carte mentale, la méthode de la dissertation, c'est-à-dire du "traitement rigoureux, ordonné et argumenté d'un problème". 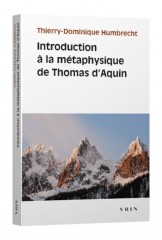

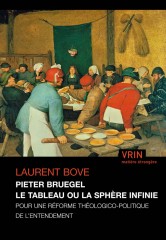 Laurent Bove : Pieter Bruegel, Le tableau ou la sphère infinie. Pour une réforme théologico-politique de l’entendement (Vrin, 2019, 324 p. avec reproduction de dessins et tableaux).
Laurent Bove : Pieter Bruegel, Le tableau ou la sphère infinie. Pour une réforme théologico-politique de l’entendement (Vrin, 2019, 324 p. avec reproduction de dessins et tableaux). 
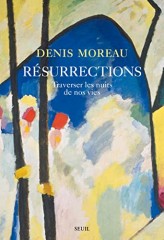 Le Professeur Denis Moreau vient de faire paraître un essai passionnant sur la fonction de l'espérance et sur le paradigme chrétien de la résurrection face aux drames de l'existence.
Le Professeur Denis Moreau vient de faire paraître un essai passionnant sur la fonction de l'espérance et sur le paradigme chrétien de la résurrection face aux drames de l'existence.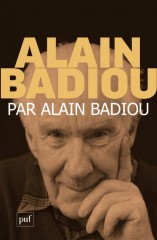

 Lorsque le philosophe se donne l’idée de problème comme thème de réflexion, il peut avoir en tête la raison d’être de sa propre discipline, adossée à quelques grands noms de son histoire (Bergson, Deleuze …). En effet, que le problème soit l’objet d’une rencontre (le problème est ce qui nous « tombe dessus ») ou qu’il soit l’objet d’une position (la fameuse « problématique »), la philosophie, pour problématisante qu’elle soit, ne saurait faire du problème l’impensé de sa propre pratique. Certes, le problème en philosophie fait l’objet d’une réflexion, mais celle-ci est trop souvent méthodologique et rarement philosophique. Et pour cause : le problème est d’abord ce à quoi le professeur rend sensible et ce que l’apprenti philosophe, élève ou étudiant, apprend à construire -- il fait donc l’objet d’un discours spécifique (problématologie) énonçant les moyens principaux de présenter un problème et de le déployer. Ainsi, dans le champ philosophique, les différents ouvrages de méthodologie constituent le lieu essentiel où l’idée de problème se trouve thématisée, sans que cette idée ne fasse nécessairement l’objet d’une réflexion philosophique précise, c’est-à-dire in fine problématique. C’est donc l’objet du livre de Philippe Danino que de proposer une ample réflexion philosophique sur l’idée même de problème.
Lorsque le philosophe se donne l’idée de problème comme thème de réflexion, il peut avoir en tête la raison d’être de sa propre discipline, adossée à quelques grands noms de son histoire (Bergson, Deleuze …). En effet, que le problème soit l’objet d’une rencontre (le problème est ce qui nous « tombe dessus ») ou qu’il soit l’objet d’une position (la fameuse « problématique »), la philosophie, pour problématisante qu’elle soit, ne saurait faire du problème l’impensé de sa propre pratique. Certes, le problème en philosophie fait l’objet d’une réflexion, mais celle-ci est trop souvent méthodologique et rarement philosophique. Et pour cause : le problème est d’abord ce à quoi le professeur rend sensible et ce que l’apprenti philosophe, élève ou étudiant, apprend à construire -- il fait donc l’objet d’un discours spécifique (problématologie) énonçant les moyens principaux de présenter un problème et de le déployer. Ainsi, dans le champ philosophique, les différents ouvrages de méthodologie constituent le lieu essentiel où l’idée de problème se trouve thématisée, sans que cette idée ne fasse nécessairement l’objet d’une réflexion philosophique précise, c’est-à-dire in fine problématique. C’est donc l’objet du livre de Philippe Danino que de proposer une ample réflexion philosophique sur l’idée même de problème.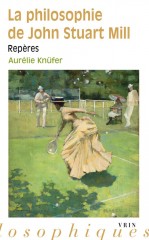 Maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Montpellier, membre de l'Institut Universitaire de France, Aurélie Knüfer fait paraître une présentation de l'œuvre philosophique de John Stuart Mill. Avec une remarquable originalité, elle y montre tout ce qui en lui ne se réduit pas à un libéralisme ordinaire, et qui permet de donner à son parcours parfois sinueux une parfaite cohérence : la redéfinition de l'individualité comme acte et comme devenir, la réflexion sur les conditions de l'épanouissement de cette individualité, l'intérêt pour les expérimentations sociales et politiques visant à ce plein exercice de l'individualité.
Maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Montpellier, membre de l'Institut Universitaire de France, Aurélie Knüfer fait paraître une présentation de l'œuvre philosophique de John Stuart Mill. Avec une remarquable originalité, elle y montre tout ce qui en lui ne se réduit pas à un libéralisme ordinaire, et qui permet de donner à son parcours parfois sinueux une parfaite cohérence : la redéfinition de l'individualité comme acte et comme devenir, la réflexion sur les conditions de l'épanouissement de cette individualité, l'intérêt pour les expérimentations sociales et politiques visant à ce plein exercice de l'individualité. Le Professeur Paul Gilbert est l'auteur d'un traité de métaphysique, où la métaphysique se retrouve elle-même objet d'un travail de libération : la métaphysique ne serait pas tant science de l'être que conscience de ce qui transcende l'être et de ce qui, face à lui, ouvre à une altérité.
Le Professeur Paul Gilbert est l'auteur d'un traité de métaphysique, où la métaphysique se retrouve elle-même objet d'un travail de libération : la métaphysique ne serait pas tant science de l'être que conscience de ce qui transcende l'être et de ce qui, face à lui, ouvre à une altérité.