Jean-Louis Poirier, ou le sens de la révolte
Par Karim Oukaci le 04 décembre 2023, 06:00 - Philosophie - Lien permanent
Jean-Louis Poirier, Bibliothèque idéale des philosophes français. De Guillaume Budé à Antoine de Saint-Exupéry, 2023, Belles-Lettres (707 pages).
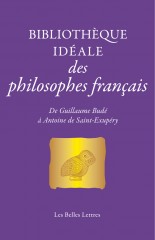 Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et l'un des meilleurs connaisseurs du monde de la philosophie française d'aujourd'hui, invite les lecteurs de cette Bibliothèque idéale à une suite de rencontres aussi merveilleuses qu'inattendues avec des philosophes français.
Jean-Louis Poirier, spécialiste de philosophie antique et l'un des meilleurs connaisseurs du monde de la philosophie française d'aujourd'hui, invite les lecteurs de cette Bibliothèque idéale à une suite de rencontres aussi merveilleuses qu'inattendues avec des philosophes français.
Les centaines de textes ici rassemblés, toujours étonnants, parfois généreux, souvent cruels, brillent par l'extrême finesse de leur intelligence, par leur attention au réel, leur sens de la révolte, leur désir de transmission. Jean-Louis Poirier nous fait découvrir des philosophes inconnus, loin de toute philosophie officielle, et nous fait lire des pages extraordinaires, singulières, bizarres d'auteurs qu'on pensait bien connaître. Il montre à quel point les philosophes d'expression française donnèrent au mot philosophie une signification de combat. Des hommes, des femmes, des romanciers, des professeurs, quelques politiques, deux trois journalistes, et même des imposteurs, sont réunis par la force de ce même esprit philosophique : voir le monde, le questionner et ne jamais céder sur les conséquences de l'Idée vraie pour laquelle on combat.
Il a accordé un entretien à L’Œil de Minerve :
Jean-Louis Poirier, Les philosophes français, ou le sens de la révolte - YouTube
- Comment l’idée de ce recueil sur les philosophes français vous est-elle venue ?
- Par hasard ! Je l’ai eue en prenant d’abord conscience d’un manque, en m’apercevant qu’à part les auteurs que tout le monde connaît, on ne trouve pas grand-chose. Si on regarde le programme actuel des classes de philosophie, il y a très peu de philosophes français : ils sont écrasés par les Anglais, les Allemands, tout ce qu’on voudra. C’est plutôt une absence qui m’a interpellé. Et, en cherchant, je crois que j’ai fait quelques découvertes. On en parlera si vous voulez !
- Est-ce un philosophe français qui vous a donné l’envie de faire de la philosophie ?
- Là vous m’interrogez sur mon enfance ! Parmi les premiers philosophes que j’ai lus, aimés et qui m’ont donné envie d’aller plus loin, il y eut d’abord Albert Camus. J’étais très petit, je devais être en quatrième. Il y eut aussi Saint-Exupéry. Beaucoup de gens se sont étonnés qu’il soit dans ce recueil. Mais c’est vrai que j’ai beaucoup donné dans cette lecture. Après, je suis passé plutôt vers des philosophes, je ne dirais pas étrangers, même au contraire, mais de l’Antiquité, avec Platon, et de l’Antiquité tardive. J’ai commencé très tôt l’Antiquité tardive !
- À la fin de votre introduction, vous rendez hommage à un certain nombre de philosophes que vous avez connus. Pourriez-vous en évoquer un que vous avez particulièrement apprécié ?
- Je les ai tous connus et tous particulièrement appréciés ! Si vous voulez, je peux en évoquer deux. J’évoquerai d’abord avec une tendresse toute particulière Olivier Clément, qui était mon professeur d’histoire et de géographie de la seconde à la terminale au lycée Condorcet à Paris. On le trouvait quelquefois un petit peu fou. Il était en vérité admirable ! Il faisait un cours d’histoire et géographie intéressant. Mais assez souvent, presque toujours, au bout de quelques minutes, il s’arrêtait et nous parlait de philosophie, même en seconde, notamment parce qu’il avait de hautes responsabilités là-dedans : il était – et j’avoue que je suis totalement indifférent à cette affaire - un orthodoxe russe, très religieux. Il nous parlait de théologie tout en nous parlant de Platon, de Plotin. Il me fit découvrir Chestov. On parlait enfin tout le temps de philosophie ! C’est lui qui m’a enseigné la philosophie dans le second degré, plus que mon professeur de philosophie proprement dit.
La deuxième figure que je pourrais évoquer plus spécialement, même si elles sont toutes sur un pied d’égalité, c’est Georges Canguilhem. Il était pour moi une espèce de modèle ou de paradigme. Il représentait à la fois la rigueur, le savoir, le sérieux. Ce qu’il m’a, je l’espère, enseigné, c’est - je le dis modestement - un certain sens de la résistance, de la provocation.
- À travers tous les philosophes qui composent votre recueil, pensez-vous qu’il se dessine une figure du philosophe français ?
- Si vous permettez, je procéderais d’une manière peut-être un peu plus théorique. Je vous l’ai dit : j’ai cherché un peu en vain des philosophes français. Et ce que j’ai trouvé est intrigant. J’ai trouvé que les philosophes français que tout le monde connaît, et qui ne nous conduisent pas très loin, ceux qui correspondent à ce qui apparaît dans ce livre avec une certaine distance et avec quelquefois une forme de dureté, sinon de méchanceté, c’est ce qu’on a appelé - ce n’est pas moi qui ai inventé cette appellation - la philosophie officielle. C’était alors au début du XIXème siècle. Mais l’enseignement de la philosophie, qui est une particularité française, doit malheureusement beaucoup à cette philosophie officielle, et n’en a sans doute pas encore apuré tous les comptes. Cela eut paradoxalement un effet prodigieux sur la philosophie française, parce que cette philosophie officielle avait pour principe, afin de ne pas choquer, de ne rien enseigner et surtout de ne pas donner de place, en tout cas pas de place excessive, à la culture, à la lecture des textes. Tant qu’on parlait uniquement des procédés de l’esprit humain, cela ne mangeait pas de pain ! Cela aboutit à ce qu’on a appelé le spiritualisme rationnel. Il y en a encore de nos jours. Mais c’était très vivace jusqu’en 1950. C’était vraiment la philosophie qu’il fallait pratiquer pour réussir ses études, pour être professeur de philosophie, etc. Canguilhem justement a donné un coup de pied dans tout cela ! Cette philosophie officielle, très inculte, vit quand même quelques grands noms émerger, et qu’il faut admirer : je citerai par exemple Jules Lagneau, bien que lui-même déborde largement cette étiquette du spiritualisme rationnel. On pourrait en trouver d’autres.
Mais cela eut surtout pour effet de stériliser la philosophie en France et du même coup de faire que ce qu’il y avait encore de philosophie possible s’est développé d’une manière que je qualifierai d’un peu semblable à celle des animaux qui vivent dans des conditions difficiles : ils se développent bien mieux, deviennent plus vigoureux et plus forts. On a eu, grâce à cela, au XIXème et au début du XXème siècle, une génération de philosophes extraordinaires, parce qu’ils étaient tout à fait hostiles à l’institution, révoltés, paradoxaux. Ils ont su mettre en question deux choses. D’une part, le rationalisme. Je n’ai rien contre le rationalisme. Mais ils ont su tout de même en produire une approche un peu moins naïve. D’autre part, ils ont su mettre en question ce qui était l’autre aspect de cet enseignement officiel, le criticisme. C’est-à-dire qu’ils ont su ouvrir toutes sortes de directions tout à fait inattendues. Voilà le premier côté par où ces philosophes, dont j’espère avoir donné un certain nombre d’aperçus dans mon livre, ont occupé le terrain et ont surgi.
Il y a évidemment un autre côté, extrêmement frappant. Ils étaient libres. On les retrouve principalement derrière les barricades, dans la rue. Pas tous, mais beaucoup d’entre eux. Ou, quand ce n’était pas derrière les barricades ou dans la rue, c’était à Sainte-Pélagie ou au bagne. Je tiens à honorer tout particulièrement la figure étonnante de Louise Michel, qui à côté d’une vie extraordinaire, qui force le respect, a produit une œuvre philosophique tout à fait intéressante.
- Votre Bibliothèque idéale nous fait lire des pages magnifiques d’un de ces personnages exceptionnels, résistant et logicien à la fois.
- Jean Cavaillès ! J’étais obligé de le citer. Et ce n’était pas du tout un devoir difficile. Il s’inscrit dans la perspective qui fut celle de Georges Canguilhem. Et c’est un philosophe qui est mort pour la France ! Il n’est pas le seul, mais dans des conditions où il a montré - c’est la leçon que nous autres philosophes pouvons en tirer - comment il pouvait y avoir une certaine articulation entre philosophie et actes de résistance, de courage. En même temps, comme le fait justement observer Georges Canguilhem, il n’était pas un moraliste. Il était spinoziste, rationaliste, logicien. C’est sa logique elle-même qui l’a conduit à se conduire comme il s’est conduit !
- Vous proposez aussi des textes de Louise Michel, pleins de résistance et de sensibilité, et même d’une sensibilité qui va au-delà de l’humain.
- Vous pensez à cette page extraordinaire où, étant enfant, elle assiste à l’exécution, si on peut dire, d’une oie. Il est bien connu que, quand on décapite une oie, si on ne la tient pas bien, le reste s’envole. Il y a cette description saisissante. Mais, quand vous dites que c’est en dehors de l’humain, il faut ajouter que la dernière partie de cette page rapporte ce souvenir à une autre évocation, celle d’une décapitation humaine, d’une exécution à laquelle elle a assisté. Cette image, littérairement saisissante, donne en même temps à penser - dans la mesure où son empathie à l’égard des bêtes ne relève pas d’une sensiblerie puérile ou absurde, mais enveloppe des sentiments humains.
- Un autre personnage incroyable que vous retrouvez, c’est Ozanam.
- Il s’inscrit, comme tous les autres, dans ce créneau de réaction à la philosophie officielle, puisqu’il était catholique - ce qui n’était pas très bien vu à l’époque. Or, ce qui est intéressant chez lui, comme ce qui m’a intéressé chez tous les philosophes présents dans ce livre, c’est qu’il a développé une attention à la réalité sociale qui l’entourait. Il était attentif à l’opposition de la richesse et de la pauvreté, à la pauvreté qui s’accroît dans la société industrielle, etc. - si bien qu’on dit souvent - c’est une étiquette un peu raccourcie - qu’il est l’inventeur du catholicisme social. Cela fait partie de son œuvre. Mais ce qui me paraît très important dans son approche théorique, c’est qu’il montre le côté contradictoire, le côté non-pensé et mal pensé des deux pôles qui s’opposaient. À l’époque où apparaissaient socialismes et traditions marxistes, il regrettait, dans cette compréhension juste du problème social, l’absence d’une visée plus idéale - ce qui compromettait selon lui le socialisme en le faisant pencher du côté des pauvres envieux des riches et vers une simplification qui ne convient pas. On retrouvera chez Jaurès le même problème, la même contradiction dont il essaie de se dépétrer – j’ai mis, d’ailleurs, le texte correspondant dans le recueil [p. 557-560]. D’un autre côté, il récuse évidemment l’indifférence des riches ou des intégristes, notamment catholiques, à l’égard des problèmes sociaux.
- Certains textes permettent de redécouvrir des auteurs qu’on croyait bien connaître. Par exemple, vous nous montrez Saint-Simon socialiste.
- Il est évidemment le théoricien du capitalisme. Mais il est sûr aussi que sont sortis des rangs des saint-simoniens un certain nombre de gens qui sont plutôt du côté du socialisme, au moins de ce qu’on appellera avec Marx le socialisme utopique.
- La Bibliothèque idéale fait aussi découvrir des auteurs extraordinaires et dont on ignorait tout, jusqu’au nom, comme Claire Démar.
- J’ai pris un certain plaisir à citer des gens dont on imagine que personne ne les connaît. Ils ne sont pas inventés pour autant ! Claire Démar était une saint-simonienne. Elle a inventé deux choses à mon avis. L’une, qu’elle a inaugurée, c’est l’installation, la présence de la philosophie dans le journalisme. Elle a fait des journaux, et des journaux militants. Quant à la deuxième chose, elle ne l’a pas inventée, car le saint-simonisme sur ce point fut quelque chose de très important : le saint-simonisme, ce n’est pas seulement le capitalisme, le socialisme, c’est aussi le féminisme – et la plupart des féministes de cette époque étaient de tradition saint-simonienne. Elle a formulé un féminisme extrêmement agressif – sans que cela n’ait rien à voir avec certains féminismes d’aujourd’hui. Claire Démar voit et considère exactement deux choses : la condition de la femme très concrètement, depuis la réalité jusqu’à sa traduction juridique, et à côté de cela la condition sociale en général dans les diverses classes, dans toute la société, ainsi que des solutions possibles. C’est pour cela que c’est quelqu’un de très attachant et de très important. Mais il y en a d’autres qui sont tout à fait inconnues. Vous ne pourrez pas me faire croire que vous connaissiez Suzanne Voilquin !
- Ce recueil contient aussi des romanciers et des gens qu’on connaît comme autre chose que comme philosophes, Senancour par exemple.
- Oui, tout dépend. Les littéraires pouvaient se l’annexer. Pourquoi pas ? Mais voyez les textes que j’ai mis ! J’aurais pu en mettre beaucoup d’autres. Il y a des textes littéraires : la littérature sur ce plan, depuis toujours, a un droit à alimenter, à éclairer la philosophie, il me semble.
- Vous nous montrez que la philosophie a aussi alimenté la politique, comme avec Saint-Just.
- Ce qui est intéressant à travers la figure de Saint-Just et de quelques autres, bien que les textes de Saint-Just le montrent mieux que d’autres, et ce qui s’illustre dans la Révolution française, dans ce que Hegel décrit sous le nom du règne de la vertu ou de la terreur, c’est le fait qu’il ne faut jamais perdre de vue qu’une certaine posture idéelle peut conduire à des conséquences qui par après ne sont pas toujours les meilleures.
- Vous avez choisi des pages d’un livre au titre incroyable, L’homme de désir, les pages du « Philosophe inconnu ».
- Saint-Martin se faisait appeler de cette façon. Il correspond à ce courant qui a été nommé en France l’illuminisme. Alors qu’en italien par exemple Illuminismo est synonyme de Lumières, en France, pas du tout, puisque c’est plutôt le côté illuminé de l’illuminisme, c’est-à-dire ce que d’autres appellent l’obscurantisme. Il y a ce côté d’une analyse des puissances du romantisme, disons pour simplifier, qui apparaît avec Louis-Claude de Saint-Martin, qui a eu une influence très grande, plus qu’il n’est connu lui-même. Il a influencé beaucoup d’autres auteurs.
- Votre recueil propose des surprises y compris sur des auteurs aussi majeurs que Descartes.
- Des surprises, je ne sais pas. Mais c’était mon intention en tout cas de surprendre. C’est-à-dire que je n’allais quand même pas mettre dans ce volume, qui ne cherche pas du tout à être provocateur ou atypique, mais à être à côté, ce qu’on publie généralement. J’ai quand même mis la première page du Discours de la méthode, parce que je crois qu’elle fait l’objet d’un contresens. Puis il y a d’autres pages où effectivement il faut faire apparaître - mais enfin tous les philosophes le savent bien, et ce livre vise au-delà, le grand public – que Descartes correspond très peu à l’adjectif cartésien en français. J’aurais pu ajouter d’autres choses. Si j’avais eu la place et l’occasion, il y a notamment quelques lignes étonnantes dans le Traité des passions, à l’article 190 : interrogé sur ce qui fait qu’un homme peut s’estimer lui-même être content, être satisfait de lui-même, il dit, outre diverses choses, qu’il faut l’être à bon escient, parce qu’on ne peut pas être satisfait de soi-même si on a mal fait ; et il prend l’exemple extraordinaire, surtout si on lit entre les lignes, d’un prince qui s’estimerait heureux d’avoir exterminé tout un peuple – ce qui est une allusion extrêmement précise et nette à Cromwell et aux Irlandais, et ce qui peut s’articuler à certaines lettres où il console la princesse Élisabeth, dont il ne faut pas oublier qu’elle était de la famille de ces rois qui se sont fait couper en deux à cette époque.
- Il y a d’autres conseillers de prince dans La Bibliothèque idéale, comme Naudé, avec des pages incroyables.
- Incroyables, oui, bien que ce genre de provocation soit assez banal. Ce qui est intéressant chez Naudé comme chez d’autres, c’est que c’est théorisé, clair, précis, et que cela interroge sur ce fait que nous connaissons bien en philosophie : qu’est-ce que cela signifie au bout du compte que la politique soit étrangère à la morale, que l’État ne soit pas soumis aux règles de la moralité ? Voilà un exemple de texte en apparence très dogmatique, mais qui pose une infinité de questions !
- Vous avez retenu des pages admirables de Montaigne et de Rabelais. Sur ce dernier, vous dites qu’il a « une langue philosophique parfaite ». En quel sens ?
- À cette question, je serais tenté de répondre : cherchez vous-même ! Mais en vérité il a une langue philosophique parfaite, d’abord parce que - c’est vrai d’à peu près tous les philosophes, mais seulement plus ou moins - c’est une langue qui est exactement adaptée à ce qu’il veut dire, c’est-à-dire que c’est une langue qui ne se tient pas bien, qui n’est pas encore tenue, ni maîtrisée dans les liens de la grammaire ou du bon parler. C’est une langue qui est vivante : il y a des pattes qui dépassent sans arrêt, ou les oreilles, ou la queue ! Et il en jouit, Rabelais ! C’est ce qui nous permet à notre tour d’en jouir évidemment. Dans ce sens, c’est bien une langue philosophique parfaite, parce que c’est d’une certaine manière le contraire de cette langue dont rêvait peut-être Leibniz, une langue univoque et bien sensée. C’est cette langue dont aurait rêvé sans doute Hegel - je ne suis pas sûr qu’il pensait à Rabelais, il pensait plutôt à Diderot.
- Avez-vous songé à inclure dans votre recueil des philosophes qui, sans être français, pouvaient correspondre à la figure du philosophe français ?
- J’y ai pensé. Mais je ne l’ai pas fait. Il y a Marx, pourtant ! Il rentrait dans les critères, puisque les critères, c’était un auteur ou bien de nationalité française, quelle que soit la langue - ce qui a conduit à mettre du Gassendi, du Budé, qui écrivaient latin, ou bien de langue française - ce qui a conduit à mettre des gens qui n’étaient pas français, comme d’Holbach ou Marx justement.
- Pourquoi avoir placé à la fin de l’introduction du recueil la reproduction d’un bas-relief de la cathédrale Saint-Trophime en Arles, représentant le Passage de la Mer Rouge ?
- Je l’ai introduite par après, parce qu’au départ je n’avais pas d’intention préconçue. Mais il m’est apparu très nettement que le lien entre pratiquement tous les textes du début à la fin pouvait se concevoir à travers la question de la transmission. Bien sûr, les philosophes n’en ont pas l’exclusivité. Mais peut-être ont-ils l’exclusivité de la conscience du fait que la transmission, c’est compliqué, et que transmettre se fait toujours d’une certaine manière au péril de sa vie. Dans ce bas-relief, ce qui est intéressant, c’est qu’en s’enfuyant, on emmène les enfants. Ce sont les enfants qui sont le vecteur de la transmission. Mais justement ils ne comprennent pas ce qu’on leur dit. Et ils le transmettent eux-mêmes et de la même manière. C’est-à-dire qu’il y a transmission, parce qu’il y a perte. Et il y a transmission, parce que, dans la perte, il y a liberté. À cet égard, je voudrais vous renvoyer à ce que je crois en être le meilleur commentaire, le texte de Renan sur le contresens [p. 681-882], où il explique que la lecture d’Aristote par Averroès est une suite de contresens, mais où justement il s’indigne contre les transmetteurs professionnels, les philologues : celui qui a raison est celui qui se trompe, celui qui déforme, qui reprend. C’est Averroès qui a raison ! Et Renan fait l’éloge du contresens. Je crois que cette articulation de la transmission de la vie et de la liberté est ce à quoi je tenais beaucoup.
- Vous dites à propos de Montaigne que « les vrais philosophes savent juger de leur temps ». Comment jugez-vous le temps présent ?
- D’abord je vais quand même demander le droit à la modestie. Lorsque j’écris cette phrase sur Montaigne, c’est à propos du fait qu’en son temps il est l’un des rares à identifier et à dénoncer le génocide qui s’effectue en Amérique du Sud. Il n’est pas tout à fait le seul, puisque, sans que cela soit sous la forme de la dénonciation, Naudé y fait également allusion. Il y a cette attention au sérieux et à la gravité de l’histoire qui, à mon avis, est essentielle à un philosophe. C’est là que c’est très difficile, parce qu’il ne suffit pas d’être chronologiquement de son temps. C’est trop facile de dramatiser ou de dénoncer. Il faut voir exactement ce qui ne va pas. Il faut comprendre la réalité. Là est effectivement l’ambition !
Vous me posez la question : « comment pourrait-on exprimer un jugement sur notre temps ? ». Je dirai, en revendiquant le droit à une subjectivité, à un arbitraire total, que le problème de notre temps, plus que pour d’autres temps, c’est une perte du sens même de la transmission. Peut-être à travers trois choses. D’une part, à travers une démocratisation de l’enseignement qui, au lieu d’aboutir à démocratiser l’enseignement, aboutit dans les faits à faire disparaître l’enseignement, au plus grand profit des privilégiés. Le deuxième point par rapport auquel on peut s’inquiéter sur la transmission - et là je rejoins ce que disait Hegel à la fin de la Phénoménologie -, c'est qu'il y a trop de choses à transmettre, parce qu’on conserve tout. Transmettre, c’est savoir ne transmettre que l’important. En ce sens, c’est l’effet pervers des bibliothèques informatisées : je ne suis pas sûr qu’on sache encore transmettre. Puis, d’un autre côté, il y a la question qui poursuit toujours la transmission, la question de la précarité de notre condition. Ce qui est surtout intéressant dans l’effort de transmission, ce n’est pas tellement de se perpétuer au-delà de sa propre génération. C’est de découvrir la fragilité de notre génération et à quoi elle se raccroche.