Marie de Marcillac, Ulysse chez les philosophes, Classiques GARNIER, 2015, Collection « Perspectives comparatistes », 540 p.

Cet ouvrage est la reprise d’une thèse de littérature comparée, écrite par Marie de Marcillac sous la direction de Tiphaine Samoyault et soutenue le 8 décembre 2011 à l’Université Paris 8 de Vincennes Saint-Denis. Contrairement à ce que son titre peut laisser supposer, l’objectif de l’auteure n’est pas de réfléchir à la récurrence du nom d’Ulysse dans l’ensemble de l’histoire de la philosophie mais uniquement dans un corpus de textes philosophiques écrits après la seconde guerre mondiale.
Le constat de départ est le suivant : il existe un engouement manifeste d’un certain nombre de philosophes européens et américains pour le personnage d’Ulysse. Horkheimer, Adorno, Jankélévitch, Arendt, Heidegger, Lévinas, Foucault, Derrida, Deleuze, Serres, Nancy, Lacoue-Labarthe, Gadamer, Conche, Castoriadis, Davidson, Diano, Bloch, ont pour point commun de se référer au personnage d’Ulysse à un moment donné de leur œuvre.
Comment expliquer cette fréquence en cette période particulière de l’histoire?
1) Ulysse, nom intertextuel
Certes, l’usage et la finalité de cette référence varient considérablement en fonction des auteurs au point que la figure d’Ulysse subit une véritable métamorphose d’un texte philosophique à l’autre. Peut-on, malgré ces variations, identifier un fil conducteur interprétatif au sein même du corpus et le nom d’Ulysse peut-il, grâce sa plasticité, relier tous ces fragments textuels ?
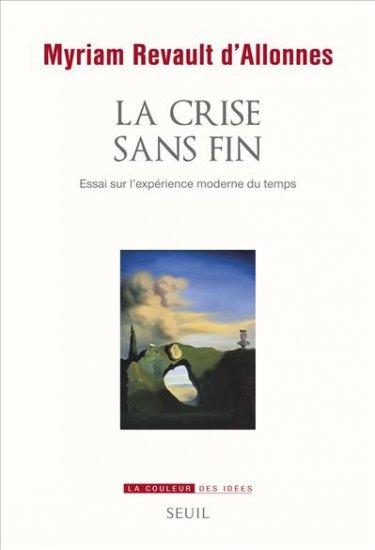 Myriam Revault d'Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, La couleur des idées, 2012.
Myriam Revault d'Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, La couleur des idées, 2012. Le titre de l’ouvrage d’Hélène Péquignat, Platon et Descartes passent le bac peut prêter à confusion, car il y est très peu question de Platon et de Descartes. Il s’agit pour l’auteure, professeur en terminale, de partager différentes expérimentations pédagogiques originales faites avec ses élèves en vue de les mettre en situation de philosophes.
Le titre de l’ouvrage d’Hélène Péquignat, Platon et Descartes passent le bac peut prêter à confusion, car il y est très peu question de Platon et de Descartes. Il s’agit pour l’auteure, professeur en terminale, de partager différentes expérimentations pédagogiques originales faites avec ses élèves en vue de les mettre en situation de philosophes.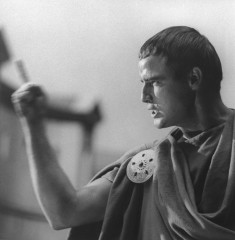
 Frédéric Laupies, La vérité, Leçon philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, 2014
Frédéric Laupies, La vérité, Leçon philosophique, Paris, Presses Universitaires de France, 2014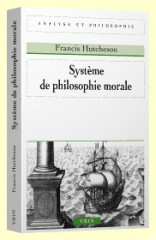
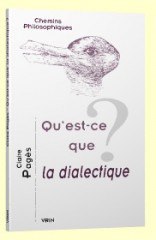
 L’usage des corps, Homo Sacer, IV, 2
L’usage des corps, Homo Sacer, IV, 2 Cet essai de Martine Zarader s’appuie à la fois sur des témoignages et sur des œuvres de fictions, nouvelles, romans, films, pour envisager la notion d’identité dans ce qu’elle peut avoir de problématique. Tous les cas ici exposés sont plus ou moins des « personnages », puisque ce qui les caractérise tous, qu’ils soient fictifs ou réels, est leur difficulté à être un moi. Martine Zarader met des œuvres de Cortazar, Borges, Dostoïevski, Stevenson, ou encore Hitchcock à l’épreuve de divers modèles philosophiques et psychanalytiques d’herméneutique de la subjectivité, pour avancer l’hypothèse phénoménologique d’une appartenance du conflit et de la division de la subjectivité aux structures fondamentales de l’existence.
Cet essai de Martine Zarader s’appuie à la fois sur des témoignages et sur des œuvres de fictions, nouvelles, romans, films, pour envisager la notion d’identité dans ce qu’elle peut avoir de problématique. Tous les cas ici exposés sont plus ou moins des « personnages », puisque ce qui les caractérise tous, qu’ils soient fictifs ou réels, est leur difficulté à être un moi. Martine Zarader met des œuvres de Cortazar, Borges, Dostoïevski, Stevenson, ou encore Hitchcock à l’épreuve de divers modèles philosophiques et psychanalytiques d’herméneutique de la subjectivité, pour avancer l’hypothèse phénoménologique d’une appartenance du conflit et de la division de la subjectivité aux structures fondamentales de l’existence.  Stéphane Vial, L’être et l’écran. Comment le numérique change la perception, PUF, 2013, lu par Guillaume Lillet.
Stéphane Vial, L’être et l’écran. Comment le numérique change la perception, PUF, 2013, lu par Guillaume Lillet. Gilles Vervisch, Puis-je vraiment rire de tout ? Les Éditions de l’Opportun, collection « Les philosopheurs », 2013
Gilles Vervisch, Puis-je vraiment rire de tout ? Les Éditions de l’Opportun, collection « Les philosopheurs », 2013