Myriam Revault d'Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, 2012, lu par Nathalie Godefroid
Par Romain Couderc le 31 janvier 2017, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
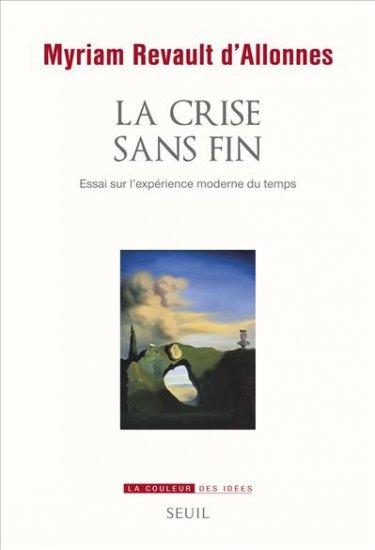 Myriam Revault d'Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, La couleur des idées, 2012.
Myriam Revault d'Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l'expérience moderne du temps, Seuil, La couleur des idées, 2012.
Notre présent est envahi par la crise. Mais qu'entendre par « crise » ? On dit « la » crise, notion englobante qui rassemble des domaines très différents (économie, autorité, éducation…). La notion en est obscurcie. Car au sens originel la krisis, c'est le jugement, la séparation, la décision, autrement dit le moment décisif qui permet le diagnostic et la sortie de crise. Or aujourd'hui, la crise est marquée par l'indécidable, elle est permanente, c'est le milieu et la norme de notre existence, instaurant ainsi une nouvelle expérience du temps.
Dans notre époque « post-moderne », le temps n'est plus moteur d'une histoire à faire, c'est un temps sans promesse : le futur est incertain, tout s’accélère mais rien ne bouge, l'initiative en reste paralysée. C'est pourquoi il faut repenser la question de l'orientation vers le futur, car une société peut-elle se passer d'un sens de l'histoire ?
Face à l'obscurcissement de la notion aujourd'hui, où tout semble dû à la crise, il faut d'abord retracer le parcours de la notion.
La notion apparaît dès l'Antiquité. Krisis signifie distinguer, choisir, décider. Son champ initial d'application est la médecine. La « crise » est le moment où l'on doit décider du traitement, car la phase est critique. La crise se développe donc dans une temporalité : c'est le moment où il faut trancher. Quelle est l'expérience du temps liée à cette conception ?
La conception grecque de l'histoire est inséparable de la naissance de la démocratie : de nouvelles capacités d'actions sont données au citoyen qui va pouvoir faire preuve d'inventivité, mais le pouvoir-faire humain rencontre aussi le hasard imprévisible, ou l'inquiétante volonté de puissance des hommes. La crise apparaît alors au croisement de ce pouvoir-faire prodigieux de l'homme et de sa nature passionnée et irrationnelle.
Il n'y a cependant pas d'idée de progrès chez les grecs. La temporalité instituée par les Athéniens est marquée par l'invention, d'où l'idée de crise : elle marque une rupture avec le modèle cyclique, ou avec la continuité de la tradition, mais cette nouveauté n'est pas « moderne », car le changement est action (politique), et non histoire, il n'est pas totalisable. La crise est ce moment historique d'une contingence jamais abolie face à l'inventivité des hommes.
Avec la modernité, se développe une nouvelle expérience du temps, liée à un concept d'histoire nouveau. La crise se lie alors à l'idée de critique (donc potentiellement au conflit), une critique qui s'exerce au nom de l'idée de progrès : c'est dans l'espérance en l'avenir que la critique trouve son fondement.
Quelle est donc la nature du projet moderne ?
La modernité se caractérise par la perte de la transcendance et des valeurs. Modernité et crise sont ainsi indissociables car il s'agit d'une crise des fondements, de la normativité, de l'identité : la modernité doit s'auto-fonder, d'où une interrogation incessante sur elle-même. La modernité est donc une position réflexive, un concept auto-référentiel : il faut s'en remettre à elle pour trouver sa norme. Le passé est périmé, la modernité fonde sa propre tradition, qui est une tradition de la rupture : tous les repères sont potentiellement ébranlés dès que posés. D'où l'ambiguïté du présent : c'est un moment chargé d'attente, qui s'accompagne d'un regard critique lui-même , c'est le temps de l'inaccompli, ce qui explique la conscience de crise perpétuelle.
Cela suppose la transposition du changement historique en histoire intelligible. Au 18e siècle émerge l'idée d'une histoire englobante, « singulier collectif », qui unifie l'ensemble des histoires particulières. Mais l'histoire devient problématique si le passé est obsolète. D'autre part, les acquis de l'expérience ne sont plus opératoires pour préfigurer l'avenir. L'histoire n'est plus « institutrice de vie ». Elle devient mise à disposition du faire humain. A la fois elle nous présente des progrès mais en même temps elle fait naître l'angoisse devant l'avenir.
Ces caractéristiques peuvent nous faire dire que la modernité est une attitude plus qu'une période : elle est conscience de soi (Hegel), l'homme y prend conscience de sa valeur absolue. Mais cette subjectivité se heurte à l'extériorité : la politique remplace le destin des tragédies, comme ce contre quoi l'individu se heurte. L'enjeu est alors de fonder un État où l'individu soit chez soi. L'Histoire universelle permet cette réconciliation. La modernité est un moment de scission, une expérience de crise décisive où la scission de la vie est portée à son paroxysme, mais elle est destinée à être abolie en tant qu'étape : la crise est moteur mais elle sera rejetée dans le passé.
Il faut finalement se demander, avec Michel Foucault, de quelle façon, dans cette modernité habitée par la crise, les individus ont élaboré leur rapport à soi. La modernité est une expérience, un ethos, c'est la première fois que le penseur s'interroge sur son présent, son actualité, comme d'un événement philosophique ; la philosophie se donne pour la première fois comme discours de la modernité. La modernité est ainsi une disposition que l'on peut résumer par l'injonction « sapere aude », tâche que l'on s'assigne à soi et aux autres. Le sujet moderne s'enracine dans l'attitude critique qui le constitue comme sujet autonome, une attitude qui ne dissimule pas la crise mais l'affronte comme une épreuve. Car la crise n'est pas clôturable : elle n'est pas ce qu'il faut dépasser, mais ce dont il faut partir pour ré-élaborer son statut.
L'auteur en vient enfin à l'analyse de l'expérience contemporaine du temps et à celle de « crise sans fin ».
Aujourd'hui nous vivons et pensons dans la crise, mais une crise permanente est-elle encore une crise ? La décision (donc la sortie de crise) a laissé place à l'indécidable. S'agit-il d'un nouveau paradigme ?
Quel est le statut de la crise actuelle ? Nous vivons dans un nouveau régime d'historicité : le présent est hypertrophié, sans futur ni passé, sans autre horizon que lui-même. Sommes-nous alors sortis de la modernité ou en est-ce un nouvel avatar ?
Aujourd'hui, les idées modernes (l'idée de temps nouveaux, l'accélération du progrès, l'idée d'une histoire disponible) sont en crise, car nous nous heurtons au problème de la technique, à l'expérience des totalitarismes. Il n'y a plus de « temps nouveaux », de progrès : marchons-nous vers le pire ? C'est ce qu'en conclut Hans Jonas : l'humanité future est périssable, l'homme dangereux pour lui-même. Ce qui sert de boussole n'est plus le progrès, mais l'anticipation de la menace.
Nous assistons alors à une détemporalisation, un temps sans promesse, un mouvement sans telos. L'accélération s'est amplifiée, mais ce n'est plus un accroissement quantitatif c'est une « immobilité fulgurante » (Paul Virilio), une inertie de la société, figée et frénétique.
C'est évident dans trois domaines : l'accélération technique, celle des rythmes de vie, celle des mutations sociales et culturelles :
- grâce à la technique on gagne du temps, mais on en manque de plus en plus car l'utilisation des nouveaux outils est chronophage,
- l'accélération des rythmes de vie s'accompagne d'un ennui de plus en plus profond, du sentiment d'une vie vide,
- au niveau social, de plus en plus de précaires ne peuvent pas se projeter dans l'avenir.
C'est pourquoi la dépression est la pathologie la plus caractéristique de notre époque.
Nous assistons enfin à une crise du temps politique : il n'y a plus d'utopies et le souci de la réactivité, du temps réel, empêche les projets à long terme, le temps long de la délibération. La politique n'est plus initiative mais réactive, et le plus souvent impuissante. La crise n'est plus aujourd'hui un moment décisif : la crise, c'est qu'il n'y a plus rien à décider.
Il ne nous semble plus possible d'avoir un regard distancié sur notre présent, le futur a été confisqué par les déclinistes: aujourd'hui l'inquiétude extrême révèle la nécessité d'un nouveau commencement, d'une réappropriation du futur.
On peut alors tirer de la lecture de Hannah Arendt l'idée que la crise est le moment où s'efface les idées toutes faites. Car les préjugés ont une signification historique : une partie du passé se dissimule en eux. Solidifiés en pseudo-théorie ou en idéologie, ils protègent de l'expérience et la rendent impossible : toute réalité est déjà prévue. Or la crise relance les questionnements.
Le temps n'est pas un continuum : il est brisé là où l'homme se tient, car l'homme est libre, il possède la faculté de commencer du nouveau. L'homme peut réaliser l'inattendu. Cette brèche dans le temps est le moment de la pensée et de l'action, l'interruption du cours du temps qui sinon va à la ruine et à la mort. Les hommes « ne sont pas nés pour mourir mais pour innover ». Il ne s'agit pas d'un commencement ex nihilo, mais de la relance d'un nouveau questionnement.
La crise est à l'origine une métaphore issue du domaine médical. Est-elle devenu un véritable concept philosophique ou est-elle restée métaphorique ?
L'auteur s'appuie alors sur l'ouvrage de Paul Ricoeur, La métaphore vive : la métaphore dit quelque chose de la réalité, elle a le pouvoir heuristique de la redécrire, elle « ne viole un ordre que pour en créer un autre », elle produit du sens par transgression. Elle ouvre ainsi à un monde auquel nous appartenons et qui précède l'objectivation du réel, le monde de la vie, sol originaire dans lequel s'enracine toute donation de sens. Ce monde pré-objectif n'est pas un résidu mais un préalable. La référence métaphorique ébranle les catégorisations acquises, elle ouvre une réflexion sur le lien entre vérité et réalité.
Les métaphores peuvent ainsi soutenir la pensée conceptuelle, elles font référence à des aspects de notre être au monde qui ne peuvent être dit de manière directe. C'est alors à la métaphore de dire ce dont le concept ne peut pas rendre raison.
La métaphore est donc la voie privilégiée quand l'univocité ne peut être atteinte, or la modernité ne peut prétendre à l'univocité : elle est inclôturable, inassignable à un concept univoque, elle présente un conflit de valeurs irréductible : la crise est ce vécu.
La métaphore privilégiée de la crise sera donc la « révolution copernicienne » interprétée comme le décentrement de la position de l'homme. La révolution copernicienne est la métaphore fondatrice de la modernité car elle contraint l'homme à prendre position sans conscience claire de son identité. L'autre métaphore utile serait celle de la terra incognita : il n'y a pas de terre ferme, il faut accepter de naviguer dans l'incertitude.
Comment conclure sur un sujet inachevable ? L'essentiel, c'est de reconnaître un paradoxe : une époque hérite de problèmes qu'elle doit réinventer, les questions qui nous sont léguées font surgir des interrogations inédites. Mais il y a des questions qui comportent une part d'indécidable (quelle est la place de l'homme dans le monde, quel est le sens de la vie, que sera le futur…). Résistant à la réduction conceptuelle, elles appellent l'expression métaphorique. C'est ce que nous enseignent les romans, art des temps modernes, emblématiques de la moderne dissolution des repères de la certitude : il n'y a pas de réalité homogène, pas d'évidence.
La crise dit la difficulté de l'homme à se situer face à la question du tout de l'histoire. Mais c'est à nous de choisir une certaine orientation dans le monde, soit dans la cage, soit dans la brèche.
L'intérêt de la réflexion de Myriam Revault d'Allonnes est de nous faire parcourir l'histoire de la pensée au travers de l'étude de cette notion si omniprésente aujourd'hui qui est celle de « crise ». Ce faisant, elle nous permet de prendre des distances avec un emploi trop vague de la notion, trop vecteur d'émotions et potentiellement de désespoir, puisqu'il nous semble effectivement aujourd'hui que la crise soit partout et qu'elle signe le déclin de la modernité et des idéaux qui l'ont portée.
Cette mise en perspective historique permet donc une relecture de ce qui constitue le propre de la « modernité », son rapport au temps et à l'histoire, pour nous permettre de mieux comprendre notre époque post-moderne et de dépasser le sentiment de lassitude qui la caractérise. Car nous sommes effectivement à une période « critique », mais le terme n'est pas à prendre au sens d'un stade terminal, mais d'un défi qui inclut la possibilité d'un retournement de situation, ce qui nous invite à la responsabilité et à l'action. Car le meilleur moyen de ne pas sortir de la crise est de se laisser envahir par le sentiment d'impuissance. Dans une époque qui a perdu ses repères, l'auteur nous invite à prendre le risque de l'action, car toute décision est un risque quand rien de certain ne peut s'ériger en norme.
Nathalie Godefroid