 Michel Blay & Christian Laval, Neuropédagogie : le cerveau au centre de l’école, éditions Tschann & Cie, 2018. Lu par François Meyer.
Michel Blay & Christian Laval, Neuropédagogie : le cerveau au centre de l’école, éditions Tschann & Cie, 2018. Lu par François Meyer.
Cet essai est consacré à dénonciation de ce que les auteurs appellent neuropédagogie.
18 février 2019
Par Florence Benamou le 18 février 2019, 15:58 - Épistémologie
 Michel Blay & Christian Laval, Neuropédagogie : le cerveau au centre de l’école, éditions Tschann & Cie, 2018. Lu par François Meyer.
Michel Blay & Christian Laval, Neuropédagogie : le cerveau au centre de l’école, éditions Tschann & Cie, 2018. Lu par François Meyer.
Cet essai est consacré à dénonciation de ce que les auteurs appellent neuropédagogie.
11 février 2019
Par Baptiste Klockenbring le 11 février 2019, 06:00 - Histoire de la philosophie
 André Pessel, Dans l'Éthique de Spinoza, collection Critique de la politique, Klincksieck, Paris, 2018 (146 pages). Lu par Éric Delassus.
André Pessel, Dans l'Éthique de Spinoza, collection Critique de la politique, Klincksieck, Paris, 2018 (146 pages). Lu par Éric Delassus.
Lire l’Éthique ne laisse pas indemne le lecteur qui accomplit cette tâche avec sérieux. En effet, ce livre est riche en effets de texte, comme le souligne André Pessel dans son livre : Dans l’Éthique de Spinoza. L’intérêt de cet ouvrage tient en ce qu’il ne propose pas un commentaire sur l’Éthique Spinoza, mais qu’il montre en quoi la lecture de ce livre produit son lecteur et le transforme en lui faisant comprendre par son contenu ontologique qu’il y est aussi question de lui-même en tant qu’il s’intègre dans son sujet même.
04 février 2019
Par Michel Cardin le 04 février 2019, 19:46 - Histoire de la philosophie
 Thierry de Toffoli, La philosophie réflexive de Maine de Biran, CreateSpace Independent Publishing Platform, novembre 2016 (236 pages). Lu par Marianne Eddi.
Thierry de Toffoli, La philosophie réflexive de Maine de Biran, CreateSpace Independent Publishing Platform, novembre 2016 (236 pages). Lu par Marianne Eddi.
Dans La philosophie réflexive de Maine de Biran, Thierry de Toffoli nous montre comment le témoignage que Maine de Biran a livré de ses méditations quotidiennes est susceptible d’éclairer une philosophie, qui répugne par principe à toute systématicité.
28 janvier 2019
Par Florence Benamou le 28 janvier 2019, 19:44 - Histoire de la philosophie
 Bernard Mabille, Cheminer avec Hegel, éditions de La Transparence, Paris, 2007. Lu par Alain Champseix.
Bernard Mabille, Cheminer avec Hegel, éditions de La Transparence, Paris, 2007. Lu par Alain Champseix.
Nous pourrions dire de Bernard Mabille ce qu’il en est de Hegel : un livre peut être un cours ou un cours peut être un livre. Cet ouvrage reprend un enseignement dispensé à la Sorbonne lors du premier semestre de 2000-2001. Il s’inspire de l’ouvrage majeur du Professeur, Hegel, L’épreuve de la contingence, Paris, Aubier, 1999. Il n’en est toutefois pas le résumé car la réflexion à la fois sur et avec le philosophe allemand est reprise au bénéfice des étudiants afin de les mettre en mesure de le lire. Tel est d’ailleurs l’objectif de la première leçon qui porte sur ce que peut signifier lire en philosophie.
21 janvier 2019
Par Baptiste Klockenbring le 21 janvier 2019, 06:00 - Esthétique
 Arild Michel Bakken, La Présence de Mallarmé, collection Romantisme et modernités, Honoré Champion, Paris, 2018 (264 pages). Lu par Paul Sereni.
Arild Michel Bakken, La Présence de Mallarmé, collection Romantisme et modernités, Honoré Champion, Paris, 2018 (264 pages). Lu par Paul Sereni.
Le livre, issu d'une thèse soutenue à Oslo en 2015, s’inscrit dans le renouvellement des études sur Mallarmé largement initié en France par Bertrand Marchal (Lectures de Mallarmé, 1983) qui fut codirecteur de la thèse. L’ouvrage, contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, ne porte pas sur la présence de l'œuvre de Mallarmé dans la poésie ultérieure, mais sur la présence de l'auteur dans son œuvre ; on met ainsi l’accent sur la communication du texte, alors même que Mallarmé passe souvent non sans raison pour un auteur impersonnel, qui s'efface presque totalement derrière ses textes.
14 janvier 2019
Par Romain Couderc le 14 janvier 2019, 06:00 - Philosophie générale
 Christophe Bouton & Barbara Stiegler (dir.), L’Expérience du passé. Histoire, philosophie, politique, collection Philosophie imaginaire, éditions de l’Éclat, Paris, 2018 (245 pages). Lu par Paul Sereni.
Christophe Bouton & Barbara Stiegler (dir.), L’Expérience du passé. Histoire, philosophie, politique, collection Philosophie imaginaire, éditions de l’Éclat, Paris, 2018 (245 pages). Lu par Paul Sereni.
Ce recueil de onze contributions, issu d’un colloque interdisciplinaire tenu à l’Université Bordeaux-Montaigne en mars 2016, cherche à répondre à la question : « la connaissance du passé - que ce soit sous la forme d’une expérience déterminée ou du savoir des historiens - fournit-elle des enseignements » ou bien faut-il penser au contraire, pour toute une série de raisons, qu’une « telle conception du passé est vaine » (p.9) ? Il s’agit donc de savoir comment, et jusqu’à quel point, on peut rendre le passé, y compris lointain, pour ainsi dire, présent.
07 janvier 2019
Par Baptiste Klockenbring le 07 janvier 2019, 06:00 - Esthétique
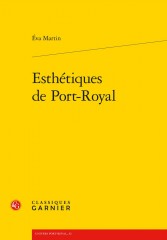 Éva Martin, Esthétiques de Port-Royal, collection Univers Port-Royal, Classiques Garnier, Paris, mars 2018 (620 pages). Lu par Nicolas Combettes.
Éva Martin, Esthétiques de Port-Royal, collection Univers Port-Royal, Classiques Garnier, Paris, mars 2018 (620 pages). Lu par Nicolas Combettes.
Il peut sembler au premier abord étrange d’associer le nom de Port-Royal à une étude sur les arts dans la France de la Contre-réforme : le nom même de l’abbaye n’évoque-t-il pas le foyer du jansénisme et une forme de spiritualité ascétique, hostile à la beauté sensible ? Le livre d’Éva Martin s’ouvre précisément sur ce paradoxe, à la faveur d’une brève description du portrait de la mère Angélique par Philippe de Champaigne (1654) : comment concilier l’existence de cette œuvre donnée au couvent, avec les déclarations antérieures de la réformatrice et modèle condamnant l’orgueil de ceux qui aspirent à se faire représenter ? Plus généralement, quelle est la place des arts dans la vie religieuse et les pratiques de dévotion ?
28 décembre 2018
Par Jérôme Jardry le 28 décembre 2018, 11:10
L'équipe de L'Œil de Minerve vous souhaite, à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année!
21 décembre 2018
Par Baptiste Klockenbring le 21 décembre 2018, 06:00 - Éthique
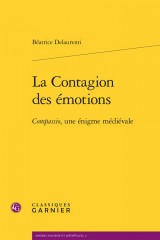 Béatrice Delaurenti, La contagion des émotions. Compassio, une énigme médiévale, collection Savoirs anciens et médiévaux, Paris, 2016, éditions Classique Garnier (338 pages). Lu par Nicolas Combettes.
Béatrice Delaurenti, La contagion des émotions. Compassio, une énigme médiévale, collection Savoirs anciens et médiévaux, Paris, 2016, éditions Classique Garnier (338 pages). Lu par Nicolas Combettes.
Le livre de Béatrice Delaurenti propose une étude de la notion de compassion, envisagée non pas en termes d’invariant culturel, mais comme concept pluriel et objet d’une double énigme, dans un champ encore peu exploré par les historiens, celui des émotions dans l’Occident médiéval des XIII e et XIVe siècles.
14 décembre 2018
Par Romain Couderc le 14 décembre 2018, 06:00 - Épistémologie
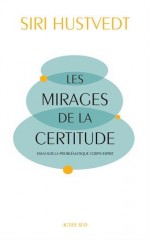 Siri Hustvedt, Les Mirages de l'incertitude. Essai sur la problématique corps/esprit, Acte Sud, 2018 (355 pages). Lu par J.-B. Chaumié.
Siri Hustvedt, Les Mirages de l'incertitude. Essai sur la problématique corps/esprit, Acte Sud, 2018 (355 pages). Lu par J.-B. Chaumié.
Siri Hustvedt est connue comme romancière, mais a déjà publié plusieurs livres ayant pour objet les neurosciences, la philosophie et la psychologie.
07 décembre 2018
Par Florence Benamou le 07 décembre 2018, 16:44 - Psychanalyse
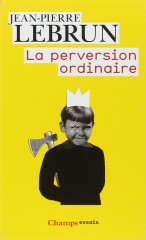
Jean-Pierre Lebrun, La Perversion ordinaire. Vivre ensemble sans autrui, collection Champs Essais, Paris, Champs Flammarion, 2015, édition originale 2007 aux éditions Denoël (436 pages). Lu par Stéphane Champié.
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste, ancien président de l'Association Freudienne Internationale, a entamé depuis plus de 20 ans un travail critique de lecture des transformations de la société, à l'aide des instruments fournis par la discipline psychanalytique.
15 novembre 2018
Par Michel Cardin le 15 novembre 2018, 19:18 - Sociologie
Après avoir longuement étudié et décrit les systèmes techniques dans ses précédents ouvrages, Eric Sadin reprend cette analyse des structures et effets du numérique en élargissant la réflexion au contexte généalogique et idéologique du monde digital, celui aussi bien des infrastructures industrielle, institutionnelle et financière qui le portent qu’à celui de la fabrique des représentations et d’une vision « siliconienne » du monde.
13 novembre 2018
Par Baptiste Klockenbring le 13 novembre 2018, 06:00 - Histoire de la philosophie
François-David Sebbah est Professeur à l’université Paris Nanterre et membre de l’Institut de recherches philosophiques. Il propose dans cet ouvrage une nouvelle lecture de l’œuvre de Levinas en en soulignant deux moments : le début (textes de la période de guerre, les Carnets de captivité, les romans inachevés, De l’existence à l’existant) et la fin (cours et conférences des années 1970 et 1980). L’auteur tente de dégager la cohérence de l’ensemble, en partant d’un épisode vécu par Levinas : la débâcle, l’exode de 1940. Cette scène inaugurale permet de comprendre pourquoi l’éthique devient, dans la philosophie de Levinas, une éthique du survivant et une éthique impitoyable.
23 octobre 2018
Par Jérôme Jardry le 23 octobre 2018, 20:18
Bonjour à tou·te·s,
L'Œil de Minerve prend ses congés d'automne: nous vous donnons rendez-vous le 5 novembre prochain.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
L'équipe de L'Œil de Minerve.
19 octobre 2018
Par Baptiste Klockenbring le 19 octobre 2018, 06:00 - Épistémologie
Lorsque l’on cite Koyré, on se réfère d’abord, incontestablement, à des travaux d’histoire des sciences : les Etudes galiléennes, par exemple. Mais les ouvrages de Koyré ne sont pas seulement une source d’information extrêmement précieuse dans ce champ très technique qu’est l’histoire des sciences. L’auteur défend constamment une thèse, qui est rappelée dans l’introduction de cet ouvrage collectif : le caractère inséparable de la science et de la philosophie (p. 10).
11 octobre 2018
Par Michel Cardin le 11 octobre 2018, 16:31 - Phénoménologie
Dans son dernier ouvrage, qui fait suite à Métaphysique du sentiment, Renaud Barbaras se concentre sur l’analyse du désir - désir qui déjà dans ses précédents ouvrages jouait un rôle important -. De quoi le désir est-il le nom ?
05 octobre 2018
Par Florence Benamou le 05 octobre 2018, 20:20 - Philosophie générale
A. Ehrenberg, La mécanique des passions, cerveau, comportement et société, Odile Jacob, 2018 Lu par Julien Olive
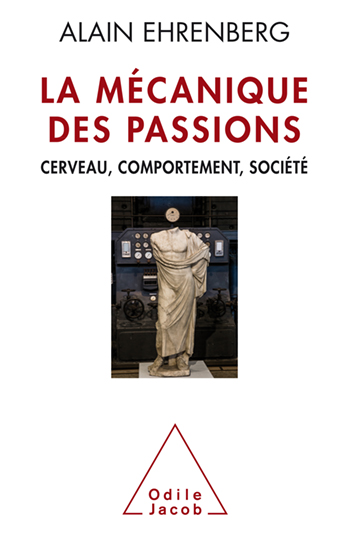
Parmi les lectures qui marquent un cheminement intellectuel, certaines s'apparentent à des initiations et d'autres à des cristallisations. Les unes nous font découvrir des concepts qui vont nous accompagner longtemps, alors que les autres viennent réorganiser des idées qui nous préoccupaient déjà depuis longtemps. Cet article décrit une rencontre de ce second genre entre les questions suscitées par un enseignement au long cours de la philosophie et un ouvrage de sociologie, La mécanique des passions de Alain Ehrenberg. Le livre traite du statut des neurosciences dans la mentalité des sociétés contemporaines et, parce que son point de vue est extérieur à celui des philosophes, il nous a semblé apporter un éclairage nouveau et prometteur sur ce qui constitue l'intérêt, mais aussi les écueils, de l'introduction des sciences du cerveau dans le cours de philosophie. Notre propos s'adresse avant tout aux enseignants qui partagent ces questionnements, pour cette raison, nous en consacrerons l'essentiel à un exposé détaillé des positions et des arguments de A. Ehrenberg, après quoi, nous esquisserons les pistes qui s'offrent au professeur de terminale pour constituer les discours sur « l'homme neuronal » en un authentique objet de réflexion problématique.
27 septembre 2018
Par Baptiste Klockenbring le 27 septembre 2018, 06:00 - Psychanalyse
Sandor Ferenczy, Réflexions sur le masochisme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2018, lu par Baptiste Calmejane.
Les textes sont introduits par Anne-Marie Saunal. Évoquant à plusieurs reprises sa propre pratique d’analyste, l’auteure de la préface aborde le motif du mal psychique sous sa double forme sadique et masochiste. Le masochisme doit être conçu, chez Freud et Ferenczi, dans sa relation au traumatisme, à l’identification à l’agresseur et à la pulsion de mort. La préface revient sur la différenciation des trois types de masochisme — moral, féminin, érogène — dans les textes de Freud, ainsi que sur la distinction ferenczienne entre orgasme normal, résultat d’un amour mutuel, et orgasme masochiste, résultat de l’identification à l’agresseur sadique. De ce point de vue, il convient de rappeler l’importance qu’il faut accorder, selon Ferenczi, à la réalité du traumatisme vécu comme source et origine de la compulsion masochiste. À l’égard des tendances masochistes, et de la souffrance en général, Anne-Marie Saunal rappelle à quel point la pratique clinique de Ferenczi reposait sur la compassion, l’humilité et l’humanité. Elle revient aussi sur la question de l’origine de l’affirmation (bejahung) de déplaisir, et sur le processus qui mène le sujet du déplaisir à la jouissance de ce déplaisir libidinalement investi. La préface s’achève enfin par une réflexion sur l’idée défendue par Ferenczi d’un épuisement de la douleur par acceptation de son existence, plus apte selon lui à en libérer le patient que la révolte, la lutte et le cramponnement hypocondriaque, ainsi que sur la place du pardon dans l’analyse.
09 septembre 2018
Par Michel Cardin le 09 septembre 2018, 23:38 - Philosophie générale
Baptiste Morizot, auteur du livre Les diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (Wildproject Editions, 2016), nous interroge sur l’art du pistage et sur la manière de mieux habiter notre monde ; car il est évident à la lecture de ce bel essai - Sur la piste animale - que nous devons apprendre à « faire monde commun» avec les autres êtres vivants qui peuplent la terre.
.
06 septembre 2018
Par Florence Benamou le 06 septembre 2018, 06:00 - Philosophie générale

Jacques Schlanger, De l'usage de soi, Hermann, 2017 (146 pages). Lu par Guillaume Fohr.
Jacques Schlanger est actuellement professeur émérite de philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans son ouvrage De l'usage de soi, il propose au lecteur une pérégrination autour du « je » en sept intervalles. Le chiffre sept n'est pas sans évoquer la menorah, chandelier à sept branches de la tradition juive dont l'étymologie désigne la racine de la lumière. Le « je » se donne parfois à voir ou reste caché, toujours est-il qu'il demeure à l'origine de toute pensée, de toute action, de toute communication. Aussi, nos sentiments, nos idées, nos savoirs, nos croyances ne font pas exception en la matière. Ce livre propose une mise en abîme des diverses modalités de l'usage de soi en philosophie.
27 juillet 2018
Par Cyril Morana le 27 juillet 2018, 06:00 - Histoire de la philosophie
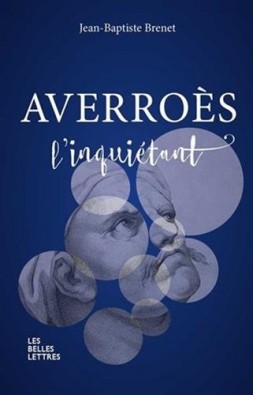
Jean-Baptiste Brenet, Averroès l’inquiétant, Les Belles Lettres, Paris, 2015 (160 pages).
Jean-Baptiste Brenet est professeur à l'Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, où il enseigne l'histoire de la philosophie arabe. Traducteur de Thomas d'Aquin, de Thomas Wylton et d'Avicenne, il dirige avec Christophe Grellard la collection « Translatio. Philosophies médiévales », chez Vrin. Il a notamment publié Transferts du sujet. La noétique d'Averroès selon Jean de Jandun (Vrin, 2003) et Les possibilités de jonction. Averroès-Thomas Wylton, suivi de : Thomas Wylton, L’âme intellective, introduction, traduction et notes (de Gruyter, 2013).
25 juillet 2018
Par Jeanne Szpirglas le 25 juillet 2018, 06:00 - Histoire de la philosophie
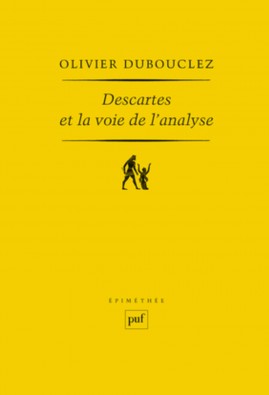
Olivier Dubouclez, Descartes et la voie de l’analyse, P.U.F., collection Epiméthée, janvier 2013 (395 pages).
Cet ouvrage est un travail d’Olivier Dubouclez (issu de la thèse qu’il a soutenue en 2008), où la rigueur de la démarche historique le dispute au merveilleux du voyage qu’il nous propose. Disons-le d’entrée : il n’est nullement question de philosophie analytique dans cet ouvrage, ni d’une interprétation analytique (disons logico-linguistique) de l’œuvre de Descartes.
24 juillet 2018
Par Michel Cardin le 24 juillet 2018, 06:00 - Philosophie politique
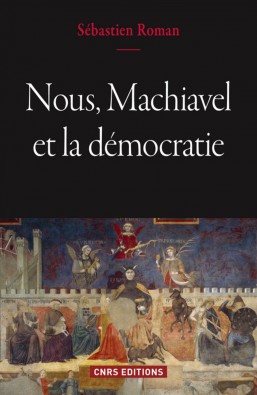
Sébastien Roman, Nous, Machiavel et la démocratie, C.N.R.S. 2017, collection PHIL (350 pages). Lu par Bertrand Vaillant.
Machiavel peut-il nous aider à penser la société démocratique et libérale dans laquelle nous vivons, société qu’il n’a ni connue ni même imaginée ? C’est la question à laquelle l’ouvrage de Sébastien Roman, inspiré de sa thèse soutenue en 2011, entend proposer une réponse affirmative.
23 juillet 2018
Par Karim Oukaci le 23 juillet 2018, 06:00 - Philosophie politique

Crystal Cordell Paris. La philosophie politique, collection Apprendre à philosopher, Ellipses, mai 2013 (224 pages). Lu par Jean-Pierre Delange.
La philosophie politique, longtemps enseignée à l’Université avec la philosophie morale, est parfois identifiée avec la science politique, laquelle souffre des inévitables maux consécutifs de l’inexorable spécialisation des sciences humaines, au premier rang desquelles la sociologie.
20 juillet 2018
Par Florence Benamou le 20 juillet 2018, 06:00 - Histoire de la philosophie
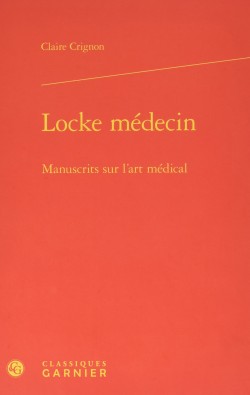
Claire Crignon, Locke médecin. Manuscrits sur l’art médical, Classique Garnier, mai 2016 (541 pages). Lu par Gilles Barroux.
Que John Locke fut attaché à la médecine par sa formation, qu’il a écrit des textes consacrés à cette matière, ou encore que cette formation initiale put constituer un laboratoire pour ses productions ultérieures, ce sont des informations connues et évoquées de manière récurrente, tant par les historiens de la philosophie que des sciences (exemple des travaux de François Duchesneau). Il manquait cependant un travail conséquent et exhaustif sur cette période de l’histoire de la formation de la pensée de Locke, ce maillon manquant est désormais comblé par l’ouvrage de Claire Crignon, Locke médecin. Manuscrits sur l’art médical, paru en 2016.
« billets précédents - page 4 de 25 - billets suivants »