Sébastien Roman, Nous, Machiavel et la démocratie, CNRS 2017, lu par Bertrand Vaillant
Par Michel Cardin le 24 juillet 2018, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
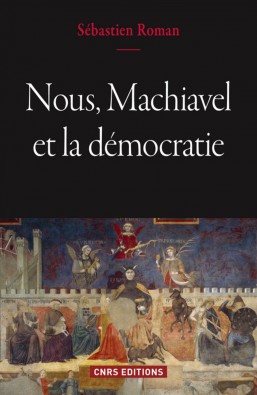
Sébastien Roman, Nous, Machiavel et la démocratie, C.N.R.S. 2017, collection PHIL (350 pages). Lu par Bertrand Vaillant.
Machiavel peut-il nous aider à penser la société démocratique et libérale dans laquelle nous vivons, société qu’il n’a ni connue ni même imaginée ? C’est la question à laquelle l’ouvrage de Sébastien Roman, inspiré de sa thèse soutenue en 2011, entend proposer une réponse affirmative.
Qu’y a-t-il de commun entre la Renaissance florentine et notre démocratie ?
D’après Sébastien Roman, un certain besoin de conflit. Une telle thèse ne manquera pas d’étonner dans les temps de vives tensions politiques, économiques,sociales et culturelles qui sont les nôtres. N’avons-nous pas plutôt besoin de consensus et d’apaisement ? Il ne s’agit évidemment pas pour l’auteur d’exacerber des tensions délétères : il s’agit de penser un modèle politique qui intègre le conflit (des partis, des classes, des individus…) comme la condition à la fois indépassable et féconde d’une saine démocratie. Comme l’humanisme florentin de l’époque de Machiavel, la pensée politique actuelle serait dominée par des tendances consensualistes. Cette recherche du consensus, devenue nécessaire à la cohésion de nos sociétés profondément pluralistes, aurait pour envers un refus ou une dissimulation du conflit, qui débouche sur l’utopie d’une société parfaitement consensuelle, idéal profondément antidémocratique.
L’auteur s’inscrit donc dans la filiation de Claude Lefort, qui pensait la démocratie comme le seul régime capable d’accepter et même de se nourrir de la division en son sein, et entend contribuer à réveiller les citoyens de leur sommeil démocratique : “Nous vivons aujourd’hui en démocratie, écrit-il, au point d’y avoir nos habitudes, jusqu’à la prendre pour une évidence, un fait, une donnée que nous ne questionnons plus.” (p.7) Cette fausse évidence nous dissimule à la fois la fragilité de la démocratie et la diversité de ses formes : celles qu’elle a prises dans l’histoire, toujours singulières, et celles qu’elle pourrait prendre, toujours à discuter. L’auteur cherche donc dans ce livre à défendre une certaine conception de la démocratie, une démocratie qui accepte le conflit sans tenter ni de l’occulter derrière une homogénéité de façade, ni de le dépasser vers une harmonie consensuelle idéale. Ce modèle, S. Roman pense pouvoir le trouver chez Machiavel, malgré la distance qui sépare notre monde du sien : “La finalité de cet ouvrage est de proposer une actualisation de la pensée machiavélienne à partir des notions de conflit civil et d’imaginaire social, qui débouche sur la construction d’un nouveau modèle philosophique appelé espace public dissensuel.” (p.20).
Il ne s’agit donc pas ici de lire en détail l’œuvre de Machiavel en faisant œuvre d’historien, encore moins de la présenter à un lecteur qui n’en connaîtrait pas les thèses fondamentales. Il s’agit de trouver chez lui les éléments essentiels d’un modèle politique fondé sur “l’entente dans le conflit”, par opposition aux modèles consensualistes, comme celui de Habermas, accusés de nier la fécondité et le caractère indépassable du conflit pour la démocratie. C’est ce syntagme de “l’entente dans le conflit” qui fournira à la fois le point de départ du livre, le modèle politique qu’il cherche à penser, et la grille de lecture appliquée aux penseurs rencontrés et souvent longuement discutés au fil de l’ouvrage : Ricoeur, Habermas, Honneth, Pettit ou encore McCormick. L’“imaginaire social” désigne la dimension structurellement symbolique et représentative de la politique, qui concerne à la fois l’image que les partis antagonistes se font d’eux-mêmes et des autres, et leur capacité à légitimer leur domination ou leur contestation par un usage créatif de l’imagination, via l’idéologie et l’utopie. Le “conflit civil” désigne quant à lui tous les degrés de la conflictualité entre les individus et surtout entre les classes sociales, entre ceux que Machiavel nomme les “grands” et le “peuple”. Si tout conflit n’est pas légitime, le conflit à l’intérieur de la société ne doit pas être perçu comme le symptôme d’une démocratie malade, mais comme le moteur d’une démocratie saine, et sa condition indépassable. Ce sont ces concepts qui constituent le véritable objet du livre, et qui seront élaborés tout au long de l’ouvrage.
Quant au modèle herméneutique ainsi appliqué à Machiavel, exposé au début du chapitre 2, Roman s’inspire encore de Lefort : il est illusoire de traiter l’œuvre comme une chose dont on pourrait saisir une fois pour toutes le sens figé. Il s’agit au contraire d’en ressaisir le questionnement fondamental et “de penser dans l’œuvre le pouvoir qu’elle a de donner à penser”[1], et ce sans pour autant prendre de libertés excessives qui conduiraient à l’anachronisme et à la contradiction - difficulté reconnue par l’auteur et affrontée à plusieurs reprises au cours du livre -. On aurait toutefois aimé voir l’auteur mieux fonder en raison sa confiance dans le point de départ de son investigation, à savoir le caractère fondamentalement et nécessairement conflictuel de la vie sociale et politique. Un tel présupposé, fil rouge du livre et moteur de la critique des philosophes abordés, demande assurément plus que la référence à Machiavel pour être admis.
La structure et la démarche du livre sont clairement dissertatives. L’auteur avance en exposant et commentant la solution des auteurs au problème posé, avant d’en montrer les limites et de justifier ainsi son recours à un modèle différent, souvent conçu comme une correction ou un juste milieu entre les thèses envisagées. Le livre comprend trois parties. La première tire de Machiavel les fondements conceptuels du modèle politique que l’auteur cherche à élaborer, l’imaginaire social et le conflit civil, articulés dans l’idéal de “l’entente dans le conflit”. La deuxième confronte ce modèle à plusieurs grandes philosophies politiques contemporaines, pour mettre en évidence les limites du consensualisme issu d’Habermas. La troisième tâche est de penser les conditions institutionnelles et morales de la mise en œuvre de ce modèle. Nous tâcherons de donner un aperçu fidèle de ces trois parties, sans pouvoir entrer dans le détail d’analyses souvent précises et détaillées, avant de revenir en conclusion sur ce qui nous semblent être les forces et les limites de l’ouvrage.
- Un Machiavel pour notre temps
Dans la première partie, intitulée “Conflit civil et imaginaire social”, l’auteur entreprend de préciser et d’appliquer sa démarche herméneutique pour tirer de Machiavel ce qui lui apparaît comme son questionnement et ses intuitions fondamentales, celles qui pourront se prêter à une certaine actualisation et nous aider à penser la démocratie. C’est la seule partie qui soit principalement centrée sur une lecture de Machiavel, les deux autres visant plutôt à préciser et déployer le modèle élaboré dans cette première partie en le confrontant aux pensées contemporaines de la démocratie.
Le premier chapitre part, non de Machiavel, mais de la Grèce, en s’appuyant sur l’exemple de l’amnistie de 403 avant Jésus-Christ, par laquelle les démocrates athéniens victorieux renoncent à poursuivre en justice les Trente tyrans et leurs partisans. Roman reprend ici la lecture qu’en fait l’historienne Nicole Loraux qui y voit, plus qu’une décision pragmatique, une “incapacité structurelle [...] de reconnaître le conflit consubstantiel de la politique” (p. 32). En organisant une politique de l’oubli pour favoriser l’unité, les Athéniens se rendent incapables d’assumer la part inéluctable de conflit, et la dissimulent en construisant l’imaginaire social de la cité une et indivisible.
Machiavel est présenté comme le contre-exemple salutaire de ce double rapport au conflit et à l’imaginaire : les chapitres 2 et 3 montrent comment il s’est élevé contre le consensualisme classique issu de Cicéron et de Polybe, en vigueur à son époque, au nom d’une certaine conception du conflit civil et de l’imaginaire social.
Pour Machiavel en effet, le conflit est au principe de tout Etat, ce dernier étant une tentative pour assurer l’équilibre entre les grands, qui cherchent à dominer, et le peuple, qui cherche à fuir la domination. L’auteur s’intéresse aux différentes dimensions de cette opposition conflictuelle et les commente de façon stimulante, en insistant notamment sur l’hétérogénéité des partis antagonistes, dont les finalités et les points de vue sont incommensurables et ne peuvent donner lieu à un simple “juste milieu” qui satisferait les uns et les autres.
Inséparable du conflit, la politique l’est également de l’imaginaire : le prince est condamné par les nécessités de sa situation à paraître, sans pouvoir révéler au peuple cette dimension nécessairement “représentative” de la politique. Il nourrit un imaginaire destiné à la conservation de l’Etat, manifestant sa propre gloire et instillant crainte et admiration parmi les hommes, usant à cette fin de la religion comme d’un indispensable moyen de contrôle social. Le prince ne saurait se maintenir sans légitimer son pouvoir par la constitution d’un imaginaire social, que l’auteur commente en s’appuyant sur les mythes du mal chez Ricoeur : la fondation de l’Etat par l’homme virtuoso de Machiavel, qui sait dompter la fortune, évoque notamment le “drame de création” de Ricoeur, la lutte de l’acte créateur divin pour ordonner le chaos originel. Suivant encore Lefort, l’auteur approfondit cette idée en mettant en évidence le caractère transcendantal de l’imagination pour Machiavel, convaincu que l’image est indépassable en politique, et qu’on ne saurait croire sans illusion accéder à un au-delà de la représentation. C’est donc en jouant sur la représentation du pouvoir, en créant un commun imaginaire que l’on peut faire tenir ensemble les désirs antagonistes des grands et du peuple, en les attachant par leur besoin de s’illusionner à l’idéal du bene comune. Ce n’est pourtant pas là oubli et disparition du conflit, mais la manière dont le conflit peut se réaliser tout en restant supportable : “Le conflit civil et l’imaginaire social sont indissociables car la division sociale “ne peut advenir au champ du visible que recouverte”[2].
Le chapitre 4 pose la question de la pertinence du recours à Machiavel pour penser la démocratie moderne, et du caractère potentiellement daté de sa pensée, tributaire d’une conception très personnalisée du pouvoir et d’un contexte historique et moral difficilement comparable au nôtre. L’auteur répond à cette objection en distinguant chez Machiavel un ensemble de moyens devenus inutilisables et même choquants (l’usage de la guerre, ou le contrôle des mœurs par “la censure, l’art militaire, la religion, et la pauvreté” p.106), et un modèle politique fondé sur l’articulation du conflit et de l’imaginaire, qui demeure éclairant. Il s’emploie à mettre en évidence la pertinence de la conception machiavélienne en la précisant grâce aux travaux de Ricoeur sur la tension conflictuelle entre idéologie et utopie dans la politique moderne, qui permettent également de penser un espace social qui assume la fécondité du conflit tout en l’encadrant par un consensus sur les “règles du jeu” qui le rendent possible. C’est bien à l’intérieur d’une dimension symbolique que se joue le conflit entre le pouvoir qui se légitime par l’idéologie, et l’utopie qui lui conteste cette légitimité en imaginant une autre société possible. Ricoeur n’est pas Machiavel, mais sa pensée témoigne de la fécondité du couple conflit civil - imaginaire social pour penser nos sociétés démocratiques -.On peut raisonnablement se demander ce qu’il reste du modèle politique de Machiavel une fois éliminé tout ce qui chez lui ne s’applique plus à notre temps, interrogation renforcée plutôt qu’apaisée par les efforts de l’auteur pour l’actualiser via le recours à des auteurs contemporains. Il faut toutefois reconnaître que l’auteur est ici fidèle à la démarche qu’il s’est fixée, et qu’il a clairement exposée dès le début du livre : s’il est toujours possible de contester cette démarche elle-même, on ne saurait faire grief à S. Roman de l’appliquer de façon cohérente.
2. Consensus et dissensus
La deuxième partie de l’ouvrage vise à mettre les concepts de conflit civil et d’imaginaire social à l’épreuve et à mesurer leur pertinence dans le champ de la philosophie politique contemporaine. Celle-ci étant pour l’auteur largement dominée par des pensées du consensus, au premier rang desquelles la philosophie de Jürgen Habermas, il est nécessaire de s’y confronter pour élaborer un modèle politique qui, lui, entend faire la part belle à un irréductible dissensus.
Cette partie est donc dominée par l’examen attentif de plusieurs philosophies politiques contemporaines, sous l’angle de leur rapport au conflit et au consensus d’une part, et à la dimension imaginaire ou symbolique de la politique de l’autre.
S. Roman commence par exposer à partir de ce questionnement la philosophie de Habermas, dans le chapitre 5. Il l’interprète à la suite de Ricoeur comme n’étant pas dénuée d’une dimension d’imaginaire social quoique Habermas soit bien davantage un penseur de la rationalité que de l’imagination. La tension entre utopie et idéologie qui caractérise l’imaginaire social chez Ricoeur trouve chez lui une traduction intersubjective dans la pratique de la discussion et de la politique délibérative. Reste que l’utopie qui anime l’éthique de la discussion est celle d’un possible dépassement des désaccords et du conflit : c’est là pour l’auteur (qui suit encore ici Ricoeur) prendre le risque de “minimiser l’antagonisme des classes sociales”. La plus grande partie du chapitre est consacrée à l’examen des raisons qui fondent cet optimisme, qui s’enracine pour l’auteur dans la substitution du pluralisme au conflit, et dans la conception habermassienne de l’homme comme étant avant tout un ego communicans, pour lequel “la communication suppose toujours originellement l’intercompréhension, et l’intercompréhension le consensus.” (p.167). La dimension imaginaire, quoique présente, est réduite au symbolisme inhérent au langage, excluant tout imaginaire social antérieur à la discussion rationnelle.
Suit, au chapitre 6, un examen de la critique de ce consensualisme par Axel Honneth, dont la théorie de la lutte pour la reconnaissance reprend explicitement Habermas en le corrigeant pour ménager une plus grande part à la conflictualité. Il s’agit d’élargir l’espace public habermassien pour faire droit aux demandes de reconnaissance qui ne parviennent pas au stade d’une argumentation rationnelle articulée, c’est-à-dire essentiellement celles des classes sociales les moins favorisées. L’intersubjectivité dans l’espace public n’est donc pas réductible à la discussion rationnelle, ce qui fragilise l’idéal d’un dépassement du dissensus par cette même discussion. Sans rejeter le cadre de discussion habermassien, Honneth revalorise donc l’antagonisme des classes. Mais pour S. Roman, Honneth ne rompt pas suffisamment avec le consensualisme : l’espace public est toujours constitué par un ensemble de normes historiquement situées, visant à donner à l’expérience élémentaire de la reconnaissance (d’autrui comme homme) un contenu moral normatif (de ce que cette reconnaissance implique pratiquement), un “consensus moral social, concernant la manière dont il faut orienter axiologiquement notre rapport à autrui” (p.203).
L’auteur se tourne alors vers l’oeuvre de Jacques Rancière, auteur d’une critique radicale du consensualisme en philosophie politique, qu’il n’aborde que sous un angle : son modèle de la “mésentente”, qu’il compare avec le modèle machiavélien de l’entente dans le conflit, et en retient (entre autres) les points suivants : ils partagent une conception de la politique comme “institution d’un commun litigieux qui oppose des classes sociales”, la pensée de l’un comme de l’autre est “une théorisation du conflit civil à partir de l’hétérogénéité du social, élaborée dans une perspective d’émancipation contre une pratique de domination” (p.217), mais Rancière s’éloigne de Machiavel en critiquant radicalement son républicanisme. Pour lui, la république n’est que “le projet, anti-démocratique, (d’)une intériorisation du lien communautaire dans une logique policière”, né du “désir de former un corps social homogène par l’inscription des lois - via l’éducation - dans les mœurs des citoyens.” (p.218). S’en suit une discussion précise des limites de cette conception de la république et des divergences entre les deux auteurs, Rancière représentant finalement, après l’excès de consensualisme de Habermas et Honneth, la figure d’une conception trop conflictuelle de la politique, qui n’est plus comme chez Machiavel “l’art de faire tenir ensemble des contraires” mais un véritable “choc des contraires” (p.220-1).
Le chapitre 7 prolonge l’examen des philosophies de Habermas et Honneth en les abordant cette fois sous l’angle de l’imaginaire social, pour en montrer à nouveau l’intérêt et les limites, et revenir une nouvelle fois à l’intérêt d’une troisième conception de l’imaginaire social, celle de Ricoeur, la plus apte à permettre une réactualisation de Machiavel - “sans que ce soit là son intention mais la nôtre”, écrit l’auteur -.
3. Des institutions et des mœurs
La troisième partie, intitulée “L’espace public dissensuel”, interroge les moyens de mise en œuvre d’un tel espace, du point de vue des institutions encadrant le conflit et de l’ethos nécessaire à sa fécondité. La question centrale de ce dernier moment est la suivante : “Comment traduire, en pratique, le conflit civil entre les grands et le peuple pour qu’il devienne le principe de la vie politique dans les sociétés contemporaines ? Par quel(s) moyen(s) garantir que la loi ne serve pas l’intérêt des grands, et se nourrisse toujours des rapports de force pour permettre la non-domination du peuple ?” (p.257).
Le chapitre 8 se penche sur les conditions institutionnelles, juridiques et politiques, de la constitution de l’espace public dissensuel, à travers un examen du constitutionnalisme. L’auteur expose et discute le républicanisme de Pettit, proche de celui de Machiavel en ce qu’il fait de la liberté comme non-domination le telos de la politique. Mais, comme Habermas, Pettit minimise les faits du pluralisme, de la divergence des intérêts et des rapports de domination entre les interlocuteurs, qui fragilisent nettement l’idéal d’une discussion neutre et rationnelle dont la réussite est nécessairement un consensus satisfaisant pour tous. Il trahit ainsi la dimension institutionnelle du conflit civil analysé par Machiavel, mais également sa dimension extra-institutionnelle, puisqu’il fait du droit de résistance un cas limite, presque impensé. L’auteur expose et reprend partiellement à son compte la critique que McCormick fait de Pettit (et de l’école de Cambridge en général) à partir de Machiavel. Il accuse Pettit de proposer une démocratie contestataire qui n’en est pas une, et fait a posteriori de Machiavel un démocrate soucieux de donner au peuple les moyens de lutter contre la domination des élites. S. Roman s’en distingue en soulignant les dangers du modèle de McCormick, accusé de retomber dans un consensualisme naïf déporté au niveau d’une assemblée de tribuns supposément rationnels et désintéressés, et son infidélité à la pensée de Machiavel. Il s’en distingue encore par une série de prises de position institutionnelles, en faveur du bicamérisme, de l’instauration de la proportionnalité des assemblées, ou encore d’une conception dynamique de la constitution.
Le chapitre 9 reprend le problème de l’utopie : c’est dans l’utopie comme produit et comme stimulant de la force créatrice de l’imaginaire social que peut se jouer la contestation du pouvoir et la lutte pour une autre société. L’antagonisme des rapports sociaux doit prendre la forme de la tension entre idéologie issue du pouvoir et utopie contestataire, grâce à une revalorisation de l’utopie. Celle-ci a mauvaise réputation dans l’opinion publique, associée qu’elle demeure aux grands totalitarismes, et particulièrement aux dictatures communistes. Elle doit pourtant, comme le montre l’auteur en s’appuyant sur les travaux de Miguel Abensour, être revalorisée dans la mesure où elle constitue la condition essentielle de la contestation du pouvoir par le peuple. Sans concevoir la démocratie de façon aussi ouvertement conflictuelle qu’Abensour, S. Roman entend intégrer la fonction contestataire de l’utopie dans le cadre de l’imaginaire social déjà décrit, en tension permanente avec l’idéologie qu’il juge, dans sa fonction d’intégration et de renforcement de l’identité collective, tout aussi nécessaire.
Enfin, le chapitre 10 s’intéresse à la question des mœurs, problème épineux puisque tous les moyens suggérés par Machiavel pour leur régulation, cités plus haut, doivent être abandonnés. L’auteur défendra donc ici “la nécessité de favoriser et d’entretenir un ethos démocratique” (p.258), qui consiste en une reprise de l’ethos démocratique d’Habermas et de son “patriotisme constitutionnel”, corrigé pour tenir compte du modèle de l’imaginaire social de Ricoeur et du caractère plus dissensuel donné à la vie démocratique. L’auteur élabore cette conception corrigée de l’ethos à partir de l’interprétation par Osiel des procès criminels concernant les crimes de masse, conçus comme des moments de restauration de la démocratie par le déploiement (mis en scène à cet effet) d’un espace public dissensuel dans lequel tous ont la parole, y compris la défense.
- Conclusion
La force du livre de S. Roman est de poser un problème conceptuellement clair, et de progresser de façon précise et méthodique dans l’élaboration de sa solution. Son travail donnera au lecteur un aperçu du champ philosophique entourant la question de la conflictualité dans l’espace public démocratique, qui ne saurait être un panorama exhaustif mais gagne en intérêt à être abordé sous l’angle d’un problème précis. C’est donc un ouvrage qui pourra intéresser un lecteur déjà doté d’un minimum de connaissances en philosophie politique, désireux d’aborder la question de la conflictualité en démocratie sous l’angle conceptuel et à travers des discussions nombreuses et précises des pensées de Ricoeur, Habermas, Honneth, Pettit et d’autres. L’auteur prend en effet grand soin d’exposer les positions en présence, de s’inscrire dans un courant herméneutique déterminé, et de façon générale de n’établir son modèle que par distinction et confrontation avec d’autres pensées. S’il manifeste ainsi sa connaissance du champ philosophique entourant la question, cette démarche l’empêche toutefois de proposer beaucoup plus qu’un modèle en creux, par correction et différence avec d’autres, perdant ainsi en originalité et en consistance ce qu’il gagne en distinction.
Cette démarche présente de plus certaines difficultés, qui tiennent d’abord à un langage et à une organisation que l’on pourra trouver trop scolaire : la structure faite de multiples divisions et sous-divisions organise certainement le propos d’un point de vue formel, mais une telle structure ne suffit pas à produire l’unité organique d’une œuvre et d’une pensée. En l’occurrence, elle produit plutôt un éclatement de la réflexion qui demande au lecteur un effort important pour ne pas en perdre le fil, d’autant que l’articulation de ces divisions n’est pas toujours claire, les transitions étant parfois fort abruptes. Quant à la forme, on pourrait encore reprocher à cet ouvrage un style par trop aride, manquant parfois de pédagogie et de simplicité. La pensée y perd souvent davantage en clarté qu’elle n’y gagne en précision. Cette organisation très formelle et ce langage abstrait mettent à mal le projet de réveil des consciences citoyennes évoqué dans l’introduction, et révèle un ouvrage de chercheur universitaire écrivant pour des universitaires, dans la continuité du travail de thèse dont l’ouvrage s’inspire.
Enfin, cette abstraction du verbe cache une difficulté plus importante de la démarche démonstrative de l’auteur. La pertinence du modèle politique défendu n’est jamais véritablement mise en évidence par ce qu’elle permettrait d’expliquer, d’interpréter, ou de prévoir quant au fonctionnement réel des sociétés, mais plutôt par sa capacité à entrer en discussion au niveau conceptuel avec de grandes pensées du champ philosophique, sur un mode dissertatif examinant et critiquant les auteurs l’un après l’autre. Le propos est d’ailleurs rythmé par la succession des pensées que l’auteur veut examiner plus que par les obstacles philosophiques rencontrés. C’est donc finalement une démonstration hors-sol, parfois très convaincante dans son élément, mais qui laisse une impression de trop grande abstraction pour un projet qui prétend répondre à une crise de notre démocratie qui est, elle, on ne peut plus réelle et concrète. Cette abstraction est particulièrement sensible dans un ouvrage dont le but explicite est de démontrer la validité de certains concepts pour penser une société donnée : la nôtre. Les dimensions concrètes du modèle politique défendu, comme la défense du scrutin proportionnel ou le bicamérisme, sont évoquées en passant et sont loin d’être d’une nouveauté radicale. Si on ne saurait reprocher à un philosophe d’être chez lui dans la discussion conceptuelle, on aurait aimé le voir partir davantage du monde pour élaborer ses concepts, et y revenir pour les lui appliquer.
Bertrand Vaillant (20/03/2018).