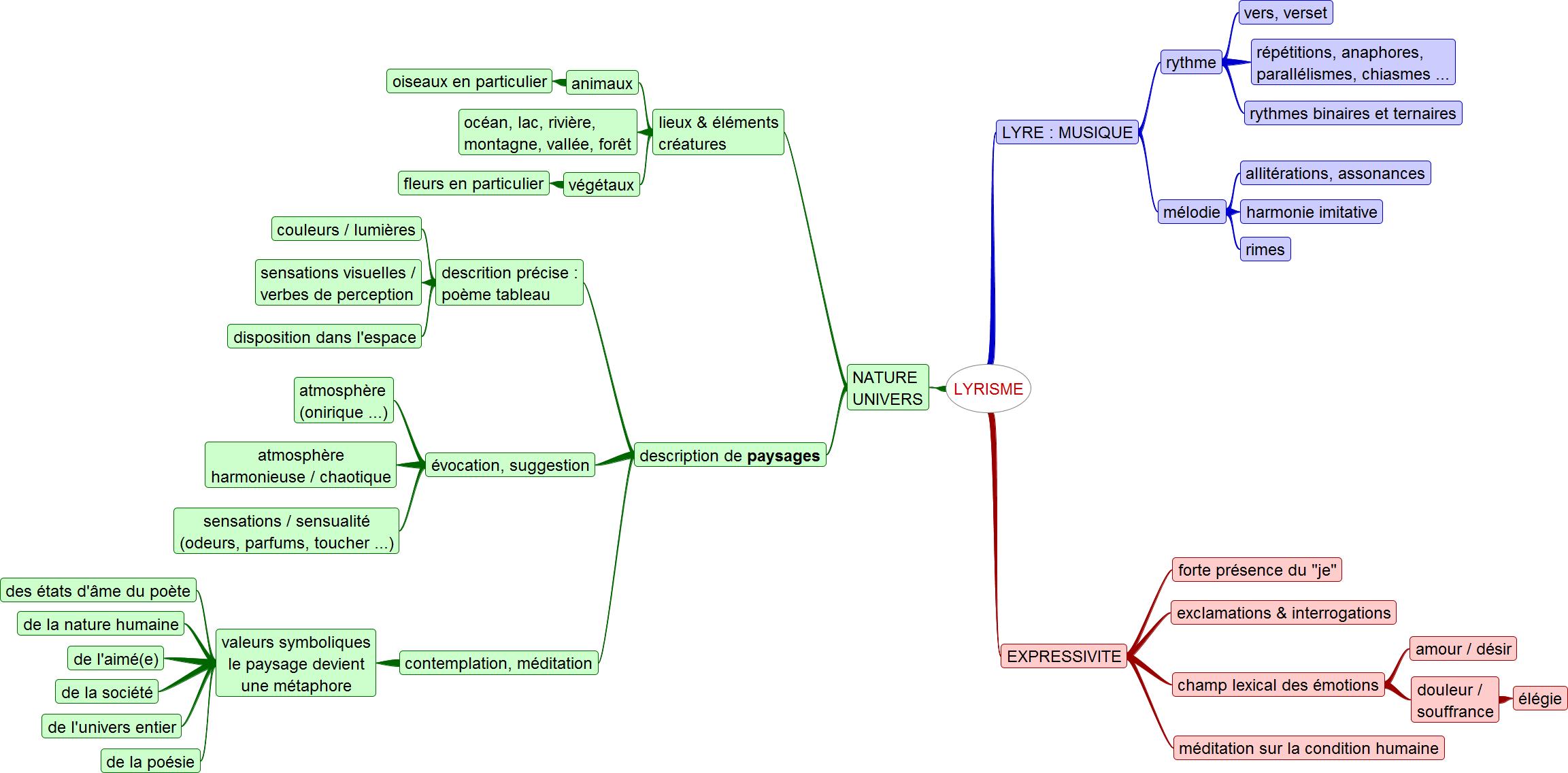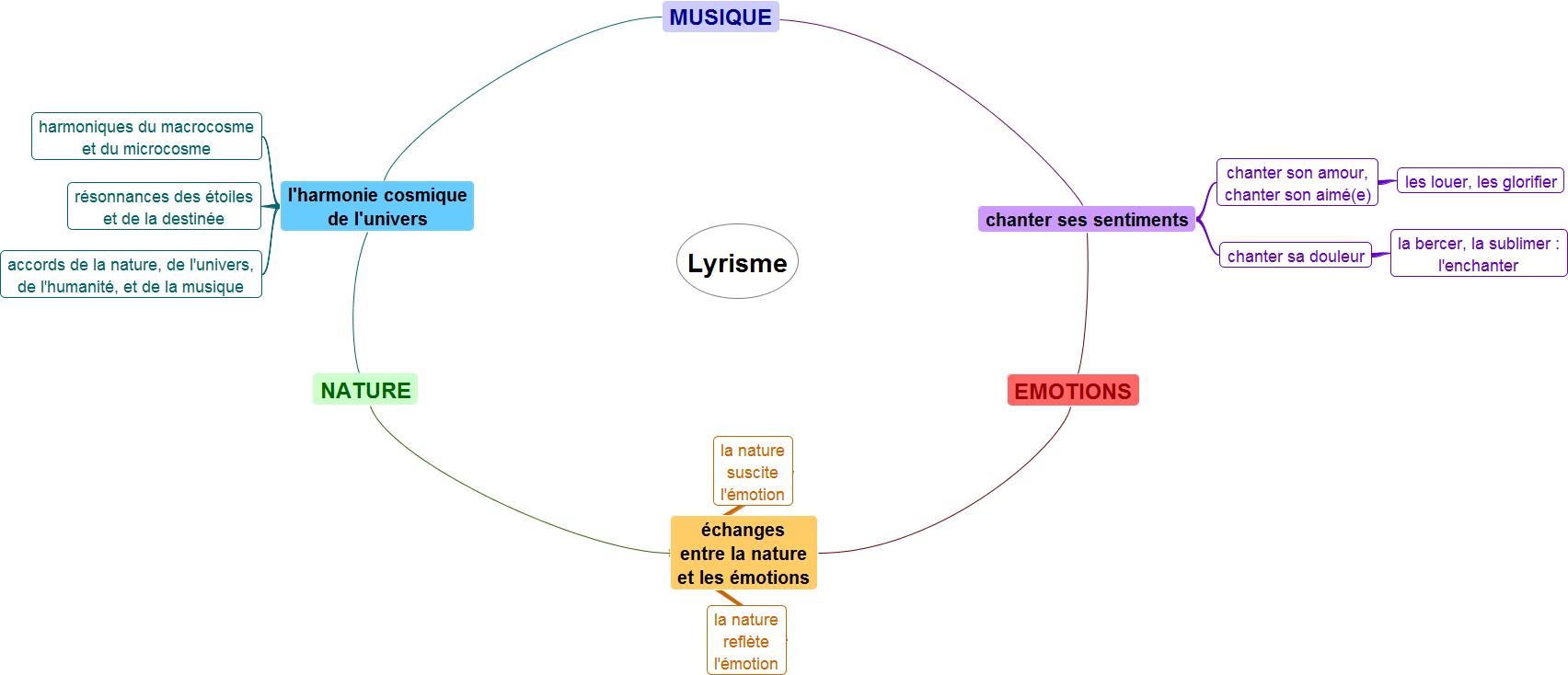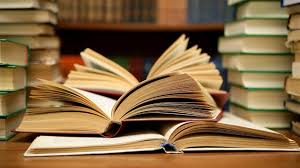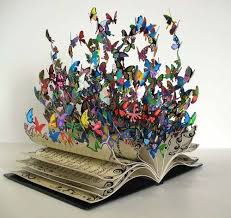I. « Hommes tout fraîchement sortis de la main des dieux » : le Nouveau Monde et ses sociétés primitives, ou le rêve nostalgique d’un âge d’or préservé
Le « Nouveau Monde », un monde vierge
Le mythe du Bon Sauvage fait son apparition avec les Grandes Découvertes : pour les occidentaux du XVIe siècle, la découverte des Amériques apparaît comme la découverte d’un monde vierge et sauvage.
→ Les différents noms données aux terres découvertes à partir de 1492 témoignent bien de cette façon de voir, qui est à l’origine du mythe du « Bon Sauvage ».
-
Les Européens appelèrent d’abord ces terres « Indes occidentales », pour les distinguer des « Indes orientales », que Colomb espérait atteindre par l’ouest, pour ouvrir de nouvelles routes commerciales vers la Chine et l’Inde. Ce premier nom est resté aux populations qui peuplaient l’Amérique avant l’arrivée des Européens, que l’on appelle communément Indiens et parfois, pour les distinguer des Indiens d’Inde, Amérindiens. Dans ce nom se lit le rêve d’exotisme qui animait les explorateurs européens du XVIe siècle. Le « Bon Sauvage » est avant tout une figure de l’altérité.
-
Mais bien vite, un autre nom fut donné à ces terres que l’on venait de découvrir, celui de « Nouveau Monde ». Nouveau, ce monde ne l’était pas seulement parce qu’on en ignorait l’existence jusqu’à ce jour. Il l’était aussi par opposition avec l’Ancien Monde, le monde européen, qui se pensait lui-même comme un monde vieillissant et proche de sa fin : nombreux sont ceux, au XVIe siècle, qui croient vivre la Fin du Monde, surtout dans la seconde moitié du siècle lorsque se développent les guerres de religion. Le « Nouveau Monde » représente donc un monde « neuf », qui n’a pas vieilli, mais qui est resté tel qu’il avait été créé, avec des habitants dont on imagine qu’ils continuent de vivre comme aux premiers temps de l’humanité.
« Ils vivent selon la nature ». Le Bon Sauvage, un homme resté proche de la Nature
Cette impression que les terres découvertes forment un monde « neuf » peut être liée à plusieurs facteurs, mais elle tient particulièrement au mode de vie des populations amérindiennes.
Bien entendu, il est difficile de faire des généralités, car les civilisations rencontrées par les Européens à partir de 1492 sont très diverses. Les cités des Incas ou des Aztèques, par exemple, ont tant impressionné les Espagnols et les Portugais, qu’elles ont donné naissance au mythe de l’El-Dorado. Mais les explorateurs ont aussi rencontré un grand nombre de peuples de chasseurs-cueilleurs, dont le mode de vie, très éloigné du leur, pouvait sembler plus « primitif » et plus « sauvage », car il était plus proche de la nature. De manière générale, d’ailleurs, les Occidentaux ont probablement dû être sensibles aux cultes rendus à certains éléments naturels par de nombreuses populations.
Commence alors à se développer l’image d’un monde qui serait « sauvage » et « primitif » d’une manière positive, car cela signifie qu’il est resté plus proche de la Nature. Or la Nature est souvent utilisée comme une norme, un modèle, par rapport auquel les différentes sociétés sont évaluées : plus une société est conforme à la nature humaine, moins elle est dénaturée ou contre-nature, meilleure elle est. Dans ce contexte, l’adjectif « sauvage » cesse d’avoir le sens négatif de « barbare » pour commencer à signifier « naturel » : on le voit en particulier chez Montaigne, qui consacre tout un développement de l’essai « Des Cannibales » à ce travail sur les mots. C’est le début du mythe du « Bon Sauvage ».
Le parallèle avec l’Âge d’Or : de l’harmonie avec la Nature à la proximité avec les origines de l’humanité
Montaigne et les explorateurs qui racontent leurs voyages (Jean de Léry, Jacques Cartier, etc.) vont plus loin : ils pensent qu’une société plus proche de la Nature est aussi une société qui a moins évolué, qui est restée plus proche des origines de l’humanité. Le mythe du Bon Sauvage tire donc une grande partie de sa séduction de la nostalgie des Européens, qui regrettent de n’être pas restés proches de leurs racines, de la nature, etc. Cette idée s’exprime à travers deux comparaisons :
-
D’une part, la culture des indiens est souvent comparée à la culture de l’Antiquité :
-
Premier exemple : Leur façon de rendre un culte aux éléments naturels est mise en parallèle avec le polythéisme des Grecs et des Romains, dont les dieux régissent souvent des éléments ou des passions (Vénus pour l’amour, Neptune pour les eaux, etc.)
-
Second exemple : Leurs arts sont souvent comparés à ceux de l’Antiquité. Leurs chants, en particulier, sont fréquemment qualifiés d’« anacréontiques » (Montaigne, Bougainville). Anacréon était un poète grec de l’Antiquité : il représente aux yeux des humanistes de la Renaissance l’une des formes les plus anciennes de poésie lyrique.
-
Qualifier les chants des Indiens d’anacréontiques revient donc à dire que ceux-ci ont préservé des formes très anciennes de poésie, qu’ils continuent de chanter comme on le faisait aux origines de l’humanité.
-
En outre, la comparaison avec l’Antiquité est, pour les humanistes de la Renaissance, le plus beau compliment qui puisse se faire, puisqu’ils admiraient l’Antiquité, regrettaient d’avoir perdu les façons d’écrire de cette époque, et s’efforçaient de les restaurer. Cette comparaison contribue donc à valoriser les civilisation indienne, en les mettant sur le même plan que ce qui constitue le summum de la civilisation aux yeux des humanistes.
-
D’autre part, et c’est le plus important, les civilisations du Nouveau Monde sont souvent assimilées au mythe antique de l’âge d’or :
-
Il faut prendre en compte le cadre temporel dans lequel vient s’insérer cette idée : pour le XVIe siècle, l’évolution historique n’est pas un progrès, une évolution vers des temps meilleurs, mais une dégradation, une chute progressive de l’homme qui s’éloigne de plus en plus de sa nature originelle. Dans un tel contexte, une société plus proche des origines de l’humanité est nécessairement meilleure que les sociétés qui ont subi cette évolution. Les sociétés amérindiennes semblent alors aux Européens avoir préservé l’âge d’or dont parlent les mythes antiques.
-
C’est ainsi que, sur la base des observations de certaines coutumes amérindiennes, commence à s’élaborer une image idéalisée de ces sociétés : elles ne sont plus seulement décrites pour elles-mêmes, mais analysées à travers une grille qui vise à en faire des modèles de sociétés idéales, dépourvues de tous les défauts des sociétés européennes.
II. « Nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie » : le Sauvage Ingénu et la critique de la société occidentale
L’absence de tous les maux de la société occidentale
En effet, la définition de la société idéale des Bons Sauvages se fait toujours à travers la négation de certains aspects critiqués de la société occidentale :
-
Du point de vue économique, les Européens imaginent souvent que les Bons Sauvages ignorent tout de la propriété, du commerce et des rapports d’argents.
-
Cette croyance se fonde sans doute sur le fait que les échanges, dans ces sociétés ne reposaient pas forcément, comme en Europe, sur le recours à la monnaie, et sur le fait que la propriété pouvait prendre des formes très différentes, qui n’étaient pas nécessairement reconnaissables.
-
En règle générale, les philosophes et les voyageurs, du XVIe au XVIIIe siècle, considèrent que le Bon Sauvage n’a besoin ni de contrats, ni de monnaie pour ses échanges, et qu’il ne connaît pas la propriété et les frontières, sources de querelles entre les hommes. C’est ce qui contribue, à leurs yeux, à rendre ces sociétés pacifiques et heureuses : elles reposent sur un partage communautaire des richesses, sans hiérarchies ni mainmises.
-
Du point de vue politique, cette absence de contrats économiques va de pair, de manière générale, avec une absence de lois : les Bons Sauvages ne sont pas des peuples procéduriers, mais sont au contraire des peuples libres, qui ne suivent que la loi et la vertu naturelles, et n’ont donc pas besoin de magistrats pour juger des problèmes.
-
Du point de vue social, les Européens ont surtout été frappés par la différence des mœurs sexuelles des Indiens par rapport aux leurs. Ils ont donc imaginé que le Bon Sauvage vivat dans des sociétés où les rapports sexuels étaient totalement libres, sans mariages ni liens définitifs, sans couvents non plus.
-
La religion que les Européens attribuent aux Bons Sauvages est une forme de déisme qui reflète elle aussi un idéal de simplicité défini par opposition avec la complexité des dogmes et des rites des religions de l’Ancien Monde : elle est présentée comme une forme naturelle de croyance en un créateur, qui serait dépourvue de toutes les superstitions qui entourent le culte dans les religions orientales et occidentales. Le Bon Sauvage apparaît ainsi comme un personnage qui se contente de rendre honneur au monde qui l’entoure (culte des puissances naturelles) et à ses morts, sans s’embarrasser de coutumes artificielles qui dénaturent ce culte naturel.
→ Cette description des Amérindiens est évidemment très éloignée de la réalité, comme le reconnaissent parfois les auteurs eux-mêmes. Bougainville, par exemple, signale dans son voyage qu’il existe à Tahiti une hiérarchie sociale stricte, contrairement à ce qu’il avait d’abord cru. Faute d’avoir reconnu chez les Tahitiens les mêmes signes de hiérarchie qu’en Europe, il avait cru à l’existence d’une société égalitaire sur l’île : c’est en se renseignant auprès de l’un des Tahitiens, embarqué à son bord, qu’il a pu mieux comprendre le fonctionnement de la société tahitienne.
→ De même, tous les traits attribués au « bon sauvage » par les Européens sont généralement le fruit d’une construction idéale : à partir d’observations superficielles, les penseurs imaginent une société qui est à l’opposé de tout ce qu’ils trouvent critiquable dans leur propre société.
La raison naturelle du Sauvage : un homme sans préjugés … dont la « naïveté » et l’ingénuité peuvent être mises au service d’un regard distancié sur la société occidentale
Le portrait du Bon Sauvage en homme naturel, qui n’a contracté aucun des défauts caractéristiques des sociétés européennes en font un instrument privilégié de la satire :
-
Non seulement, en tant qu’étranger, il est naturellement amené à s’étonner de tout ce qui ne lui semble familier, et peut ainsi mettre en lumière certains ridicules de la société européenne.
-
Mais en plus, en tant qu’homme naturel, il est aussi dépourvu de préjugés : s’il est resté proche de l’état naturel de l’homme, il fait aussi usage de sa raison d’une manière naturelle, qui n’a été déformée par aucune éducation. Ses remarques sont alors supposées être inspirées par la raison naturelle elle-même, ce qui leur donne plus de poids. Le Bon Sauvage est donc un porte-parole rêvé pour dénoncer toutes les pratiques déraisonnables ou irrationnelles des Européens.
→ Cette faculté permet au Bon Sauvage de s’inviter même chez des auteurs qui se montrent par ailleurs critiques à l’égard de ce mythe, comme Voltaire : ils utilisent le regard « naïf » et rationnel du sauvage pour dénoncer les dysfonctionnements de leur propre société.
III. « La pure nature est bonne » ? Le mythe du Bon Sauvage et les débats du XVIIIe siècle sur la définition de la nature humaine
Le mythe du Bon Sauvage connaît un regain d’intérêt au XVIIIe siècle, dans le cadre des débats sur l’état de Nature. En effet, les philosophes du siècle des Lumières se passionnent pour la question des fondements de l’état social et politique : ils cherchent à définir un état social idéal, qui serait le plus conforme possible à la nature humaine. Il leur faut donc définir la nature humaine.
C’est dans cette perspective que toutes les découvertes de civilisations qui semblent plus proches de la nature que la civilisation occidentale les passionnent : les civilisations d’Amérique et des îles du Pacifique, comme celle de Tahiti, semblent offrir une image de ce que serait une société qui suivrait la « loi de Nature ». Elles sont abordées comme une sorte de modèle idéal de civilisation en harmonie avec les lois dictées par la nature de l’homme. On tourne alors un peu en rond : on cherche à définir à partir de ces sociétés ce qu’est l’état de nature, mais elles-mêmes sont décrites comme l’incarnation d’un état de nature défini a priori à partir de réflexions philosophiques …
→ Pour simplifier, deux façons de voir l’état de Nature s’opposent :
-
Pour certains, la violence et les inégalités sont dans la nature humaine, qui est dominée par la « loi du plus fort ». Dans cette perspective, la nature est un état sauvage, où les hommes luttent pour survivre, et où les plus forts s’imposent. Les inégalités sociales actuelles sont donc la conséquence directe de la loi de nature : les lois sociales établies par convention ont juste donné une valeur légale à des rapports de force déjà existants dans la nature, et rendu plus complexe le jeu des rapports de force. Dans cette perspective, l’état social n’est pas pire que l’état de Nature : il le prolonge. En revanche, l’état social, dans la mesure où il repose sur des lois, peut tempérer ce jeu naturel des inégalités, en établissant des règles. La vie en société est donc « meilleure » que la loi de nature, d’autant plus qu’elle apporte aussi les avantages des progrès techniques et de la culture.
-
Pour d’autres, au contraire, l’état de nature est pacifique et égalitaire. C’est évidemment cette seconde conception de l’état de Nature qui se retrouve dans le mythe du Bon Sauvage, où la nature est idéalisée. Cette seconde définition de l’Etat de Nature a été théorisée principalement par Rousseau, qui met en avant deux idées :
-
Les hommes font naturellement preuve d’empathie les uns pour les autres : ils sont naturellement portés à compatir aux malheurs des membres de leur espèce et à éprouver de l’horreur pour les actes de violence. L’état de nature n’est donc pas un état de violence, où l’homme est un loup pour l’homme, mais un état d’entente naturelle. C’est la vie en société, avec la propriété et la concurrence qu’elle implique, qui est à l’origine des rapports de force et de leur violence.
-
Les hommes naissent égaux en droits : les hiérarchies sociales ne sont pas dans la nature, elles sont un produit de la société. Cette idée se retrouvera, à partir de la révolution française, dans des textes comme la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui partent eux aussi du principe que l’existence d’une nature humaine commune à tous les hommes suppose l’exercice de droits et de devoirs également communs à tous les hommes.