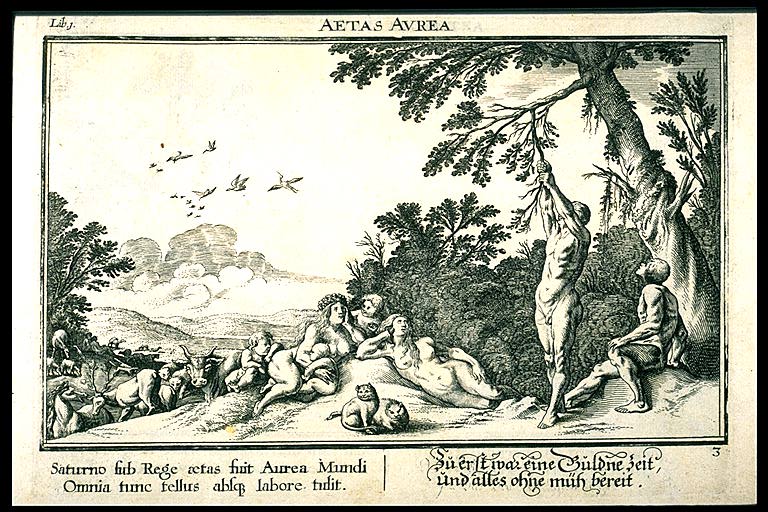Une lettre est un texte en prose écrit à la première personne du singulier et au présent pour s’adresser à quelqu’un qui n’est pas présent au moment où l’on écrit.
-
La personne qui envoie la lettre est son expéditeur. On peut aussi parler de mandataire, d’auteur ou de rédacteur de la lettre. Celui qui écrit une lettre peut également être appelé un épistolier.
-
La personne à qui la lettre est envoyée et qui reçoit cette lettre est son destinataire.
-
Pour un ensemble de lettres qui forment un échange suivi entre deux ou plusieurs personnes, on parle de correspondance. Les personnes qui échangent des lettres sont des correspondants.
-
Les lettres qui sont écrites en vers sont appelées des épîtres. L’épître est la forme poétique de la lettre.
-
L’adjectif qu’on utilise pour parler de ce qui est lié à la lettre est épistolaire (exemple : le genre épistolaire).
Une lettre comporte traditionnellement huit éléments : la date et le lieu d’envoi, les salutations d’ouverture, la notification de l’objet de la lettre, le développement, les remerciements par anticipation, le souhait final concernant l’avenir, les salutations de clôture, et la signature.
En outre, on ajoute souvent dans les lettres administratives un en-tête et un objet. Ceux deux parties ne figurent pas dans une lettre personnelle.
I. L’en-tête et l’objet (lettres administratives)
La fonction de l’en-tête est de rappeler toutes les informations sur l’expéditeur et le destinataire qui sont nécessaires au suivi administratif du dossier dont relève la lettre : nom et prénom, coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail), numéro de dossier. On met en premier les informations qui concernent l’expéditeur, suivies de celles qui concernent le destinataire. Les informations sur l’expéditeur sont précédées de la mention « De : », et celles qui concernent le destinataire de la mention « A : ».
L’objet indique le sujet sur lequel porte la lettre, sous la forme d’un titre.
II. La date et le lieu d’envoi
La date et le lieu d’envoi doivent toujours figurer dans une lettre. On peut les faire apparaître
-
soit au début de la lettre, avant les salutations d’ouvertures, sous la forme « Le …. à …. ». On les place alors en haut, à droite de la page (dans une lettre administrative, après l’en-tête et avant l’objet).
-
soit à la fin de la lettre, juste avant la signature, sous la forme « (Fait) à …, le … ». On les place alors en bas, à droite de la page.
III. Les salutations d’ouverture : une apostrophe qui ouvre le dialogue avec le destinataire
Les salutations d’ouverture sont une apostrophe qui ouvre le dialogue avec le destinataire. Elles se placent un peu à gauche du centre de la ligne. Leur formulation doit être modulée en fonction du statut du destinataire, de la relation que l’expéditeur entretient avec lui, et de la situation d’énonciation : on ne s’adresse pas de la même façon à un ami, à une administration ou à son supérieur hiérarchique, de même qu’on n’écrit pas de la même façon une lettre officielle et une lettre personnelle. Les variations possibles sont de deux ordres :
-
Tout d’abord, on peut nommer le destinataire de différentes façons :
-
de manière impersonnelle (Madame ou Monsieur)
-
par son nom dans une lettre administrative (Madame Durand ou Monsieur Dupont), ou son prénom dans une lettre personnelle (Pierre, Martin, Marie, Emma, etc.)
-
par son titre, c’est-à-dire le mot qui désigne son statut dans la structure sociale à laquelle il appartient (Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, etc.)
-
par un mot qui désigne la relation qu’on entretient avec le destinataire (ami, cousin, frère, sœur, etc.). Noter que ce type de désignation n’est en principe valable que dans une lettre personnelle.
-
Par ailleurs, on peut chercher ou non à mettre en place une relation plus personnelle avec le destinataire, en ajoutant à la façon dont on nomme le destinataire des adjectifs qui introduisent une forme d’affectivité dans la formulation : Cher Monsieur, Chère Madame ; Cher Directeur, Cher Client ; Chère Madame Durant, Cher Paul ; Cher ami, Chère maman, etc.
-
On remarquera que le mot « cher » fait partie du style épistolaire : il est simplement une façon de renforcer les liens avec le destinataire, et ne suppose pas forcément que l’on soit extrêmement proche de la personne à qui l’on écrit. Il vaut mieux, toutefois, éviter d’en abuser dans une lettre purement officielle, adressée à quelqu’un qu’on ne connaît pas personnellement et dont, souvent, on ne sait rien.
IV. La notification de l’objet de la lettre : le paragraphe d’introduction
Une fois le dialogue avec le destinataire mis en place à l’aide de l’apostrophe, il faut lui présenter l’objet de la lettre, lui dire pourquoi on lui écrit (et pourquoi in doit prendre la peine de nous lire!). Ce paragraphe d’introduction doit être concis : pas plus de deux ou trois phrases. Deux cas de figures sont possibles, selon que la lettre est le premier envoi d’un échange, ou qu’elle répond à une lettre précédente.
-
Si la lettre est la première de l’échange, il faut présenter les faits qui sont à l’origine du courrier de manière succincte, en allant à l’essentiel et en respectant la chronologie. Les temps utilisés dans cette partie sont le présent et le passé composé.
-
Si, en plus de cela, vous écrivez pour la première fois une lettre à quelqu’un qui ne vous connaît pas, il ne faut pas oublier de commencer par se présenter. Cette présentation doit tenir en quelques mots : il ne s’agit pas de raconter sa vie ou de faire son autoportrait, mais d’indiquer à quel titre on se permet d’écrire au destinataire, et de mettre en avant les qualités qui légitiment la mise en place d’un échange (et seulement celles-là).
-
Si la lettre est une réponse
-
Il faut tout d’abord indiquer à quelle lettre on répond. Pour plus de précision, en particulier dans un courrier administratif, il peut être bon de rappeler la date à laquelle le courrier a été envoyé, et la date à laquelle on l’a reçu.
-
Si l’on répond avec du retard, que la lettre soit officielle ou personnelle, il est bon de s’excuser d’avoir tardé à écrire, c’est-à-dire à la fois de demander au destinataire de bien vouloir nous pardonner, et de donner une raison (si possible valable, et sinon, au moins humoristique!) qui explique ce retard …
-
Il faut également reformuler le contenu de la lettre précédente de manière courtoise et concise, en identifiant bien l’idée essentielle et sans la déformer.
V. Le développement : informer, argumenter … toujours communiquer
On dit souvent que la lettre est un écrit personnel, où s’expriment les idées de l’auteur. Cependant, la lettre n’a rien d’un journal intime, comme on s’en rend compte lorsqu’on ne regarde pas seulement les lettres familières mais aussi les lettres administratives : le principe fondamental lorsqu’on rédige une lettre est de toujours écrire en ayant à l’esprit le destinataire, et ce qu’on veut lui transmettre.
La recherche des idées
Lorsqu’on cherche les idées que l’on veut faire passer dans la lettre, il faut toujours analyser le point de vue du destinataire. Une méthode efficace pour préparer la lettre est de faire un tableau à trois colonnes :
-
dans la première colonne, on se met à la place du destinataire, en faisant la liste de ses intérêts (ce qu’il veut savoir), ses opinions, ses points de vue, ses connaissances. On se demande aussi quelles sont les attentes du destinataire par rapport au courrier : pour bien faire passer ses idées, il est nécessaire de prendre en compte ces attentes.
-
dans la seconde colonne, on se demande quels sont les buts de la lettre : quels intérêts veut-on défendre, quelles idées veut-on transmettre ?
-
dans la troisième colonne, on fait la liste des faits qu’il est nécessaire d’évoquer pour parvenir à son but, et on ajoute les faits qui peuvent servir à ce but en fonction de ce qu’on sait du destinataire.
→ On écrit des lettres principalement dans trois buts :
-
-
transmettre des nouvelles au destinataire, c’est-à-dire l’informer.
-
demander quelque chose au destinataire. Dans ce cas, la lettre est un texte argumentatif, où il faut convaincre le destinataire, le persuader de faire quelque chose.
-
échanger des idées. Là encore, la lettre est un texte argumentatif, où l’on cherche à convaincre et persuader le lecteur de la justesse de ses idées. Souvent, ce but est associé à des lettres dont le ton est plus personnel, plus proche de celui de la conversation.
Le plan
La plupart du temps, information et argumentation sont associées dans une lettre. En effet, l’échange d’idées ou la demande s’appuient le plus souvent sur le récit d’un événement. Il faut donc commencer par le récit de ce qui s’est passé, puis ensuite seulement, formuler son opinion ou sa demande, et argumenter.
-
Pour plus de clarté, le récit doit être mené de manière chronologique, en commençant par le début, et en suivant l’ordre des faits. Ce récit se conclut sur un bilan de la situation actuelle qui résulte de cet enchaînement de faits.
-
Le temps utilisé pour évoquer les événements passés est le passé composé ; le temps utilisé pour le bilan est le présent.
-
Le récit débouche généralement sur l’évocation des situations à venir qui pourraient résulter de cette situation. Celle-ci se fait au futur ou au conditionnel, en fonction du degré de certitude de l’expéditeur par rapport à ses hypothèses.
-
La partie argumentative de la lettre doit être attentive à la logique du destinataire : il ne faut pas confondre :
-
« organiser ses idées » selon une logique qu’on est seul à comprendre.
-
élaborer un plan d’action pour élaborer un écrit (dans quel ordre vais-je procéder pour arriver à écrire mon texte ?) : cela correspond aux étapes à suivre au brouillon.
-
élaborer le plan du texte : le plan du texte est élaboré dans le but de communiquer, qui suppose d’adopter la logique du destinataire.
La rédaction et les relectures
-
Il faut écrire en imaginant qu’on parle à son destinataire comme s’il était en face de soi. Cependant, il faut tout de même faire attention : le niveau de langue qu’on utilise est un peu moins familier à l’écrit qu’à l’oral. Il faut donc utiliser un niveau de langue courant, sans vulgarité.
-
Il est bon de relire sa lettre avec le regard du lecteur, en se demandant si elle lui paraîtra claire, si elle comporte toutes les informations qu’il attend, et si elle produira sur lui l’effet attendu. Et, comme pour tout autre type de texte, il faut prendre garde à relier les idées du texte entre elles et à respecter les codes syntaxiques et grammaticaux.
VI. Les formules de clôture
La lettre comporte également de nombreuses formules de clôtures. Celles-ci ont un double but : elles doivent à la fois mettre fin à la lettre, et ouvrir vers la poursuite de l’échange : on n’écrit jamais simplement pour écrire, mais toujours pour recevoir une réponse !
La fin de la lettre doit donc à la fois servir à conclure, à prendre congé, et à appeler le destinataire à répondre. Pour cela, on fait se succéder plusieurs formules, qui ont toutes pour but d’évoquer de façon positive un futur proche.
Les remerciements
Il est de bon ton de remercier le destinataire d’avoir pris la peine de nous lire, surtout si la lettre est longue (et dans ce cas, il faut accompagner ces remerciements d’excuses, car la lettre est censée être un texte bref) : « En vous remerciant de votre attention, … ».
On peut aussi faire d’une pierre deux coups, et orienter ces remerciements vers la future réponse : ce sont alors des remerciements par anticipation : « Je vous remercie par avance pour votre réponse à ce courrier … ». L’avantage d’une telle formule est de condenser les souhaits et les remerciements.
Les souhaits
Les souhaits servent plus particulièrement à ouvrir vers le futur échange avec le destinataire. La nature de ces souhaits peut être très variable en fonction du type de lettre :
-
Dans tous les cas, on souhaite recevoir une réponse : « Dans l’attente de votre prochaine réponse ... », « En espérant te lire très prochainement … », « J’espère avoir bientôt de tes nouvelles … », « Réponds-moi vite ! », etc.
-
Parfois, on ne souhaite pas seulement recevoir une réponse, mais aussi pouvoir bientôt rencontrer son interlocuteur en personne : « J’espère avoir bientôt l’occasion de vous rencontrer », « J’espère qu’on se reverra bientôt », etc.
-
Dans une lettre personnelle, ce souhait s’accompagne généralement de vœux de bonne santé (et autres) : « J’espère que cette lettre te trouvera en bonne santé », « Porte-toi bien », etc.
Les salutations finales
Les salutations finales servent elles à mettre fin à la lettre, à prendre congé du destinataire. Leur ton et leur longueur peuvent être très variables, en fonction de la relation qu’entretiennent l’expéditeur et le destinataire.
-
Des formules à la fois très brèves et très familières, comme « A bientôt » ou « A très vite » ne s’utilisent que pour des proches, des amis, ou des personnes que l’on côtoie quotidiennement, et que l’on reverra le lendemain (dans le cas d’un mail, par exemple).
-
A l’opposé, dans une lettre officielle adressée à une personne que l’on ne connaît pas ou qui est placée au-dessus de nous (recruteur, supérieur hiérarchique, etc.), il est d’usage de recourir à des salutations assez développées telles que « Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses », « Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées », « Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus cordiales ».
-
Il faut cependant faire attention à ne pas avoir l’air d’en rajouter, et d’être trop cérémonieux. C’est pourquoi, la plupart du temps, on recourt à des formulations qui ont le même sens mais qui tiennent en quelques mots : « Cordialement », « Bien cordialement », « Bien à vous », « Respectueusement », « Très respectueusement ». Toutes ces formules n’ont pas la même valeur :
-
« Cordialement » et « Bien cordialement » ne s’utilisent en principe que d’égal à égal, ou lorsque l’expéditeur occupe un rang supérieur à celui du destinataire. Utiliser « Cordialement » revient donc à se placer en position de force.
-
Au contraire, lorsque le destinataire occupe un rang supérieur à celui de l’expéditeur, ou même simplement lorsque l’expéditeur formule une demande un peu délicate, il faut utiliser « Respectueusement » ou « Très respectueusement ».
-
« Bien à vous » est plus neutre : il peut s’utiliser dans toutes les situations où les rangs respectifs des deux interlocuteurs ne sont pas nettement définis l’un par rapport à l’autre. Il existe d’ailleurs une variante plus familière, pour s’adresser à quelqu’un que l’on côtoie quotidiennement sans en être proche, « Bien à toi ».
La signature
La plupart du temps, la signature se compose uniquement du prénom et du nom de l’expéditeur. Dans certains cas, ceux-ci peuvent être accompagnés :
-
Du titre de l’expéditeur, qui justifie que ce soit lui qui ait écrit, et qui indique à quel titre il écrit : Paul Durand, directeur marketing ; Ta cousine, Emma.
-
D’une formule qui introduit une dimension affective dans l’échange : Votre dévoué, Paul Durand, directeur marketing ; Ta cousine qui pense bien à toi, Emma.
Dans le cas d’une lettre qui doit avoir une valeur légale, la signature est précédée d’une mention légale, le plus souvent accompagnée de la date et du lieu : Fait pour valoir ce que de droit, à Paris, le 17 février 2016.