Anne Merker, Une morale pour les mortels, Belles-Lettres 2011, lu par Baptiste Klockenbring
Par Karim Oukaci le 26 juin 2019, 06:00 - Éthique - Lien permanent
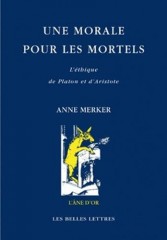 Anne Merker, Une morale pour les mortels. L’éthique de Platon et d’Aristote, collection L’Âne d’or, Les Belles-Lettres, Paris, 2011 (407 pages). Lu par Baptiste Klockenbring.
Anne Merker, Une morale pour les mortels. L’éthique de Platon et d’Aristote, collection L’Âne d’or, Les Belles-Lettres, Paris, 2011 (407 pages). Lu par Baptiste Klockenbring.
Là où la philosophie scolaire nous avait habitués à voir sinon une opposition, du moins de profondes divergences entre Platon et Aristote, Anne Merker entreprend, dans une vaste et profonde étude de leur philosophie morale respective, de montrer la profonde unité des éthiques grecques, sous le motif central d’une éthique enracinée dans la nature même de l’homme écartelée entre désir et logos, c’est-à-dire une éthique pour les mortels.
On pourrait s’étonner à la simple lecture du titre du dernier ouvrage d’Anne Merker, paru en 2011 aux Belles-Lettres dans la collection l’Âne d’Or , qui nous annonce « une morale pour les mortels » avec comme sous-titre, « l’éthique de Platon et d’Aristote » ; là où la philosophie scolaire – mais pas seulement : qu’on se souvienne de l’ouvrage d’Aubenque sur la prudence chez Aristote, dont l’un des ressorts essentiels est l’opposition à Platon – nous avait habitués à voir sinon une opposition, du moins de profondes divergences entre les deux figures majeures de la philosophie antique, Anne Merker entreprend, dans une vaste et profonde étude de leurs philosophies morales respectives, de montrer la profonde unité des éthiques grecques, sous le motif central d’une éthique enracinée dans la nature même de l’homme écartelée entre désir et logos, c’est-à-dire une éthique pour les mortels. C’est que la mortalité constitue le cœur du propos, qui commande, à suivre l’auteur, tout l’édifice de la réflexion éthique des deux figures majeures de la philosophie antique, et c’est sous cette idée centrale que se dessine la grandiose cohérence de thèses classiques, trop souvent morcelées par une vulgate qui, faute de les bien comprendre, a pu les isoler, les disperser, voire les opposer, sans toujours en saisir la profonde unité. Ainsi sont abordés et restitués, en une logique lumineuse et stimulante, tous les motifs de la morale platonicienne et aristotélicienne : la figure du Bien et sa puissance, la question de l’akrasia, celle de l’unité du bien, du beau, de l’utile et du bon, la question du plaisir et celle de l’unité des vertus, la phronèsis, jusqu’au fameux paradoxe socratique selon lequel nul n’est méchant volontairement…, toutes ces questions se mettent ainsi à consonner, à prendre vie et consistance pour constituer une vaste fresque de la morale antique, mêlant avec rigueur et profondeur analyses philologiques pointilleuses, distinctions conceptuelles audacieuses autant que fructueuses, et une profonde érudition antiquisante, appelant cet ouvrage à devenir une véritable référence des études de philosophie grecque.
Introduction : La mort, le désir et la morale. – C’est en effet sous le signe de la mortalité, ou plus exactement ce dont la mortalité humaine est le signe, que s’ouvre la question grecque de l’éthique tant chez Platon que chez Aristote : la mortalité constitue de fait l’homme en son « endeia », comme être de manque et de défaut, tout ce en quoi l’homme se détermine comme déficient dans son être même ; or à ce vocabulaire du manque, de la déficience (endeia), répond l’injonction proprement morale qui se situe d’emblée sur ce même registre du manque : « il faut », en grec, se dit : Dei ! C’est ainsi l’indigence, le manque à être de l’homme, qui aimante la vie de l’homme vers une perfection qui lui fait défaut, et ouvre ainsi l’espace dans le quel se joue l’éthique grecque : de ce que l’homme est un être en défaut, qui engage un falloir, il résulte que l’homme est un être de désir, désir qui est tension vers ce qu’il faut (déon), ce dont le manque est manque et qui se détermine comme le bien (agathon), c’est-à-dire ce qui est de nature à combler le manque constitutif du désir. Mais si l’homme est être de désir, il est aussi être de pensée, et c’est à la pensée qu’il revient de prescrire au désir son objet, ce qu’il faut (to déon) ; ainsi est-ce bien la suite endeia, dei, déon, qui structure l’éthique grecque ; et c’est ainsi de cette double détermination de l’homme, entre animalité et divinité, entre désir et pensée, entre tension vers un bien dont essentiellement il manque, et détermination de ce bien par le logos, que s’ouvre l’espace de la morale grecque.
« Il faut ». – La première partie s’intitule ainsi sobrement « Il faut », et creuse ce fait massif qu’en grec l’injonction morale se dit plus volontiers dans les termes impersonnels d’un il faut, plutôt que dans un tu dois – qui renvoie au champs lexical de la dette et du devoir, et met d’emblée en jeu l’interlocution. Anne Merker rapporte ce fait à la parenté évidente entre l’endeia, le manque, l’indigence ontologique de l’homme, et l’injonction impersonnelle à la troisième personne dei ! « il faut », un sens qu’on entend encore en français dans l’expression « comme il faut ».
Ce préambule linguistique, qui au fond commande toute la suite du raisonnement et en contient toute la pointe, ouvre ainsi sur la question du bonheur, de l’euzen, dont on sait qu’il constitue le cœur même de la réflexion éthique grecque – chacun a en mémoire la thèse qui ouvre l’Éthique à Nicomaque ; or le recentrage de l’injonction autour du vocabulaire de l’endeia affecte en premier lieu ce pont aux ânes qui fait du bonheur le Souverain Bien – selon une formule et une graphie critiquable qui porte les stigmates d’un passage par le latin summum bonum – qui est ce bien qui contente, c’est-à-dire qui ne laisse rien à désirer (Eth. Eud.) : or cette thèse rebattue, masque, précisément parce qu’elle est rebattue, ce qui est à entendre dans la question du bonheur telle qu’elle se pose aussi bien dans les Éthiques d’Aristote, que dans le Gorgias ou encore le Philèbe platoniciens. Et de fait, la question grecque de l’éthique a pour formulation précise : comment faut-il vivre si l’on veut bien vivre (euzen) – question qui constitue l’objet même de la République ? La question de l’euzen doit ainsi être entendue dans ses termes précis qui sont ceux d’un il faut, qui renvoie au manque constitutif de l’être de l’homme : si la question de l’ éthique se pose en termes d’un il faut, n’est-ce pas qu’elle se pose à propos d’un être dont la vie laisse précisément à désirer, c’est-à-dire est en défaut (endeia) — un mortel ? C’est que la mortalité, n’en déplaise à Épicure, structure de part en part la vie de l’homme : pour ne serait-ce que se maintenir dans l’être, l’homme doit toujours se refaire, compenser les pertes, rétablir un équilibre instable qui toujours se défait, image de la mort au sein de la vie même, dont le désir précisément est le signe paradoxal. L’âme même, tout immortelle qu’elle soit, est frappée d’endeia : n’a-t-elle pas besoin d’un objet, pour être en acte ce qu’elle est ? C’est ainsi sur le fondement de cette endeia que le dei, le « il faut » prend son sens, et se détermine comme une tension vers ce qu’il faut, tension qui se dit en grec : orexis, ce qui est « désir » (p. 45).
L’éthique se joue ainsi dans cet espace en tension d’un défaut, vers la prise, (choix novateur de traduction pour hairesis) susceptible de combler l’endeia première et constitutive, si bien que c’est par le désir que la morale prend son sens ; de ce point de vue, il n’y a pas lieu d’opposer désir et besoin, comme on se plaît à le faire ordinairement : le besoin est le manque d’où jaillit le désir qui se porte vers ce qui manque, ce qu’il faut. On notera du reste que satisfaire le besoin n’équivaut pas à mettre fin à l’endeia, « car si l’état de manque peut être comblé et trouver remède, la condition de manque est en revanche irrémédiable » et « la satisfaction du besoin ne délivre pas du besoin d’être satisfait » (50) ; l’infinité du désir ne vient dès lors pas d’un trait propre au désir par opposition au besoin qui serait, lui, déterminé, mais de ce que le désir est le signe d’une relative indétermination (a-teleia) de l’être en défaut (endees), qui implique que celui-ci ne se tienne précisément pas dans sa limite, dans son peras et son achèvement. L’endeia qui donne lieu au désir et fondement à la morale est ainsi, plus qu’un état, une modalité même d’être, et c’est sur le fond de cette insatisfaction principielle, ontologique si l’on veut, que le désir peut devenir pleonexia, désir d’avoir toujours plus, qui est, note Anne Merker, une dérive naturelle du désir. Sans que la pleonexia ne soit propre à l’être humain, celui-ci y est d’autant plus enclin que sa faculté intellectuelle lui permet de s’élancer vers ce qui est au-delà de ce qui est présent. L’infinité du désir est en somme, le pendant chez l’homme de son indéfinité, de son inachèvement.
Reste que si le désir tend à se saisir (hairesthai) de ce qui manque, cela ne peut se faire, chez l’animal que par la représentation de cet objet qu’il faut : ignoti nulla cupido, dira Ovide. Cette représentation peut n’être qu’imaginative, ou sensorielle, mais elle peut aussi être calculative chez l’homme ; il faut bien, en effet, que l’objet qu’il faut meuve la faculté désirante de l’animal, qui à son tour provoquera le mouvement de l’animal. C’est ici l’analyse de la conception aristotélicienne de l’action, en tant qu’elle entrelace le désir et l’intellect, qui est restituée et analysée, donnant lieu à une intéressante discussion de l’aristotélisme de Descartes dans sa doctrine de la volonté et du libre-arbitre, à l’exclusion notoire bien entendu, de la faculté de se déterminer. C’est dans ce contexte que prend place l’une des thèses le plus fortes et les plus incisives du livre : la discussion autour de la notion de hairesis, dont la traduction marque la profonde originalité du propos d’Anne Merker ; là où la plupart des traducteurs traduisent hairesis par choix, Anne Merker récuse cette option, pour lui préférer la notion, certes moins naturelle pour le français mais plus précise de prise, comme étant ce qui vient conclure la poursuite d’un bien. Ainsi se trouve exclu tout risque de contre-sens sur les prémices d’un libre-arbitre chez Aristote : la hairesis dénote l’accomplissement, l’atteinte du mouvement du désir, non une quelconque élection parmi des possibles. La fin du désir est en ce sens non seulement l’objet désiré, l’objet qu’il faut, mais la prise, l’appropriation à soi de cet objet: c’est cela que vise le désir, la prise pour soi, par lequel « le vivant désire un avoir pour être, ce qui veut dire être pleinement ce qu’il est, et qui pour lui est un avoir-à-être ». (p. 75).
Reste que la question doit alors être posée : si l’être en défaut qui désire, désire précisément par relative indétermination, cet objet qu’il désire est marquée de la même indétermination, si bien que « l’atteinte de la fin du désir est (…) profondément incertaine et erratique » et « l’appropriation à soi de ce qu’il faut est lourdement problématique ». L’enjeu est ici clair : le désir peut-il être par lui-même normatif alors qu’il est le désir d’un être marqué par l’ateleia, d’un être inachevé et imparfait ? De ce que l’être désirant est précisément en défaut, c’est-à-dire marqué par l’inachèvement et l’imperfection (l’ateleia), son désir ne doit-il pas recevoir une prescription normative, être guidé ? Ici la prescription de la pensée doit alors s’ajouter au désir : le il faut qu’il faut ne peut se comprendre par la pression de la nécessité et du manque ; il y faut également la détermination de la pensée. D’où la deuxième partie (de loin la plus fournie : 144 pages à elle seule), au titre tout aussi laconique que la première, et qui porte sur la détermination de l’objet du désir :
Le bien. – Il est de fait que cette question n’est pas sans soulever un paradoxe apparent ; en effet, l’une des thèses les plus constantes de l’éthique grecque, réside dans l’identification en quelque sorte analytique de l’objet du désir et du bien : l’objet qu’il faut (dei) est le bien (to deon = to agathon), étant entendu que pour Platon aussi bien que pour Aristote, « le bien est le beau, entendu au sens de la vertu et de tout ce qui lui est apparenté (to agathon = to kalon) », si bien que l’on peut résumer la morale platonicienne, aussi bien que l’aristotélicienne par cette équivalence : « le bien a pour objet la vertu et ce qui lui est apparenté « (to deon = to kalon). Dès lors, il faut conclure que « l’âme humaine désire toujours et par nature le beau moral, de manière indéfectible » (p. 77). Comment comprendre ce paradoxe ? Est-ce à dire que l’homme serait bon par nature, et que Platon comme Aristote donneraient dans l’angélisme ? En aucune façon : c’est que le bien n’a, en soi et tout d’abord, pas de valeur morale : il n’est au fond que le corrélat du désir, ce qui vient combler l’être en manque. Le bien est alors ce qui fait être en bon état, ce qui a la puissance de combler le désir et l’endeia, c’est-à-dire aussi de produire la perfection : l’utile, le bénéfique et l’avantageux, et non une valeur morale.
Cette puissance du bien, c’est dans la causalité finale qu’elle se manifeste de façon exemplaire : de fait, c’est la cause finale qui non seulement permet de connaître chaque chose (on se rappelle ici du Phédon : seul le bien permet de répondre véritablement à la question pourquoi ?, puisque le bien seul rend raison de l’effet de toute chose, et seul le bien comble le désir de savoir : le fait qu’il soit bon que les choses soient ce qu’elles sont, mettant un terme à l’interminable suite des pourquoi), mais de même que le soleil donne à chaque chose génération et croissance, de même le bien donne à toute chose l’être et l’étance (ousia) (Rép. VI), puisque la raison ultime de chaque chose n’est autre que le bon. Le bien est ainsi l’ultime réponse au pourquoi, la raison radicale de toute chose. On ne possède la raison ultime de chaque chose, que lorsqu’on saisit qu’il est bon qu’elle soit ce qu’elle est. En cela on comprend que le bien soit epekeina tès ousias, selon la célèbre formule de la République, étant le principe de toute chose. Le bien est ainsi cause, et même seule cause véritable, qui lie toutes les choses de l’univers en un Tout. Chez Aristote, si le bien comme Idée, comme réalité en soi et par soi, est l’objet de la sévère critique que l’on sait, la thèse selon laquelle la fin de toute chose, c’est le bon, n’en est pas moins affirmée avec force ; le bien est ainsi puissance, en tant qu’il meut par attraction, par aimantation, sur le mode de la causalité finale : la fin est ainsi le « premier moteur » duquel, finalement, part tout changement ; le dieu est ainsi la fin, et, pour cette raison même, le début de toute chose. Le dieu, c’est-à-dire le bon, est ainsi la fin et la cause de toute chose et du tout.
C’est du reste ce qui se manifeste dans le désir, qui ne porte pas tant sur l’être que sur le bon ; il est ainsi des cas où se défaire d’un membre, ou même de l’existence est, sub specie boni, l’objet du désir. Ce qui donne corps et sens concret à cette formule, sur laquelle on a tant glosé, d’un bien epekeina tès ousias, au-delà de l’être : au-delà de l’être, le désir, en effet, vise le bien. Même l’éternité n’est désirée, chez Platon, qu’en tant qu’elle n’est que la possession éternelle du bon. Ainsi le manque n’est-il pas un simple ne pas être, mais un ne pas être relatif à la perfection : la fin n’est pas seulement telos, elle est teleion, parfaite. Or seul le bon est parfait, si bien que seul le bien est ce qu’il faut (deon). C’est du reste, là encore, la même idée qu’on retrouve dans la thèse aristotélicienne selon laquelle la nature ne fait rien en vain, c’est-à-dire, au fond, qu’elle tend toujours vers le meilleur. De fait, la nature comme principe immanent du devenir (genesis), est aussi principe de perfection, puisqu’aussi bien, le terme de la genesis n’est autre que l’entelecheia, l’état de ce qui est en possession de son terme, de son telos. Bref, la nature produit en vue d’une fin, cette fin étant le bon, si bien que « la raison même du devenir en général et de l’advenir à l’être réside dans le bon » (p. 106). Du reste, l’incipit même de l’Éthique à Nicomaque ne dit pas autre chose : toute action humaine se fait en vue de quelque bien, et ce bien doit être de nature à combler le désir ; d’où le titre de ce bien : to ariston, le bien ultime, en ce qu’il comble enfin le désir, et met ainsi fin à la poursuite : ainsi le but des Ethique n’est rien d’autre que la détermination d’un bien qui doit mettre fin au désir, combler et achever, et l’éthique n’est en cela qu’un exemple de la puissance du bien.
De ce point de vue, on comprend que l’argument de Calliclès dans le Gorgias, qui voit le bien comme puissance, mais comme puissance de se procurer des biens (et non de les produire) en réponse aux désirs jusqu’à la pleonexia ; dès lors, pour Calliclès, qui admet certes une identité du bien et du beau moral, c’est-à-dire de la vertu en ce sens que le bien est la puissance de combler ses désirs sans les mutiler (kolazein), la justice n’est précisément plus une vertu, mais contraire à la vertu, en ce qu’elle est la stratégie des plus faibles (et les plus nombreux) pour dompter les plus forts qui, selon la nature, devraient dominer, et a ainsi pour effet de diminuer la puissance du bien, et de procurer des biens moindres, modérés et médiocres, non pour les meilleurs, mais pour le plus grand nombre. Si bien que la modération est comprise comme une véritable castration, et constitue une morale des impuissants. Ainsi ce que Calliclès dans le Gorgias, mais aussi Thrasymaque dans la République dénoncent, c’est l’idée que la vertu puisse procurer un bien, c’est-à-dire précisément l’impuissance de la vertu au sens de bien moral. Contre cette généalogie sophistique de la morale, Socrate développera l’idée que précisément, si les plus nombreux parviennent à imposer la justice et la modération aux plus forts, c’est bien qu’ils sont en fait le plus puissants. C’est en effet que pour Socrate, le juste, loin d’être le fruit de l’impuissance, est puissance de produire le bien. Suit ici une analyse minutieuse de la République, pour montrer comment Socrate établit la justice comme puissance bénéfique, tant de l’âme que de la cité, en ce que l’une et l’autre sont plurielles, pour conclure que « notre intérêt, c’est la vertu. » (133). La justice est ainsi, dans l’âme comme dans la cité, « harmonia, « agencement, emboîtement, harmonie, contenu concret de la beauté (…). C’est à cause de la présence d’une pluralité de composantes hétérogènes au sein de l’âme, que son bien (ce qui la fait être, c’est-à-dire accéder à la plénitude de son essence, et ce qui la sauve, c’est-à-dire ce qui la préserve dans cette plénitude) sera harmonia, c’est-à-dire beauté, et par là aretè, vertu. Ainsi, conclut Anne Merker, se trouve assimilés le beau et le bien, celui-ci consistant précisément en celui-là. Chaque partie de l’âme a ainsi sa vertu qui est son bien propre, la justice étant le bien du tout – d’où son privilège : elle est le lien qui unifie l’âme, tout comme elle fait l’unité de la cité. De là aussi l’idée que l’homme privé de justice, le tyran plus que tout autre, est aussi privé de la puissance bénéfique de toutes les autres vertus : toute excellence dans les mains de l’injuste, renforce ses capacités destructrices de lui-même, si bien que l’on peut conclure que l’injustice est à elle-même son propre malheur.
A cet égard, et malgré une différence de style et de méthode, Anne Merker souligne une convergence des Éthiques aristotéliciennes et de la République, sur l’idée que les activités accomplies selon la vertu sont, comme le déclare le livre I de l’Éthique à Nicomaque : « maîtresses du bonheur » : l’œuvre propre d’un être humain étant l’acte de son âme, à savoir vivre, la vertu de l’être humain doit donc être ce qui lui permet de bien vivre ; d’où l’idée que, le bien vivre étant le bonheur, celui-ci n’est rien d’autre que la vertu. Anne Merker détaille alors une méticuleuse analyse de l’âme aristotélicienne et de ses fonctions qui l’amène à concevoir l’être de l’homme comme entrelaçant l’animal et le divin. De là, une analyse de l’action humaine, se distinguant du mouvement animal, lequel repose sur le désir et une représentation imaginative ou sensorielle, par le fait que le désir est chez l’homme d’emblée mêlé de pensée : il est ainsi prohairesis, ce que Anne Merker traduit par intention. L’intention est ainsi une sorte de désir assumé, par une délibération de la pensée sur les moyens en vue de la fin, ce qui constitue ce que l’auteur appelle « une anticipation (pro-) de la saisie (hairesis) de la fin désirée ». C’est ce qui explique, du reste la dualité des vies humaines : « la vie contemplative, qui est propre à l’être humain parmi les vivants mortels, quoique surhumaine en elle-même », et « la vie d’action, qui est proprement humaine parmi tous les vivants, que ce soit parmi les immortels qui ont part à la pensée ou parmi les vivants mortels » ; d’où également une dualité de la vie bonne : vie contemplative réussie et vie pratique réussie, la tension entre les deux étant irréductible, reposant sur la problématicité même de l’être humain, et non sur une supposée contradiction d’Aristote. Anne Merker détaille ensuite les vertus, proposant une lecture très éclairante de leur répartition selon les facultés de l’âme, d’une part, et selon les actes des facultés de l’âme d’autre part ; son analyse l’amène ainsi à étudier successivement la vertu pratique éthique, puis la vertu pratique intellectuelle (à travers la prudence) et une analyse de la solidarité des vertus pratiques. Enfin c’est la vertu éthique comme médiété qui fait l’objet d’un long paragraphe, mettant en évidence que si la vertu est ce qui met en bonne état, c’est par la mesure, qui rend possible la vie de la pensée, là où le désir dans sa démesure rend la pensée impraticable. En cela, Anne Merker montre que « la domination de la pensée au sein de la vie humaine », qui n’est précisément « pas vie de la seule pensée », est ce par quoi la mesure est spécifiquement bénéfique à l’âme et la vie humaines.
Reste alors un dernier point à examiner : « le problème du plaisir ». Ce problème se pose non seulement du fait de la nature même du plaisir, mais aussi de la nature complexe de l’homme, où se mêlent désir et pensée. En ce sens, la question du plaisir ne peut être qu’épiphénoménale, et non fondamentale. C’est que le plaisir présente précisément l’allure du bon, alors qu’il se révèle en de multiples occasions nuisible et mauvais. Ainsi présente-t-il l’un des deux caractères du bien : celui-ci fait être de façon excellente, et de ce fait, d’autre part, se présente comme la fin. Or c’est précisément l’un des caractères du bien, que de présenter une « puissance d’attraction universelle sur le désir », c’est-à-dire comme fin : qui ne désire le plaisir ? De là le raisonnement, qui n’est certes pas concluant, mais emporte une certaine force persuasive : le bien est poursuivi par tous, le plaisir est poursuivi par tous, le plaisir est le bon. De même, le fait que le plaisir soit poursuivi pour lui-même, lui donne les atours d’un bien valant en soi et pour soi. Reste bien entendu que le plaisir se révèle nuisible en bien des circonstances. Pour autant, on ne peut exclure le plaisir de la vie bonne : si le bon, rappelle Aristote, était source de déplaisir, nul doute que personne ne le supporterait, idée que l’on retrouve à l’œuvre dans le Philèbe. Ainsi le bon ne peut être ni le bon, ni séparé du bon.
Il s’agit ainsi de clarifier le statut du plaisir à l’égard de la fin du désir ; ici Aristote et Platon divergent sensiblement : pour Platon, le plaisir étant de l’ordre du devenir, il ne peut prétendre à la place de fin, le mouvement étant l’indice de l’inachèvement : le plaisir advient ainsi chez Platon dans le retour à la nature et à l’harmonie de l’animal sentant, et étant processus, ne saurait prétendre constituer la fin, le telos de ce processus ; ainsi les dieux ne sauraient être dits avoir du plaisir, étant parfaits. Aristote, quant à lui, maintient le plaisir sous le régime de la fin, mais une fin qui survient par surcroît, et il substitue à la kinesis, l’energeia – qui marque du reste la spécificité de la psychologie aristotélicienne : le plaisir n’est ainsi pas dans la restauration d’un équilibre perdu, mais dans l’acte même d’exercer une faculté, pour autant qu’il soit sans empêchement et de façon correcte. Or c’est bien en vue de sa fin que consiste l’acte d’une faculté, si bien que le plaisir réside dans l’entelecheia, « l’état de ce qui est en possession de sa fin » : ainsi le plaisir est dans la fin, sans être la fin ; il s’ajoute à la fin lorsqu’elle est excellemment effectuée. Le plaisir est ainsi signe de perfection.
D’où vient dès lors que le plaisir, en ce qu’il est signe de perfection (Aristote) ou de retour à l’harmonie de la nature (Platon), puisse être dit nuisible en de nombreux cas ? C’est que dans le plaisir, nous ne connaissons pas de limite, alors même qu’il consiste dans l’acquisition de la limite, du terme (telos). Mais « c’est le plaisir qui nous entraîne sans cesse au-delà de ce qui est bon, de ce qui est raisonnable, c’est-à-dire au-delà de ce qui est vrai touchant le bon, que la pensée rationnelle seule peut saisir ». Car notre « être en défaut » est tel qu’il instaure en nous, être de manque, quelque chose d’illimité, qui rend toute satisfaction inconsistante, et nous entraîne dans la pleonexia : « toute satisfaction est minée par un besoin de satisfaction ». (211). Le plaisir ne fait ainsi que rendre manifeste en l’amplifiant une illimitation qui est liée à notre nature, et non à son essence : ce n’est pas que le plaisir soit mauvais, mais il est du bon qui s’oppose au bon qu’est le bien. C’est ainsi « du bon qui s’oppose à du bon, du fait de la pluralité de la nature humaine ».
De fait, « la pluralité de la nature humaine, comme un prisme, provoque une démultiplication du bon, que le plaisir épouse ». Anne Merker convoque ici le livre IX de la République, dans lequel Platon détaille un désir propre à chaque partie de l’âme ; de là, chaque partie de l’âme a aussi sa fin propre, c’est-à-dire aussi son bien propre, et aussi un plaisir propre ; le philokerdes est ainsi ami de l’argent, de même que le philotimon de l’honneur et de la victoire ; le philosophon, quant à lui, chérissant le savoir de la vérité, et y trouvant son plaisir : ainsi, chacune des parties de l’âme tient sa fin propre pour le bon, ce qui démultiplie le bien en autant que de partie de l’âme. A cela s’ajoute un quatrième bien qui est le bien du tout de l’âme (ou, par analogie, de la cité). Ce bon doit être l’objet de la partie calculative, puisqu’il réside en une proportionnalité. On voit donc que le plaisir de l’une des parties ne coïncide pas nécessairement avec le bien du tout, si bien que le caractère éventuellement nuisible du plaisir dépend essentiellement de la hiérarchisation des parties de l’âme de l’homme. Aristote mène une analyse semblable, en ce qu’il détaille trois espèces de désirs et trois objets du désir ; le plaisir corporel n’est ainsi qu’une partie du plaisir, qui tend à s’arroger pour lui seul le nom du genre : la foule n’ayant jamais goûté aux autres plaisirs, les ignore et ne retient donc qu’une partie du plaisir, celui accompagnant l’acte de la faculté psychique la plus basse ; en outre, le plaisir renforçant l’activité qu’il accompagne, finit par entraver les autres fonctions psychiques. Bref, le plaisir n’est certes pas mauvais en lui-même, mais se révèle, de fait, bien souvent nuisible.
Anne Merker montre ainsi que le désir, diffracté par la complexité de l’être humain, tend à s’éparpiller, et se révèle ainsi incapable d’acheminer l’homme à son véritable bien, en tant qu’il est un être humain, si ce n’est par une « harmonisation des objets désirables, produisant l’harmonisation de ses élans », comme dans la vertu complète qu’est la justice platonicienne, qui est tout aussi bien celle d’Aristote.
C’est dire que la complexité humaine, entre désir et pensée, appelle ce que traite l’avant-dernière partie intitulée :
L’hégémonie de la pensée. – Cette partie, de fait, traite de ce qui permet l’harmonisation, sous la férule de la pensée, des différents intérêts des parties de l’âme, rejoignant ici le thème classique de la domination de la raison sur les passions. C’est en effet par la pensée intellectuelle que le désir peut être conduit à la fin qu’il vise, et ainsi accomplir son élan, non seulement parce que l’âme est principe de mouvement – ce que l’on retrouve dès les formes végétales – mais parce que chez l’homme, l’âme s’élève jusqu’à la capacité à se saisir des principes et des causes, qui lui permettent d’atteindre les fins qu’il vise. Seule la pensée en effet peut saisir et ainsi prendre soin du tout qu’est l’homme.
Suit alors une discussion autour de ce qu’Anne Merker nomme « l’utilitarisme » de Platon, l’utile (chrèsimon) étant chez lui la nécessaire médiation par quoi le bon peut effectivement devenir le bénéfique (ôphelimon) ; la chrèsis est ainsi ce qui permet de tirer le bon de la chose, ce qui suppose de posséder la science de cet usage, et donc, en ce sens, l’hégémonie de la pensée : ainsi seule la science, en ce qu’elle est seule capable de déterminer l’usage correct, c’est-à-dire ce en quoi un bien est un bien, peut être dite inconditionnellement bonne. Seule la science, qui prendra, dans la République la figure de la science complète qui est science du bien, peut ainsi tirer des choses le bon ; les choses en elles-mêmes, soumises au devenir, ne sont jamais bonnes absolument : l’eau, par exemple, est bonne selon les circonstances, mais peut tout aussi bien être nuisible à l’hydropique, par exemple ; si bien qu’il doit y avoir « quelque cause qui fait que l’eau est bonne, distincte de l’eau, et à quoi l’eau est néanmoins capable de participer ». Or cette autre chose n’est plus une chose bonne – faute de quoi, la régression à l’infini serait inévitable – mais le bon lui-même. Si bien que seule la science du bon peut nous permettre de saisir ce qui est bon pour nous, au sein des choses variables, et pour notre nature composée et complexe : « l’usage de toute chose est ainsi une vue prise par la pensée sur le bon, qui permet de saisir dans la chose en quoi elle participe du bon relativement à l’agent qui tente d’en tirer parti » (p. 237). Ainsi peut-on dire que « tous les biens extérieurs, et tous les biens du corps, ne sont des biens qu’à partir des biens de l’âme que sont les vertus réunies en la justice (…), et les biens de l’âme elle-même ne sont des biens que pour autant qu’ils sont suspendus à la pensée (noûs) ».Mais il est à noter également que la pensée elle-même, « est suspendue au bien, et ce n’est qu’en tant qu’elle participe du bien – ce qui pour elle consiste à le toucher, le saisir, c’est-à-dire le connaître, en avoir la science et l’intelligence –, que la pensée est le bien de l’être humain » ; ainsi faut-il préciser que chaque étape, dans cette architecture, n’est bonne qu’en tant qu’elle contient de la pensée. La pensée est ainsi la seule capable de viser le bien de l’homme en tant qu’homme, et de le conduire (ce qui est le rôle de l’hegemon), vers son intérêt propre à travers la dispersion que sa complexité produit dans le désir et le désirable, intérêt qui est précisément la pensée elle-même, si bien que la pensée est « à la fois moyen et fin, partie et tout, commencement et fin du bien que l’être humain désire s’approprier ». En un sens, on peut ainsi dire que « la pensée tourne en rond sur elle-même », ce qui n’est pas cercle vicieux, mais figure du divin. A ce cercle, doit être intégrée la notion de philautie, mais aussi, plus largement celle de philia, qui renvoient au noûs qui est en nous le véritable soi, dont la pensée et la philosophie a à prendre soin.
L’hégémonie de la pensée chez Aristote, dont l’analyse clôt longuement cette partie, est un véritable traité de l’action humaine selon le Stagirite. Annonçant du reste un livre à venir et une nouvelle traduction de l’Ethique à Nicomaque, Anne Merker détaille de façon à la fois scrupuleuse, originale et lumineuse la conception aristotélicienne, telle que la prohairesis – conçue par elle, nous l’avons mentionné, comme « prise anticipée » – en est le principe, détaillant comment la pensée vient en l’homme s’articuler au désir, pour faire de ses mouvements, de véritables actions (praxis). La prohairesis, désir délibératif, ou intellect désirant, est ce qui chez l’homme compose la partie désirante (orexis) avec la partie délibérative, qui, montre Anne Merker, ne porte certes pas sur la fin, mais portant sur les moyens, le fait en vue de la fin : il s’agit ainsi, la fin étant posée, de remonter par l’analyse régressive, à un premier moyen qui se trouve en notre pouvoir (eph’hèmin), dont la prohairesis, se saisit. C’est donc ici encore la pensée « en tant qu’elle est animée de désir » (orexis bouleutikè) qui dirige l’action ; non que le bien n’ait aucune action causale, comme chez l’animal, mais plutôt qu’il est chez l’homme redoublé par la prohairesis qui consiste à assumer la fin pour son propre compte, prendre en charge le désir activement (là où il est chez l’animal pure passivité, par le moyen de l’aisthesis ou de la phantasia) : dans la prohairesis, la faculté désirante n’est pas agie par le désirable, mais au contraire, c’est activement que la faculté intellectuelle, en recherchant les moyens en vue de la fin, « trace ainsi le chemin qui mène jusqu’à la fin ». La prohairesis amène ainsi l’homme à « prendre sur soi la causalité », à « faire remonter jusqu’à soi la cause » et donc à « s’instituer soi-même comme une archè », le principe de ses action. C’est par là seulement, par l’hégémonie de la pensée, que l’on passe du désir à l’intention, que l’humain est « principe de son être-principe » : ainsi que le dit Anne Merker en une jolie formule : « Ni purement libre [le sujet ne pose pas librement une fin, c’est bien le désirable qui reste bien le premier moteur non mû de l’action dans une action qui reste essentiellement hétéronome], ni purement déterminé passivement [comme dans la kinèsis animale], l’humain assume : il prend sur lui une causalité dont l’origine véritable n’est pas en lui, et par cette assomption de la causalité, il suspend à son intelligence la passivité du désir sans la supprimer » (290). En cela la praxis se distingue radicalement de la poiesis : l’une est pro-duction, « processus qui produit au dehors », l’autre est ap-propriation « processus qui ramène à soi ».
De là A. Merker détaille l’articulation de cette dimension à la question des vices et des vertus, notamment à travers une analyse détaillée de la passion et de la figure de l’akratès : chez ce dernier, la prohairesis, l’intention, se détache de la hairesis, la « prise », et bien qu’ayant trouvé la médiété qui constitue la vertu, bien qu’il le désire, il ne réussit pas à s’en saisir ; voyant le meilleur, le pire s’ensuit. C’est ici le lien entre le désir et la raison qui faiblit, paralysant l’intention ; dès lors, la raison se trouve seule face à un désir issu de l’epithumia qui se porte impulsivement vers le plaisir. Or l’epithumia étant dénuée de logos, la raison est impuissante à la raisonner, livrant l’agent à la causalité de l’objet désirable « sans passer par l’assomption de la causalité opérée par l’intellect » dans l’intention (prohairesis). Et Anne Merker de conclure sur l’importance de l’éducation et des institutions politiques justes, pour un être dont le principe qui lui permet de se conduire « n’atteint que tardivement son développement », ce qui suppose que « l’activité préalable du désir » qui lui est toujours déjà là, « ait posé aveuglément, la bonne fin et non une autre, sur un mode non rationnel, en attendant son assomption par la rationalité. C’est pourquoi il faut de l’ethos, de l’habituation, voire du conditionnement, et de la répétition qui inscrive dans l’âme sur un mode non rationnel une fin qui devra devenir fin rationnelle ». C’est ainsi sur la politique que repose ultimement l’éthique, « car c’est dans la communauté humaine que se forme l’èthos avant le développement de la rationalité immanente à l’individu ». Mais réciproquement, « la politique n’est pas séparable de l’éthique », en laquelle s’accomplit la condition humaine.
Nul n’est méchant de son plein gré. – On ne s’étendra pas, pour finir, sur la dernière partie qui constitue une sorte de mise en situation des réflexions qui précèdent dans l’analyse du paradoxe socratique et platonicien selon lequel nul n’est méchant de son plein gré. Anne Merker y montre la pertinence de ce paradoxe, qui est significatif de cette éthique pour les mortels, paradoxe vainement critiqué par Aristote, avec en arrière plan, l’enjeu de la punition et du châtiment.
Conclusion : « intellectualisme moral ». – Pour conclure, Anner Merker montre que l’éthique grecque, telle qu’elle se déploie tant chez Platon que chez Aristote, si elle repose sur le fait que tout dépend de la pensée, ne saurait pour autant définir à proprement parler un « intellectualisme moral » : c’est qu’en effet le désir structure tout aussi bien l’être mortel de l’homme, qui oriente ce dernier vers ce dont, de fait, la pensée seule peut se saisir, scil. le bon qui dispense l’être. Désir et pensée découvrent alors leur secrète parenté, et réunis en l’homme, donnent à ce dernier sa dimension proprement métaphysique : « la pensée est tout entière prise dans le problème de l’être et du non-être, comme le désir, avec lequel elle constitue l’humanité même de l’être humain » (p. 370).
On aura compris l’importance de cet ouvrage qui, au-delà d’un très stimulant renouvellement de la lecture des éthiques grecques – celle d’Aristote en particulier – et d’une interprétation pleine de souffle, réinscrit l’éthique de manière lumineuse dans une perspective qui lui donne une signification enthousiasmante, et lui restitue de la sorte toute sa dignité et sa valeur authentiquement métaphysiques. L’ouvrage allie ainsi une grande valeur scientifique – sans jamais tomber dans la sécheresse, les références et les discussions les plus arides étant reléguées dans des notes, par ailleurs souvent stimulantes, qui entament ici et là un dialogue avec le texte principal – avec une profonde inspiration interprétative, ainsi qu’un grand souci pédagogique, qui le rend parfaitement accessible à l’honnête homme non helléniste qui voudrait s’initier à la philosophie grecque. Bref, c’est un ouvrage appelé sans aucun doute à devenir un incontournable des études grecques, utile aussi bien au débutant qu’au spécialiste.
Baptiste Klockenbring (13/06/2014)