Yohan Ariffin, Généalogie de l’idée de progrès, histoire d’une philosophie cruelle sous un nom consolant, Le Félin (Kiron), 2012, lu par Astrid Silvan
Par hmuller le 10 octobre 2014, 06:08 - Philosophie générale - Lien permanent
Le progrès est souvent conçu comme norme mais c’est alors comme si cela allait de soi, comme si la représentation du temps qui était sous-entendue avait toujours été la même, comme s’il allait de soi que la fin de l’action humaine était le bien de l’homme et qu’ainsi la somme des maux serait toujours compensée par un plus grand bien pour l’humanité, comme si enfin l’humanité tout entière profitait de ce mouvement global voulu finalement par une certaine civilisation.
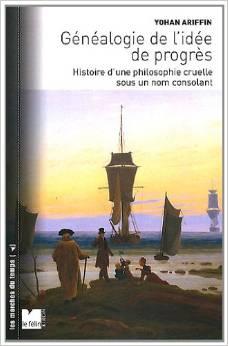
Comment une telle idée a-t-elle pu naître de la confrontation au travers des siècles de représentations contraires ? Comment en a-t-elle retiré la force qu’elle a aujourd’hui et qui parfois nous contraint à penser que ce qu’elle sous-tend va de soi ? Tel est dans un premier temps la tâche que se fixe Yohan Ariffin en cherchant à établir une généalogie de l’idée de progrès.
Le 18e siècle est sans aucun doute celui qui conduira à une reformulation de thèses anciennes. Il est aussi celui où s’affrontent la thèse selon laquelle les peuples connaissent un devenir historique que l’on peut se représenter de manière linéaire et celle qui s’interrogeant sur ce qu’il pourrait en être de l’homme, voit dans d’autres formes de culture, une représentation d’un certain âge d’or perdu. Ainsi l’âge d’or est-il devant nous ou bien plutôt derrière nous tel un paradis perdu à force de sombrer dans la démesure ? Question sans doute pérenne qui demande pour que nous en comprenions les enjeux, une plongée dans les sources qui ont nourri une idée qui nous paraît souvent révolutionnaire.
D’ailleurs faut-il entendre par « révolution » ce cycle comparable à celui des saisons, ce mouvement récurrent ou l’apparition d’une ère inédite ? La première représentation est celle qui nous amène également à penser à la roue de la Fortune, à Hésiode et ses races d’hommes enfermés dans un recommencement éternel, à ces constitutions qui connaissent la dissolution avant de se régénérer. Dans les sources chrétiennes, le propre de l’homme de foi et de raison est de ne pas être roulé par la Fortune en s’attachant à de faux biens. Ainsi à la Renaissance peut apparaître l’idée selon laquelle l’homme peut dans une certaine mesure devenir maître.
Les Lumières deviennent alors cette époque où on admet que s’il existe de bonnes raisons aux choses, la Raison devrait les trouver. Faute de le faire, on peut critiquer alors l’hypercivilisation, les excès, le despotisme du dieu chrétien ou du monarque de droits divins. Les hommes apparaissent alors mus par leurs passions. Même les phases de déclin œuvreraient à l’avancement de l’humanité. Epreuves et erreurs serviraient à tirer des leçons pour l’avenir.
Dans une deuxième partie, il convient alors de se demander si par son action éclairée, l’homme est sorti de l’âge de la minorité ? Comment alors juger de l’action humaine ? Sa fin est de lutter contre la surpuissance de la nature, la caducité de notre corps, la déficience des dispositifs censés régler les relations humaines (famille, société, Etat). Le procès civilisateur qui a pour fin de lutter contre ce qui pourrait conduire à certains maux est-il alors un bien en tant qu’il conduit à un progrès ou bien un mal qui devient la cause de l’infélicité ? Cela ne peut-il pas être les deux ?
Au 18e s’affrontent alors deux représentations : la 1ère trouve sans doute sa source déjà dans les mythes puisqu’on pense que le temps est le lieu de la corruption, que l’homme n’a de cesse de s’éloigner de la mesure correspondant à la race des héros chez Hésiode, que l’évolution du monde est alors un vieillissement. La cause de cela est le feu qui, en étant volé, allait devenir cause de la mollesse et de la sensualité des hommes. C’est alors la lutte pour obtenir toujours plus de biens. Chez les Romains et Lucrèce, le civilisé n’apparaît pas comme celui qui est supérieur. C’est la disparition progressive des valeurs, traditions. Cette déliquescence touche même le politique. Mais ce qu’a inventé l’homme comme le signale la 2e représentation pourrait être mis à profit. L’état de nature devient alors le stade où l’homme était proche de la bête. Les techniques deviennent un don des dieux. Il peut trouver des remèdes à ses maux. L’homme désormais peut parce qu’il sait. Mais rien n’est joué d’avance et on peut très bien penser qu’il connaîtra des catastrophes suivies de remontées. Les événements suivent une oscillation. Inventer c’est pouvoir compenser ces manquements et aller au-delà. Mais cela ne peut-il conduire à l’expression de la violence contre la nature, entre certains hommes, entre certaines sociétés ?
Il nous faut comprendre que cela va aussi conduire à une nature désacralisée et comme dans la Genèse tout semble agencé afin d’être utile à l’homme. Pourquoi ne pas penser dorénavant le monde à travers une doctrine des âges correspondant à l’éducation par degrés de l’humanité ? Celui que l’on dit sauvage est-il celui qui est simple, bon, innocent alors que nous sommes par notre procès civilisateur, les vrais sauvages, barbares ? Ne peut-on pas aussi comparer l’état sauvage à l’enfance de l’humanité ce qui conduirait au nom d’un idéal, à un devoir : les civiliser ?
Avec ce procès, l’homme perd trois attributs : sa simplicité, son innocence, une certaine liberté et égalité naturelle. Apparaissent alors prodigalité, individualisme, arbitraire politique. Sans doute pourrait-on affirmer que le mouvement qu’il connaît correspond à la perfectibilité mais cette dernière est aussi à penser en fonction des circonstances extérieures et des individus.
La troisième partie de cette œuvre conduit alors à s’interroger sur les enjeux. Selon la conception que nous avons du temps, de la fin de l’action, la compréhension que nous avons de la perfectibilité, on peut alors tenir un certain discours sur l’homme et créer un certain système de valeurs. Qu’en est-il en effet de l’autre ? Est-il un monstre, un barbare ? Mais qui est le véritable barbare ? La civilisation ne peut-elle dégénérer en hyperbarbarie ? Les monstres sont-ils les impies, les anthropophages ? Que penser de ceux qui spolient, répandent des épidémies ? On peut aussi, en utilisant Darwin, admettre que ces êtres que l’on veut intégrer à l’humanité sans cela disparaîtraient comme s’il s’agissait d’une sélection naturelle. Faut-il faire le deuil des populations sauvages pour mieux croire au progrès ? Le leitmotiv doit-il être destruction, conversion, absorption ? Si on est capable de reconnaître la barbarie des civilisés, le remède est-il la civilisation des barbares ?
Le but est-il de donner une consolation face aux maux cumulés ? On peut sacraliser le savoir, les sciences et techniques, admettre que l’âge d’or n’est pas derrière nous mais devant nous, vouloir libérer l’homme de l’angoisse de l’avenir grâce à sa maîtrise mais face à cela, n’y a-t-il pas aussi des signes d’alarme en provenance du monde extérieur ? N’avons-nous pas oublié que le désir comme le plaisir ne peuvent exister que grâce au manque ? Sait-on garder une juste mesure ? L’homme peut tout désirer, tout conquérir en oubliant de rester raisonnable. La crise environnementale ne devrait-elle pas nous ramener à certaines interrogations ? Ne devons-nous pas faire nôtres les interrogations de Yohan Ariffin sous peine de rester aveugle à ce qui pourrait nous guetter ? N’avons-nous pas oublié que cette société que nous avons voulue peut nous ramener au même destin que ces hommes sauvages qui disparaissent ?
Le progrès se construit dans un intervalle entre mythe et réalité. Mais quelle réalité voulons-nous ? Quel prix sommes-nous prêts à payer ?