Michaël Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012, lu par Eric Delassus
Par Baptiste Klockenbring le 09 mai 2014, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
 Michaël Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012.
Michaël Foessel, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012.
L’ouvrage de M. Fœssel se présente comme une critique du catastrophisme contemporain qui reprend le thème de la fin du monde sous un jour nouveau. Le fait que nous soyons désormais en mesure de détruire notre planète et que, comme le laisse entendre G. Anders, nous ne vivions plus dans une époque mais dans un délai nourrit une représentation sécularisée de la fin du monde qui n’a plus rien à voir avec sa forme religieuse qui s’ouvrait sur l’espérance d’un après porteur de salut.
Présentation
L’ouvrage de M. Fœssel se présente comme une critique du catastrophisme contemporain qui reprend le thème de la fin du monde sous un jour nouveau. Le fait que nous soyons désormais en mesure de détruire notre planète et que, comme le laisse entendre G. Anders, nous ne vivions plus dans une époque mais dans un délai nourrit une représentation sécularisée de la fin du monde qui n’a plus rien à voir avec sa forme religieuse qui s’ouvrait sur l’espérance d’un après porteur de salut. En réalité, à lire M. Fœssel, nous vivons déjà après la fin du monde dans la mesure où nous avons rompu avec les représentations antérieurs du cosmos qui voyait dans le monde un univers ordonné et finalisé. Il s’agit donc ici d’analyser le catastrophisme actuel à la lumière des conceptions antérieures de la fin du monde. Cette « critique de la raison apocalyptique » tout en remettant en question le catastrophisme contemporain ne donne pas pour autant dans le culte du progrès. Il s’agit plutôt de découvrir quelles sont les conditions de possibilité permettant de « faire monde » et d’échapper à cette perte du monde qui nous menace.
L’ouvrage est divisé en deux parties. Dans un premier temps l’auteur établit une généalogie de la notion de « fin du monde » pour dans une seconde étape établir un diagnostic en analysant diverses expériences de « perte en monde » et montrer en quoi il est possible de se dégager du catastrophisme en repensant le concept de monde.
Introduction
Le thème de la fin du monde n’a jamais disparu de l’histoire moderne, il s’est sécularisé à la suite des horreurs du XXème siècle. Les hommes étant dotés des moyens de détruire le monde, la « fin du monde » ne relève plus du phantasme, mais d’une catégorie universelle de l’expérience, elle est passée du rang de représentation religieuse à celui de description rationnelle de l’avenir. Cette conscience apocalyptique trahit un sentiment de panique de l’occident face à la perte de son influence dans un univers globalisé. Il n’y aurait de monde que pour la raison occidentale dont l’affaiblissement entraînerait l’apocalypse. Mais cette explication est insuffisante et doit y être ajouté le fait que le « monde » a perdu toute valeur du fait de la technicisation du réel qui a produit les moyens de la destruction universelle et qui fonctionne selon sa propre logique.
Le « monde » a donc valeur de métaphore pour désigner ce qui se situe hors du langage et renvoie à notre expérience et notre croyance en l’existence primitive du monde, il exprime ce qui nous est familier et que nous ne remettons pas en question. Le problème vient de ce que le monde est désormais souvent pensé dans les termes de sa fin. Nous vivons la fin du monde du point de vue des représentations, nous ne croyons plus en l’existence d’un cosmos finalisé, et du point de vue de l’avenir puisque nous craignons sa destruction. La question se pose donc à la modernité de savoir si un autre concept de monde est possible car le catastrophisme est toujours antimoderniste, il voit dans le progrès l’oubli du monde mais se refuse à dépasser la fin du cosmos pour penser autrement le monde.
Le but du livre est d’envisager la fin du monde sous l’horizon de sa perte et de s’interroger sur le sens de cette perte afin d’aborder un monde qui n’est plus le cosmos comme un nouvel horizon d’espérances. La logique du pire a tendance à restreindre la portée du concept de monde puisqu’elle considère que l’avenir doit déterminer le présent, le monde n’est plus alors un horizon de possibles, mais ce qui doit échapper à une nécessité destructrice. On le voit bien, le monde dont il est ici question, ce n’est pas la nature ou la planète, mais notre rapport présent et porteur de sens à une réalité dans laquelle nous sommes engagés. C’est pourquoi ce livre confrontera les thèses qui favorisent la primauté de la vie et celle qui s’efforce avant tout de « faire monde », vouloir préserver la vie consiste essentiellement à vouloir reproduire l’identique tandis que le monde est porteur de nouveauté en tant qu’il fait signe vers la pluralité et l’altérité.
Première
partie : Généalogie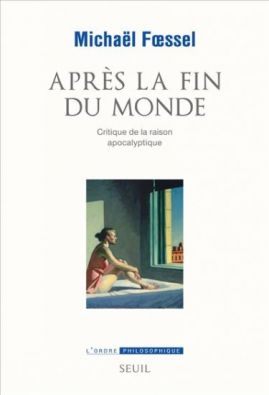
Si le livre de M. Foessel prend pour sous-titre Critique de la raison apocalyptique, c’est parce qu’il ne rejette pas du côté de l’irrationnel les thèses catastrophistes, mais qu’au contraire il y perçoit une certaine forme de rationalité qu’il faut mettre à jour pour mieux en montrer les insuffisances. L’auteur va donc s’interroger sur les raisons qui font que l’idée d’apocalypse hante les temps modernes, pas nécessairement comme une crainte explicitement formulée, mais plutôt comme ce qu’il faut neutraliser. Ainsi, sur le plan politique la philosophie de Hobbes est présentée comme un effort de la pensée pour concevoir les conditions empêchant le retour à l’état de guerre qui nécessite la souveraineté du Léviathan.
À l’origine du catastrophisme, il semblerait donc qu’il y ait tout d’abord le souci de répondre à la disparition du cosmos, à la fin de notre croyance dans un monde dont le sens ne dépend pas des sujets qui le constituent par le rapport qui les relie au réel, mais qui aurait sa signification en lui-même. À cette fin du monde envisagée d’un point de vue cosmologique, il faut ajouter désormais la perspective de voir le monde effectivement disparaître du fait d’une technicisation qui rend possible sa destruction et qui pourrait nous obliger à déterminer notre action actuelle en fonction du pire possible qui fait l’objet de nos peurs présentes (Jonas - comment agir pour qu’il reste quelque chose plutôt que rien ?).
Nous vivons donc dans un acosmisme qui nous conduit à nous éloigner d’un monde qui se réduit à n’être que le lieu dans lequel l’individu cherche à s’affirmer ou qui parvient à prendre sens dans l’idée de progrès qui se présente comme une consolation à la disparition de l’ordre du monde. Mais peut-être le progrès peut-il permettre de redonner sens au monde dans la mesure où il n’est pas articulé sur la fin du monde mais sur la possibilité de fins accessibles dans le monde ?
Ce désenchantement du monde ne donne pas nécessairement lieu au catastrophisme et l’acosmisme peut prendre d’autre forme. C’est ainsi que Max Weber y décèle la figure de l’ascète intramondain qui, même dans la jouissance, s’impose des règles de vie pour réinvestir le quotidien. L’ascète qu’il distingue du mystique qui, au lieu d’être un instrument actif au service de dieu, se perçoit comme le réceptacle du divin. Comme le fait remarquer H. Arendt, Weber a permis de mieux comprendre en quoi le détachement du monde peut donner lieu à une intense activité mondaine. L’ascète s’oppose au monde et attend de ce combat la confirmation de son élection.
Une réponse métaphysique est également possible face à la fin du monde. C’est par exemple celle de Hegel qui plutôt que d’en rester à « la colère contre le monde » considère que l’exercice de la raison nécessite la négation du monde. Ainsi sa philosophie commence-t-elle par une logique spéculative qui n’a pas besoin de présupposer l’existence du monde pour faire sens. Soumis à une telle logique qui le précède, toute contingence est évacuée du monde et la disparition d’un monde est toujours l’acte d’apparition de l’esprit. Ce à quoi s’oppose la position critique qui valorise cette contingence comme condition d’une liberté permettant de « faire monde » sans se réduire à un ordre cosmique qui limiterait les projets d’autonomie.
Le discours catastrophiste contemporain est surtout problématique dans la mesure où il implique un rapport au temps qui dévalorise le présent. En affirmant la certitude de la fin du monde, en posant l’avenir comme ce qui doit nécessairement advenir, on est conduit à considérer que le temps qui précède l’apocalypse est sans valeur, aussi loin d’ailleurs que l’on situe la fin à venir, et, par conséquent, on se trouve conduit à dévaloriser le présent.
Deuxième partie : Diagnostic
La seconde partie de l’ouvrage qui se présente comme le diagnostic de notre présent débute par le commentaire d’une formule utilisée par un résistant polonais pour désigner le ghetto de Varsovie : « ce n’était pas un monde ». Ainsi est exprimé l’effondrement du sens commun qui caractérise l’absence du monde, monde qui apparaît avec d’autant plus d’acuité qu’il est manquant. Cette absence de monde renvoie à la notion de « désolation » telle que l’a forgée Hannah Arendt pour caractériser les régimes totalitaires et désigner le sentiment de non appartenance au monde qu’ils induisent chez les individus qui leur sont soumis.
Un autre exemple emprunté au cinéma évoque « la perte en monde » qui consiste à percevoir le monde comme si tout était déjà passé, comme si l’historique hypertrophié aboutissait à l’abolition même de l’histoire qui n’a de sens que pour qui fait la différence entre son monde et un monde ancien. Ainsi dans la film Allemagne année zéro Rossellini montre l’égarement d’un jeune garçon qui s’était laissé entraîné par le nazisme, au milieu de Berlin en ruines, jusqu’au moment où il se suicide, incapable qu’il est d’investir son environnement pour à nouveau « faire monde ».
Par ces expériences de « perte en monde » qui sont ici décrites, il faut donc entendre des situations dans lesquelles le réel ne peut plus être investi pour faire sens et n’est plus que le lieu d’une errance désolante.
Ces situations débouchent sur la distinction établie par M. Foessel entre le monde et la vie. En effet, le catastrophisme a tendance à se présenter comme la nécessité de choisir la vie contre le monde, de faire de la vie le seul horizon de sens possible. Le problème c’est que la vie ne suffit pas pour « faire monde » car, selon M. Foessel, elle ne cherche qu’à persévérer dans l’être sans pour autant s’ouvrir sur un horizon de possibles et de nouveautés. Aussi, la thèse ici défendue est qu’il faut préférer le monde à la vie. Ce qui s’oppose à un certain discours écologiste qui semble nous inciter à faire l’inverse et à considérer la protection de la vie comme l’exigence suprême, mais sans s’interroger sur ce qui peut nous permettre de faire monde parce qu’il pose la vie comme le critère évident en fonction duquel se distingue le juste de l’injuste, le légitime de l’illégitime. La variante catastrophiste de l’écologie politique a tendance à confondre la fin du monde et la disparition de la vie et à privilégier l’effectif sur le possible.
Aussi, pour édifier le possible, la solution qui est proposée est celle du cosmopolitisme qui désigne ici le choix du monde qui ne consiste pas simplement à se soumettre à « l’impératif de vivre » comme pourrait le laisser entendre un certain cosmopolitisme de la survie qui résulterait de la conscience mondiale induite par le catastrophisme. Nous appartenons tous à un même monde menacé par l’usage que nous faisons de la technique et, les risques écologiques ne connaissant pas les frontières, nous devons donc appréhender de tels dangers en tant que citoyens du monde. Mais c’est un autre cosmopolitisme qui est défendu ici, un cosmopolitisme qui ne confond pas le monde et la vie et qui s’appuie sur une conception plus phénoménologique du monde compris comme horizon de sens, comme champ des possibles. Le monde n’est plus alors un ensemble de choses, mais désigne une capacité, une capacité de se rapporter au présent qui va au-delà du seul espace de l’expérience. Ce cosmopolitisme se traduit tout d’abord dans la manière d’appréhender la figure de l’étranger puisque l’étranger est celui qui est porteur d’une parcelle du sens du monde, celui dont le point de vue diffère du mien et qui incarne une possibilité autre que la mienne. Il y a donc au principe de ce cosmopolitisme, qui répond à la peur de la fin du monde, le droit pour l’étranger de ne pas être considéré comme un ennemi mais comme un autre point de vue possible sur le monde car « être au monde, c’est être d’emblée exposé à autrui ».
Conclusion
Le monde, en tant qu’il désigne autre chose qu’un ordre où chacun trouve sa place et une justification de son existence, renvoie à un horizon s’ouvrant sur l’incertitude. La modernité qui consiste dans une manière différente pour les individus de se rapporter au réel s’est toujours située par rapport à la question de la fin du monde qui s’est posée de plusieurs façons sous sa forme contemporaine. La catastrophisme contemporain entraîne une conception du temps dans laquelle l’avenir est déjà à l’œuvre dans le présent et, lorsqu’il conclut à l’urgence du sauvetage, en arrive à confondre le monde et la vie. Ce qui va à l’encontre de la conception moderne du monde qui cesse d’être une chose ou un ordre qui n’aspire qu’à sa perpétuation pour devenir un agencement du réel figurant un horizon dans lequel il est possible d’agir. Le catastrophisme repose finalement sur une méprise au sujet des expériences contemporaines de perte du monde, c’est pourquoi on ne peut considérer le concept de fin du monde comme vide de sens. Est catastrophique un agencement existentiel qui ne permet plus de déceler le possible dans le présent et aborde tout du point de la nécessité, interprétant comme une fin ce qui pourrait tout aussi bien être un commencement. Ainsi, les principales inventions de la modernité, comme l’idée de progrès, furent contemporaines de la conviction de devoir vivre après la fin du monde. Il s’agit donc désormais, plutôt que de configurer le présent à partir de la crainte de l’avenir, d’inventer de nouveaux agencements à partir desquels une action serait possible sans craindre le pire.
Commentaire
L’intérêt de l’ouvrage de Michaël Foessel réside donc dans une approche du catastrophisme et de la notion de fin du monde qui cherche à en comprendre la rationalité pour mieux en faire ressortir les limites, et montrer qu’il n’est possible de « faire monde » dans le présent qu’en réinvestissant le concept de monde pour en faire un espace de décision en vue d’un avenir à construire. Cette Critique de la raison apocalyptique nous invite à redonner sens à la notion de possible en ne nous soumettant pas à un avenir jugé comme certain et nécessaire et qui viendrait déterminer notre présent. Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’opposer au catastrophisme un optimisme excessif qui refuserait de regarder en face les risques qui nous menacent, il s’agit plutôt de penser le monde comme capacité à construire un avenir plutôt que de s’en éloigner en se soumettant à un avenir qui agirait déjà sur le présent. Penser « après la fin du monde », c’est donc réinventer le monde en réaffirmant l’indépendance du présent par rapport à un avenir qui reste à construire.
Eric Delassus.