Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, traduction inédite de l’allemand par O. Mannoni, Petite Bibliothèque Payot, 2014, lu par Jean-Jacques Sarfati.
Par Baptiste Klockenbring le 12 mai 2014, 06:00 - Psychanalyse - Lien permanent
 Sigmund Freud, Inhibition,
symptôme et angoisse, traduction inédite de l’allemand
par O. Mannoni. Petite bibliothèque Payot, 2014. Préface D.
Renauld, 229 pages.
Sigmund Freud, Inhibition,
symptôme et angoisse, traduction inédite de l’allemand
par O. Mannoni. Petite bibliothèque Payot, 2014. Préface D.
Renauld, 229 pages.
Deux textes sont présentés dans ce recueil. Ils présentent un intérêt pour celui qui cherche à mieux comprendre l’évolution de la pensée freudienne car ils ont, entre autres, le mérite de mettre en évidence la genèse de deux tournants majeurs qui s’opéreront dans la pensée du fondateur de la psychanalyse.
Deux textes sont présentés dans ce recueil.
Ils présentent un intérêt pour celui qui cherche à mieux comprendre l’évolution de la pensée freudienne car ils ont, entre autres, le mérite de mettre en évidence la genèse de deux tournants majeurs qui s’opéreront dans la pensée du fondateur de la psychanalyse.
Le premier texte, publié le 15 janvier 1895, est une œuvre de jeunesse. Il est court, clair, facile d’accès et annonce le deuxième Freud - non plus le premier qui interroge la médecine positiviste avec Bleuler et Fliess - mais qui celui qui commence à trouver sa propre voie et qui expliquera principalement, par le refoulement inconscient des pulsions, l’origine des troubles psychiques.
Dans ce premier travail, la thèse freudienne est efficace et semble ne devoir susciter aucune interrogation particulière pour le jeune chercheur qu’il est alors. Pour ce dernier, l’angoisse se manifeste par différents symptômes qu’il identifie et serait, tout comme l’hystérie, le produit d’un refoulement sexuel (p.70). Pour l’auteur qui s’annonce, lorsqu’une personne s’abstient ou que son désir sexuel n’est pas totalement assouvi, la puissance de la pulsion demeure et le système nerveux lutte continuellement à l’intérieur de l’individu assiégé par le désir refoulé, qui - épuisé par ces attaques perpétuelles qu’il ne maitrise pas - se sent ainsi oppressé et angoissé (p. 73). L’angoisse n’est donc que l’expression d’une fatigue interne, celle d’un sujet qui lutte intérieurement contre ses propres frustrations.
Pour le dire autrement : au diable Kierkegaard et ses épigones (eux-mêmes sans doute dominants dans la doxa psychiatrique de l’époque et la bonne pensée bourgeoise), l’envie d’infini non réalisée n’est pas cause de l’angoisse ! Seules les souffrances infligées aux corps sont, pour le jeune Freud, à l’origine de celle-ci.
Le second article publié dans le recueil est une œuvre de la maturité. Elle est plus longue que la précédente et bien plus dubitative que celle-ci. Elle a été publiée en 1926 lorsque Freud a 70 ans. Elle annonce le troisième Freud, celui qui, confronté à la montée du nazisme et du stalinisme, face à l’arrogance d’un certain positivisme qui commence à se développer et au succès de la psychanalyse, a une autorité reconnue dans le monde qui est le sien et commence à réinterroger la ou les religions, en réinterrogeant ce que Rolland appellera le « sentiment océanique ». Cette étude préfigure donc : L’avenir d’une illusion (1927), Le Malaise dans la civilisation (1930) et le Moise et le Monothéisme.
En 1925 lorsque ce texte est rédigé, Freud, comme le rappelle D. Renauld, semble en effet « à court de nouvelles idées » (préface p.19). Il est certes sûr de sa pensée, mais cette assurance est celle de celui qui sait mieux s’interroger et qui, de plus, a vécu des drames personnels qui le questionnent sur l’existence, et il cherche autrement, il nuance. Il s’avoue même (est-ce ici le fait d’une stratégie pédagogique, qui sait ?) :
presque honteux après un si long travail de continuer à rencontrer des difficultés dans l’appréhension des situations les plus fondamentales (p. 150)
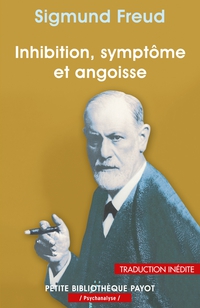 Certes, la névrose
d’angoisse fait partie de ces situations essentielles pour lui
malgré les 30 années passées, cependant une évolution s’est
opérée et l’auteur ne semble plus dans l’affirmation presque
péremptoire du texte précédent. Il s’interroge et avoue même
cette fois ne toujours pas totalement connaître ce qu’est
l’angoisse devenue « difficile à appréhender » tant
sont contradictoires certaines données qu’il a pu accumuler au
cours des recherches, analyses et lectures (p.161). La pensée s’est
donc épaissie et nuancée. L’importance scientifique de l’article
apparait selon nous, lorsque Freud, interpelé par le jeune Rank, ne
souhaite pas remettre en cause l’étiologie sexuelle de l’angoisse
mais se demande :
Certes, la névrose
d’angoisse fait partie de ces situations essentielles pour lui
malgré les 30 années passées, cependant une évolution s’est
opérée et l’auteur ne semble plus dans l’affirmation presque
péremptoire du texte précédent. Il s’interroge et avoue même
cette fois ne toujours pas totalement connaître ce qu’est
l’angoisse devenue « difficile à appréhender » tant
sont contradictoires certaines données qu’il a pu accumuler au
cours des recherches, analyses et lectures (p.161). La pensée s’est
donc épaissie et nuancée. L’importance scientifique de l’article
apparait selon nous, lorsque Freud, interpelé par le jeune Rank, ne
souhaite pas remettre en cause l’étiologie sexuelle de l’angoisse
mais se demande :
Comment mettre ce résultat en relation avec l’autre, selon lequel l’angoisse des phobies est une angoisse du moi, naît dans le moi, ne découle pas du refoulement mais suscite le contraire ? (p.124)
En d’autres termes, il se demande pourquoi « mécaniquement » ce qui était refoulé réapparaît sous d’autres formes et le plaisir perdu crée autant de déplaisir. Il cherche des causes plus profondes, des mécanismes plus cachés. Il sait qu’il a la possibilité intellectuelle de cet approfondissement et il veut aller en profondeur encore et encore.
Le fondateur de la psychanalyse reconnaît donc que la thèse du refoulement ne suffit en effet pas à expliquer totalement l’origine de ce mécanisme étrange qu’est l’angoisse. Il évoque alors l’idée d’une origine de cette névrose comme réaction face à un danger mais il ne parvient pas à identifier précisément celui-ci. C’est alors qu’en se questionnant toujours, il convoque les instances du moi et le Surmoi précédemment « inventées » et remarque que, dans l’angoisse,
Le moi qui, d’une part sait qu’il n’a pas commis de faute ne peut d’autre part s’empêcher de ressentir un sentiment de culpabilité qu’il est incapable de s’expliquer (p.138).
Qu’est ce qui fait que le moi pourtant innocent se condamne ? Qu’est ce qui fait qu’il s’angoisse ainsi de manière récurrente chez le névrosé ?
Freud ne le sait pas encore ou n’affirme encore rien de définitif sur le sujet dans ce texte mais celui-ci nous intéresse car il semble que notre auteur commence à pressentir que c’est en creusant ce « sentiment » particulier, celui que certains religieux appellent le « péché originel » qu’il trouvera de nouvelles solutions heuristiques à ses recherches. Il pressent, sans savoir encore comment, qu’il soutiendra par la suite que c’est par le truchement du sentiment de culpabilité (ainsi que celui de honte qu’il analysera peu en revanche) que toute la domination de la « mauvaise éthique » opérera.
Dans ce texte, Freud s’interroge encore mais on note qu’il pressent déjà ce qu’il écrira à la fin de ce grand livre qu’est le Malaise dans la civilisation, à savoir que la névrose n’est rien d’autre qu’une réaction au danger que constitue l’introduction subreptice et intérieure de la pulsion de mort par une instance brutale et violente qui a pris le pouvoir en nous (le Surmoi frustré). L’angoisse est ainsi à la fois une peur face à la domination de la mort que cette instance nous impose en nous privant encore et toujours, et condamnation de ladite instance pour des désirs qui demeurent malgré tout en nous malgré le refoulement. L’angoisse est donc le produit d’une peur irrationnelle suscitée par un Surmoi rendu agressif par les privations, et par le rôle que la société lui assigne par souci d’ordre et de régulation. Elle est une peine que le névrosé s’applique à lui-même et qu’il s’applique en permanence d’où sa régularité et sa constance en quelque sorte.
Certes les choses dans le texte recensé ne sont pas aussi claires mais elles commencent à se préciser en annonçant une évolution majeure. Pour le moment, Freud se contente de noter que l’angoisse demeure une réaction face à un danger qu’il ne parvient pas à identifier (p 192). Il sait bien que le refoulement demeure une tentative de fuite. Il écrit bien :
Le refoulé devient une créature à abattre, exclue de la grande organisation du moi, soumise aux seules lois qui règnent dans le domaine de l’inconscient (p. 197).
Toutefois, il ne sait ou n’ose pas encore écrire que l’angoisse est ce par quoi cette tentative de meurtre ou de liquidation s’opère. Il ne sait pas encore clairement pourquoi certains se laissent plus aisément abattre que d’autres parce qu’ils sont « plus moraux » et donc se sentent plus pécheurs que d’autres. Pour le moment, il s’interroge et en cherchant, il nous permet d’approfondir ce qu’il pourra plus aisément clarifier plus tard.
En conséquence, la lecture du recueil recensé est intéressante pour trois raisons au moins : a) d’une part peut-être parce qu’il met en évidence la différence qui peut exister entre le « jeune » chercheur et celui qui a avancé en âge et qui (lorsqu’il évolue « bien ») cherche à nuancer celui qu’il fut autrefois sans le trahir pour autant ; b) d’autre part parce qu’il nous aide à approfondir la subtilité de la pensée freudienne ; c) et enfin, parce qu’il nous montre avant tout ce qu’est un grand penseur, à savoir quelqu’un qui cherche, qui invente et qui ne se contente pas de reproduire ou de réécrire ce que d’autres (voire lui-même) ont pu écrire auparavant mais qui ne rejette rien de ce qui pourrait le faire avancer.
Le grand penseur est celui qui produit une pensée en mouvement, une pensée qui ne cesse de s’interroger librement, sans tabou, ni crainte et sans se trahir pour autant.
C’est également celui qui nous aide à avancer tout en le dépassant. La recension de cette publication est donc, pour nous, l’occasion de l’expression d’un souhait, celui du rappel de la nécessité pour les philosophes de réinvestir la pensée freudienne pour permettre son dépassement en lien avec une psychanalyse, qu’il ne faut pas combattre car celle-ci demeure encore un des seuls lieux d’expression libre dont l’amour de l’efficacité simplificatrice et triomphante contemporaine a permis, avec la philosophie plus libre encore selon nous, la sauvegarde.
Mais jusqu’à quand ?
Telle est la question qu’il convient désormais de se poser et que Freud dans ces deux textes pose, selon nous, en osant - lorsqu’il fut jeune - combattre la pensée-comme-il-faut qui créait tant de ravages et - lorsqu’il fut plus âgé - se remettre en cause afin de montrer à ceux qui croyaient que tout était simple que rien ne l’était vraiment et qu’il fallait encore et toujours inventer, innover, se dépasser et créer librement pour se retrouver.
Jean-Jacques Sarfati