Claude Debru, Au-delà des normes : la normativité, Hermann, Octobre 2015, lu par François Chomarat
Par Cyril Morana le 21 mars 2016, 05:13 - Épistémologie - Lien permanent
 Claude Debru : Au-delà des normes : la normativité (Hermann, Octobre 2015)
Claude Debru : Au-delà des normes : la normativité (Hermann, Octobre 2015)
Dans
son dernier livre, Claude Debru remet ses pas dans ceux de son maître
Canguilhem, pour explorer à nouveau toutes les facettes du concept de
normativité. Il se défend d'avoir écrit un traité, plutôt une suite
d'essais. En un sens, les différentes lignes du livre tiennent à l'objet
lui-même, et à une de ses idées-clés : « C'est l'expérience de la
"désunité", désunité sociale autant que désunité individuelle, qui
suscite l'intention et l'invention normatives » (p. 93). En effet, « le
grand arbre de la normativité humaine a certainement de nombreuses
racines » (p. 94), et la normativité elle-même – capacité humaine de
modifier ou de créer des normes – comporte quelque chose de
transgressif, y compris à l'égard de la fixité des concepts comme des
frontières disciplinaires. Cette exploration n'est donc pas non plus
dissociable d'histoires de vie, et d'un certain engagement personnel et
vital de l'auteur qui est coutumier des rencontres intellectuelles
singulières dont beaucoup de ses travaux antérieurs peuvent témoigner.
L'auteur note lui-même que l'équation « humanité = normativité » n'a cessé de prendre de l'importance depuis la seconde moitié du XXe siècle, notamment en raison de l'extension de la réflexion éthique face aux améliorations promises des capacités humaines (p. 93). Dans cet ordre d'idée, le domaine médical est l'objet d'une des parties les plus importantes du livre, parce qu'elle permet d'aborder, via la maladie, le handicap ou encore la psychiatrie, une normativité empêchée mais subsistante : « Diminuée d'un côté, la normativité renaît de l'autre avec une force accrue, même si elle s'y manifeste avec toute l'acuité du précaire. » (p. 191) On pourrait ainsi parler d'une tentative d'anthropologie critique qui n'oublie jamais que cette normativité est d'abord celle d'un vivant, mais aussi que la « créativité normative », qu'elle soit individuelle ou sociale, a besoin d'étayages variés, ce qui rend caduque une approche réductrice ou unilatérale de la normativité.
Après un premier chapitre : « Valeurs et Normativité » (p. 29-94), un second sur « Le langage et la science » (p. 95-151), on trouvera un chapitre sur le développement des idées normatives (« L'acquisition de la normativité humaine », p. 153-189) ; le chapitre qui suit explore les relations du vital au social (« Le vital et le social : la normativité en acte », p. 191-236) et le chapitre final, celles entre « la violence et l'altruisme » (p. 237-259), sur la base des explications naturalistes du comportement humain. En conclusion, Claude Debru revient sur sa question initiale, laissée curieusement en arrière-fond de son livre : « quelle idée de l'homme doit guider ou orienter l'évolution qui se déroule sous nos yeux ? » Autrement posé : comment se saisir de la diversité par des normes ? Si un élément de normativité s'introduit toujours par le biais du langage, quelle langue parler pour faire droit à cette diversité d'expériences humaines ? Il conçoit lui-même son livre comme un éloge du cosmopolitisme humain (p. 6). S'appuyant sur des textes relevant de courants intellectuels trop souvent réfractaires les uns aux autres, de la phénoménologie et de l'anthropologie philosophique à la philosophie analytique du langage en passant par la biologie des populations ou la psychologie cognitive, l'auteur les fait dialoguer et se demande : « Comment donc articuler les unes sur les autres des pensées différentes exprimées dans des langues différentes et traduisant des traditions philosophiques et des attitudes culturelles profondément différentes ? » On serait donc tenté d'y voir un éloge de la diversité des ressources normatives par lesquelles l'humanité ne cesse de se réinventer elle-même. Ce livre fait alors écho à un autre : les lecteurs du dialogue entre Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur, La nature et la règle (Odile Jacob, 1998), y verront peut-être un renouvellement des mêmes questions pour enfin aboutir à parler d'une voix. Car cette « discussion », prometteuse dans ses intentions (découvrir des transitions entre l'évolution biologique et l'affirmation éthique de soi et de la norme), apparaissait décevante dans ses résultats (Ricoeur affirme nettement, p. 241 du livre avec Changeux, que « le désir doit être mis en synergie avec le normatif », mais est-ce l'absence de langue commune entre philosophie morale et neurosciences ? Il semble qu'il y ait plutôt deux discours parallèles qui se font face jusqu'à la fin.)
Qu'est-ce que la normativité ?
En guise de première approche, l'ouvrage commence par une enquête sémantique. Debru rappelle que le terme « normatif » s'est diffusé à partir de la fin du XIXe siècle, particulièrement avec l'Éthique de Wundt en 1886 qui introduit le terme de « sciences normatives » (recoupant fondamentalement l'éthique et la logique). Le contexte est celui des discussions sur la dualité des points de vue explicatifs ou normatifs dans les sciences. Sur cette base, on pourrait se contenter de l'adjectif normatif, désignant selon une apparente neutralité tout ce qui concerne les normes ou un devoir-être. Une ambiguïté se fait jour à ce stade : est-ce la conformité à la règle qui est suggérée par là (et qui l'emporte le plus souvent comme connotation du terme dans les dictionnaires) ou est-ce la faculté de changer les normes ou de créer des normes nouvelles ? Normativité, terme moins courant, ajoute encore à la difficulté. Si, comme Debru, on commence par suivre Canguilhem sur ce terrain, la normativité serait effectivement une capacité, quelque chose comme la source du normatif. Capacité d'établir des normes, de les mettre en œuvre, de les modifier : « La vaste notion de normativité doit comprendre essentiellement la capacité de produire, ou de modifier, ou d'accepter d'acquérir des normes (ce qui apparaît dangereux pour les conservatismes de toutes espèces et de tous lieux) » (p. 97), ou encore la capacité de « reconnaître des règles de comportement autant que de les enfreindre au nom d'autres règles, normes ou valeurs » (p. 97). Mais il faut avoir à l'esprit cette précaution sur laquelle l'auteur insiste fortement : forger un substantif, normativité, à partir de l'adjectif normatif, c'est aussi prendre le risque de tomber dans l'abstraction réifiante. Finalement, est-il certain que ce « pouvoir » ou cette disposition existe, que l'existence du mot ne crée pas une unité illusoire à partir d'un faisceau de faits d'origines diverses à travers lesquels se fait sentir l'action des normes dans la vie des hommes et les transformations qui en résultent ? Cette difficulté est en quelque sorte intériorisée dans le sens même de la normativité, qui suggère toujours une forme de décrochage par rapport au simple donné.
Plus généralement, il semble que l'idée de normativité articule les éléments suivants :
Une dimension normative émerge quand une existence devient ou se rapporte à une exigence pouvant être plus ou moins bien remplie – par exemple, on considérera que la relation de représentation (x représente A) présente une dimension normative, parce qu'au lieu d'une simple relation de corrélation ou de causalité (x varie conjointement à A, ou A cause x) s'introduit la notion de correction et de déviation possible (x doit représenter correctement A, ce qui implique que l'on puisse évaluer son degré de correction qui puisse se révéler en défaut) -
Mais le terme de normativité est à prendre ici en voie active, d'où ces deux éléments supplémentaires pour distinguer le terme de normativité de la simple désignation de la norme ou du normatif comme domaine objectif d'investigation : d'une part parce qu'il renvoie non seulement à l'existence d'une norme mais à sa position (le normatif, c'est ce qui pose la norme en tant que norme – on peut ici parler de l'autorité du normatif) ; d'autre part par le fait que, pour un être rationnel, mais déjà pour un être vivant, la norme ne peut fonctionner comme telle qu'à être interne à l'individu, qui se l'est au moins appropriée s'il n'en est pas à l'initiative même. En ce sens, le sujet ne se contente jamais d'appliquer purement et simplement une norme sans la mettre à l'épreuve et se mettre à l'épreuve lui-même en tant que porteur de l'efficacité de la norme, ou en tant qu'il la questionne, la détourne, la récuse, etc.
Sans faire nécessairement de la présence d'une volonté le critère à partir duquel identifier le normatif, et sans professer non plus un dualisme métaphysique entre faits et valeurs, il semble qu'on ne puisse évacuer le sujet et son attitude par rapport à la norme, qui ne désigne jamais la seule régularité dans une conduite, auquel cas c'est la dimension normative elle-même qui serait évacuée au profit de la seule constatation des faits. La normativité serait alors le normatif réinscrit dans cette dynamique du ou des sujets, et non abstraitement considéré.
La première partie du livre revient longuement sur l'apport de Georges Canguilhem. On a le plus souvent retenu du Normal et le pathologique la conception de la normativité biologique, par laquelle Canguilhem désigne la position de valeur par le vivant, non seulement dans son milieu propre mais aussi dans son organisme. « Il n'y a point de vie sans norme de vie » (p. 155), énoncé à entendre au sens où vivre revient à instituer sa propre norme. Le vivant selon Canguilhem « invente des adaptations et des interactions avec et en fonction de son milieu » (Le Normal et le Pathologique, p. 211) Du fait que les valeurs négatives de la vie - la maladie, l'erreur-, soient intériorisées sous forme d'épreuve ou d'obstacle à repousser par le vivant, le concept de norme s'avère alors irréductible à un concept objectivement déterminable par des méthodes scientifiques.
Cependant, tout le propos de Canguilhem revient à penser l'articulation entre la science de la vie et l'activité normative de la vie, articulation opérée par cette technique qu'est la médecine, et qui permet une approche concrète du problème philosophique (trop souvent posé abstraitement) de l'articulation entre les faits et les valeurs, ou entre les régimes descriptifs et prescriptifs du langage pour employer des termes plus contemporains. À travers l'étude du normal et du pathologique, Canguilhem a posé les premiers éléments d'une philosophie concrète des valeurs, dont on trouvait déjà les premiers développements dans la première partie de son œuvre avant qu'il ne soit connu par ses travaux de philosophie de la médecine ou des sciences. Claude Debru nous donne d'ailleurs des extraits tout à fait passionnants de notes de cours sur « Les normes et le normal » de Canguilhem, en train d'élaborer en 1942-43 sa pensée de la normativité (ces notes sont conservés au CAPHÉS de l'ENS, rue d'Ulm). Mais il prolonge surtout ce travail de mise en confrontation de la pensée philosophique sur l'axiologie, avec les connaissances biologiques et neurologiques contemporaines, de telle sorte qu'une recherche sur les fondements naturels de la normativité s'esquisse également dans son livre, même si elle ne débouche pas sur une théorie unitaire.
La spécificité de l'approche de Claude Debru
Il faut garder à l'esprit que la question de la normativité est au cœur de la philosophie contemporaine. Elle est intimement liée à celle du réalisme et/ou du naturalisme en débat avec le constructivisme. Mais aussi parce qu'elle est au cœur d'un certain tournant pragmatiste (nous pensons par exemple à Robert Brandom, et à son ouvrage de 1994 : Making it explicit, mais on devrait citer également Putnam et Habermas) qui a voulu prendre la norme pour terme primitif à la place de la représentation, en théorie de l'esprit et du langage ainsi qu'en épistémologie. L'intérêt de la démarche de Debru est de permettre une confrontation entre ces différentes approches et de ne pas se limiter à ce problème de la représentation et de l'intentionnalité, même si l'on peut considérer en un premier temps que la normativité relève bien de la capacité humaine à adopter des attitudes ou à former des jugements au sujet de ce qui doit être et pas seulement de ce qui est, à se « représenter des faits qui n'existent pas » ou à « chercher à les faire exister » (p. 17).
Sur ce point, Claude Debru remet à l'honneur un courant philosophique quelque peu négligé : celui de l'Anthropologie Philosophique, particulièrement représenté en Allemagne par les œuvres de Max Scheler et d'Helmuth Plessner. Ces auteurs restent peu connus en France. Plessner n'est malheureusement pas traduit. Alors que cette approche n'occupe qu'une partie restreinte du livre (sur Scheler, voir p. 31-54 ; sur Plessner p. 54-67), il n'est pas anodin qu'elle ouvre son chapitre premier. Le travail de Debru pourrait être considéré comme un de ses prolongements singuliers et inattendus. Il nous explique que ce courant, pour éviter une « chosification » de l'homme, a substitué la question « qui est l'homme ? » à « qu'est-ce que l'homme », en lien avec la question des valeurs (p. 30). Mais, plus fondamentalement, il s'agit de partir, pour situer l'homme dans le monde, de la position de l'organisme vivant dans son milieu, de sorte que les caractères spécifiques de l'existence et de la subjectivité humaines soient identifiés à partir de cette base de la vie animale. La phénoménologie en première personne se voit fécondée par une philosophie tournée vers la vie. On pourrait parler d'une forme de phénoménologie excentrée par la biologie, une phénoménologie de l'écart humain par rapport au vital. Cette position a surtout été élaborée par Plessner, qui a proposé de concevoir l'homme comme objet et sujet de sa vie (p. 60). Selon lui, l'homme est à la fois centrée et excentrée, dans une « positionalité » originale, qui implique tout autant la possibilité d'une connaissance de son propre comportement qu'une instabilité où la vie apparaît comme une tâche toujours à recommencer : « L'apparition d'une normativité est nécessitée par la contingence introduite par l'humanité dans son devenir ouvert. » (p. 63) Ce qui n'apparaît dès lors plus très loin de la perspective de Canguilhem, qui écrivait dans l'ouverture de La connaissance de la vie : « Le conflit n'est pas entre la pensée et la vie dans l'homme, mais entre l'homme et le monde dans la conscience humaine de la vie. » On s'explique alors qu'aucune fondation prétendant à l'autonomie, qu'elle soit dans la conscience intentionnelle, ou dans le langage, ne puissent valoir par elle-même, le fait que cette conscience ou ce langage soient portés et déployés par un vivant intervenant comme un surcroît de sens qui empêche au fondement de se boucler sur lui-même : « L'anthropologie philosophique élabore une vision d'ouverture, de non-terminaison, de non-réconciliation, voire de tragique, plutôt que de fondation. » (p. 64)
Il en va bien ainsi des approches multiples de la normativité dans le livre de Debru. On s'attendrait par exemple à ce que le chapitre II intitulé « Le langage et la science » ferme le livre, avec l'exposé des théories de la normativité de Christine Korsgaard (p. 101 à 107) ou de Ralph Wedgwood (107 à 115) et des thèses sur le lien de l'intentionnel au normatif. Mais d'autres considérations sur les émotions, le soin, le handicap, le rapport à la maladie, viennent ouvrir à d'autres sources possibles de la normativité que la seule sémantique des termes normatifs ou la seule élaboration de l'autonomie morale. En ce sens, du descriptif vient toujours à nouveau se loger dans du normatif et réciproquement, en une forme de chiasme. Debru s'attarde notamment sur l'éthique du soin, et sur le dialogue soignant-soigné, dialogue par lequel s'expérimente une normativité qui est rendue possible par le croisement entre des cadres institutionnels et une parole singulière. Ce qui est soigné est alors tout autant la relation que les êtres. C'est ici que son livre, dialogue entre les « langues » philosophiques, est aussi une mise à l'épreuve de la philosophie elle-même, qui oublie plus que de raison la part de résistance ou de complication que le « réel » oppose à la raison.
On doit admettre que la thèse de Canguilhem fonctionne ici comme fil conducteur implicite : le normatif est toujours second, il n'y a pas de normatif originaire. L'exigence est toujours une rectification. Et, pour prolonger cette perspective, on pourrait aussi admettre que le normatif est toujours embarqué et soutenu, son autonomie ou son irréductibilité n'est jamais pleine et entière, comme certaines « évidences » philosophiques (la loi de Hume par exemple) pourraient nous le faire accroire.
Comme le pointe d'ailleurs Debru (page 236), l'outillage philosophique se retrouve parfois usagé, vieilli, comme ces catégories qu'il conviendrait de retravailler : « identité », « personne », « conscience ». La rationalité est toujours prise dans une situation particulière : « Il s'agit de ce que je dois faire dans une situation donnée (un mélange de motivation et de "raisonnement pratique"). Cette intuition profondément personnelle n'est pourtant pas inanalysable. Elle n'est pas irréductible. Il est toujours possible d'en dégager les motivations, d'ordre psychologique, qui ne sont pas toujours réductibles à un calcul. Cette considération doit nous protéger contre une sorte d'hyper-rationalisme ambiant. » (p. 122) Pour Claude Debru, les enjeux normatifs se jouent donc aussi dans l'émotion et dans l'affect, et non seulement dans les raisons d'agir ou de penser.
Du vital au langagier, et retour
La question normative pourrait être formulée ainsi : si les « faits normatifs » sont irréductibles à des « faits naturels », puisqu'ils correspondent à des idées à réaliser et non à des réalités observables (p. 101), comment comprendre leur force, autrement dit : « comment un certain contenu, conceptuel, propositionnel, une certaine idée peut impliquer, entraîner, et souvent mettre en œuvre une disposition à agir » ? (p. 100)
Sur cette question disputée du fait des valeurs, c'est la position de Canguilhem que Debru explicite dans un premier temps : la norme, c'est ce qui fait norme dans une situation donnée. Par exemple : le professeur de philosophie propose une dissertation à ses élèves qui est le corrigé, et qui prend alors valeur de norme par rapport aux dissertations produites par les élèves qui seront jugées par rapport à ce modèle ; mais rien ne s'opposerait à ce que, à la lumière d'un autre modèle, la dissertation du professeur soit jugée à son tour, si celui-ci doit passer un concours de recrutement par exemple. Le problème de la norme est alors posé : comment comprendre sa nécessité et sa contingence en même temps ? Car, depuis cette position, on ne peut faire de la norme un absolu indépendant des sujets qui la posent pour déployer leur pratique, ici celle de la dissertation. De la sorte, il n'y a pas de règle originelle dans l'expérience anthropologique : « la règle ne commence à être règle qu'en faisant règle » comme l'écrit Canguilhem (Le normal et le pathologique, p. 178), de sorte que – comme l'indique Debru en reprenant des extraits des notes de cours de Canguilhem de 1942-43 (texte cité par Debru, p. 75), « un objet ou un fait ne devient norme que parce qu'un sujet affirme une intention normative et prend une décision normatrice ou normalisante […] Le normal c'est ce qui est normatif dans une situation définie.» La normativité va de pair avec l'immanence des normes à une intention et à une pratique normatives, par opposition à un point de vue extrinsèque, qui verrait dans la norme une exigence s'imposant de l'extérieur aux sujets.
Cette position peut trouver quelques échos dans celle de Christine Korsgaard, dont les travaux sont abordés dans la suite du livre, aux pages 101 à 107. Elle aborde pourtant cette question par un tout autre biais. La philosophe de Harvard est connue pour son livre The sources of Normativity (Cambridge University Press, 1996). Selon elle, l'adhésion par réflexion est la source de l'autorité morale, de la force que la moralité exerce sur nous. Sa position est dite internaliste, la raison est ici normative au sens où elle est en même temps motivante pour le sujet lui-même. Mais Christine Korsgaard s'appuie moins sur la normativité biologique que sur le rôle du langage dans l'élaboration et la justification par le sujet de ses raisons d'agir. Il lui faut tenir deux thèses à la fois : le sujet formule lui-même ses raisons mais il n'y a pas de langage privé . En tant que normative, la signification est toujours déjà relationnelle. D'inspiration kantienne, il s'agit d'un internalisme qui inscrit ainsi l'universel dans la subjectivité : « C'est l'humanité elle-même qui s'inscrit dans le monde privé […] En attribuant de la valeur à notre propre humanité, nous attribuons de la valeur à l'humanité en général. » (Debru explicitant les thèses de Korsgaard, p. 106)
Les positions de Ralph Wedgwood, auteur de The nature of normativity (Oxford University Press, 2007) sont également examinées. Selon la « sémantique des rôles conceptuels » par laquelle il aborde la spécificité des termes normatifs, tout jugement normatif, tel que « je dois effectuer telle action » implique une règle conceptuelle, un engagement dont on peut évaluer la rationalité. Affirmer : « je dois effectuer telle action », c'est cherche également à l'effectuer, s'engager à la réalisation de l'action planifiée. De telle sorte que « les agents rationnels passent nécessairement du jugement normatif à l'intention ou disposition à agir » (p. 113) Ce qui n'est pas le cas pour un jugement non normatif, du type : « mon action plairait à un tel... » On peut alors parler d'une irréductibilité seulement relative du normatif : les jugements normatifs résultent d'une forme d'intuition a priori d'une espèce particulière, qui repose sur l'enchaînement de l'idée à l'action, mais une explication non circulaire en est possible, par l'examen de la sémantique des termes normatifs et de la logique qui peut être construite sur cette base. En ce sens, sans faire partie des faits naturels, la référence d'un terme normatif est néanmoins garantie par le fait qu'il renvoie à l'usage de la même règle conceptuelle pour deux locuteurs, alors même qu'ils ne partageraient pas les mêmes intuitions morales.
On serait tenter de faire appel à une forme d'intuition supérieure pour rendre compte de notre compréhension des termes ou jugements normatifs. Wedgwood se réfère lui-même à la République de Platon, et Debru résume ainsi son propos : « Telle est, selon Wedgwood, la sensibilité au monde normatif qui est nécessaire et éternelle et qui anime l'intelligence. » (p. 120) Néanmoins, il s'agit d'une rationalité en contexte, d'une intuition singulière et personnelle.
À travers ces différentes approches, une voie moyenne se cherche, pour éviter les deux écueils du non-cognitivisme radical (un jugement normatif exprime l'émotion et l'approbation du locuteur) et du réalisme dogmatique (un jugement normatif correspond ou non à la réalité spécifique d'un devoir-être).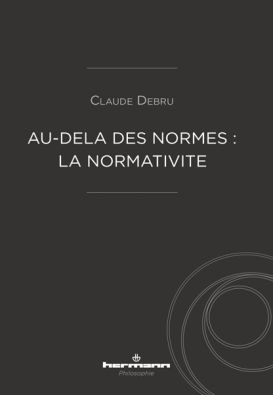
On peut, sur ce point, s'interroger : Canguilhem lui-même n'hésitait-il pas entre deux positions, celle qui verrait la norme dépendre essentiellement d'un sujet qui la pose (au risque de quelque arbitraire), et celle qui la verrait dépendre de la situation plus englobante à laquelle le sujet est aux prises ? On constate que le texte du Normal et le Pathologique utilise tantôt le terme d'invention, tantôt celui d'institution. Ne peut-on pas admettre que les normes s'établissent plutôt qu'elles ne s'inventent ? Dans ce cas-là, c'est d'une dialectique du sujet et de la situation qu'il est question, ou pour reprendre un vocabulaire plus proche de celui de Canguilhem : d'un débat du sujet avec son milieu, débat qui produit de la norme. Si l'on transpose à la problématique morale et langagière de Korsgaard, on peut supposer que ce qu'elle exprime en termes d'identité personnelle et d'intégrité pourrait très bien être reformulé en terme d'épreuve vitale à affronter, si tant est que cette épreuve puisse être mise en mots et partagée intersubjectivement.
Les chapitres qui suivent, tirant partie des éclairages de la médecine, de la psychiatrie et des sciences neurologiques, vont plutôt chercher la normativité du côté d'une propriété dite de « haut niveau » (au même titre que la planification de l'action ou a reconnaissance d'objet par exemple), une sorte de supervision (p. 203) : la capacité, pour l'individu, de « construire son propre devenir ou, tout au moins, d'en conserver un certain contrôle » (p. 201), voire même : « le pouvoir de créer un nouvel environnement dans une activité "propulsive" » (Idem), cette dernière expression étant empruntée aux travaux sur le temps vécu du psychiatre-phénoménologue Eugène Minkowski. L'intégrité du sujet est alors entée sur une activité auto-normative capable de donner une allure – ou des allures – à la vie, à entendre autant comme un style que comme un rythme, en secouant l'inertie de la seule identité-idem (« allure de la vie » est une expression qu'utilisait Canguilhem, qui l'empruntait peut-être à Georges Bénézé, philosophe des valeurs et auteur de L'allure du transcendantal en 1936.)
Sur ce dernier point, et en guise de confrontation polémique, on peut repenser à ce que Pierre Macherey écrivait sur Michel Foucault (« pour une histoire naturelle des normes », dans Michel Foucault philosophe, p. 218 – Debru consacre d'ailleurs des pages finalement assez critiques à Foucault, p. 203-214) : « Élaborer des normes de savoir, c’est-à-dire former des concepts, en rapport avec des normes de pouvoir, c’est s’engager dans un processus qui engendre lui-même, au fur et à mesure qu’il se déroule, les conditions qui l’avèrent et le rendent efficace : la nécessité de cette élaboration ne se rapporte à rien d’autre qu’à ce que, déjà, Pascal appelait d’une formule stupéfiante la ‘force de la vie’... » Or, précisément, cette supposée force de la vie peut-elle quelque chose par elle-même ? N'est-elle pas reprise par et dans les forces du langage ? Le livre de Debru contient sur ce point un passage particulièrement intéressant concernant le travail de Nadine Le Forestier, praticien hospitalier à l'hôpital de La Salpêtrière, spécialiste de la « maladie de Charcot » (voir pages 228-236). Elle s'occupe depuis longtemps de cette maladie neurodégénérative motrice dure, incurable, la sclérose latérale amyotrophique (dénommée maladie de Charcot en France) qui se termine inexorablement par la mort par étouffement. Dans de telles conditions, comment aborder l'annonce à la personne malade ? Peut-on améliorer cette « situation existentielle philosophique vécue dans l'annonce » ? Sur quoi faire fond ? Comment dire au mieux ?
Les philosophèmes plus ou moins vitalistes de la « force de la vie » sont alors confrontés à un partage de la précarité. Entre le médecin, le patient et le proche, il faut bien admettre que « tous sont vulnérables » (p. 234). Comme le rappelle Claude Debru : « Il n'y a pas de vraie maîtrise, car il n'y a pas de maîtrise du temps, pas de maîtrise du déroulement d'un processus. Il n'y a qu'une vulnérabilité partagée et reconnue. » (p. 234) Une structuration philosophique triangulaire se met en place entre les protagonistes. L'éthique joue alors un rôle, pour étayer une normativité excentrée, qui n'est plus dans l'évidence d'un vouloir-vivre ou d'un élan vital propulsif. C'est alors la question d'une vie humaine que pose la normativité, vie singulière qui doit s'inventer elle-même et en même temps être consolidée par ses relations et les cadres institués.
Le langage, les émotions, le social : les sources multiples de la normativité
Le chapitre III porte tout entier sur l'acquisition de la normativité, en revenant notamment sur les travaux de Piaget (la formation du jugement moral chez l'enfant, l'importance de la phase des jeux de groupe avec leurs règles conventionnelles) ; en évoquant également les observations et les thèses de Michael Tomasello (voir Aux origines de la cognition humaine, Retz, 2004). À travers ces études de psychologie du développement, on voit comment la pensée morale réflexive est liée aux questions touchant les croyances ou désirs d'autrui (p. 171), la normativité passant par l' « appropriation-internalisation de la perspective, de l'idée et de la pratique de l'autre » (p. 172). La fin du chapitre III porte sur « émotions, valeurs, normativité » (p. 175-189). S'appuyant sur le livre de Pierre Livet, Émotions et rationalité morale (PUF, 2002), Debru fait rentrer les émotions dans le jeu de la normativité. On peut penser qu'elles jouent un rôle-clé dans la révision de nos préférences au contact de l'expérience. Pierre Livet suppose que nous appréhendons les valeurs par des « coups de sonde » qui sont nos essais de jugements de valeur, « coups de sonde ou ondes de choc qui déclenchent ces échos radar que sont les émotions. » (p. 177) Cette approche fait écho à l'idée d'une saisie axiologique ou perception affective des valeurs, conçue par Max Scheler, dont nous parlions plus haut, comme une attitude émotionnelle (p. 36). La phénoménologie converge ainsi avec certains développements des neurosciences sur les émotions. Pierre Buser, Joseph LeDoux ou Antonio Damasio, dans ce champ de la neuropsychologie, permettent de soutenir la thèse de l'existence d'un inconscient émotionnel, distinct de l'inconscient cognitif, mais qui joue un rôle dans l'ensemble des processus d'évaluation que nous mettons en œuvre.
Sans aller jusqu'à affirmer que les émotions soient une véritable perception des valeurs, Livet – repris ici par Debru – en fait le « révélateur des valeurs » : elles nous donnent la motivation de réduire le différentiel de la réalité avec nos désirs (p. 188).
Le chapitre suivant porte précisément sur le vital et le social, ou la « normativité en acte », à partir de certains problèmes auxquelles se confronte la psychiatrie, notamment celui des schizophrénies qui peuvent nous enseigner comment la normativité subsiste et à quel prix, dans des pathologies lourdes.
Il s'agit selon nous du chapitre-clé, dans la mesure où interviennent, à partir des questions du handicap et notamment des maladies neurodégénératives, des réflexions sur la manière dont la normativité du vivant individuel peut être étayée par une normativité sociale ou du moins inter-individuelle : « La situation de handicap permet d'observer l'intrication de plusieurs sources de normativité, individuelles et sociales, dans l'aménagement de l'espace de vie de l'handicapé. » (p. 220) Ce qui aboutit à concevoir une forme de normativité stratifiée, problème au cœur du livre tout entier. En effet, à travers le lien entre normativité et intentionnalité, et la question du langage (voir ci-dessus), était notamment posée la question de la référence individuelle : l'autonomie, renvoyant à des raisons, n'est-elle pas déjà une relation normée aux autres, inscrite dans le caractère public du langage et la normativité des significations ? Quelle part le sujet lui-même peut-il revendiquer dans la position de cette norme linguistique intériorisée dans le discours intérieur ?
Dans ce chapitre, Debru aborde ces questions par un autre aperçu, si l'on veut plus affectif et/ou émotionnel. Il s'appuie ici notamment sur les textes du philosophe Philippe Barrier : détecté diabétique à l'âge de 16 ans, sa maladie est devenue l'objet de son travail philosophique, dans une méditation sur le soin que l'on peut se porter à soi-même pour être libre. Une distinction ferme est posée ici entre action normative et normalisation : le soin relève de la première, en tant notamment que le soin est conçu comme un « transfert d'humanité » (p. 217). Il s'agit de faire de la norme un projet plutôt qu'une règle fixe à appliquer. Là encore, on retrouve le thème central d'une normativité intrinsèque opposée à une normalisation extrinsèque, à la frontière de la subjectivité. Ce dualisme est-il suffisant pour penser ce qui est en jeu ici ? Debru énonce une limite : « Notons tout de même que, aussi essentielle que soit l'auto-normativité de l'individu, elle a besoin d'étayages variés, dont, dans le cas précis, la psychanalyse. » (p. 216) C'est bien à une position intermédiaire qu'il faut semble-t-il se ranger : « régulateurs externes et internes doivent collaborer dans la créativité normative » (p. 216)
La question du naturalisme
Qu'en est-il de la formation des idées normatives ? Peut-on expliquer la normativité, c'est-à-dire en rendre compte dans les termes des sciences de la nature ?
On peut se demander si un des buts de Debru dans ce livre, n'est pas de contourner le problème de la naturalisation des normes, par une stratégie quelque peu « bergsonienne » d'encerclement par de multiples lignes de faits. Car, dans le chapitre II, « le langage et la science », la question restait ouverte, de savoir si le normativisme de la signification et du contenu avait ou non pour conséquence l'exclusion de toute approche naturaliste de la normativité.
Une des solutions proposées par les philosophes au problème du surgissement du normatif, consiste souvent à faire fond sur une structure qui posséderait une intentionnalité intrinsèque. Ce qui tient parfois ce rôle ici, n'est-ce pas le vivant en débat avec son milieu ? On retrouvait déjà cette solution chez Canguilhem : c'était d'ailleurs ce qui le conduisait à employer ce terme de normativité, puisqu'en un sens, tout vivant avait en tant que tel résolu le problème de son adaptation, mais uniquement sous forme de tâche à recommencer, c'est-à-dire sans pouvoir supprimer le problème (on se souvient d'ailleurs que Canguilhem faisait sienne cette phrase de Brunschvicg : « la philosophie est la science des problèmes résolus », au sens où elle vit des problèmes qui ne sont pour elle jamais annulés une fois pour toutes.) On peut d'ailleurs admettre que le vouloir-vivre est déjà proto-normatif, et qu'en ses modalités conscientes il consiste à s'engager envers sa propre vie.
Dans ce chapitre V et dernier, il est surtout question de la violence et de l'altruisme, questions qui finissent par être abordées dans le cadre de la biologie évolutive.
On sait que – dans ce cadre – le problème de la « sélection de groupe » pour expliquer les comportements altruistes a fait couler beaucoup d'encre. Elle a pris le relais de l'idée de Darwin d'une sélection des instincts sociaux, exposée dans la Filiation de l'homme. La théorie Darwinienne repose sur la reproduction différentielle des individus. La question est de savoir comment sont néanmoins sélectionnés les comportements qui semblent bénéficier au groupe plutôt qu'à l'individu lui-même. Les tenants de la sélection de groupe font appel à un mécanisme conçu sur le modèle de la sélection naturelle, mais fonctionnant au-delà de la seule parentèle, et favorisant un avantage adaptatif collectif. Il faudrait citer notamment l'ouvrage très discuté de Elliott Sober et David Sloan Wilson : Unto Others. The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior (Harvard University Press, 1998). Sur l'ensemble de ces questions, et sur une explication naturaliste des comportements moraux, on peut aussi consulter en ligne la thèse de Christine Clavien, « l'éthique évolutionniste, de l'altruisme biologique à la morale. » (Université de Neuchâtel/Université de Paris I, 11 janvier 2008) qui permet de compléter notre information sur certaines des questions-clés disputées dans ce chapitre.
Le débat reste ouvert. Rappelons qu'un des termes du débat est la critique de l'extrapolation qui est souvent faite par les uns, d'une explication en termes évolutionnistes des comportements biologiquement altruistes (le comportement d'un organisme favorise la fitness d'un autre organisme) à une explication de l' « altruisme psychologique » ou des sentiments moraux altruistes des êtres humains. Un autre problème est que la définition de ce qui est avantageux au groupe semble dépendre du point de vue de l'observateur, et ne peut donc être tenu pour un mécanisme intrinsèque.
À quel niveau peut-on parler de normativité ? Ne faut-il pas faire appel implicitement à des mécanismes cognitifs pour caractériser l'altruisme, « mécanismes » qui n'en sont pas réellement car ils seraient déjà empreint de normativité. C'est donc bien, là encore, le passage du descriptif au normatif qui est problématique. Debru semble se tenir au critère de la pertinence des niveaux d'explication : d'évidence, il apparaît illusoire d'expliquer le fonctionnement des sociétés humaines par la mécanique quantique. Selon un principe analogue : « l'explication évolutionniste, qui ne saurait guère être contestée dans son principe, ne doit pas être considérée isolément. » (p. 255)
Debru explore néanmoins certaines voies possibles. Notamment : celle qui fait appel à la double composante, génétique et épigénétique, des phénomènes comportementaux (p. 248) Pour le développement cérébral, le rôle des gènes est important. Le rôle de l'environnement à certaines étapes-clés l'est tout autant. Finalement, « que le cerveau humain soit éducable implique qu'il soit sensible à des influences "normatives" ou "normantes". La "normativité" humaine passe nécessairement par lui. (p. 248)
Quel bilan tirer de ces questions ?
Un des aboutissements de tout ce chapitre, qui porte à la fois sur les explications naturalistes de l'agression et de l'altruisme, et sur la violence dans les sociétés contemporaines, est qu'il s'agit de restaurer la force des règles, énoncé dans lequel il faut sans doute voir un projet normatif. Cela nous incite à penser qu'une naturalisation complète des normes reste impossible, du fait qu'une certaine rectification de la norme reste nécessaire. La nature ne fait la normativité qu'à moitié. Cette « restauration » de la règle peut malheureusement s'entendre en bien des manières. Ce qui est clairement affirmé, c'est que – selon Debru - seule la règle peut s'opposer à l'individualisme contemporain, terreau de la violence. Dans la perspective de l'auteur, il faut voir dans la règle une orientation de la vie sociale qui prend le parti de la coopération. En cohérence avec l'ensemble de son propos, l'auteur ne nous invite sans doute pas à interpréter cette restauration en un sens autoritariste, comme si elle devait s'appliquer du dehors à des individus hétéronomes. Il s'agit donc bien de restaurer le sens de la règle dans l'individu contemporain lui-même. Comment s'y prendre ? En repensant aux pages sur Canguilhem, à la normativité biologique, et aux problématiques médicales abordées, on se prend à penser à une forme de médecine sociale, mais on sait à quel point cette idée est dangereuse. Il n'y a pas de natura medicatrix sociale sur laquelle s'appuyer, et la société n'est pas un organisme. Ne retrouverait-on pas, in fine, mais sous une forme inchoative, l'idée d'une normativité décentrée, forme à mettre en évidence qui livrerait la clé de la « santé » intersubjective à l'œuvre dans une société qui se doit de rester ouverte et relationnelle ?
Bilan :
La notion de normativité est d'apparence complexe. Il semble qu'elle gagne à être analysée selon des voies divergentes, les unes conduisant à une éthique du soin, les autres à une analyse du langage prescriptif. Néanmoins, et dans la postérité des travaux de Canguilhem, la réflexion menée dans cet ouvrage se tient toujours sur la ligne de recoupement de deux traits principaux du concept : d'une part, dans la relation toujours rappelée de toute norme à l'activité normative qui la pose ; d'autre part, dans la recherche d'une voie moyenne, entre une normativité pure constituant un domaine autonome irréductible à toute positivité, et un naturalisme allant jusqu'à nier la spécificité du normatif.
La question est alors : une compatibilité est-elle concevable entre ces différentes thèses sur la normativité ? En creux et sur un mode plus historique, se repose la question de la cohérence interne de la pensée de Canguilhem, où un certain « normativisme » trouvant ses origines dans la philosophie française et allemande des valeurs (un certain néo-Kantisme, l'influence de Lagneau via Alain, mais aussi de Le Senne ou de Dupréel – des influences que l'on cerne mieux aujourd'hui grâce au travail de Xavier Roth : Georges Canguilhem et l'unité de l'expérience. Juge et agir. 1926-1939, Vrin, 2013) – a croisé Spinoza, Nietzsche, et les penseurs de la vitalité, puis s'est transmué en philosophie de la biologie. La pensée axiologique du vivant de Canguilhem s'expliquerait-elle avant tout par l'identification du troisième terme, l'exigence vitale, entre le fait physique et la norme rationnelle, pour continuer à maintenir une spécificité du domaine des valeurs sans renoncer à toute explication naturelle ? Par ses prolongements s'appuyant sur les savoirs actuellement disponibles, Debru en souligne peut-être en même temps la fécondité et les limites.
Peut-on identifier une thèse centrale autour de laquelle s'articulerait l'ensemble du livre ?
Nous en proposons trois :
1.Il n'y a de normativité qu'au sein d'un monde partagé. C'est donc prioritairement le langage qui introduit dans le vécu un élément de normativité (page 264), mais pas seulement : d'autres éléments participent de la constitution de ce Mitwelt nécessaire, notamment la communication des émotions ou les intentions partagées dont nous fait part la psychologie cognitive contemporaine.
Voir notamment cet énoncé, page 266 : « Ce qui est normatif, c'est une certaine qualité de la relation entre les êtres humains», que nous serions tentés de relier à l'éthique du soin, ainsi qu'à l'intention de sortir d'une façon ou d'une autre de la philosophie du sujet centré sur soi.
2.Pour étayer cette première thèse, il faut penser aussi aux pages que Claude Debru consacre à l'anthropologie philosophique d'Helmuth Plessner, et à ses thèses sur la « position excentrée » de l'homme par rapport à son milieu, une option que Debru envisage en confrontation avec une normativité auto-centrée qu'il récuse : « la normativité égocentrée n'est pas une solution, c'est bien plutôt un problème, dont toutes les relations humaines pâtissent manifestement. » (p. 27)
Cette seconde thèse, l'affirmation d'une normativité excentrée, thèse plutôt suggérée que pleinement développée dans cet ouvrage, figure sans aucun doute comme une de ses plus intéressantes propositions.
3.Si le normatif est irréductible au descriptif, on ne saurait néanmoins rendre raison du normatif sans faire appel au descriptif. On pourrait ici paraphraser Hume en affirmant : l'espèce humaine est une espèce normative. En ce sens, Claude Debru nous semble opter pour un naturalisme modéré, cherchant dans les travaux des sciences naturelles non pas tant une réduction des normes aux faits qu'un étayage de la normativité sur des structures naturelles dégagées par les sciences objectivantes. Par exemple, il note que l'analyse des sources de la force normative par le biais des émotions « permet de "naturaliser" et surtout d'humaniser notre compréhension de la normativité », comme s'il y avait ici une équivalence implicite naturalisation = humanisation (p. 188), mais sans que l'on puisse déceler explicitement en quel sens l'entendre.
L'ouvrage se conclut sur une dernière proposition, esquissée entre les lignes : les formes classiques d'organisation sociale ne remplissent peut-être plus leur rôle normatif aujourd'hui, à savoir qu'elles étouffent plutôt qu'elles n'engendrent des initiatives individuelles et collectives porteuses de normes nouvelles de vie. De nouvelles formes de normativité globale sont donc à inventer, et gageons que ce livre, jalon d'une méditation plutôt que traité définitif, puisse participer à sa façon singulière de ce mouvement d'émergence et d'ouverture.
On aimerait alors reprendre ce propos de Anne-Lyse Chabert, cité par Debru (p. 228), et qui traduit bien selon nous l'esprit de ce livre qui donne à penser : « L'homme ne meurt pas de ses manques ou des défauts qu'il projette sur sa vie ; il meurt de ne plus se créer quotidiennement, faute de force, faute d'espace. Il meurt ne pas s'épanouir dans ses projets. » (extrait de : Transformer le handicap, ou l'invention d'un usage détourné du monde. Essai de cheminement conceptuel à partir d'expériences de vie, Doctorat Université Paris-Diderot, 15 Déc. 2014)
Lectures complémentaires :
Sous la direction d'Arnaud François et de Frédéric Worms, Le moment du vivant, PUF, janvier 2016, avec notamment dans la partie I, un texte de Giuseppe Bianco : « Vie de douleur : contradiction et effort chez Georges Canguilhem. »
Sur le paradigme de l'Anthropologie Philosophique, on trouve des indications précises dans l'article de Joachim Fischer : « Exploring the core identity of Philosophical Anthropology through the Works of Max Scheler, Helmuth Plessner, and Arnold Gehlen », Iris, 1 avril 2009, p. 153-170, Firenze University Press.
Le dernier numéro de la revue Alter, numéro 23/Novembre 2015 : « Anthropologies philosophiques »
Plus généralement, sur les normes :
Pierre Livet, Les Normes, Paris : Armand Colin, 2006
Guillaume Le Blanc, Canguilhem et les normes, Paris : PUF, « Philosophies », 1998
Pierre Macherey, De Canguilhem à Foucault, la force des normes, Paris : La Fabrique, 2009
On peut aussi se reporter, sur Internet, aux travaux du GRIN, groupe de recherche sur la normativité à l'Université de Montréal :
http://grin.normativity.ca/
François Chomarat