Patricia Paperman, Care et sentiments, PUF, 2013, lu par Paul Jacqmarcq
Par Cyril Morana le 16 décembre 2013, 06:00 - Éthique - Lien permanent
 Patricia Paperman, Care et sentiments, PUF, 2013
Patricia Paperman, Care et sentiments, PUF, 2013
Care et Sentiments est un livre d’une soixantaine de pages écrit par Patricia Paperman, professeur de sociologie au département de science politique à Paris 8. Son propos principal consiste à dégager un espace pour l’étude de l’éthique du care en dehors d’un cadre sociologique et philosophique classique. Elle désire ainsi fonder une méthodologie spécifique lui permettant de décrire la particularité de la dimension morale du care.
Sommaire de l’ouvrage :
1. Convergences : connaissances de l’intérieur
Malentendus ordinaires
2.Dichotomies et déplacements : ce que nous apprennent les sentiments
Des sentiments hors du commun
Les sentiments remis à leur place
3.Travail du care, travail de la connaissance
Le
care comme connaissance et comme critique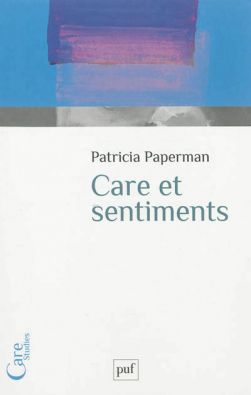
1.Patricia Paperman commence en se référant à une oeuvre de Dorothy E. Smith, The Conceptual Practices of Power, dans laquelle elle distingue deux formes de connaissances utilisées en sociologie - l’une, dominante, qui définit les formes objectivées de la connaissance,
- et l’autre, minoritaire, qui rend compte des conditions concrètes, particulières et locales du monde social, ce que Paperman nomme une connaissance « de l’intérieur ».
Or ces deux modes de connaissances sont inconciliables. Le propos général du livre consiste donc à réfléchir sur les méthodes de la connaissance en sciences sociales, plus précisément « sur le rapport à la connaissance qu’implique l’éthique du care » (p.10).
A partir de là, tout l’ouvrage de Paperman nous invite à entrer en résistance contre la sociologie dominante qu’elle définit comme « patriarcale » afin d’élaborer une sociologie d’inspiration féministe à même de pouvoir décrire l’éthique du care.
Paperman montre dans une première partie comment la conception classique de la morale incarnée notamment par son acception kantienne ne laisse aucun moyen pour rendre compte de la dimension morale du care. Il faut donc sortir du cadre classique pour montrer l’existence de points de vue moraux « ordinaires », c’est-à-dire « 1) au sens où ils émergent de la vie de tous les jours ; 2) au sens où ils ne sont pas inclus dans les conceptions majoritaires – autorisées, dominantes – de la morale » (p.13).
Pour montrer cela, Paperman se réfère aux études morales de Gilligan qui critique la théorie de Kohlberg. D’après cette théorie qui se fonde sur une conception kantienne de la moralité, les filles sont jugées déficientes par rapport aux garçons. Pour pouvoir rendre compte de la dimension morale des femmes, et plus généralement de l’éthique du care, il faudrait donc sortir de l’éthique de la justice et définir la moralité dans une autre perspective. Car autant les concepts généraux et abstraits de droits, d’obligations et de règles organisent la perspective de la justice, autant l’éthique du care se fonde sur le concept particulier et concret de responsabilité. Or, les acteurs du care, pour exprimer la dimension morale de leurs activités, vont utiliser un vocabulaire affectif lié à des expériences toujours particulières. Nous sommes donc face à une difficulté d’après Paperman : comment faire de la sensibilité un outil de connaissance et de compréhension morale alors qu’elle risque toujours d’être jugée « immature ou peu aboutie » (p.18) ?
2. Dans une deuxième partie, Paperman centre son analyse sur la difficulté de la part de la sociologie à reconnaître la légitimité des émotions et des sentiments dans la construction du monde social. Ce qui amène du même coup à rejeter certains acteurs dans l’analyse du monde social : les femmes, les enfants, les pauvres, les handicapés au nom de leur prétendue nature émotionnelle. Après avoir expliqué les causes de cette disqualification en se fondant sur la distinction classique (Durkheim, Mauss) entre sentiments collectifs et individuels, Paperman cherche a contrario à réhabiliter la sensibilité individuelle et privée en montrant qu’elle est socialement constituée et de ce fait socialement intelligible. Mais alors comment analyser sociologiquement cette vie intérieure, essentielle en ce qui concerne l’étude du care ?
Pour cela, il faut en premier lieu se détacher des schèmes dominants de la pensée sociologique et philosophique qui reposent sur des dichotomies telles que sentiment/raison, subjectif/objectif, passif/actif, individuel/collectif, féminin/masculin... afin de « remettre les sentiments à leur place : dans le registre de l’activité pratique » (p.35). Paperman en vient à définir en trois points la particularité de l’analyse novatrice des sentiments qu’elle propose : 1) ne pas analyser les sentiments de manière générale mais seulement ceux qui donnent une dimension morale aux relations (amour, attention, compassion, respect, souci...) ; 2) ne pas considérer les sentiments comme des motifs irrationnels d’une action rationnelle mais comme un élément qui permet d’éclairer des choix face à des situations particulières ; 3) considérer les sentiments comme expressions de points de vue moraux « ordinaires » (cf. plus haut) les rendant ainsi sensés et compréhensibles.
Il découle de cette nouvelle analyse une autre conception de la morale et de la justice pour laquelle l’impartialité n’est plus un impératif : « Ce sont plutôt les engagements pratiques envers des personnes particulières qui en composent le socle. » (p.37) Ce faisant, Paperman s’inscrit d’après elle dans une perspective féministe qui consiste à une réévaluation du domaine des relations informelles pour concevoir la morale : non seulement le sentiment et la relation particulière entre deux personnes qui étaient écartés par la tradition kantienne de la définition de la moralité sont réhabilités, mais du même coup les femmes sortent de leur soit-disant incapacité morale due à leur place et à leur affaire considérées comme privées. Ainsi la perspective du care intègre cette dimension épistémique et morale des émotions.
3. Dans une dernière partie, Paperman tire partie de son analyse pour nourrir sa réflexion sur la connaissance du care, sujet principal de sa recherche. A partir d’une analyse des raisons de l’intérêt qu’on a commencé à porter au care dans les années 1980, puis en s’appuyant à nouveau sur l’importance de l’étude de l’engagement dans le care, Paperman cherche à définir une connaissance qui pourrait produire « une objectivation de l’organisation sociale du care » (p.51). Pour cela, « une position de surplomb » par rapport aux relations personnelles composant le monde social est à proscrire. Au contraire, le sociologue doit se plonger dans ces relations pour comprendre ce qu’elles produisent comme formes de vie humaine.
Concernant cette approche méthodologique, après avoir rejeté tout rapprochement avec la proposition de la sociologie pragmatique développée par Boltanski et Thévenot, Paperman insiste sur la nécessité de l’abandon d’une posture monologique de l’observateur qui pourrait accéder à la vérité du phénomène. Au contraire, il s’agirait de mettre à jour la réalité complexe et parfois conflictuelle des relations des sujets en proposant une méthode d’analyse (ou d’enquête) collaborative ou dialogique.
Et Paperman de conclure que « Le défi qu’adresse le care aux sciences sociales est d’abord épistémologique. » (p.54) Il s’agit, en effet de concevoir le travail de recherche de façon radicale-ment différente « de ce que préconise la conception mainstream de la connaissance qui prévaut en sociologie » (p.57) en s’inspirant de l’épistémologie du point de vue : « une manière de produire des connaissances qui intègrent des protagonistes qui en seraient normalement absents, qui élargit son public, lui rend des comptes et revendique son caractère politique. » (p.58)
Cet essai de Patricia Paperman me semble prioritairement adressé aux sociologues soucieux de comprendre la spécificité du care, en indiquant les pistes épistémologiques d’une méthodologie particulière s’inspirant des courants féministes.
D’un point de vue philosophique, toute sa critique de la définition de la morale kantienne n’est pas sans intérêt, notamment lorsqu’elle développe le modèle de développement moral proposé par Kohlberg. L’exemple qu’elle tire d’Une voix différente de Gilligan s’intitulant « le dilemme de Heinz » (Heinz n’a pas d’argent, sa femme est malade, Heinz devrait-il voler le médicament au pharmacien qui refuse de le lui donner ?) montre à quel point la prétendue dimension morale d’une décision dépend de la définition préalable de cette morale, ce qui, dans ce cas, pousse Kohlberg à conclure que les réponses des filles à cette alternative sont « déficientes » d’un point de vue moral.
Dans une perspective pédagogique, ce dilemme de Heinz pourrait ainsi permettre de montrer une des limites de la définition kantienne de la morale tout en initiant une réflexion sur le care.
Paul Jacqmarcq