Vincent Descombes, Les Embarras de l’identité, Paris (Gallimard, nrf Essais), 2013, lu par Miguel Karn
Par Cyril Morana le 12 décembre 2013, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
 Vincent Descombes, Les Embarras de l’identité, Paris (Gallimard, NRF Essais), 2013, lu par Miguel Karn
Vincent Descombes, Les Embarras de l’identité, Paris (Gallimard, NRF Essais), 2013, lu par Miguel Karn
L’ouvrage progresse en quatre chapitres. Les deux premiers fixent les règles linguistiques et logiques préalables à l’usage correct mais nécessaire du vocabulaire de l’identité. Le troisième interroge la réalité de l’identité au sens subjectif. Le quatrième enfin examine les problèmes que posent les identités collectives.
Vincent DESCOMBES relate comment il a saisi la richesse de l’emploi actuel du terme « identité » et ses écarts avec le sens académique, en lisant un guide de tourisme vantant le quartier San Lorenzo comme « un des quartiers populaires de Rome ayant le mieux conservé son identité » (p. 13). Qu’est-ce que cette qualité originale et distinctive, que l’on peut garder ou perdre, qui peut qualifier le caractère (objectif) d’un quartier mais aussi l’attachement (subjectif et affectif) de ses habitants ? Comment ce qui désigne le fait (ou le jugement) qu’il n’y a qu’un seul et même être, en vient à désigner pour une « chose » individuelle ou collective (de manière problématique) la vertu d’être elle-même ?
Le Chapitre Premier (« Apprendre à parler l’idiome identitaire ») présente les articulations de la notion d’identité. Il distingue l’identité au sens logique élémentaire de l’identique ; puis au sens de la psychologie morale (l’identité : parler de la même personne) et sociale (l’identitaire : parler d’un même groupe, auquel on s’identifie).
On découvre rapidement « une énigme lexicale », puis une série de difficultés propres à l’acte de « déclarer son identité », dans le paradigme premier de la présentation de soi selon la double question : « Qui suis-je ? » et « Qui sommes-nous ? ». Car, manifestement, le sens élémentaire de l‘identité (au sens de l’identique entre choses qui sont pareilles) ne peut rendre compte du registre récent des identités, de l’usage moral et psycho-social. Comment passe-t-on de l’un à l’autre ?
Le « langage de l’identitaire » s’est imposé lorsque, aux États-Unis, les sciences sociales y ont étudié les rapports très spécifiques entre individus et société (enquêtes de l’historien Philip Gleason sur l’ « American identity ») ; puis la crise générationnelle (travaux du psychanalyste Erik Erikson sur le stade de la crise de l’adolescence comme celui de la formation de l’identité).
En sorte que les sciences sociales ont fini par prendre le mot identité en deux sens opposés : - l’exercice d’un rôle ou d’un personnage (cf la persona latine) que, selon l’interactionnisme, l’individu doit savoir jouer comme tel et faire varier sur la scène sociale ; - la difficulté de l’adolescent à se construire une et unique identité permettant de se définir dans sa relation avec le groupe social.
D’où une série de confusions. Le mot a été introduit
sans avoir été défini ; ensuite la notion a été tirée dans des directions
opposées, entraînant de l’incohérence dans les débats. Et il faut distinguer
deux registres de l’identité : l’usage réifiant des militants politiques
(réclamant des droits et les revendications d’un groupe qu’on suppose exister
réellement), et celui des chercheurs qui s’ingénient à en déconstruire la
pertinence (p. 37, 52). Comment concilier ces deux attitudes naïves ?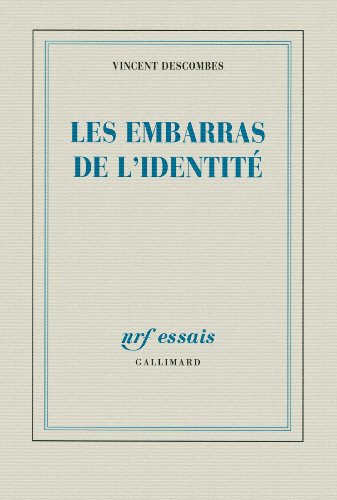
La critique du « parler identitaire » épingle le courant critique des sciences sociales qui réduit l’identitaire (la réalité socio-historique d’un groupe, permettant de le mobiliser autour de sentiments de solidarité et d’appartenance) à la construction sociale d’une idée (ou représentation), assimilée à une fiction. Et l’incohérence du « constructivisme mou » (selon Roger Brubaker et Frederick Cooper), qui, contraint d’admettre les identités, les dissout dans le fait qu’elles sont multiples, variables, contingentes, composites, renégociées…, donc inconsistantes. D’où l’efficace mise en évidence des contradictions insurmontables de l’idéologie de l’identité plurielle (p. 45), qui porte la menace que le soi devienne étranger et étranger à soi (p. 50-51). Pour Descombes on ne peut pas renoncer au concept d’identité sous prétexte d’historicité et de diversité anthropologique, ce qui conduirait à éliminer le langage de l’identitaire mais aussi celui de l’identique.
Le problème du langage est ainsi devenu un problème philosophique : « Que le langage me fasse dire ce que je ne veux pas dire, ou qu’il m’empêche de dire ce que je voulais dire, c’est là une difficulté proprement philosophique » (p. 55), avec ses effets pervers. On retrouve les « réfutations sophistiques » d’Aristote : « cette forme d’autoréfutation par laquelle on se précipite de soi-même dans le piège d’un sophiste ». Pour résoudre ces apories de l’identité, il faut repartir de l’usage élémentaire puis d’une compréhension de l’identité morale.
Le Chapitre II : « à quoi sert le concept d’identité ? » répond à deux objections contre l’application de la notion de l’identique dans ce monde :
1) Physique ou ontologique : les choses sont mouvantes, tout change et se transforme (thème héraclitéen, qui inspire l’argument de la croissance). 2) La forme logique a=b, comme relation et signe d’identité pose deux difficultés : comment une chose a peut-elle être identique à une autre chose b ? Et comment peut-elle être identique à elle-même ?
La première ne concerne pas l’identité mais la notion d’organisme vivant ou d’une personne humaine, avec pour enjeu le principe d’individuation. Comment un être peut-il demeurer lui-même et pourtant changer dans ses mesures numériques (masse, grandeur) ou ses composants (ses cellules ou ses parties) ? (p. 71). Là est le sophisme et l’erreur du matérialiste (qui rend impossible de concevoir des individus historiques) : « changer dans sa composition » (matérielle) ne signifie pas « se changer en une autre chose ». De même un fleuve contient des eaux (par nature diverses) s’écoulant dans le même lit et la même direction (sa « forme » qui enserre le flux matériel). Et le vaisseau de Thésée (dont les Athéniens remplacent au fur et à mesure les différentes pièces) ne reste pas le même selon sa matière, mais selon sa « forme ».
Pour la deuxième objection, l’auteur puise dans la philosophie analytique, depuis Frege et le Wittgenstein du Tractacus, la critique logique de la conception relationnelle de l’identité, en liaison avec la question du nom propre (p. 73 sq.).
Il s’agit de fixer les règles du critère d’identité, tel qu’il permette de parler d’un même être selon un « principe, de dépendance sortale » (rester le même selon son type) et de l’individuer dans son espèce (Callias dénomme un homme, pas une collection de cellules dont la qualité changerait à chaque variation de ses éléments). Ou d’autoriser l’identité se rapportant au sujet (et non pas côté prédicat, ce qui se heurte aux apories logiques de l’identique « dans la différence ») comme l’enchaînement des propositions narratives dans un récit biographique : quand le nom propre ou le pronom se réfère au même individu (Cicéron est le même homme que Tullius). Enfin, la clé est fournie par ce que l’auteur nomme la règle de [Peter] Geach (dans Mental Acts) : quand on cherche si l’objet a est le même que l’objet b, la règle consiste à demander : « le même quoi ? ». Faute d’un tel terme général individuatif je ne sais pas à quoi j’ai donné un nom propre.
Mais qu’en est-il de l’identitaire, comme identité éprouvée ou conçue comme propre à un sujet, à la première personne, du singulier ou du pluriel ?
La chapitre III : « l’identité au sens subjectif », chemine du sens littéral au sens figuré de l’identité. Un sujet s’identifie en disant ce qu’il est « pour nous » (identité littérale ou objective, selon l’état civil, répondant à la question « qui est-ce ? »), mais aussi « pour lui-même » (l’identité d’un soi ou d’un self, sujet et objet d’une conscience d’être identique à soi : « Qui suis-je ? »). Cette question a donné lieu à deux philosophies de la subjectivité et de subjectif, comme ce qui existe : 1) Dans l’intériorité mentale ; 2) ou dans l’expressivité personnelle.
Après avoir retracé la position de la psychologie réflexive classique, sa mise en cause par de Locke, puis l’impossibilité d’établir un critère d’identité pour attester de la permanence d’un même soi (Wittgenstein), V. Descombes examine la philosophie d’un sujet qui cherche à devenir et à faire ce qu’il est pour trouver pleine satisfaction de soi en tant qu’individu particulier. C’est Hegel qui promeut cet Homme manifestant la volonté d’être soi : « Il ne peut être satisfait de lui-même que s’il peut s’attribuer à lui-même, à son propre choix, la responsabilité de ce qu’il est » (p. 118). On passe alors à une conception du sujet centrée sur l’expression : « Est subjectif ce qui venant d’un particulier, dit quelque chose de ce sujet particulier parce que cela l’exprime » (p. 118) ; comme si par son acte et par sa décision, il parlait à la première personne, puisque personne ne peut décider à sa place. Mais en quel sens ? Si l’identité littérale (son état civil) échappe à la libre décision de l’individu, il n’en va pas de même pour son identité narrative, la version de sa vie passée, et plus encore de son avenir.
Être ou ne pas être soi-même (p. 120). Vincent Descombes résume lui-même ses résultats en fin de ce chapitre III. Il était tentant de chercher ce sens pratique de l’identité pour soi dans une théorie existentielle du « choix radical » qui rend le sujet entièrement responsable de ses attributs. Mais cette solutions s‘avère une impasse, par son indétermination même. Suite à l’Esthétique de Hegel, dans l’ample perspective du roman d’apprentissage (Bildungsroman), la belle analyse de Hamlet décrit la crise d’identité comme crise d’indécision, en montrant que l’interpellation « Être ou ne pas être… », ne pose aucune question, car il lui manque un attribut : être ou ne pas être quoi ? Aucun adjectif déterminé ne remplit les points de suspension, et la question reste indéfinie, alors que les seules questions pratiques sont les questions finies : faire quoi, positivement, ici et maintenant, en disposant de quelles possibilités ?
Parallèlement, sur le modèle des analyses de Charles Taylor transposant les apports de l’histoire économique (Karl Polanyi) devenir un individu normatif au sens moderne semble poser un individu « désimbriqué » (disembedded) par rapport au reste de la société, donc désocialisé. Mais la lecture de Pascal (p. 150 sq.) depuis le « Discours sur la Condition des Grands » jusqu’aux Pensées (« Qu’est-ce que le moi ? »), montre que la définition de l’homme comme individu désocialisé est en fait seconde : les modernes se définissent aussi d‘abord, comme tous les êtres humains, comme des êtres sociaux, et à partir de cette position originaire, ils doivent se construire eux-mêmes comme déconstruits. Mais qu’y a-t-il d’estimable dans ce qui fait mon individualité « sans qualité » (sociales) ?
Seul un agent individué et situé peut exercer un pouvoir des possibles (celui qui est arrivé à tel carrefour où il a le choix entre tels chemins). Le sujet supposé d’un choix radical est en réalité un « individu vague », incapable de poser des questions finies par rapport à des fins, un agent indéterminé dépourvu de raisons déterminantes lui permettant de définir une décision comme l’expression de lui-même. On privilégiera alors le choix délibéré, pour ses propres raisons, qui a accepté son individuation, définie par des origines et des conditions humaines.
L’auteur termine par la notion d’identité ou d’individualité expressive sur le modèle de celle de l’artiste qui s’aime lui-même dans son œuvre, comme l’avait déjà remarqué Aristote (Éthique Nicomaque, IX) (p. 169). La métaphysique négative du jansénisme de Pascal lui faisait dire : si vous m’aimez pour mes qualités extérieures ou celles de mes actes, vous ne m‘aimez pas, moi. La thèse de l’expression justifie que l’artiste dise au contraire : si vous n’aimez pas mon œuvre dans les qualités qui expriment l’actualisation de ce que je suis en puissance, vous ne m’aimez pas, moi, parce que mon œuvre fait partie de moi (p. 171).
Le chapitre IV (« les identités collectives ») reprend la question « Qui sommes-nous ? » qui anime les débats contemporains (sur l’identité nationale ou l’identité européenne : histoire commune, valeur commune, identité politique délimitée ?).
Beaucoup nient que les groupes humains aient une réelle existence sociale et historique. Dire « la France a beaucoup changé » rend-il impossible de dire « la France » pour énoncer quelque chose qui n’aurait pas changé ? Si on conteste la validité même d’une identité collective comme illusion réifiante et mystifiante, si dire et penser « le même pays » n’a plus de sens, alors il ne reste plus d’objet au sociologue ou à l’historien, ni au discours politique qui se référerait à un « nous » préalable. Or le nominaliste inconséquent qui n’accorde de réalité qu’aux individus et non aux groupes (en tant que groupes), comme le sociologue ne jurant que par « l’identité changeante », méconnaît l’existence d’une identité diachronique essentielle (Popper) (p. 180-182).
Qu’est-ce qui peut individuer et distinguer des entités collectives qui comprennent plus qu’une collection d’individus, mais auxquelles ces individus peuvent s’identifier ? L’auteur reprend les origines spéculatives de nos conceptions juridiques et politiques des corps collectifs et de leur représentation. Il examine « l’analogie d’une personne et d’un peuple » (ses sentiments, sa conscience de soi…), qui rend possible une « volonté d’être soi » (p. 195) ? Il suit avec Kantorowicz la formation de la doctrine de la « personne morale » et de la permanence des collectivités organisées (p. 196 sq.) comme totalité permanente dotée d’une existence future et pouvant agir au travers du temps. Quand une Ville ou une Université contracte un emprunt (cas emprunté à Yann Thomas), des prêteurs physiques entrent en relation avec le sujet d’une relation juridique, effectuant un acte qui engage l’avenir (une institution et non la pluralité ou l’association de ses particuliers). Il faut distinguer les individus naturels, la personne institutionnelle, et ceux qui en assurent la représentation. Il faut bien que la totalité sociale possède une identité propre en dehors de l’individu. Mais quelle est la valeur sémantique de son nom propre ?
Qu’est-ce alors qu’une Cité (p. 203) ? Quelle peut-être cette « forme » qui ne change pas ? Ce qui, selon Aristote, fait son unité morale et politique comme tout indépendant, sa « forme de composition », l’esprit de sa politeia ou sa « disposition ». Qu’est-ce qu’une nation ? (p. 207 sq.). Descombes renouvelle nos références en citant « La nation » de Marcel Mauss et sa méthode comparative : dire quel est le caractère sociologique de ce type de société et ce qui la distingue des autres. - Il s’agit d’une société à fort degré d’intégration, dotée d’un pouvoir central, d’une unité morale et culturelle, où la population adhère consciemment à l’État comme à ses lois, met en œuvre le désir de se gouverner elle-même mais à l’intérieur d’une définition politique de son unité.
Par opposition au communautarisme ou « communalisme » (selon R. Dumont, Homo hierarchicus), où l’unité du groupe se fonde sur la religion plutôt que sur l’adhésion des citoyens aux institutions politiques, et où chacun donne « à sa communauté [religieuse] l’allégeance qui doit aller normalement à la nation », dans l’État-nation moderne, la sphère politique n’est pas englobée dans la religion du groupe, mais la valeur de l’idée normative d’individu (la « religion de l’individu ») permet l’autonomie et les valeurs propres du politique. Ceci implique la laïcité (il ne peut y avoir de religion d’État), et la réunion des particuliers dans un individu politique, incompatible avec la religion de type ancien (p. 210-213).
Concernant le devenir des nations, de rang intermédiaire entre les ordres anciens et la perspective d’une société plus vaste, les références précédentes tendent à faire voir les nations comme organismes (d’un animal), qui ne peuvent fusionner entre eux sans perdre leur personnalité. L’individualisme des citoyens a trouvé son expression dans l’État et s’identifie à la particularité de son territoire limité : il y a un particularisme inhérent à la communauté politique qui entend se gouverner elle-même (p. 214-217).
L’analyse linguistique de « nous » (et de « moi »), le rappel de la conception moderne de la souveraineté et de la volonté générale aboutit à en étoffer la compréhension, notamment avec Rousseau. Allant plus loin que l’appareil conceptuel du jusnaturalisme, montrant le rôle des institutions nationales, la fonction centrale de l’éducation civique et l’importance, pour un Peuple, de « l’esprit de son institution » (à savoir « des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opinion »), le Contrat Social signe la formation d’une véritable « identité collective », dotée d’une substance sociologique (et anthropologique : la succession des générations) qui produit une sensibilité à toute agression contre le corps collectif, et une solidarité par laquelle chaque citoyen dilate son « moi » aux dimensions d’un « nous ». Pour Aristote aussi, la politeia ne comprenait pas seulement les lois constitutionnelles mais l’ensemble des lois collectives (p. 224-229).
La réflexion aborde alors deux enjeux contemporains (p. 231 sq.).
1) Dans le débats sur le « droit à la différence », plusieurs idiomes se télescopent : celui de l’émancipation humaine, et celui de la « reconnaissance de l’autre dans ce qui le rend autre ». Or, la reconnaissance d’une valeur et non d’un fait peut se faire de manière équistatutaire (on tient la différence de l’autre pour égale, donc sans valeur normative), ou, nécessairement, de manière hiérarchique (on assigne un statut ou un rang inférieur ou supérieur à une particularité, en donnant à l’autre une autre valeur qu’à soi). Mais il va y avoir contradiction logique et politique à demander simultanément d’être reconnu comme égal et « en tant qu’autre ». D’un côté, on reconnaît l’autre comme un semblable. De l’autre, quelle place accorder à une minorité : majeure ou mineure ? C’est la contradiction d’une politique de la diversité (identity politics) qui instaure une hiérarchie au nom de l’égalité des citoyens. Mêmes contradictions logiques chez celui qui dit « nous » en s’adressant à « vous », sans cohérence possible.
2) Une démocratie multiculturelleest-elle possible ? Le multiculturalisme concerne un appel à transmettre et reproduire une manière globale de faire et de penser : mais laquelle parmi plusieurs (au moins deux) ? Comment un individu peut-il composer les affirmations : « Je suis un A », « Je suis un B » et « Je suis un AB » (voire « Nous sommes les AB ») ? De manière équivalente ou hiérarchique ? Avec quel groupe englobant et quel groupe englobé ? La solution de « l’identification structurale » consiste à opposer distinctivement le groupe B et le groupe non-B au sein des A ; avec sa traduction pratique : faire primer la politique extérieure sur la politique intérieure.
Toute société humaine, en tant qu’elle se fait une représentation d’elle-même, doit se donner la possibilité d’un « nous » (p. 242) : il lui faut donc se représenter comme étant à la fois fermée et ouverte, définie par elle-même et rapportée au monde extérieur. Il lui faut faire la différence entre citoyen et non-citoyen. Mais comment peut-on fonder un statut, inaugurer une tradition, comment la volonté même collective peut-elle instaurer une coutume ? Il faut humaniser notre conception de la scène inaugurale de la fondation du politique. D’où la distinction (reprise de C. Castoriadis) entre « pouvoir constituant » (pouvoir de faire ou de refaire la constitution) et « pouvoir instituant » (qui produit et reproduit l’ensemble des institutions qui en sont les conditions préalables propres à une société).
S’il est possible de réunir une assemblée qui délibère, c’est qu’il y a une déjà une société instituée, une légitimité qui précède tout exercice proprement politique d’une autorité publique : « pouvoir implicite » ou pouvoir premier dont tous les autres procèdent, « pouvoir instituant » qui précède toute constitution. Or, dans une société historique, tous participent à la famille, à la langue, aux mœurs, aux usages innombrables qui constituent la culture : c’est la « coutume » des classiques, habitude et seconde nature, au sein de laquelle par conséquent est possible la puissance expressive de l’individu. La société contractuelle s’inscrit dans une société historique dont la participation requiert des facultés d’invention et de conception autant que de réception et de répétition.
La conclusion (« Envoi », p. 248-254)) fixe les grandes lignes du parcours : pour que la notion d’identité collective soit légitime et nécessaire, il faut pouvoir attribuer à un groupe une identité diachronique et une conscience de soi. Il faut qu’il y ait un « nous » collectif représentant une communauté historique Ceci relève-t-il de l’imaginaire ? Mais s’il y a un imaginaire irréel et mystifiant, il y a par contre un imaginaire actuel qui active une figuration des choses au sens du pouvoir instituant. L’identité collective n’est pas sans réalité, parce qu’une société est définie par l’instauration et la transmission d’institutions entre les générations qui ont été éduquées et préparées à le faire.
Pour les Lumières, le droit du sujet signifiait le droit et le devoir de s’émanciper. L’homme d’aujourd’hui le complète et l’interprète comme un droit à définir lui-même son identité, en y incluant des liens sociaux et humains dont la substance ne doit rien au contrat social abstrait. Le fait, pour des individus se demandant de quelle histoire ils sont l’œuvre, d’élargir les contours de leur moi de manière à y inclure un « nous, représente une manière de se rétablir dans leur condition humaine. « L’individu se définit en déclarant ce qui à ses yeux fait partie de son identité. Mais ce qui fait partie de son identité, c’est cela même dont lui-même fait partie ».
Sans doute, les méthodes linguistiques et logiques, somme toute formelles, dont Vincent Descombes a tiré le meilleur parti, dans un travail de clarification et d’élucidation hors pair, ne permettent guère d’aller plus loin. On peut regretter que l’analyse anthropologique et sociologique ne soit pas encore plus substantielle, par exemple au travers de la notion de « symbolique » (telle qu’elle peut être empruntée à E. Cassirer). Est-on bien sûr qu’on puisse clarifier et réduire à des idées parfaitement rationnelles et définies ce lien rémanent qui fait notre identité socio-culturelle ? L’identité des peuples et des nations aux prises avec leurs contradicteurs n’est-elle qu’une affaire d’imaginaire instituant mis en acte, d’éducation et d’opinion ? La lutte, et les logiques stratégiques, entre des désirs de puissance opposés (Spinoza) n’y est-elle pour rien ? Le conflit pour la légitimité n’est-il pas des plus âpres, et n’engage-t-il pas des contenus et des intérêts vitaux, à l’image de ce qui anime le renversement des valeurs diagnostiqué par Nietzsche ? Enfin, peut-on totalement éviter l’enquête, et donc la polémique, sur les valeurs ou la cohérence des principes, dans leur fond, entre lesquels se partagent les différentes identifications culturelles, et qui peuvent représenter des options opposées en faveur de telle ou de telle identité collective particulière ?
Miguel Karm, avec Marion Chavaren (professeurs de Philosophie à Versailles).