Bernard Sève, L’Instrument de musique, lu par Olivier Chelzen
Par Karim Oukaci le 16 octobre 2013, 06:00 - Esthétique - Lien permanent
 Bernard Sève, L’Instrument de musique. Une étude philosophique, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2013.
Bernard Sève, L’Instrument de musique. Une étude philosophique, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2013.
Très curieusement, l'instrument de musique apparaît comme le parent pauvre au sein de la littérature philosophique portant sur la musique. Bernard Sève répare cette lacune en lui consacrant un livre extrêmement stimulant.
Sans instruments de musique, il n'y a pas de musique ; et celle-ci n'existe que "sous condition organologique"[1]. Telle est la thèse centrale défendue dès la première partie par Bernard Sève. Cette thèse, selon laquelle la musique est affaire d'instruments, ne va pas de soi, tant la philosophie est marquée par une conception "vocaliste" trouvant certainement ses racines dans la pensée religieuse. Selon cette dernière conception, la voix seule est susceptible, au prix d'un dépassement, voire d'un rejet de l'instrument, de s'élever à la musique pure. Si la musique est la voix de l'âme, alors l'instrument, trop matériel, trop technique et en un mot trop humain, fait nécessairement obstacle à cette élévation spirituelle que seul un concert angélique et purement vocal permet. Cette tension de l'homme vers le Ciel au moyen de la musique est freinée par l'instrument qui le ramène trop brutalement vers la Terre. Comme le montre l'auteur dès les premières pages, cette thèse vocaliste est merveilleusement illustrée par une Santa Cecilia peinte par Raphaël pour l'église de San Giovanni in Monte à Bologne. Nous voyons Sainte Cécile (la patronne des musiciens) au centre du tableau, munie d'un orgue portatif injouable. Au sol, divers instruments sont cassés. Au ciel, le concert a capella des anges. Voilà bien exprimée ici toute une philosophie : il faut se débarrasser des instruments, se libérer de la gangue matérielle pour accéder au spirituel, en musique comme en toute autre chose. Dans tout son ouvrage, l’auteur prend le contre-pied de cette conception : dévaloriser l'instrument ou en affirmer la secondarité par rapport à la voix (dont il ne pourrait fournir qu'une imitation imparfaite), c'est passer à côté de ce qu'il y a d'essentiel dans la musique. L'instrument est premier ; la musique naît d'un jeu instrumental qui lui donne vie.
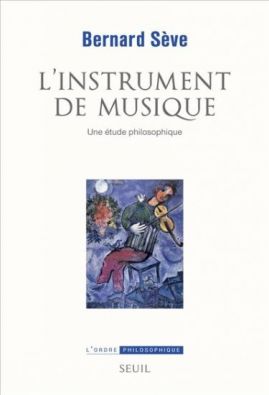
Dans la première partie de l'ouvrage, "Inventions, de l'instrument à la musique", Bernard Sève va vers l'instrument dans ce qu'il a de matériel, de sensible, en commençant par pointer un fait remarquable : toutes les sociétés ont donné naissance à une quantité impressionnante d'instruments de musique. Cet universel anthropologique est d’ailleurs d'autant plus étonnant que l'inventivité répond ici à un mobile qui n'est nullement utilitaire. L’auteur nous conduit parmi ces milliers d’instruments aux formes si différentes ; la fin poursuivie étant relativement indéterminée (il s’agit seulement de produire des sons), celle-ci ne contraint nullement l’imagination qui peut s’épancher librement, cherchant à produire la palette la plus large de sons au moyen d’une palette non moins large de matériaux. On ne peut lire sans une certaine émotion ces pages dans lesquelles se manifeste la passion avec laquelle les hommes ont fait, si l’on peut dire, feu de tout bois. Les animaux n’ont pas été épargnés dans cette affaire : tibias d’ours, carapaces de tortues, dents de cheval, peaux d’antilope, de reptile, boyaux, vessies, plumes, il n’est presque rien dont on ne se soit un jour demandé si cela ne pouvait servir à faire de la musique[2].
Ce processus au cours duquel un ensemble de matériaux devient progressivement un instrument de musique entre les mains du luthier, est relayé par un autre processus, au cours duquel il passe de son corps physique à son corps musical entre les mains du musicien. Bernard Sève utilise ici un vocabulaire qu’il emprunte à Ernst Kantorowicz, et à sa célèbre thèse sur les deux corps du Roi, le corps naturel et mortel, le corps politique et immortel. Concernant l’instrument de musique, on peut dire d’abord qu’il est un corps physique, comme un autre, capable selon les circonstances de rendre une multitude de sons. Mais pour faire de la musique, il faut que ces sons soient conformes à un ensemble de normes reconnues par une société, à une époque donnée (intervalles constitués par les échelles ou gammes, certains types d’attaques et non d’autres, etc.). On est ici au plus près de la relation entre le musicien et l’instrument, dans ce qu’elle a de plus intime : le moment de l’accord par exemple (pensons au violoniste concentré sur la manière dont sonnent ensemble ses quatre cordes, juste avant le concert), ou encore les mises en doigts que constituaient autrefois les préludes, les toccatas, morceaux largement improvisés qui avaient pour fonction de donner au musicien l’occasion de faire sonner l’instrument, de l’apprivoiser, autrement dit de le faire passer de son corps physique à son corps musical. Ce dernier n’est d’ailleurs pas fixé une fois pour toutes. Au contraire, l’histoire de la musique est aussi l’histoire de cette évolution des potentialités musicales des instruments que les compositeurs n’ont cessé d’élargir. On pense par exemple au Pizz Bartók (une forme de pizzicato, consistant à faire claquer la corde sur le manche de l’instrument), mais aussi à l’ensemble des sons, voire des bruits, que les compositeurs des XXème et XXIème siècles se sont ingéniés à intégrer à la musique.
La seconde partie, « Présentations, du sensible à l’écriture », est largement consacrée aux modalités selon lesquelles l’instrument se manifeste à notre conscience. Tout d’abord, Bernard Sève fait observer que l’instrument est souvent l’objet, dans la musique, de ce qu’il appelle une présentation esthétique. Dans les Concertos brandebourgeois par exemple, Bach met tour à tour en avant des instruments afin de les présenter, de porter à la conscience de l’auditeur l’éventail de leurs possibilités. C’est notamment le cas du clavecin, dans le célèbre concerto n°5, qui sort du rôle obscur de continuo pour devenir pour la première fois un instrument soliste. De même, les Sequenze de Luciano Berio sont des présentations esthétiques d’instruments : ces derniers ne sont plus des moyens au service de la fin que constitue la pièce musicale ; c’est au contraire la pièce musicale qui devient moyen pour la mise en évidence de l’instrument.
La présentation esthétique, sensible, peut alors passer le témoin à la présentation discursive, qui n’est autre que la définition de l’instrument. Pour Bernard Sève, un instrument est d’abord un artefact séparable du corps humain (ce qui exclut la voix), et « permettant de transformer l’énergie produite par le corps de la personne qui en joue en sons considérés comme musicaux par la culture dans laquelle l’instrument est utilisé » (ce qui exclut les ordinateurs et les installations électro-acoustiques puisque la programmation exclut cette causalité mécanique du musicien)[3].
Ainsi, tout ce qui peut produire des sons n’est pas pour autant instrument : encore faut-il que ces sons soient considérés comme pertinents, c’est-à-dire conforme à l’« alphabet musical » reconnu par la culture considérée. C’est pourquoi, dans le dernier moment consacré aux rapports entre l’instrument et l’écriture, l’un des temps forts est assurément le passage consacré à l’« archi-écriture » dont les instruments sont porteurs, dans leur matérialité même[4]. Ainsi, les trous d’une flûte à bec sont percés selon des intervalles qui restituent les tons et les demi-tons correspondant à l’échelle des sons reconnue dans le langage musical occidental. Une œuvre musicale composée pour cet instrument s’inscrit alors nécessairement dans le paysage sonore que dessine son archi-écriture.
La troisième partie intitulée « Ontologie, de l’instrument à l’œuvre » vise essentiellement à déterminer la nature de l’œuvre musicale en mettant en évidence la fonction qu’y occupe l’instrument de musique.
Les instruments ne sont pas isolés ; ils fonctionnent ensemble au sein de ce que Bernard Sève n’hésite pas à appeler une société. Cette société est d’abord l’instrumentarium propre à une société, ou à une époque. On parlera de l’instrumentarium baroque, de l’instrumentarium romantique. Mais cet ensemble est-il homogène ? Pour quelle raison les instruments baroques, par exemple, sonnent-ils bien ensemble ? Un autre problème est posé par les associations d’instruments voulues par le compositeur. Des instruments, parfois très différents, peuvent cependant être associés lorsqu’ils ont des affinités, c’est-à-dire lorsqu’ils forment un tout équilibré et harmonieux. Mais pour le savoir, seuls les essais, parfois infructueux, et les tentatives nouvelles peuvent être pour le compositeur d’un précieux secours. Là encore, la solution est dans la rencontre avec le divers de l’expérience, la prise en main des instruments dans une expérimentation dont on ne peut connaître à l’avance le résultat. Les affinités semblent plus évidentes pour les instruments de même famille : le quatuor à cordes, par exemple, paraît être un ensemble constitué depuis toujours, tant la littérature destinée à cette formation est importante, mais il n’existe pourtant que depuis le XVIIIème siècle.
La fin du livre montre que ces instruments, source émettrice des sons qui constituent l’œuvre effectivement réalisée, ne peuvent être exclus d’une théorie de l’œuvre musicale. Ainsi, notre auteur va s’attacher à mettre en question la thèse de Francis Wolff sur cette question, afin de mieux faire apparaître la sienne par la suite. Rappelons que Francis Wolff[5] oppose l’écoute ordinaire et l’écoute musicale. L’écoute ordinaire est une écoute causale : un événement sonore renvoie à la cause qui l’a produit, car nous cherchons à travers lui une information sur le monde. L’écoute musicale, quant à elle, nous déconnecte de cette causalité « matérielle ». La note entendue semble n'avoir aucune autre cause que la note qui la précède, à laquelle elle paraît succéder au sein d’un enchaînement nécessaire : la totalité structurée que constitue le morceau.
Bernard Sève reprend cette thèse en montrant qu’une œuvre musicale peut être pensée selon deux dimensions. Selon la dimension horizontale, les sons se suivent et paraissent même parfois (mais pas toujours) obéir à un ordre nécessaire. Selon la dimension verticale, au contraire, chaque son est rapporté à sa cause physique : le violoncelle, ou la voix qui lui a donné naissance. Dans les phrases musicales qui se succèdent et s'assemblent au sein du morceau, les instruments conservent une présence qui fait précisément la vie de l'œuvre. On peut d'ailleurs dire qu'une exécution réussie est celle dans laquelle la trame dramatique horizontale n'oblitère en rien la dimension verticale. Bien au contraire, celle-ci conserve une force que la thèse de Wolff semblait lui refuser.
On ne saurait donc comprendre ce qu’est une œuvre musicale sans intégrer cette présence vibrante des instruments, autrement dit cette dimension interprétative qu’est l’exécution du morceau par l’interprète. C'est pourquoi Bernard Sève propose une ontologie de l'œuvre musicale "par cercles concentriques" en partant d'une critique de Nelson Goodman. Pour ce dernier, en effet, une œuvre n'est vraiment donnée par un interprète que dans la mesure où son exécution ne comporte aucune fausse note. En effet, si l'on accorde que l'interprétation de la Pathétique de Beethoven avec une fausse note soit bien la Pathétique, alors il n'y a pas de raison de le refuser à une interprétation qui en comporterait deux, trois, etc., et au bout du compte, d'appeler Pathétique de Beethoven un morceau qui ressemblerait plutôt à Au clair de la Lune ! Nelson Goodman pense donc l'œuvre musicale en termes d'identité, comme si l'interprétation du morceau devait être le calque de la partition. Bernard Sève pense au contraire l'interprétation dans le prolongement de la composition, comme un processus se connectant à un autre pour aboutir alors, et alors seulement, à la pleine réalisation de l'œuvre. L'interprétation idéale est à la fois "correcte" et "réussie". Correcte parce qu'elle respecte la partition, réussie parce que l'interprète, par son jeu, en déploie au maximum les potentialités esthétiques. Cet idéal est le centre de ces "cercles concentriques", jamais atteint, maintes fois approché. Ensuite, à mesure que l'on s'éloigne de ce centre, on a toujours affaire à la même œuvre, à un moindre degré cependant. Mais laissons le lecteur lire ces pages savoureuses où il sera question d’enfer musical et de téléphones portables.
Partant de la thèse selon laquelle la musique n'existe que sous condition organologique, Bernard Sève montre par la suite, de manière extrêmement convaincante, que l'on ne saurait donc penser la musique sans mettre l'accent sur la dimension du jeu. Le jeu du luthier, avec les matériaux, le jeu du compositeur, avec les mélodies, les rythmes, mais aussi les timbres (et donc les instruments) qu'il veut assembler, le jeu de l'interprète qui tente, par son travail préparatoire avec l’instrument et à l'occasion de sa prestation au concert, de faire apparaître les beautés d'une partition. Le jeu du musicien est comme la vie ; il fonctionne par essais, tâtonnements, reprises. Il comporte toujours le risque de l'erreur, mais c'est une erreur qui n'est jamais définitive, et qui peut se transformer, au gré du processus musical, en une extraordinaire réussite. La musique est un art vivant qui déploie entièrement son être sur la scène, lorsque des instruments bien présents sont pris en main et "joués" par des musiciens.
Reste la question de la voix, dont nous avons vu qu'elle ne possédait pas le statut d'instrument pour Bernard Sève. Évidemment, la voix n'est pas un artefact ; elle n'est pas extérieure au corps de l'instrumentiste. Et pourtant, l'auteur envisage lui-même dans une très belle page, la possibilité d’assimiler la voix à un instrument. En effet, la voix d'un chanteur est travaillée "comme un instrument", comme si elle était un "extérieur". Ce mouvement d'extériorisation, de prise de distance du chanteur vis-à-vis de sa voix, qui tend à en faire "une voix", nous ramène indéniablement dans une perspective instrumentale[6]. Il est frappant de constater à quel point ce que dit l'auteur de l'instrument tout au long du livre vaut aussi pour la voix. Ainsi, le passage du corps naturel au corps musicien, le rapport à l'écriture, les affinités des instruments (une voix aussi a un timbre qui s'accordera plus ou moins bien avec d'autres instruments, ou d'autres voix). Même ces phases préparatoires à l'exécution où il s'agit d'essayer l'instrument[7] trouvent leur répondant dans le domaine de la voix. Pensons par exemple aux vocalises parfois périlleuses d’avant-concert. Accepter cette intégration de la voix à l’instrument n’est d’ailleurs nullement contradictoire avec la thèse ici avancée du primat de l’instrument. Dire que la voix est un instrument, ou du moins fonctionne comme un instrument, c’est en accepter la secondarité.
On le voit, cet ouvrage très riche donne copieusement à penser, aussi bien au philosophe qu'au musicien. Précisons pour finir que le lecteur n'a besoin d'aucune connaissance technique préalable, sur le plan musical notamment, pour lire ce livre passionnant en tous points.
Olivier Chelzen.
[1] Bernard Sève, L'Instrument de musique, p. 86.
[2]Ibidem, p. 48.
[3]Ibid., p. 169.
[4]Ibid., p. 208.
[5] Cf. Francis Wolff, Dire le monde, Paris, PUF, 1997 ; 2ème édition Paris, PUF, « Quadrige » 2004.
[6] Cf. L’Instrument de musique, p. 100-101. Bernard Sève s’appuie ici sur les analyses d’André Schaeffner, Origine des instruments de musique, Paris, Editions de l’EHESS (réédition), 1994, p. 13-35.
[7] Cf L’instrument de musique, p. 73.