Benoît Charuau, La rédaction de Paul, Editions Le Manuscrit, septembre 2013, lu par Guy Renotte
Par Romain Couderc le 18 juin 2014, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
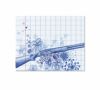 Benoît Charuau, La rédaction de Paul, Editions Le Manuscrit, septembre 2013, 288 pages.
Benoît Charuau, La rédaction de Paul, Editions Le Manuscrit, septembre 2013, 288 pages.
Benoît Charuau dans La rédaction de Paul, réinvente le roman polyphonique à la française, cet art du roman « total » où se mêlent fiction et essai, autobiographie et fable, parce qu’il est évident que pour lui vie et philosophie ne font qu’un, et que la littérature, comme la vie, n’a pas à se conformer à une philosophie, ni à s’engager. La littérature est engagée parce qu’elle est une action et que nous sommes « embarqués ». Il semble que Benoît Charuau ne répugne pas à prendre des risques puisque le sujet qu’il choisit de coucher sur le papier est pour le moins « sensible » : l’histoire d’un jeune détenu dont l’auteur a été le professeur de philosophie en maison d’arrêt.
On
aurait pu craindre un énième récit sur l’univers carcéral ou une analyse
psychologique de plus sur la personnalité des « adolescents
criminels » : rien de tel.
Benoît Charuau nous livre un texte brûlant, qui séduit par ses grandes
qualités d’écriture, mais qui n’est pas non plus sans nous interroger et nous
ébranler sur notre façon d’appréhender ces jeunes détenus dont le regard croise
le nôtre et nous renvoie à nos propres angoisses et doutes. Écrire l’histoire
de Paul ne va en effet pas de soi puisqu’elle est nécessairement constituée
depuis l’autre. Ce n’est que progressivement que la figure de Paul émerge et paraît pouvoir se dire sans recourir à une fiction qui consiste à servir de
matrice. Tout se passe comme si les confrontations successives à l’enfance,
puis à l’adolescence de Paul devaient se donner à lire comme génératrices du
sujet qu’il est. Il semble ainsi que le regard critique tel que le conçoit et
le pratique Benoît Charuau sur celui qui fut à la fois son élève et son séducteur,
consiste à tenter d’entrer dans la peau d’un autre et d’en ressortir davantage
soi-même qu’auparavant. D’où cette multiplicité de textes et d’images qui
compose peu à peu ce « roman philosophique » du millefeuille de la
personnalité de Paul et donne à l’écriture de l’auteur sa superbe légèreté qui
n’est que la forme élégante de la sagesse et du sérieux.
Le geste d’écriture qui consiste à faire correspondre le récit fictif de la vie du petit Paul avec celle de Benoît Charuau, lui-même professeur de philosophie en maison d’arrêt, fait droit, en l’assumant non sans pudeur, et même avec une certaine fragilité, au fait que l’auteur engage une part conséquente de lui-même dans ce travail qui entre manifestement en dialogue avec un vécu et des enjeux existentiels.
Faut-il en ce sens voir dans le choix délibéré du romancier de nous interpeller nous lecteurs, dès les premières pages, des résonances avec certains des biographèmes que l’auteur de l’ouvrage dissémine au fil du livre ? On peut être tenté de le penser, dans la mesure où l’élaboration de l’ouvrage est particulièrement concertée : « Un jour, il y aura crime. A ce stade, lecteur, ce seul savoir suffit. C’est une indication sur les motivations de ces pages. Remise-la en marge de ta lecture. Suis Paul comme tu accompagnerais tout autre. Parfois, il sera mon élève. Plus souvent, celui que nous venons de rencontrer. Toi ou moi, jadis. Un enfant solitaire par la force des choses d’abord. Doublant le réel de son imaginaire.»
De toute évidence se fait jour une volonté de reprendre à son compte le sillon creusé par la trajectoire de Paul, qui se décline sur le mode d’une triade faisant écho à la triple identité constituée au cours de son cheminement par la mère ogresse, obèse et inculte, le père absent, ivrogne et miroir, le frère et la sœur, attachement et repoussoir.
 A l’échelle du livre, dans
l’agencement de ces textes de fiction, l’assomption du « je » du Paul
de roman, ne va pas de soi. Il semble qu’elle doive nécessairement en passer
par la mobilisation de tiers. Mobilisé d’abord comme identité fictive, puis à
titre de destinataire imaginaire, le petit Paul se construit progressivement au
fil de notre lecture comme un « je » qui semble être le fruit de ce
parcours de lectures successives.
A l’échelle du livre, dans
l’agencement de ces textes de fiction, l’assomption du « je » du Paul
de roman, ne va pas de soi. Il semble qu’elle doive nécessairement en passer
par la mobilisation de tiers. Mobilisé d’abord comme identité fictive, puis à
titre de destinataire imaginaire, le petit Paul se construit progressivement au
fil de notre lecture comme un « je » qui semble être le fruit de ce
parcours de lectures successives.
Sa figure très présente, puis obsédante, finit par se couler dans le souvenir et se dissoudre dans le fleuve de notre mémoire ou celle du romancier : « Certes, vous cheminerez encore dans mon crâne et dans le regard que je porterai sur d’autres. Mais, par la grâce de mon Paul, vous n’obséderez plus ma tête. Vous basculez dans ma mémoire. »
Comment interpréter un tel geste d’écriture autrement que comme une volonté manifeste de rompre avec un certain habitus discursif et, plus largement avec une certaine assignation d’identité (et de rôle) liée à une fonction sociale ? Nul doute que la meilleure façon de prendre à bras le corps ce singulier roman philosophique est de s’employer à rendre compte de sa complexité et de ce qu’elle donne à lire et à penser.
Lire La rédaction de Paul, c’est d’abord accepter de se déprendre de soi pour épouser le devenir d’un autre, suivre les pas d’un « homme de langage évoluant au rythme pulsionnel d’un gamin de trois ans ».
Paul c’est d’abord ce petit être en éveil, hypersensible, attaché au corps de ce gros animal avachi qu’est la mère. Cette mère omniprésente, obsédante comme un cauchemar, affreuse et insignifiante. La mère qui manifestement est hors du langage, à mille lieues de son fils qui finira par lui reprocher sa propre manière de parler : « C’est elle. C’est elle si je parle mal. L’est à cause d’elle tous ces Le ! » La mère devenue insupportable et pourtant constitutive de notre être le plus profond, notre langue maternelle. La mère comme une déchirure et une souffrance, premier point d’ancrage de l’identité de Paul.
Paul c’est aussi le père, cet être invisible et éperdument désiré, se dérobant là où on l’attend, incapable de s’affirmer face à la toute-puissance d’une mère écrasante et se réfugiant dans l’alcool pour échapper à ses démons intérieurs. Face à lui, Paul est ce petit garçon fou de désir qui cherche à le rencontrer, à partager avec lui ces moments de bonheur qui sont toujours repoussés au lendemain. Cette fixation « érogène » au corps du père, l’auteur la décrit avec une force sans égale dans une scène dont la violence troublante s’impose au lecteur : « Sous sa main, sur sa peau, il sent le sexe se raidir et grandir et enfler. Il le lâche. Il regarde : l’animal se dresse et se décalotte et devient immense et veineux. Médusé, Paul repose le bout d’un doigt, puis d’un autre, puis sa paume, jusqu’à tout empoigner. Il enserre la queue raide de son père ». Des âmes sensibles pourraient s’effaroucher d’une telle description ou même la condamner. Mais la force de l’écriture est là pour rappeler à leur aveuglement tous les censeurs du monde prêts à juger et à condamner les signes annonciateurs d’une perversion annoncée.
Paul, c’est encore la relation ambivalente à la sœur détestée, Marie, toujours cachée dans les robes de la mère et au frère Loïc dont Paul cherche à capter l’attention et les regards pour le soustraire à l’emprise malveillante de la mère.
Tout autant d’identités, tout autant de leurres. Paul, qui oserait le traiter d’imposteur ? C’est lui qui souvent annonce l’imminence des troubles amoureux, l’étreinte impossible et gratuite des semblables, la pluie qui fait reverdir le monde, le vent qui fait danser les étoiles… Rêve des mots, douce euphorie du langage.
Benoît Charuau évoque de façon saisissante par le biais de l’imaginaire, ce moment où la frontière du réel et du fictif devient trouble. Ce moment où le Paul de fiction rencontre le Paul de chair et de sang, facétieux et enfantin, fasciné par les mots, séducteur et rebelle, qui fascine autant qu’il irrite parfois : « Qui étiez-vous, Paul ? Quelles perturbations motivaient vos mimiques ? Quels crimes poussés « très loin » occupaient votre conscience ? Quelle force soutenait votre humeur badine envers et contre la brutalité de la détention ? Je ne savais rien. J’avançais dans l’ignorance des agitations de votre tête. J’étais pris de vertige à l’idée des détonations d’une année de mes paroles dans vos secrètes tempêtes. »
On comprend ainsi que ce va-et-vient permanent entre l’histoire fictive de Paul et l’histoire réelle de Benoît Charuau, professeur de philosophie en maison d’arrêt, confère à l’ouvrage une épaisseur de réflexion, en le constituant comme un espace stéréographique permettant le croisement des regards et des perspectives. Le roman tend à participer du même principe d’enchevêtrement des voix, de résonance des points de vue et de décloisonnement des frontières génériques qu’il explore au sein même de la vie imaginaire de Paul. Le livre apparaît comme un prisme au sein duquel les enjeux abordés par les différentes strates de l’histoire de Paul se reflètent et s’altèrent par la proximité avec l’histoire personnelle du romancier lui-même et, en définitive, sous le regard du lecteur de ce volume.
Du point de vue de la chronologie du récit, pareille épaisseur ne laisse pas de déstabiliser le lecteur. En témoigne ces propos de l’auteur lui-même : « Ne rien savoir, mais voir Paul derrière les barreaux avec son lot d’étrangetés. Telle fut, lecteur, pendant deux ans, la position de mon regard. Tel est, par contrecoup, l’inconfort que je t’impose. Le malaise de l’ignorance. La crainte de savoir. Le refus de réduire une jeune vie à l’un de ses jours. La curiosité morbide. Des questions intimes. Notre goût de l’effroi. » Faut-il voir dans cette interpellation du lecteur par l’auteur un effet de décentrement provoqué par la composition du livre même, et qui amène le lecteur à y voir double, voire davantage ?
Ce vacillement des assises du discours narratif et de ses limites ne signifie cependant pas que l’ouvrage soit le fruit du hasard. Au contraire, tout semble ici particulièrement réfléchi. A travers cet agencement de textes et de voix en dialogues, c’est un peu de la linéarité coutumière de la logique pénitentiaire qui se trouve non pas tant remise en question — elle trouve également sa place — qu’épaissie et, ce faisant, enrichie par ses interactions avec d’autres logiques discursives, déterminée par d’autres finalités. Tout se passe comme si la lecture du roman de Benoît Charuau donnait à de multiples reprises à repenser les mêmes interrogations, en fonction de points de vue neufs, et en les illustrant par l’exemple. Le roman se constitue en effet comme un théâtre d’écriture où se rejouent les questionnements mis en évidence au sein de la trajectoire criminelle de Paul, dans une démarche qui conduit l’auteur à se mettre en jeu : « Je suis plus paisible, moins rongé de questions, presque distant à la relecture de ces pages. Distant aussi, vraiment distant, lorsqu’on me parle de crimes « monstrueux », comme si ma capacité d’effroi venait à s’épuiser. Alors une inquiétude sourde. Un malaise de ma raison plus que de mes sentiments. D’autres parricides ont pris votre place en cours et en cellule. Seulement, leurs actes — ce type d’acte — me laissent maintenant de glace. Qu’ai-je fait ? Qu’ai-je écrit ? Peut-on, de la sorte, s’habituer à ce qui, jadis, stupéfiait ? Vous-même, ou bien mon Paul, m’avez pris quelque chose. Je vous l’ai cédé. Etait-ce une faute ? Je l’ignore pour le moment. Moi aussi, Paul, je deviens autre. »
Le roman de Benoît Charuau est pour parler franchement un texte dont on ne ressort pas indemne. Au-delà de la réalité des faits racontés, qui importe assez peu il est vrai, ce roman donne littéralement le vertige. Vertige de l’auteur qui saisit le sens du verdict des juges. Vertige du lecteur qui perçoit derrière le visage du criminel le masque de ses désirs. Vertige de l’écriture elle-même qui, par sa forme, comme par ses finalités, déjoue certains des attendus du discours académique et donne à réfléchir aux conséquences des coupures abstraites que notre culture moderne a instauré entre le réel et le fictif, la sexualité et le savoir, la monstruosité du crime et la « normalité ».
Ce roman est un régal tant il dit simplement des choses si simples : l’amour est bon pour l’homme, la perversité réside moins dans les actes que dans notre regard, l’imaginaire est un exutoire grâce auquel l’appétit peut être sublimé.
Les mots de Benoît Charuau nous rappellent que les actes criminels de Paul ne doivent pas occulter le désert affectif auquel on assigne les jeunes, décrétant qu’ils n’ont point de chair, point de sensualité, et que la volupté, le plaisir et l’amour se manifestent brusquement par ordre légal, à la majorité ! C’est comme ça ! C’est réglé ! Dans quel état d’ailleurs se pointent-ils à ce rendez-vous du corps programmé ? Comment vivent-ils l’amour, comment aiment-ils les femmes ou les hommes, ces ados criminels qui traversent puberté et adolescence dans le vide sexuel le plus total ?
En somme, La rédaction de Paul est l’espace d’une trajectoire à travers laquelle se donne à lire rien moins qu’une métamorphose de l’auteur en soi. Métamorphose aussi du petit criminel qui peut quitter son corps de papier pour rejoindre le monde de la réalité. Ici brillent les saturnales du châtiment, lorsque la peine s’y retourne en privilège.
Guy Renotte