Denis Kambouchner, L’École, question philosophique, Editions Fayard, 2013, lu par Etienne Akamatsu
Par Michel Cardin le 04 septembre 2013, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
 Denis Kambouchner, L'École, question philosophique, Editions Fayard, 2013.
Denis Kambouchner, L'École, question philosophique, Editions Fayard, 2013.
L’Ecole est une question philosophique : une telle affirmation nous est familière ; et nous savons, comme le dit l’auteur, que « philosopher » signifie d’emblée « enseigner », ou du moins « statuer sur un enseignement possible ». Pourtant, comme le dit aussi Denis Kambouchner, « l’éducation est chez les philosophes une question délaissée ». Il y a là un paradoxe, mais aussi un défi, que relève cet ouvrage : s’efforcer de dresser un bilan approfondi et circonstancié des controverses appelées par l’évolution récente du monde scolaire.
Denis Kambouchner le constate : on demande beaucoup à l’école. Elle n'est pas seulement un « service » public, mais une « institution » fondatrice de la civilisation moderne et d’une vie sociale apaisée. On attend d’elle non pas seulement des fournitures – en informations, en savoirs, en diplômes – mais une contribution décisive à la vie publique, voire à la légitimité républicaine. Cela n'est guère contesté. Pourtant, si les réformes de l’école se préoccupent couramment des moyens, elles ne s’interrogent pas, ou guère, sur les fins et sur les « principes » (p. 9). Cette défaillance n'est évidemment pas sans conséquences sur l’évolution des structures et des pratiques. Ainsi avons-nous besoin de traiter des principes, si nous voulons juger de l’école, c'est-à-dire de ce qu’elle « offre » et, pour mieux dire, de ce qu’elle « apporte » et de ce qu’elle « promet » (p. 177). Et, en ce sens, la philosophie de l’école n'est pas nécessaire aux seuls philosophes.
L’Avant-propos inscrit l’ouvrage dans une perspective pratique : comment l’école pourrait-elle « redevenir, ou plutôt devenir au-delà de ce qu’elle a jamais été, une institution efficace et dynamique » (p. 14) ? Les conditions d’une telle efficacité sont multiples : puisque naissent de nouvelles technologies, il faut en déterminer avec précision le rôle (p. 14) ; mais il faut veiller à « préserver et cultiver une relation verbale, seule à être enseignante au sens fort » (p. 15) ; il faut donc éviter d’opposer artificiellement « la passion du savoir » et « le souci des élèves, de leur progrès et de leur devenir » (p. 16, p. 54) ; enfin, « pour être exacte et compréhensive, ferme et ouverte, attentive, rigoureuse et modulée, la parole adulte doit être instruite à un haut degré » (p. 18).
Le diagnostic dressé par Denis Kambouchner est dès l’abord, et souvent, sévère. « La crise française de l’école peut s’appréhender en termes de dérèglement ou de disharmonie interne à l’institution. Ce dérèglement est né, il y a près de quarante ans, du peu de sérieux avec lequel a été préparée une opération capitale, l’unification du système d’enseignement (‘‘collège unique’’) » (p. 12). Il importe selon lui de rétablir, avec l’aide de l’histoire culturelle, les perspectives d’une réflexion assurée et apaisée.
L’exposé des idées suit dans l’ouvrage un plan en deux grandes parties : « Dans une première partie (Horizons), les questions cardinales (autorité pédagogique, sens des savoirs, statut de la culture scolaire, justice en éducation) sont abordées à travers la critique ou déconstruction de plusieurs discours parmi les plus autorisés. Une seconde partie (Arrière-plans) recherche dans l’archive, principalement française, des écrits sur l’éducation les éléments d’une généalogie de notre crise intellectuelle, non sans relever ce qui subsiste d’attachement, jusque dans les thèses les plus provocantes dans le genre moderne, à la notion classique de la culture de l’esprit » (p. 19).
Donnons un aperçu rapide de ces analyses, en en retenant quelques moments significatifs.
Première partie : « Horizons ».
Le Chapitre premier (« L’éducation, question première ») essaie d’évaluer les chances de la parole philosophique confrontée aux transformations de la société. La modernité, l’effacement des autorités, voire « l’abandon de tout principe », ont conduit à « une anarchie complète dans les premiers apprentissages » (p. 29), à une dissipation des intérêts loin de toute « culture générale ». Les anciens cursus sont bouleversés. En effet, « dans une démocratie moderne, l’éducation ne peut pas rester inculcation : elle est plutôt, à titre essentiel, offre d’opportunités en grand nombre à un sujet qui dès son plus jeune âge se caractérise par ses propres projets » (p. 31). Dès lors, l’action éducative se définit, comme le dit John Dewey, comme une « réorganisation de l’expérience » (p. 33). Elle ne peut ignorer la « nouvelle pression sociale dirigée contre l’affichage d’un modèle unique de l’excellence » (p. 37). Cependant, l’autorité pédagogique résulte, pour une part décisive, de la consistance de ses objets : à cet égard, on peut suggérer que « la partie générale de la formation scolaire » soit « rendue plus philosophique » (p. 39).
Le Chapitre 2 (« Crise de l’enseignement et critique de la culture ») propose de revenir à « des données de sens commun » (p. 41). On parle de « crise de l’éducation » (H. Arendt) : ce diagnostic est certes discutable. Ce qui est certain en revanche, c'est le témoignage, rendu par les enseignants eux-mêmes, d’une « crise de l’enseignement ». Ainsi dira-t-on que les élèves « ne tiennent pas en classe » (p. 47). Or il n'y a pas de pédagogie sans autorité. Cette autorité elle-même dépend non seulement de conditions de fait, mais de conditions transcendantales. Le « bon professeur », dont Denis Kambouchner trace un court portrait, est avant tout celui qui sait organiser les attentes de son auditoire (p. 51) et qui réfléchit aux modalités par lesquelles son savoir « est effectivement communicable » (p. 53). Le bon professeur est celui qui porte « l’élévation de sa matière à son plus haut degré de communicabilité » (p. 54). « Le bon professeur approfondit ou perfectionne continûment la communication de sa matière dans un style qui lui est propre » (p. 54).
Ce point appelle une lecture des thèses célèbres de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron (dans La reproduction, Ed. de Minuit, 1970). La notion d’autorité pédagogique du professeur, expliquent-ils, est le masque idéologique des conditions réelles – c'est-à-dire la division et l’opposition des classes - qui façonnent la situation d’enseignement et rendent possibles à la fois le discours du professeur et sa réception par les élèves. On croit que la transmission est le fruit de l’enseignement lui-même ; mais c'est une illusion, car en réalité « il n'y a pas d’action d’enseignement qui fasse autre chose que confirmer du déjà-là » (p. 63), de sorte que « toute l’action du système d’enseignement consiste au fond à renvoyer chacun à sa classe » (p. 64). Pour sortir de l’illusion et de la pédagogie implicite, il faudrait instituer (mais qui le ferait ?) une pédagogie explicite et rationnelle. De plus, comme le dit aussi Bourdieu, dans La distinction, « la jouissance de la culture la plus valorisée » est ce qui est demandé à l’école pour pouvoir désigner ceux qui, passant ainsi pour les meilleurs, justifient ainsi leur pouvoir social. Bref, l’école contribue à ce que la culture reste « l’apanage des classes dominantes » (p. 68). Denis Kambouchner note que la « critique sociale de la culture » ne peut manquer d’apparaître comme « un encouragement apporté au relativisme » (p. 68).
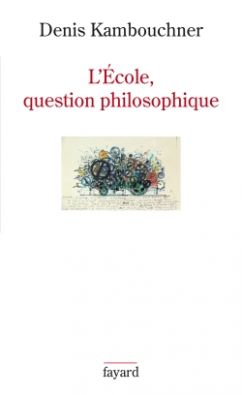
Le Chapitre 3 (« L’autorité pédagogique et le ‘‘sens des savoirs scolaires’’ ») reprend l’analyse des « conditions socioculturelles » qui ont produit la « crise » dans les sociétés démocratiques. Il s’en dégage l’idée que l’institution scolaire n'est plus guère soutenue par une « représentation à la fois forte et positive » de ce qu’elle est (p. 83), de sorte qu’elle apparaît comme une machinerie implacable et stérile (« effet Tinguely ») ou arbitraire (p. 85). De là vient, par exemple, la « disharmonie » entre « les attentes des familles et celles de l’école elle-même » (p. 82), ou que l’école, au niveau secondaire, reste « une machine à discours vides » (p. 84). Or « la critique [sociologique] de l’arbitraire culturel a partout renforcé l’arbitraire pédagogique plutôt qu’elle n’a contribué à le réduire » (p. 88).
Le remède, selon Denis Kambouchner, consiste à prêter attention aux « connexions internes à un savoir donné », dont on peut faire la « cartographie » minutieuse, et dont la conscience constituera « une culture au sens objectif » (p. 74-75). Cela permettrait de « restituer aux enseignements scolaires un certain type de nécessité organique dans leur rapport à des objets » (p. 90). Il ne faut certes pas confondre cette culture avec le « socle commun de connaissances et de compétences », « pur artefact institutionnel » (p. 90) qui est si différent du « régime prédominant des études universitaires » (p. 94).
Ainsi, « la pédagogie requise [...] ne peut pas seulement être une pédagogie des prestations ni en général des opérations, mais [...] une pédagogie des objets », des objets « positifs, solides, évidents » (p. 78) et formellement transcendants, comme le dit aussi Marcel Gauchet, dans L’Ecole à l’école d’elle-même (1985). Autrement dit, au rebours des discours sur la « construction » par l’élève de ses propres savoirs, au rebours du discours managérial (le discours de la « réussite »), il faut une normativité scolaire fondée sur des objets. Cela n’empêche évidemment pas que la pédagogie implique une forme d’engagement et d’immersion. L’art d’enseigner est un « art de présenter ou constituer des horizons », de sorte que les élèves puissent reconnaître ce qu’on leur enseigne comme « constituant une partie [...] de l’expérience d’un certain objet » (p. 96). Le professeur attirera l’attention grâce à ses « démonstrations, règles et initiatives » (p. 100). Enfin, le projet qu’esquisse Denis Kambouchner est celui, démocratique, d’une école « qui offre et qui pourvoit » plutôt que d’une « école qui classe » (p. 107).
Le Chapitre 4 (« La culture scolaire et après ») complète l’analyse des mauvais bilans de l’école, revient sur la « loi du zapping » en matière d’organisation des savoirs (p. 113), etc. Rappelons-nous qu’une « culture [...] ne peut se constituer par décret » (p. 116) et qu’elle comporte, même en milieu scolaire, un aspect « cultuel » (p. 117). Denis Kambouchner revient ici plus longuement sur les « folies » du « socle commun de connaissances et de compétences » (p. 118-127), qui répond à des recommandations européennes (p. 127-133). Enfin, ce chapitre formule douze principes pour la reconstruction d’une culture scolaire assumée dans son exigence propédeutique (p. 134-142).
Le Chapitre 5 (« Les principes d’une école juste ») commence par un bref aperçu historique : Condorcet, le Rapport Langevin-Wallon de 1947, l’épuisement contemporain de la « démocratisation de la réussite » (p. 144-150). Puis il revient à la sociologie de l’éducation, en particulier aux analyses du Déclin de l’institution, de François Dubet, qui dénonce « l’hypocrisie scolaire » (p. 151).
Un article de F. Dubet et Marie Duru-Bellat rappelle que la notion de justice est plurivoque, jusqu’à la contradiction. Denis Kambouchner en fait la critique. Il se demande si la mise en cause du principe méritocratique, si les corrections qui lui sont appliquées en vue de compenser les inégalités résiduelles ou induites, « n’aboutissent pas à lui ôter toute consistance » (p. 160). Au demeurant, la « ‘‘méritocratie’’ n’a jamais eu qu’une existence très problématique », et personne, pas même un « ‘‘républicain’’ attardé », ne s’ingénierait à soutenir que la méritocratie « actuelle serait juste, et elle seule » (p. 162).
Denis Kambouchner montre ensuite qu’il serait vain de chercher une analogie avec la Théorie de la justice, de Rawls. S’inspirant des Sphères de justice de Michael Walzer, il suggère plutôt de « dénombrer sans a priori » les principales opérations de l’école, « pour chercher ensuite quelles règles de justice peuvent s’appliquer à chacune » (p. 169). Cette procédure fait apparaître ceci : « Un système scolaire sera d’autant plus juste qu’il remplira de manière plus satisfaisante, dans l’ordre, ces quatre fonctions principales » : accueillir, apporter (« nourrir »), demander, décider (p. 172). Denis Kambouchner commente point par point cette proposition (p. 172-180), mêlant le constat à la recommandation, formulant ce que l’école doit faire pour accomplir réellement ce qu’elle promet ; répondant à quelques objections attendues, il appelle en somme à un débat.
La conclusion oppose la définition du minimum de « culture commune », et la visée d’une « expérience de la culture » (p. 181).
Deuxième partie : « Arrière-plans ».
Le Chapitre 6 (« Eclaircissements sur la ‘‘culture’’ ») revient - après l’article que Denis Kambouchner lui avait consacré dans le troisième tome des Notions de philosophie (Ed. Folio, 1995) - sur la notion de culture, un « labyrinthe moderne » (p. 185). Nous avons l’idée d’une « éducation libérale », selon l’expression de Leo Strauss (Le libéralisme antique et moderne, Ed. PUF). Mais la notion cicéronienne de culture – la cultura animi – semble s’être « retournée en elle-même » lorsqu’elle en est venue à désigner, chez Vico, Montesquieu, etc., des processus sociaux (p. 187).
Trois acceptions principales s’entrecroisent en ce mot : un concept classique, un concept socio-ethnologique, un concept transcendantal (p. 188). Denis Kambouchner cite et commente Cicéron (Tusculanes, II, 11-13 ; De l’orateur, I, 20) et Isocrate (Panégyrique, 48). Mais il relève aussi le divorce qu’il y a eu entre l’éloquence et la philosophie (p. 193). Il rappelle que la paideia grecque concernait un petit nombre de familles, et que, dans le processus de perfectionnement par la vertu, il y a une concurrence entre divers critères : doit-on privilégier les grandes actions, les beaux discours, ou l’intellection d’objets idéaux (p. 195) ? Faute de principe unique, « le processus de culture déconcerte toute modélisation » (p. 196). La critique de la culture est intrinsèque à la culture, chez Platon, Montaigne, Rousseau, Nietzsche, etc. (p. 196-199). Et ce serait une erreur de limiter la valeur de la culture aux fonctions socio-économiques qu’elle est appelée à jouer (p. 200).
Être cultivé, c’était être humain. Or, dans la modernité, la culture devient collective, investie par le besoin d’identification subjective. Mais Denis Kambouchner remarque que, si la revendication d’une identité culturelle implique « un certain acte de fermeture », elle ne parvient, en réalité, jamais à se définir « dans son ensemble », ni, vraiment, à se délimiter : ce concept de culture collective est donc « problématique » (p. 204) ! Renvoyant aux analyses de Louis Dumont sur les paradoxes de l’usage allemand des mots Kultur et Bildung (p. 205), l’Auteur pose finalement cette question : y a-t-il une contradiction entre la prétention universaliste (humanitas) et la réalité des cultures particulières ? Il y répond fermement en formulant trois arguments : les cultures communiquent entre elles, et l’universalité « se démontre constamment dans la pratique » ; de plus, c'est plutôt la cohérence et la clôture de telle ou telle culture particulière qui reste à démontrer ; enfin, le relativisme perd toute pertinence en dehors de son rôle purement épistémologique (p. 208).
Il ajoute en conclusion qu’en attendant une discussion serrée de la thématique des « droits culturels », il faut s’en tenir, du point de vue pratique, à l’idée que « les principes de laïcité [...] restent inconditionnellement valables » (p. 209). Contre « l’idole de l’identité culturelle », entrons dans la « civilisation qui n'est l’apanage de personne, parce qu’elle est toujours devant nous » (p. 210).
Le Chapitre 7 (« Rousseau et le temps des livres ») veut dissiper les malentendus qui sont nés des passages de l’Emile qui semblent discréditer la lecture. Ainsi, au Livre II : les livres sont pour les enfants « les instruments de leur plus grande misère », les livres rendent pédant, etc. Malgré Erasme et Locke, la morale ne s’apprendrait donc pas dans les « bonnes lettres » (p. 214). Kambouchner rappelle ici les thèses de Locke et de Condillac sur la formation des idées et leur influence sur la conception, par Rousseau, de l’éducation dite « négative », qui consiste en l’exercice des sens – d’où procède chez l’enfant la « raison sensitive », la considération des rapports de convenance, puis les idées d’utilité (p. 219). Il apparaît que la grande erreur, selon Rousseau, est de laisser entrer dans la tête de l’enfant, par l’effet des mots utilisés sans relation vivante avec les besoins, de « fausses idées » de la morale, d’où résultent un « égarement », voire un « dérèglement », dans les relations humaines et dans les passions mêmes (p. 225). « De lui-même, aucun livre ne peut instruire », il ne produirait qu’une « fausse culture » (p. 226).
Pourtant, Rousseau ne proscrit pas les livres. Car il y a Robinson Crusoé, ce « merveilleux livre » (Emile, III) ; il y a les livres des anciens, Plutarque, Homère, qui « disent peu et prononcent beaucoup » (Emile, IV) ! Ces œuvres-là n’empêchent pas Emile de sentir ni de penser. Puis il y a même un « temps des livres », un temps pour lire de l’histoire, et de beaux textes, qui participent à une « éducation du goût » (p. 228). D'ailleurs, La Nouvelle Héloïse conseille d’apprendre l’esprit critique par la conversation (p. 232). Bref, « nous sommes là tout près de Montaigne » (p. 231). Dernier argument en faveur des livres : « il faut aux enfants du mémorable » (p. 236). C'est aussi le propos de Charlotte Brontë (Jane Eyre) et de Henry David Thoreau (Walden ou la vie dans les bois), longuement cités.
Le Chapitre 8 (« Diderot et la question des classiques ») évoque le Plan d’une université ou d’une éducation publique dans toutes les sciences (1775). Diderot y développe pour Catherine II l’idée d’un cursus d’études choisies et ordonnées pour leur « utilité » (p. 241). Diderot fait mine d’admettre avec la souveraine que la morale et l’obéissance sont une suite logique de l’instruction. Tandis que Rousseau dénonce les travers de l’amour-propre (p. 245), Diderot fait, d’une manière « un peu optimiste ou lénifiante », l’éloge de l’émulation (p. 247). Sa pédagogie est celle de la clarté - d’où « la priorité donnée aux mathématiques » - et celle du livre (p. 249) : les modernes, le Discours de Descartes, la Nature humaine de Hobbes, d’Alembert, Newton, Linné.
Par contraste, nous voyons aujourd'hui que « tout livre classique [...] a disparu de notre enseignement » (p. 251). C'est l’effet de l’influence des « théories pédagogiques » et de « la marginalisation de l’autorité intellectuelle » (p. 252), de la « passion de l’égalité » appliquée aux livres scolaires (p. 253). Denis Kambouchner en appelle à « la diffusion de livres classiques, c'est-à-dire à vocation pédagogique » (p. 253). En tout cas, nous devrions traiter de ces questions : « Qu'est-ce qui demande à être enseigné ? », et : de quelles « Lumières » sommes-nous « nous-mêmes capables » (p. 255).
Le Chapitre 9 (« Durkheim et la crise des humanités ») s’arrête à un « moment-clé de l’histoire de l’éducation moderne en France » (p. 258) : celui où, dans les œuvres de Durkheim, la sociologie reçoit la mission de former « un concept exact de la morale » afin de parachever « sa laïcisation en identifiant dans la société elle-même la vraie source de nos obligations » (p. 260). Denis Kambouchner scrute « l’orientation anticlassique » (p. 264) du programme durkheimien. La culture littéraire est accusée d’aggraver « le développement d’une certaine morbidité sociale » (p. 265) ; sont dénoncés aussi la « culture esthétique intempérante », et le « rationalisme simpliste » issu de Descartes (p. 267). On devrait désormais préférer les sciences, surtout les sciences de la vie, qui éveillent à la complexité du réel (p. 267), et qui sont complétées par l’histoire et la sociologie.
Dans L’évolution pédagogique en France, Durkheim dénonce la routine des professeurs, leur misonéisme, les clivages entre spécialités, la « perte de foi » (p. 269-270). Il réhabilite la pédagogie médiévale, contre le raffinement de la Renaissance (p. 271), les artifices trop littéraires des jésuites (p. 272), loue le réalisme des protestants (p. 273), et l’œuvre de la Révolution (p. 274). Denis Kambouchner recense ensuite quelques partis pris de Durkheim, et ses sources (le positivisme, p. 278 ; le soutien aux humanités modernes par Gustave Lanson, p. 277-281). L’ennemi, c'est surtout la « rhétorique », c'est le « formalisme », c'est « la ‘‘fusion’’ artificielle ‘‘de l’idéal chrétien avec l’idéal romain et l’idéal grec’’ » (p. 285). Or, selon Durkheim, « l’esprit est fait pour penser des choses » : ce sont ainsi d’autres civilisations (p. 286), et la « culture logique » des sciences (p. 287), qui peuvent le mieux l’instruire. Cela dit, Durkheim admet que « l’étude du langage – c'est-à-dire de la grammaire et de la langue – constitue l’assise commune de tout enseignement » (L’évolution pédagogique en France, p. 398).
L’éducation intellectuelle durkheimienne associe donc culture des langues, culture scientifique et culture historique afin de rendre la raison autonome, à la manière cartésienne (p. 290). Cette discipline pédagogique, « essentiellement ascétique » (p. 293), non dénuée d’une « ingratitude », typiquement « moderne », à l'égard de l’éducation classique (p. 294), n’en fournit pas moins, selon Kambouchner, le concept robuste, nuancé, sinon inégalé, d’une « forme d’humanisme épuré et élevé aux dimensions du monde nouveau » (p. 295).
Cependant, on oppose volontiers ceux qui, tel Johann Friedrich Herbart, pensent que la formation de l’esprit résulte essentiellement des « contenus » qu’on lui présente ; et d'autre part les tenants de la pédagogie « progressiste », tel John Dewey, pour qui le « processus vivant lié à l’interaction de l’être avec son milieu » est décisif (p. 297). A cette aune, Durkheim n'est-il pas un conservateur, « républicain, jacobin, rationaliste affirmé », « normatif jusqu’à la caricature » (p. 298) ? Non, selon Denis Kambouchner, car on peut encore parler, malgré ses limites, d’un « modèle durkheimien » : en effet, pour enseigner, il faut « croire » à ce qu’on enseigne aux élèves, à l’objet qui est « visé » par l’enseignement (p. 299) ; et d'autre part, « lettres et sciences partagent une communauté de destin » (p. 300).
Le Chapitre 10 (« L’enseignement selon Foucault ») scrute d'abord la présentation de l’école - comme « machine disciplinaire », comme « police » de la production des discours (p. 305) - et de la science elle-même comme police disciplinaire des savoirs. De ce savoir normatif, l’enseignant, loin d’être un auteur, n'est qu’un « répétiteur » et un surveillant d’examen (p. 309), un « technicien » qui ne prend aucun risque (p. 311), et l’école « n'est plus le lieu d’un savoir authentique », voire « une institution du refus du savoir » (p. 312). L’école est un morne « purgatoire » (p. 314). A l’université, l’étudiant est, dit Foucault, un « exclu » ; ou plutôt, corrige Denis Kambouchner, il est dans un « sas où l’on apprend une forme douce et intellectualisée de soumission » (p. 315), et où la parole professorale est un « archaïsme » (Foucault, Dits et écrits, I).
Michel Foucault a reconnu avoir bénéficié comme professeur au Collège de France d’une liberté extraordinaire, exempt de rapports de pouvoir avec son auditoire, et revendique plus volontiers la « provocation érotique » de ses livres (p. 319). Il s'est plaint aussi de la contradiction entre la recherche authentique, transgressive, et les contraintes, normées, de l’enseignement public requis par le Collège (p. 322). Il ressort de cette opposition binaire que le métier d’enseignant est marqué par Foucault « d’une valeur négative » (p. 324). Mais, rétorque Denis Kambouchner, il est « pratiquement impossible d’enseigner sans chercher », et les enseignants sont des sujets, qui ne sont « pas absolument captifs » de l’appareil disciplinaire qu’ils servent (p. 325). Derrida, dans Du droit à la philosophie, le dit assez semblablement : certes, l’agrégé-répétiteur à Ulm est un expert attitré, représentant le pouvoir dominant ; mais c'est au même titre que les programmes qu’il expose sont par lui « enrayés, détournés, combattus » (p. 327) !
Que serait une école « post-disciplinaire » ? Voilà une question restée sans réponse. C'est pourquoi Denis Kambouchner lui substitue cette formule : « là où il y a le plus de savoir, il y a aussi le plus de liberté et de libéralité » (p. 328). Dès lors, dit-il en quelques phrases denses, l’école doit admettre qu’elle « montre » et « préfigure » « quelque chose au-delà d’elle » ; et cette expérience est solidaire d’un « anti-minimalisme culturel » (p. 329).
Le Chapitre 11 (« ‘‘Retrouver en soi l’enfant [Repuescere]’’ : réflexions sur un précepte classique ») invite à une « méditation » à partir du De Pueris statim et liberaliter instituendis d’Erasme. Le bon pédagogue, dit-il, use de douceur envers les enfants ; plus encore, pour être aimé de l’enfant, il faut d’une certaine manière qu’il redevienne enfant [praeceptor quodammodo repuescerat oportet] (p. 332). Sans négliger d’aucune façon l’apprentissage des « choses excellentes », que le maître se souvienne qu’il a été lui-même adolescent, plus encore qu’il entre avec l’enfant dans « une dimension ludique et jubilatoire » (p. 335). Il est vrai que le monde de la littérature gréco-latine « est lui-même un univers de jeu », et que « l’univers classique est d’avance pédagogiquement structuré » (p. 337). « La repuerescentia, c'est en somme la charité du maître ; c'est aussi la pédagogie en personne » (p. 339). C'est encore aujourd'hui, le type de médiation dont doit être capable le pédagogue lorsqu’il s’adresse, chez l’enfant, à « l’esprit adulte » capable de « discerner ce qu’il y a de sérieux dans le jeu même » (p. 340).
On voit à travers ce rapide parcours la diversité des analyses assumées par cet ouvrage. Denis Kambouchner s’y applique à un état des lieux scrupuleux des questions pédagogiques qui préoccupent - ou devraient préoccuper - les professionnels de l’enseignement et, au-delà, tous ceux qui, parents d’élèves et citoyens exigeants, accordent à l’école un rôle central dans notre vie publique.
Il se montre inquiet : l’idée que nous devons affronter une période de « dérèglement » y est insistante. Cependant, la mélancolie ne prend pas le dessus : le livre fourmille aussi de suggestions pratiques auxquelles ceux mêmes que le débat ne tentent pas peuvent trouver un fort intérêt à considérer.
Etienne Akamatsu