Lambert Wiesing, La Visibilité de l’image, Vrin 2014, lu par Jean Colrat
Par Florence Benamou le 02 juillet 2018, 06:00 - Esthétique - Lien permanent
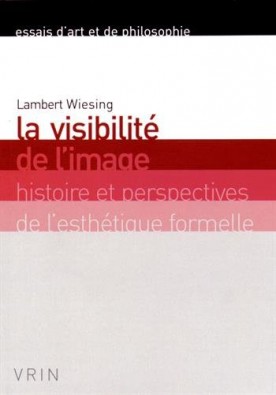
Lambert Wiesing, La Visibilité de l’image - Histoire et perspectives de l’esthétique formelle, tr. fr. Carole Maigné, Paris, Vrin, 2014 (320 p.). Lu par Jean Colrat.
La Visibilité de l’image. Histoire et perspectives de l’esthétique formelle permet de lire en français Lambert Wiesing. Le titre est explicite : l’auteur pose la question de l’essence de l’image, donne une réponse d’un nouveau genre et propose de la comprendre dans la perspective d’une esthétique formelle dont il construit un historique. Ce texte fut d’abord la thèse d’habilitation du philosophe allemand né en 1963, aujourd’hui professeur à Iéna. Il fut publié en allemand en 1996 et réédité en 2008. Depuis, au fil de nombreux ouvrages et articles, Lambert Wiesing est devenu une figure majeure de la bildtheorie qui, grâce à cette traduction établie par Carole Maigné, sera moins méconnue en France.
On peut présenter la bildtheorie (ou « théorie de l’image ») comme la part explicitement philosophique de ce qui, à la fin du siècle dernier, fut appelé iconic turn et/ou pictorial turn1. Simultanément, William J. T. Mitchell et Gottfried Boehm proposèrent ce tournant méthodologique affirmant que l’image dit et pense selon une logique qui n’est pas celle du signifiant linguistique. Même si la sémiotique peut bien faire parler les images, une véritable iconologie doit, selon les acteurs du tournant iconique, renoncer à une approche sémiotique de l’image. C’est contre le linguistic turn de Richard Rorty que s’est constitué l’iconic turn2. La bildtheorie n’est donc pas une certaine théorie au sujet de l’image. Plutôt l’affirmation que la question de l’essence de l’image se présente avec une spécificité et une actualité qu’elle n’a peut-être jamais eu depuis la crise byzantine du viiie siècle, et sous un jour si nouveau qu’elle impose, pour pouvoir être seulement posée, que l’on franchisse les frontières disciplinaires entre esthétique, psychologie, histoire de l’art, voire physiologie. La bildtheorie semble retrouver le programme du Socrate de l’allégorie : la situation de la philosophie est face aux images, et sa charge de savoir dire la différence entre les images et ce dont elles sont les images. Il aura donc fallu la profusion contemporaine des images, la nouveauté de leurs manières et la place qu’elles occupent dans nos espaces et nos temps pour que s’impose de replacer là l’essence du questionnement philosophique. La bildtheorie est à la fois moins qu’un corpus doctrinal au sujet de l’image, et beaucoup plus : une situation de la philosophie.
La Visibilité de l’image occupe une place singulière dans le corpus de la bildtheorie car l’ouvrage fut conçu au début des années 1990, avant que ces recherches ne reçoivent ce nom et que s’ouvre le champ des visual studies. Comme le constate l’Avant-propos à la réédition allemande de 2008, ajouté quand les mots et la chose étaient désormais bien installés, l’expression bildtheorie est quasiment absente du livre alors qu’il n’est question que de cela. Cette édition française, vingt ans après l’originale, nous place donc dans l’intéressante situation de lire un ouvrage qui prépare sans le savoir l’apparition imminente d’un champ d’études désormais bien installé.
Avant-propos
L’avant-propos de 2008, douze ans après la première publication, est essentiel puisqu’il ressaisit le projet à la lumière de ses effets. Wiesing s’y étonne de n’avoir employé que deux fois le terme bildtheorie. Pourtant c’est bien une théorie de l’image que veut construire ce livre et non une « science de l’image » ou une « sémiotique de l’image », jusqu’alors dominantes. Pas une « science de l’image », car la science de l’image qui étudie les images dans leur particularité est foncièrement empirique3, tandis que la bildtheorie « veut savoir ce que signifie aborder quelque chose en tant qu’image ou quelles propriétés doit avoir cet objet pour être une image » (p. 14). C’est un savoir qui porte sur le concept, sur la bildlichkeit (traduit ici par imagéité). Contre l’approche sémiotique, Wiesing affirme que la fonction de signe ne rend pas compte de l’image en tant que telle, c’est-à-dire selon l’auteur : dans sa visibilité. Les images ne sont pas en tant que telles des signes, qui se manifestent dans des usages, alors que l’imagéité « est une propriété perceptible des choses, et non pas le résultat d’un usage des objets ». C’est dans sa visibilité qu’il faut chercher la spécificité de l’image, et cette visibilité de l’image, Wiesing la nomme « pure visibilité ». Ce concept, forgé par Benedetto Croce pour parler de Konrad Fiedler, signifie que dans l’image, la chose vue consiste exclusivement dans sa visibilité, délestée de tous les prédicats qui caractérisent son existence mondaine4. Une table en image, c’est une table dont l’être égale la visibilité. Ni plus (pas la table du menuisier), ni moins (pas une duperie). La pure visibilité est une catégorie ontologique, propre à ce genre d’étant que l’on appelle image. C’est cette manière d’être fragile qui subsiste entre le moment où le regard s’enfonce dans la matérialité opaque (surface, pigments, pixels) de la chose trop présente qui fait image et celui où il s’évade vers la chose très absente que désigne l’image devenue transparente. Wiesing parle alors de « présence artificielle5 ». La pure visibilité n’est pas le seul aspect des images, ni le plus important lorsqu’elles sont des œuvres d’art, dont on ne peut pas nier que la matérialité et la signification soient essentielles, mais le livre porte sur autre chose : « ce qui fait que quelque chose est une image » (p. 19). L’œuvre d’art n’est pas l’objet privilégié de la bildtheorie, même si elle doit y jouer un rôle décisif, car il y eut au xxe siècle, des images produites en vue de leur seule visibilité, des images asémantiques (collages, vidéoclips, jeux informatiques). Ces images quasi dématérialisées et sans effet de dénotation sont en quelque sorte plus « purement visibles » que toutes les autres. Elles supposent pour leur compréhension, et présupposent pour leur existence, une théorie de l’image nouvelle, que veut être La Visibilité de l’image.
Introduction
L’introduction de la première édition indique l’origine du projet, sa visée et sa méthode : « Les études ici présentées s’appuient sur un diagnostic : l’image au 20e siècle s’est émancipée des fins de représentation, elle est produite et regardée eu égard à sa pure visibilité. C’est pourquoi une question se pose : où et quand une compréhension de l’image s’est-elle développée, de telle sorte qu’aujourd’hui il paraisse évident d’user des images sans visée informative sur leurs objets ? La réponse et la principale thèse historique de ce travail est la suivante : dans l’esthétique formelle. » (p. 28)
Le motif de cette thèse, c’est l’afflux des images au xxe siècle. Ce qui pourrait être un constat banal devient avec Wiesing l’occasion d’une hypothèse : cet afflux ne peut s’expliquer par les usages auxquels ces images servent. Elles s’imposent comme fin, et l’image en tant que fin est pure visibilité. C’est pourquoi cet afflux se double d’une nouveauté qualitative : l’apparition d’images déliées de fonction déictique, condition première de leurs divers usages. C’est l’histoire spécifique de l’image au xxe, depuis l’abstraction jusqu’aux figures des jeux vidéo, qui semble afficher la loi iconique, aussi essentielle que secrète : « les images sont des dématérialisations qui transforment un objet en pure visibilité » (p. 29). Les images contemporaines, dans leur double nouveauté quantitative et qualitative imposeraient donc de reprendre la question de l’être de l’image comme pure visibilité et c’est en revisitant l’esthétique formelle, issue de Herbart, que Wiesing construira sa thèse. L’ouvrage sera donc à la fois une ontologie de l’image et un travail d’historien, restaurant une esthétique négligée, qui va des philosophes Herbart et Zimmermann aux historiens de l’art Riegl et Wölfflin, en passant par la figure essentielle de Konrad Fiedler.
Chapitre 1. Les débuts de l’esthétique formelle : Robert Zimmermann (1824-1898).
Le parcours dans l’esthétique formelle du xixe commence avec Robert Zimmermann, et Wiesing indique ce qu’il y a d’intempestif à retourner vers ce formalisme oublié, en un temps où l’esthétique analytique (Dickie) ou l’esthétique de la réception (Jauss) délaissent l’objet au profit de l’expérience esthétique. Avec le formalisme, c’est bien un retour du côté de l’objet qui est tenté. La critique de l’idéalisme hégélien par Herbart (1776-1841) est ici matricielle. Avec Hegel « le beau se définit comme le paraître sensible de l’idée6». La beauté est dans le pouvoir expressif de la forme à faire paraître l’idée. L’idéalisme est donc une esthétique classique de l’unité du fond et de la forme. Herbart affirme au contraire l’autonomie de la forme et du contenu. Zimmermann veut établir cette autonomie esthétique du formel7. La forme n’est pas un contour, mais un ensemble de rapports qui peuvent être soumis à l’étude logique. Il ne s’agit pas de se demander comment telle forme simple pourrait être belle, la forme est toujours un complexe. L’esthétique de Zimmermann est un exemple de l’usage que Wiesing veut faire de cette étude du formalisme herbartien : cette esthétique est biface, d’un côté rétrograde dans sa façon, tournée vers Kant, de maintenir la question du beau comme centrale, d’autre part ouvrant une perspective pour le xxe dans sa façon de définir l’objet esthétique comme structure relationnelle. En se référant aux écrits théoriques de Kurt Schwitters, Wiesing montre le rapport entre ce formalisme et les premiers collages abstraits. De façon plus générale, « l’absolutisation de la visibilité de la surface » qui caractérise plusieurs images du xxe ne peut plus être pensée avec une esthétique du contenu. Le travail de Zimmermann peut servir pour « tenter de voir positivement le dédoublement de la forme et du contenu » (65), positivité de la séparation qui ne fait pas problème en logique. Mais chez Zimmermann ce logicisme va conduire à la contradiction : en cherchant à penser la beauté comme un ensemble de rapports formels déterminables a priori, objectivement présent dans l’objet beau, Zimmermann en vient finalement à replacer le beau dans une forme idéale. Cela est dû à un excès de logicisme et c’est pourquoi Wiesing va plutôt étudier la façon dont cette esthétique formaliste s’est développée chez certains historiens de l’art.
Chapitre 2. Esthétique formelle et logique des relations. Aloïs Riegl (1858-1905).
Le deuxième chapitre veut montrer comment l’historien d’art Aloïs Riegl (1858-1905), élève de Zimmermann, va faire évoluer ce formalisme. Avec Riegl, le formalisme n’est plus normatif mais descriptif parce que sa question n’est plus celle de la nature du beau mais de la diversité des styles : « Tout ce qui est, est beau [mais] tout ce qui est n’a pas nécessairement de style » (cité p. 72). Le formel dans l’objet, les relations immanentes à cet objet, ne décide pas de sa beauté mais de son style, et la question de l’historien de l’art devient celle des différentes façons dont s’établissent ces relations entre les parties et entre les parties et l’ensemble. Wiesing expose alors comment Riegl fait de la différence entre deux formes de vision (optique et haptique), la différence stylistique fondamentale entre le pictural et le linéaire8. L’origine formaliste, via Zimmermann, de cette notion de style a pour conséquence qu’un style est ici moins lié à une époque ou un tempérament qu’à quelques transcendantaux par lesquels une forme peut se construire dans le visible. Ce style a donc une réalité objective. Les styles dont parle Riegl ne se confondent pas avec les styles que l’historien de l’art prétend discerner dans le cours des œuvres, ils en sont plutôt les conditions syntaxiques, formelles. Ainsi s’accomplit chez Riegl le programme herbartien d’une esthétique comme science a priori. Chaque forme déterminée résulte d’une certaine façon de mettre en œuvre ces conditions, et cette mise en œuvre apparaît comme une décision, une « volonté d’art » (kunstwollen). Wiesing montre de façon convaincante comment cette célèbre notion riegelienne s’enracine dans la philosophie de Schopenhauer, qui introduit le concept de visibilité dans le deuxième livre du Monde comme volonté et représentation pour signifier que dans toute production de forme visible, il y a un reste qui ne peut être expliqué historiquement ou psychologiquement. La conséquence est que l’on peut parler d’une rationalité pré-conceptuelle de la visibilité formelle : « le pictural et le linéaire sont les différents types d’une rationalité directement visible à la surface de l’image ». G. Boehm parlera lui d’une « tendance au concept » de l’image. Wiesing montre comment cette pensée se trouverait aussi dans la phénoménologie de Husserl ou d’Alfred Brunswick (phénoménologue oublié), chez Nietzsche ou chez Hermann Nohl dans Style et vision du monde (1920). L’assimilation des concepts fondamentaux en art (optique/haptique) à des catégories logiques, impose d’expliquer ce que veut dire logique ici. Wiesing le fait en comparant ce formalisme à la logique formelle des relations qu’A. Pierce, E. Schröder et A. De Morgan développent au même moment. Sans négliger les différences entre une logique de l’entendement et une logique de l’espace, il montre comment Riegl a cherché à mettre au point une logique formelle des relations esthétiques. Autrement dit : la pure visibilité possède une rationalité.
Chap. 3. La logique des manières de voir : Heinrich Wölfflin (1864-1945)
Ce chapitre est consacré à l’historien d’art Heinrich Wölfflin. Il veut montrer comment son travail, en particulier ses Principes fondamentaux de l’histoire de l’art parus en 1915, s’inscrivent dans le courant formaliste déjà décrit. Si les Stilfragen de Riegl faisaient de la différence entre le pictural et le linéaire la différence stylistique fondamentale, il est bien connu que Wölfflin enrichit la palette des catégories formelles avec quatre oppositions nouvelles : surface/profondeur, forme fermée/forme ouverte, multiplicité/unité et clarté/obscurité. Mais Wiesing propose ici une lecture peu orthodoxe de cette typologie. Si Wölfflin a prudemment réservé la pertinence heuristique de ces catégories à la différence entre le classique et le baroque, Wiesing les étend à la totalité des images, après avoir essayé d’établir entre elles des possibilités combinatoires plus souples que chez Wölfflin. Ces couples deviennent les conditions a priori de toute visibilité iconique. Wiesing prétend même montrer que ces catégories wölffliniennes sont assez identiques aux réglages informatiques que proposent les logiciels de traitement d’images, qui deviennent ainsi de véritables générateurs de pure visibilité. Et si Wölfflin a négligé la couleur, comme si elle ne s’inscrivait pas ou peu dans l’ordre du formel, Wiesing propose de réparer cet oubli en complétant les catégories wölffliniennes par le couple contraste/harmonisation, qui décrirait les conditions a priori de la coloration du visible iconique.
Wiesing montre ensuite que ces conditions formelles de la production (i.e. présentation) sont pensées par Wölfflin comme également engagées dans nos représentations intuitives du monde visible : les manières de montrer sont identiques aux manières de voir. L’esthétique formelle devient ainsi une théorie de la perception cherchant à définir ses formes a priori. L’intuition serait un medium au même titre que les mediums artistiques. Wölfflin se revendique ici du Kant de l’esthétique transcendantale, et non celui de l’analytique du beau. L’art est à la perception ce que la science est, chez Kant, à l’entendement : la possibilité de retrouver dans l’objet sa propre légalité a priori. À cet instant, le projet de Wiesing est transparent : relire l’histoire d’une esthétique formaliste essentiellement consacrée à l’art pour y trouver les ressources d’une théorie des images comme pure visibilité. Une différence majeure s’impose pourtant avec Kant : les principes fondamentaux de Wölfflin sont des couples, dont les termes décrivent des possibilités limites entre lesquelles la présentation d’images doit se déterminer. Autrement dit : si les catégories de Wölfflin sont nécessairement engagées dans toute intuition et toute présentation, la manière dont elles déterminent le visible est multiple. Ces formes a priori sont changeantes, elles définissent des styles de vision, (qui ne sont jamais des styles individuels ou nationaux chez Wölfflin : voir pour cela la célèbre introduction à ses Principes fondamentaux). Cette relativisation de l’a priori kantien ancre dans la vie le style de déploiement de ces formes, et Wiesing de rappeler ce que cette conception du sujet pourrait devoir à Dilthey dont Wölfflin fut l’élève. On assiste ici à une historicisation de la subjectivité transcendantale, hérétique certes, mais fructueuse. Wiesing rappelle que Wölfflin n’a pas l’exclusivité de cette transgression au début du siècle, la Philosophie des formes symboliques de Cassirer étant le cas le plus connu. Si l’espace est forme a priori, Kant ne voit pas que l’espace mathématique euclidien est un style de relations spatiales, dominant certes, mais parmi d’autres possibles, tous aussi formels.
Chapitre 4. De la manière de voir à la visibilité. Konrad Fiedler (1841-1895)
Ce chapitre est le plus long de l’ouvrage parce que les trois ambitions du livre (ontologie de l’image, théorie de la pure visibilité et histoire de l’esthétique formelle) s’y réunissent et s’y accomplissent, grâce à l’étude de Konrad Fiedler, figure la moins connue mais la plus radicale de cette esthétique formelle.
L’étude de Fiedler est d’abord l’occasion de systématiser ce qui précède. Une esthétique formaliste peut se fonder sur l’assimilation du beau au formel (esthétiques de Herbart et Zimmermann) ou sur l’assimilation néo-kantienne de l’art à la présentation des diverses formes de vision (histoire de l’art selon Wölfflin et Riegl). En dissociant le beau et l’art (c’est une thèse principale de Fiedler : le beau n’est pas l’affaire de l’art, une philosophie de l’art ne peut-être une esthétique ou une callistique), Fiedler est à l’origine de ce formalisme caractéristique dans l’histoire de l’art vers 1900. Cette double possibilité définit les deux premiers degrés d’une théorie de l’image comme pure visibilité, dans la mesure où toute référence à un ailleurs de l’image y est secondarisée. Wiesing a pourtant montré comment l’image n’y atteint pas une pleine autonomie qui lui permettrait de consister dans sa seule visibilité. Herbart et Zimmermann ne peuvent éviter de référer l’image à un idéal formel, tandis que Wölfflin et Riegl font de l’image la présentation d’une manière de voir. L’image continue d’être l’image de quelque chose, même si le quelque chose en question n’est plus une chose. Trop de transitivité et de transparence, pas assez d’autonomie ni d’opacité. Mais Wiesing montre alors comment Fiedler, dans les derniers chapitres de Sur l’origine de l’activité artistique (1887), dépasse ce néo-kantisme vers un formalisme de la pure visibilité. L’image artistique n’y est plus définie par le travail de mise à jour des conditions a priori des manières de voir, mais par celui de construire un objet dont l’être ne serait que visibilité : « Son esthétique est donc une invitation aux artistes à trouver une forme d’image dont la maxime serait : cesse de vouloir interpréter le monde en produisant une image de la réalité visible, et tente à la place de comprendre la création de l’image comme construction d’un objet où la visibilité serait une forme autonome de l’être ! » (p. 187). Même si Wiesing ne le mentionne pas, c’est surtout dans les Aphorismes de Fiedler qu’apparaît ce phénoménisme intégral de type berkeleyen, qui récuse la dualité kantienne du phénomène et de la chose en soi et qui délie la production d’images du travail de mise à jour des formes constitutives du voir. C’est dans cette radicalité fiedlerienne que le projet de Wiesing se justifie : trouver dans l’histoire de l’esthétique formelle la possibilité de penser la visibilité comme finalité principale de l’image. C’est donc logiquement dans ce chapitre que l’essentiel de l’apport théorique de Wiesing à une théorie de l’image se trouve, dans la section intitulée « Les images produites techniquement en fonction de leur seule visibilité ». C’est là que Wiesing va montrer quel genre d’image correspond à l’ultime philosophie de l’art de Fiedler. On comprend alors qu’un des motifs principaux de cette thèse soit l’étude des techniques contemporaines de l’image (vers 1990), dans lesquelles Wiesing décèle le règne d’une pure visibilité.
Au fil d’une subtile phénoménologie, Wiesing distingue quatre formes de visibilité : les visibilités fixe du tableau, mobile du film, manipulable de l’image numérique, interactive de la simulation par ordinateur. La distinction est une progression, au cours de laquelle s’accroit le « processus d’isolement de la visibilité », selon les mots de Fiedler. Dans les deux premiers cas, le spectateur ne peut intervenir sur la visibilité qui lui est donnée. Le traitement numérique va permettre de faire émerger une pure visibilité manipulable : « le traitement numérique de l’image est fait pour traiter l’apparaître pictural comme une forme d’être » (p. 205). Le personnage d’un jeu video ou la maison produite par un logiciel d’aide à l’architecture n’ont pas d’autre réalité que leur visibilité. Avec la simulation – un simulateur de vol par exemple –, un pas est franchi : « La visibilité d’une simulation se comporte comme si elle était liée à des propriétés physiques et psychiques, bien qu’elle soit sans substance. La visibilité désubstantialisée par l’apparence de l’image est artificiellement substantialisée dans la simulation, elle est dotée de comportement, de résistance, de volonté (…) L’apparence gagne en potentiel et devient alors paradoxalement une forme de l’être » (p. 199). La visibilité du tableau ou du film correspond au type de visibilité pensé par Riegl ou Wölfflin, celle de l’image numérique manipulable et plus encore celle de la simulation correspondent à Fiedler, dont la radicalité en termes de pure visibilité apparaît alors comme l’ontologie appropriée à l’imagerie de la réalité virtuelle.
Ceci montre que c’est la forme des médias plutôt que les modalités artistiques qui décide des nouvelles formes de visibilité. Wiesing appelle cela le medienwollen, le vouloir des médias. Dans l’image-simulation, la simulation peut être saisissable (lorsqu’elle se fait sur écran) ou insaisissable lorsque le simulateur de vol n’est pas simplement un écran. Cette seconde simulation peut aller jusqu’à créer tout l’environnement en image, à 360°, dans le cyberespace, où il n’y a plus d’environnement non-imagé. « L’effet du cyberespace est évident : un monde visible apparaît qui ne possède aucune matérialité, pas même celle du support de l’image » (p. 208). Ceci correspond exactement au moment fiedlerien, quand l’apparaître devient une forme d’être : « Le cyber-espace est le point final d’une absolutisation achevée de la pure visibilité. Cette dernière, qui constitue un aspect de toute image, en devient la totalité, entraînant ainsi l’image jusqu’à ses propres limites »(p. 209)9. Dans le cyber-espace qui réalise un monde visible davantage qu’il ne le présente, il est absurde de penser l’image comme un signe. Et Wiesing de conclure que si la notion de vérité de l’image a encore un sens dans le formalisme de Herbart/Zimmermann ou de Riegl/Wölfflin (conformité à un idéal formel ou à une manière historique de voir), on doit y renoncer dès que l’on passe à la visibilité numérique du jeu video ou des simulateurs.
Ce chapitre sur Fiedler a donc établi qu’il y a trois façons pour l’image d’échapper à l’être de la transitivité. Le premier est celui par lequel l’image, indépendamment de ce qu’elle figure se manifesterait comme un ensemble de relations formelles. C’est le formalisme de Herbart ou Zimmermann, dont Wiesing considère qu’il retombe finalement dans une conception sémiotique de l’image parce que l’image y serait la représentation d’un idéal formel. Le moment de pure visibilité finirait par disparaître au profit de ce dont l’image est l’image. Le deuxième ordre est celui du formalisme des manières de voir (Riegl, Wölfflin, et « premier Fiedler »), dans lequel l’image ne montre pas quelque chose mais montre la manière de voir (et l’on a vu que pour Wiesing cela revenait tout de même à montrer quelque chose, de telle sorte que cette sorte de pure visibilité n’est pas totalement pure). Le troisième ordre correspond à la visibilité numérique des logiciels de production d’images ou de réalité simulée. L’image y est absolument détachée de toute référence iconique, il n’y a rien d’autre à voir que ce qui est à voir. Il est théorisé par ce que l’on pourrait appeler, selon la lecture de Wiesing, le second Fiedler.
Chapitre 5 : Réduction phénoménologique et abstraction imagée : Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) et Chapitre 6 : De la formule au discours formatif : Charles William Morris (1901-1979)
Les deux derniers chapitres constituent un ensemble homogène dont le contenu surprend doublement, car l’ancrage historique déborde l’esthétique formelle vers la phénoménologie et la logique de Charles W. Morris, et parce que Wiesing retourne vers un ordre médian de pure visibilité, celui des manières de voir et de l’art abstrait, alors que grâce à « Fiedler 2 » Wiesing semblait avoir atteint la forme radicale de pure visibilité dans les images par simulation numérique. Les raisons sont d’abord que le xxe est à la fois un temps d’accélération dans la production d’images relevant de la pure visibilité et celui du déclin théorique de l’esthétique allemande de la forme. Wiesing cherche donc où cette esthétique de la pure visibilité a pu se développer au xxe. Le second étonnement s’explique sans doute par l’analyse de la réalité virtuelle à laquelle « Fiedler 2 » conduit Wiesing : ces images sont à ce point intransitives que l’on peut se demander dans quelle mesure elles peuvent encore être appelées images. Ni ombres caverneuses, ni choses du monde, elles semblent exister dans un espace dont la numérique luminosité abolit la distinction entre les images et les choses. Leur visibilité semble s’être épurée jusqu’à faire disparaître leur statut iconique. L’étude de l’art abstrait menée à la lumière de Merleau-Ponty et de Morris permettra de revenir à une ontologie de l’image qui est l’ambition de cet ouvrage. Wiesing accomplit donc ici le pas que l’on a souvent reproché à Wölfflin de n’avoir pas osé : appliquer ses Principes fondamentaux de l’art à l’art abstrait, plutôt qu’aux arts figuratifs.
Il ouvre cette analyse de l’art abstrait en affirmant que le geste caractéristique de la phénoménologie husserlienne s’inscrit, pour la question de l’image, dans la continuité de l’esthétique formelle et la théorie de la pure visibilité, surtout dans les derniers écrits de Merleau-Ponty. Le rapport entre l’esthétique formelle et la phénoménologie semble évident à Wiesing : le processus de mise hors-jeu de tout ce qui dans l’image ne relève pas de sa seule visibilité est une opération de réduction homogène à l’épochè que le phénoménologue veut appliquer à tout ce qui se donne dans la thèse naturelle du monde. Le formalisme, tel que Fiedler le pense, serait une épochè limitée au monde des images, où il s’agirait de s’en tenir à ce qui est donné à même l’image, sans transcender ce donné vers l’existence d’un quelque chose existant dont l’image serait l’image. Mais Wiesing inverse immédiatement le rapport. Le formalisme de la visibilité n’est pas un cas particulier de l’attitude phénoménologique, il en est la vérité et surtout la seule possibilité réelle : « Si l’idée originelle de Husserl concernant la réduction phénoménologique s’empêtre dans des apories, cela implique que l’idée d’une épochè n’a de sens que dans la contemplation de l’image » (p. 236). Donc : « La visibilité est le véritable thème de la phénoménologie, de même qu’inversement, l’esthétique formelle est une phénoménologie avant la lettre. (p. 244).
Les « apories » où « s’empêtre » Husserl, ce sont celles qui le conduisent à instaurer un ego transcendantal, faute de pouvoir situer ailleurs la donnée réduite. Or la réduction de l’image à sa visibilité permet d’échapper à ce « défaut », car « le phénoménologue reste face à une image, même après la réduction (…) Il prend pour objet la surface de l’image. Cette surface est un phénomène, qui se place dans les présentations entre l’objet et le sujet, permettant ainsi de ne pas régresser dans le purement subjectif » (p. 239). La réussite phénoménologique du formalisme esthétique tiendrait donc au fait que cette réduction livre véritablement une évidence : celle qui se tient à « la surface de l’image » et qui se nomme : pure visibilité. Wiesing affirme alors que le dernier Merleau-Ponty serait celui qui a su voir cela, et faire de la visibilité le véritable thème de la phénoménologie, au-delà des seules images.
Le peintre abstrait, comme le phénoménologue, opèrerait donc une réduction du visible à sa pure visibilité, avec cette différence que le produit de la réduction serait accessible dans l’attitude naturelle. Considérant « l’art abstrait » comme un tout homogène (Wiesing revendique cette indifférenciation et le refus d’évoquer tel ou tel artiste particulier), Wiesing l’analyse à partir d’un propos de Merleau-Ponty : « le peintre jette les poissons et garde le filet ». Le filet ne serait pas ici l’outil du pêcheur, mais « l’infrastructure planimétrique » permettant la figuration, la condition du visible, la visibilité même. L’art abstrait serait donc la mise en image du voir, il montrerait les conditions de la mise en image.
Le tableau abstrait n’a pas de signification objectuelle (il n’est pas une transparence vers un objet), mais il n’est pas pour autant un simple motif décoratif (une pure opacité, une chose ne renvoyant qu’à elle-même). Ce dernier point en particulier est désigné comme « l’expérience cruciale » du formalisme. Une théorie formaliste de l’image doit parvenir à secondariser la dimension objectuelle de l’image sans la réduire au rang de motif décoratif, comme un art abstrait doit parvenir à supprimer la figure sans passer au stade du décoratif géométrique. Il y a ici une identité de problème pour le théoricien formaliste et l’artiste abstrait. Wiesing se réfère alors à l’usage que fait Merleau-Ponty de la notion de style pour penser cette capacité à présenter non pas les choses, mais une manière de voir les choses : « le style est ce moyen par lequel on peut construire une signification dans l’image. Sans une certaine mise en forme de la surface, on ne peut présenter aucun objet. L’abstraction dans l’image est une mise à l’écart totale de l’objet au profit d’une image tournée « vers elle-même », et même vers les méthodes plastiques qui sont à disposition pour capturer quelque chose par l’image. Ce n’est rien d’autre qu’une mise en forme de la surface par des formes visibles. L’abstraction est une forme d’autoréflexion plastique sur ce processus (…) L’abstraction devient ici réduction phénoménologique, accomplie par l’image. La convergence entre abstraction et réduction phénoménologique tient à ce qu’on isole la surface de l’image pour qu’elle devienne un aspect visible de l’image, tout en rendant l’objet artificiellement absent. » (p. 247) L’artiste abstrait et le phénoménologue « cherchent à amener à l’intuition les conditions sous lesquelles on peut présenter quelque chose dans une image. Il s’agit d’une réflexion sur l’émergence des images. Les images abstraites portent à l’intuition la réflexion sur l’image dans la forme d’image. » (p. 249)
C’est toute image, abstraite ou non, artistique ou non, qui contient ce moment de pure visibilité, dans lequel abstraction faite de ce qui se montre, la visibilité elle-même se manifeste. Mais le plus souvent, ce moment de pure visibilité est recouvert dans l’image par les usages qu’elle propose ou que l’on en espère, qui la font tomber du côté de l’illustration signifiante ou de l’intransitivité décorative. Il faut devant toute image être capable de faire ce travail d’abstraction pour la percevoir en tant qu’image. L’image abstraite fait elle-même ce travail pour le spectateur : « la particularité d’une image abstraite réside en ce qu’on peut la considérer dans l’attitude naturelle comme une image objectuelle issue de l’épochè. La nécessité de mettre entre parenthèses le rapport à l’objet et la dimension contre nature de la saisie formelle disparaissent dans une image abstraite. L’image abstraite montre à un spectateur normalement disposé ce qu’une image objectuelle peut montrer à partir d’une position artificielle (p. 250) » (cette position artificielle que doit prendre le spectateur face à une image figurative pour ne pas se laisser emporter vers ce que l’image prétend signifier). D’où cette affirmation : « Dans toute image objectuelle est inscrite une image abstraite comme une partie non interrogée ». Toute image se dédouble donc en image objectuelle et en image abstraite, et c’est ce rapport que Wiesing cherche à penser ultimement en faisant appel à la logique de Charles W. Morris. Ce n’est pas le chapitre le plus convaincant, et il semble souvent relever du côté « thèse » de toute thèse qui veut se conclure. Il reste que la mise à jour de cette image abstraite dans l’image est le moment de saisie formelle de l’image. Wiesing ignore peut-être trop que cette analyse de l’image abstraite ne peut correspondre à la totalité de l’art abstrait, ni peut-être même à sa plus grande partie. Mais elle conviendrait assez bien aux premières images abstraites de Mondrian (arbres, océan et jetée, vers 1912-1914) ou bien aux premières abstractions de Kandinsky. Cette capacité de l’art abstrait à produire des images qui conservent un horizon de transitivité sans pourtant donner l’image de quelque chose, est résumée dans la dernière phrase du chapitre 5 : « Les images abstraites exigent une progression phénoménologique : qui voit sur une image abstraite autre chose que des formes, échoue autant que celui qui ne voit que des formes ».
La Visibilité de l’image de Lambert Wiesing est donc un ouvrage complexe, attentif à la diversité des images et multipliant les ressources théoriques pour proposer, aux premiers temps de la bidtheorie, une ontologie de l’image. On peut considérer que cette ambition élevée n’est pas pleinement accomplie ici, mais ce travail a le mérite de remettre à l’ordre du jour une esthétique formelle oubliée sinon décriée et de penser (très tôt) les formes nouvelles de l’image (numérique) avec une rigueur dont manque la profusion des analyses de la pop philosophie. Il eut surtout, et conserve, le mérite d’avoir voulu resituer la philosophie au pied du mur qui est le sien selon le Socrate de la République, le mur des images.
Jean Colrat
Notes
- W. J. T. Mitchell, « The pictorial turn », Artforum, mars 1992 repris dans Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago, 1994 ; Gottfried Boehm : « Die Wiederkehr der Bilder », dans Was ist ein Bild, Munich, 1994, p. 11-38.
- Une très utile présentation de ce pictorial turn est accessible en ligne, dans la revue Trivium (2008, n°1, « Iconic turn et réflexion sociétale »). Il faut aussi signaler la contribution essentielle des 3 ouvrages dirigés par Emmanuel Alloa parus aux Presses du réel : Penser l’image (2011, 2015 et 2017).Il faut noter que pour G. Boehm, la réflexion sur la logique des images est davantage un fondement pour la sémiotique qu’une opposition (voir « Par-delà le langage ? Remarque sur la logique des images, in Trivium, 2008 ; op. cit.)
- Wiesing conteste en outre, avec Horst Bredekamp, Gottfried Boehm ou Hans Belting, que l’histoire de l’art ne soit qu’une partie de cette science de l’image.
- Voir Benedetto Croce, « La Théorie de l’art comme pure visibilité » (1912), (tr. fr. in L’année 1913, vol. III, Klincksieck, 1973)
- Ce sera le titre d’un ouvrage de Lambert Wiesing paru en 2005.
- Esthétique, tr. fr. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Paris, Aubier, 1997, tome 1, p. 153.
- Voir Carole Maigné, Une science autrichienne de la forme. Robert Zimmermann (1824-1898), Vrin, 2017 ; ainsi que Formalisme esthétique. Prague et Vienne au xixe, dir. C. Maigné, Vrin, 2012 (je me permets de signaler ma recension de cet ouvrage sur ce site).
- Cette distinction, essentielle dans l’histoire de l’art formaliste depuis la fin du xixe, oppose une manière de voir qui se produirait et se penserait sur le modèle d’un toucher à distance à une manière de voir qui relèverait exclusivement des conditions propres au voir. Elle a d’abord été proposée par le sculpteur et théoricien allemand Adolf von Hildebrand (1847-1921). Voir Le problème de la forme dans les arts plastiques [1893], tr. fr. E. Beaufils, L’Harmattan, 2002.
- Sur cette question de la réalité virtuelle, traitée ici de façon précoce vers 1990, voir le prolongement que proposera L. Wiesing dans « Réalité virtuelle : l’ajustement de l’image et de l’imagination », Trivium, 2008, op.cit., (http://journals.openedition.org/trivium/288).N