Regis Debray, Modernes Catacombes, Gallimard, 2013, lu par Bernard Dufour
Par Cyril Morana le 23 avril 2013, 06:05 - Histoire de la philosophie - Lien permanent

Régis Debray, Modernes Catacombes, Gallimard, 2013, 309 pages
Le livre de R.Debray regroupe vingt-cinq publications autour du genre propre à la France de la littérature d’action et confronte la génération d’écrivains contemporaine de la guerre de 39-45, qui, dans la « ligne de Chateaubriand », fut la dernière à s’être pensée dans une histoire, avec une modernité qui refuse désormais toute médiation et enterre tout ce qui la dépasse.
Le premier texte est une réponse en forme de pamphlet à l’adresse de P. Sollers qui a accusé l’auteur d’être passé de De Gaulle à Guévara. Sollers est pour Debray le reflet exact du monde littéraire d’aujourd’hui. Ecrivain caméléon, homme de tous les revirements, esthète narcissique uniquement soucieux d’occuper le terrain médiatique, c’est le repoussoir du livre. Chez lui révoltes et transgressions, libertarisme et terrorisme culturel ne visent qu’à flatter une société qui ne connaît plus que l’impératif du plaisir. Son œuvre, à l’image d’une vie sans grandeur ni gravité, ne peut être que vide car il n’est pas de beauté sans souffrance.
Foucault semble d’abord pris dans le même reproche de conformisme avec la différence que cet authentique savant, écrivain de grand style à l’intelligence scrupuleuse et souriante, n’a jamais recherché un tel rôle. Il a néanmoins été « béatifié » par une génération qui a vu en lui le philosophe qui réconciliait les extrêmes : disparition du sujet et construction de soi par une éthique du plaisir, comme Bergson avait réuni l’Esprit et l’Evolution. Plus sévèrement, outre son anticommunisme passionnel, Debray reproche à Foucault d’avoir préféré le document à la vie, la discontinuité des épistémé à la praxis, le synchronique au diachronique, l’énoncé à la croyance, en bref l’ordre du discours à l’épaisseur du monde, alimentant la chimère d’une société sans mythes. L’histoire est absente des Dits et écrits et on y cherche vainement une entrée sur l’identité, les médias ou la mondialisation. Son grand mérite est certes d’avoir : « positivé la notion de pouvoir » mais dans une vision quasi-vitaliste qui en a fait une catégorie ontologique affablissant toute autorité et déconsidérant l’institution comme contraire à la liberté.
En contraste, Debray se livre à une vigoureuse défense de Breton contre l’accusation, aujourd’hui passe-partout, de totalitarisme. Refusant les images, homme courageux et inflexible dans ses choix, Breton était le contraire d’un médiocrate et d’un esthète. S’il ne fut pas Résistant il rejeta très tôt tout fascisme et se montra sévère pour le stalinisme d’Eluard et d’Aragon. Sans doute ce « créateur-bricoleur » eut-il une connaissance fantaisiste de l’inconscient mais peu de courants ont, comme le surréalisme, « transformé notre sensibilité à la vie », bousculant les grands mots et les vieux dualismes de la culture occidentale et l’obligeant à se tourner vers le monde. De Ténérife à Fort de France et à Mexico, toujours du côté des vaincus et de l’émancipation des faibles, Breton a fait du poème une fraternité. Esprit religieux au fond, loin du nihilisme de Dada, il vit dans l’écriture non une transcendance naturelle ou révélée mais un acte « au service d’une aventure plus grande qu’elle » et un merveilleux « capable d’au-delà ».
La littérature d’action, nous dit alors Debray, n’est pas sans rapport avec la « brevitas » antique » qui est depuis César, la langue des chefs car elle renonce _ non sans orgueil _ à tout dire, à « venir à bout du réel par les mots », brièveté qui est aussi le style du Misanthrope que l’auteur regrette de ne pas avoir été « pour de bon ». Mais c’est un genre incompatible selon lui avec l’autobiographie à moins, nous dit-il en hommage à Lévi-Strauss, d’écrire une « Triste politique » de portée universelle. Mais il ne se sent pas capable pour sa part de trouver l’équilibre entre concept et récit qui puisse reconstituer un engagement personnel dans des erreurs « déjà jugées par l’histoire » et sur des « questions qui ne se posent plus ». Car il a la conviction que désormais l’idée de révolution a rejoint le phlogistique au grenier des accessoires et que la croyance en un avenir meilleur « fait rire tout le monde ».
La littérature d’action se distingue également du journalisme. Malgré son estime pour A.Londres, J.Daniel et J.Lacouture, Debray montre qu’au contraire des médias qui ne visent qu’à rassurer en nous donnant l’impression de vivre avec nos semblables alors qu’ils ne font que reproduire l’imitation universelle des plus forts et des plus riches par les plus faibles, la littérature n’a pas de message, elle inquiète, « désindustrialise, démassifie le langage » et sépare de la tribu en proposant de l’insubstituable. Si le journal nous parle, comme disait Gide, de « tout ce qui nous intéressera moins demain qu’aujourd‘hui », la littérature a pour matière la dimension intime de l’homme , le temps, que notre modernité croit dominer par son extraordinaire maîtrise de l’espace. Contre les « médias de l’ubiquité » Debray voit dans la littérature le « medium de l’historicité » en raison du caractère incompressible du temps de la lecture, mais aussi de sa syntaxe et de ses descriptions qui en font une « machine à décélérer » et une méditation de notre existence.
Un chapitre brillant
sur Madame de Sévigné et le genre épistolaire dans la culture
occidentale nous en donne un exemple : la difficulté
d’acheminement de la lettre, sa réalité matérielle et la lenteur
de son écriture essentiellement différée en firent « la
civilisation même ». Au contraire des messages des réseaux,
qui sont des « cris par la fenêtre », elle était
événement, portant l’empreinte de la personne, et vecteur
d’amitiés authentiques.
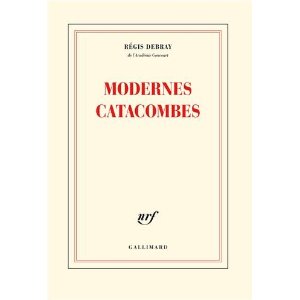
L’hommage à M. Fumaroli dont la culture exceptionnelle a su traverser les siècles et rapprocher la madeleine de Combray du chant de la grive chez Chateaubriand et de la pervenche des Confessions souligne ce rôle de la littérature.
On comprend que le Bloc-notes de Mauriac que l’auteur admire pour la force de ses traits d’esprit qui donnent encore au chuchottement du vieil académicien le volume d’un « mégaphone » appartienne à la littérature d’action. S’il nous ramène dans la « ligne de Chateaubriand » c’est que le romancier du Nœud de vipères réunissait de façon « tragique » un réalisme politique digne de Machiavel et une spiritualité nourrie d’une culture « engloutie », celle des « humanités »_ Racine, Molière, la Bible_ par laquelle il tenait à distance un monde auquel il avait, disait-il, « consenti à ne pas plaire ».
On retrouve l’idée d’une distance, d’une séparation indispensable entre la scène et la salle, à contrepied des courants dominants, dans deux articles sur le théâtre. Tout en saluant l’apport essentiel de Vilar, Debray défend l’artifice de la représentation théâtrale et la nécessité d’un scénario contre l’immédiateté du vérisme et du « live » parce que « la scène est le lieu métaphysique du passage entre la nature et la culture » et que le « symbolique y est en jeu ». Le théâtre qui, à son origine, mit la vengeance à distance n’est pas simple spectacle mais traduction de notre vie en destin par un savoir de notre mortalité. C’est à cette condition qu’il permettra dans un monde virtualisé et programmé le retour à une parole pleine.
On attendait Sartre, bien sûr, que Debray qualifie de « généreux » car ce « moraliste » fut « une personne, un personnage et beaucoup de monde ». l’Etre et le néant est pour lui un sommet de l’idéal classique français et nous restons tributaires de l’existentialisme car « Sartre a pensé avant les sciences humaines et nous avons à penser après elles ». Mais la Critique de la raison dialectique reste pour lui une vaine tentative de continuer Descartes et Husserl par le marxisme. Le génie de Sartre a été, dans l’analyse de la « mauvaise foi » ou du « visqueux », d’associer concept et situation en rendant le sensible intelligible. Mais l’auteur des Mots est aussi l’inventeur d’une langue « à l’impeccable spontanéité du trait », porteuse d’une éthique avec laquelle il affronta gaiement et courageusement la triste bourgeoisie d’où il venait.
Gracq le géographe, qui n’a pas quitté son bocage français, dont l’écriture a prétendu s’opposer à la transformation du monde par la contemplation de ses paysages, préférant leur horizontalité à la verticalité de la lutte prométhéenne avec les dieux et de l’héritage judéo-chrétien, est aussi pour Debray un écrivain d’action car son œuvre redonne densité à l’espace et consistance à l’histoire. C’est pour avoir méconnu la topographie de la jungle bolivienne que le « Che » est tombé.
Deux écrivains de personnalité très différente peuvent être rapprochés dans la recherche ascendante de l’auteur : Gary et Malraux. Assurément la distance est grande entre le « loubard » Compagnon de la Libération, l’anar patriote capable de se moquer de sa biographie et, dans un ultime acte de courage, de sa vie, et le Résistant tardif, le mythomane « pompeux et farceur », aux raccourcis artistiques et historiques vertigineux, à l’apparent appétit de pouvoir, qui arrivèrent pourtant ensemble, et en retard, le 12 novembre 1970 à Colombey. Mais ils furent deux Don Quichotte, deux fous capables de rêver la réalité française, de marier l’éthique et l’esthétique en se mettant au service de cet « homme de théâtre qui tint tête, par cela même, au monde entier ». Debray dresse une ode à Gary pour qui : « l’homme sans mythologie de l’homme c’est de la barbaque », et dit son allégeance à Malraux dont le lyrisme sut transfigurer le réel. En dépit d’un goût modéré pour ses écrits sur l’art il salue celui qui sut prévoir le réveil de l’orient en 1925 et fut le dernier à avoir cru en une histoire-destin. Tous deux ont rêvé la réalité française l’aidant à se soutenir un moment au-dessus d’elle-même.
De Gaulle fut ce qu’il disait. Au point qu’on hésite à parler de littérature d’action parce qu’avec lui la légende « a remplacé le réel » ressuscitant une histoire qui avait été anéantie par la défaite. Debray revient sur l’incroyable isolement à Londres : cinq réponses le 30 juin, la condamnation à mort par les siens, l’hostilité de la Résistance jusqu’au parachutage de Moulin, les humiliations de toutes sortes, le seul appui de Churchill qui s’intéressa à lui « faute de mieux » après la dérobade de « tout ce qui comptait » en France. Sa parole va redonner sens, structure, ordre parce qu’elle ouvre un avenir, non par des envolées mais par des directives précises qui ne visent qu’à faire la guerre. Parce que De Gaulle est un homme d’action, non de pouvoir, qui sait que le rétablissement d’un parlement en France passe par Bir Hakeim et Monte Cassino. Mais il ne fut pas seulement une extraordinaire « présence vocale » : en homme politique qui savait que « les héros ont besoin de poètes » il vénérait les « humanités » et les écrivains, au point d’oublier que la Résistance fut globalement leur échec, persuadé que la France ne pouvait revivre sans la langue française et La Princesse de Clèves. Debray nous apprend que J.Moulin rêvait de devenir après la guerre ministre des Beaux-Arts.
Mais on se souvient des silences de De Gaulle : en demandait-il trop à ce pays ? Pressentait-il que celui-ci aspirait au fond à sortir d’une histoire commencée au baptême de Clovis et à Valmy ? C’est ce que semble penser Debray qui achève son livre par un article sur P.Nora dont le concept de « moment » opère une lente restructuration, entre « actualité »et « époque », d’une historiographie qui a rompu avec le roman national et républicain de Michelet et Lavisse, et même avec les universaux de la vie en société pour devenir, dans un monde où « le futur s’est lassé », résolument et tristement plurielle.
Le livre de Debray est dans l’ensemble amer et nostalgique mais dans un style brillant et imagé. Il est attachant mais parfois irritant car l’auteur résiste rarement à un bon mot. C’est le livre d’un moraliste qui s’appuie sur une culture classique considérable, sans avoir rompu avec les analyses d’un marxisme sans illusion .
Bernard Dufour