Dans les parages de Nicolas de Cues : trois lectures de Jocelyne Sfez
Par Romain Couderc le 07 novembre 2017, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
Exceptionnellement, nous publions trois recensions portant sur la pensée de Nicolas de Cues : le lecteur pourra ainsi se faire une idée plus précise de l'oeuvre du philosophe de la Renaissance. Nous remercions vivement Jocelyne Sfez pour ce travail riche et substantiel.
Federici Vescovini Graziella, Nicolas de Cues. L’homme, atome spirituel, Paris, Vrin, « Bibliothèque des philosophies », 2016.
Participation et vision de Dieu chez Nicolas de Cues (éd. Isabelle Moulin), Paris, Vrin, « Publications de l’Institut d’études médiévales de l’Institut catholique de Paris », 2017.
L’humilité chez les mystiques rhénans et Nicolas de Cues (éd. Marie-Anne Vannier), Paris, Beauchesne, « Mystiques chrétiens d’Orient et d’Occident », 2015.
Lus par Jocelyne Sfez
Les toutes dernières années, nous avons vu fleurir en langue française les ouvrages consacrés à Nicolas de Cues, ce grand penseur du XVe siècle. Si, depuis la réception de l’ouvrage d’Ernst Cassirer, Individu et cosmos à la Renaissance, tout public francophone un tant soit peu cultivé connaît au moins de nom ce cardinal philosophe, son immense œuvre philosophique et théologique, aux ramifications métaphysiques, scientifiques et épistémologiques, morales et politiques, est restée longtemps cachée derrière une seule et mauvaise traduction de la Docte ignorance (1440). C’est une chose curieuse si l’on veut bien se rappeler que l’édition de Paris, publiée sous la direction de Lefèvre d’Étaples dès 1514, a été l’édition de référence jusqu’à la publication de l’édition scientifique et critique, initiée, entre autres, par Raymond Klibansky dans les années 30 à l’Académie des sciences de Heidelberg, et aujourd’hui achevée.
Entre-temps, le nombre de latinistes — et de germanistes — a fortement décru en France, et il était urgent de procéder à de nouvelles traductions, philologiquement et philosophiquement plus rigoureuses. C’est en passe d’être fait, même s’il est possible, et fortement souhaitable, de soumettre à un examen attentif ces traductions parues ces dernières années[1]. Certaines d’entre elles sont tout à fait convenables, d’autres doivent être revues de façon urgente.
Logiquement, les commentaires de l’œuvre devraient suivre. Nous attendons avec une certaine impatience la traduction française du grand ouvrage de Kurt Flasch, Nicolaus von Kues, Geschichte einer Entwicklung. Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie (Klostermann, Francfort s. M., 1998), que Maude Corrieras, déjà traductrice et commentatrice du Béryl (1458), prépare pour Ipagine. Cet ouvrage est remarquable dans sa clarté comme dans son étendue, et constitue, actuellement, la meilleure introduction qui soit à l’œuvre du Cusain, comme l’est d’ailleurs, pour la philosophie de Maître Eckhart, l’ouvrage non moins remarquable de Kurt Flasch, Maître Eckhart, philosophe du christianisme, traduit en 2011 par Catherine König-Pralong pour la « Bibliothèque des philosophies » dirigé par Michel Malherbe.
 Nous attendions donc avec un intérêt certain le texte de Graziella Federici Vescovini, Nicolas de Cues. L’homme, atome spirituel, à paraître dans la même collection. G. Federici Vescovini a été professeure d’histoire de la philosophie à l’Università degli Studi di Firenze et a traduit en italien les œuvres philosophiques du Cusain. Excellente connaisseuse de l’œuvre de Nicolas de Cues, elle est donc tout à fait qualifiée pour donner en français une vue générale et précise de cette philosophie difficultueuse.
Nous attendions donc avec un intérêt certain le texte de Graziella Federici Vescovini, Nicolas de Cues. L’homme, atome spirituel, à paraître dans la même collection. G. Federici Vescovini a été professeure d’histoire de la philosophie à l’Università degli Studi di Firenze et a traduit en italien les œuvres philosophiques du Cusain. Excellente connaisseuse de l’œuvre de Nicolas de Cues, elle est donc tout à fait qualifiée pour donner en français une vue générale et précise de cette philosophie difficultueuse.
De premier abord, le point de vue qu’elle adopte semble d’ailleurs être le même que celui de Kurt Flasch. Elle souligne la nécessité d’une approche historique et de première main de l’œuvre du Cusain. Lire l’œuvre de Nicolas dans son contexte historique, lire toute l’œuvre de Nicolas, afin d’en examiner sa pertinence et sa cohérence. Ce sont là des conseils méthodologiques de bon sens qui devraient valoir pour toute étude philosophique (même s’il est évident qu’il faut bien commencer par un bout de l’œuvre !), et qu’il n’est pas inutile de rappeler : d’une part, les problèmes, seraient-ils de philosophie générale, se déploient dans une histoire, qui est celle, certes, de la philosophie mais aussi, plus généralement, des idées et des productions humaines, des sciences et des techniques, de l’économie, de la politique, etc. ; d’autre part, une pensée, serait-elle philosophique, se donne rarement d’emblée, elle peut évoluer, se développer, changer, connaître des ruptures… Cela est particulièrement vrai pour une œuvre qui s’étale sur plus d’une vingtaine d’années et qui comprend de nombreux textes, dont plusieurs sont considérés comme des œuvres majeures : La Docte ignorance (1440)[2], Les Conjectures (1441-1443)[3], Le tétralogue du Laïc (1450)[4], La Paix de la Foi[5] et La Vision de Dieu (1453)[6], Le Béryl (1458)[7], Le dialogue à trois sur le Pouvoir-est (1460)[8], Le Non-autre (1462)[9], La Chasse de la sagesse[10] et Le Jeu de la boule (1463)[11]… auxquels on doit encore adjoindre toute une série d’opuscules mathématiques, théologiques et philosophiques. Il n’est qu’à penser à l’Égalité[12] et au Principe (1459)[13], ou à l’Apologie de la docte ignorance (1449)[14], pour réaliser que même la qualification en œuvres majeures et en œuvres mineures est toute relative, qu’elle relève d’une axiologie et que celle-ci doit a minima être explicitée pour être fondée.
De même, avant de parler de pensée de système, ou même de « la pensée » d’un auteur (la commentatrice parle de « la doctrine du Cusain », ce qui revient au même), il convient d’adopter le bon point de distance et, tout à la fois, d’en mesurer l’étendue et d’en parcourir le paysage et les méandres. Cela demande du temps et de la disponibilité, voire de la passibilité. C’est seulement alors qu’il est possible d’adopter un point de vue structural plutôt que chronologique. Pour sa part, Kurt Flasch se refuse à cette modélisation qui risque de gommer les arêtes et les saillies d’une pensée toujours en train de se faire : l’unité de l’œuvre est postulée comme conséquence de l’unité de la tête qui la produit, mais celle-ci, comme vivante, a une histoire… Graziella Federici Vescovini adopte un point de vue thématique : elle « prend en considération les connexions des thèmes structuraux de [la] pensée [du Cusain] ». Pourquoi pas ? Mais si, à juste titre, elle souligne que « l’on ne peut pas ramener les idées importantes de sa philosophie à un seul concept, comme celui de la connaissance par la conjecture se perpétuant à l’infini, en négligeant d’autre idées telles que, par exemple, la définition de Dieu comme Non-autre, la proportion d’égalité et sa théorie des signes » (p. 8), elle se condamne par-là même à quitter les points de vue génétique et/ou perspectiviste et, contrairement à ce qu’elle affirme, à ne pas « suiv[re] les développements du discours passant d’un argument à l’autre, ou même traitant du même sujet, considéré de différents points de vue » (p. 8). Cette manière-là de procéder l’aurait, précisément et de fait, obligée à mettre au centre de sa réflexion et à théoriser le concept de conjecture associé au concept de perspective. Or, si le concept de conjecture n’est pas le seul, il a le mérite d’être présent sur l’ensemble de l’œuvre du Cusain — comme le concept de docte ignorance — , ce qui n’est guère le cas, par exemple, du concept tardif de Non-autre. La question se pose alors de la pertinence des concepts ou des idées-forces retenus pour jalonner le parcours dans l’œuvre. Il se trouve au contraire que le concept de conjecture, qui désigne au fond un essai de penser dans le vrai, permet précisément de rendre compte de l’émergence des autres concepts cusains. Ce que Federici Vescovini reconnaît in fine : « La vérité, on ne la possède pas à l’avance, mais on l’atteint par la recherche qui procède de conjecture en conjecture, en s’engageant dans l’amélioration continue de la connaissance. » (p. 17). Il en va de même du concept de « docte ignorance », mais ce n’est pas le cas de tous les concepts, et on risque alors de laisser de côté certains aspects essentiels de cette philosophie, comme cela s’avère par exemple le cas ici, dans l’ouvrage de Federici Vescovini, pour un concept pourtant aussi fondamental de la philosophie tardive du Cusain que l’est le « pouvoir-est ».
Par ailleurs, il est franchement étrange que ce texte, qui semble être paru dans l’urgence[15] pour servir aux malheureux agrégatifs latinistes qui avaient au programme en 2017 la traduction et le commentaire du très difficile De possest (1460), et qui prétend « contribuer à offrir une connaissance la plus exacte possible de la doctrine (sic) du Cusain » (p. 7), ne fasse, par exemple, guère de place à l’élaboration d’une philosophie tardive de la puissance et du pouvoir, qui retiendra pourtant, entre autres, l’attention d’un Bruno. On s’étonnera aussi d’une bibliographie très incomplète et de « détails » biographiques non scientifiquement prouvés[16]. Il y a des assertions problématiques, voire choquantes, dans cette introduction : comment peut-on écrire, sans barguigner : « La renommée du Cusain philosophe et penseur est récente. Sauf Giordano Bruno et Lefèvre d’Étaples et, au XIXe siècle, Goethe et Schlegel, personne n’avait eu l’intuition de son importance et c’est la philosophie idéaliste, et mieux encore, néo-criticiste qui l’a découvert. » (p. 21) ? L’ouvrage magistral et maintenant classique de Stephan Meier-Oeser, Die Präsenz des Vergessenen. Zur Rezeption der Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. Bis zum 18 Jahrhundert (Aschendorff, Münster, 1989) démontre point par point l’importance qu’eut Nicolas dans toute l’Europe savante du XVe au XVIIe siècles pour s’éclipser effectivement au XVIIIe siècle et revenir au centre de l’intérêt philosophique dans l’idéalisme allemand et le néo-kantisme dès le XIXe s. et dans la philosophie juive allemande du début du XXe s. Non pas seulement Bruno, mais tout le cercle des favristes, Beatus Rhenanus, Bovelles, Reuchlin, mais aussi Campanella, Copernic, Descartes, Dürer, J. Eck, Ficin, Robert Fludd, Gassendi, Huyghens, La Motte le Vayer, Leibniz, Léonard de Vinci, Locke, Malebranche, Mersenne, Montaigne, Pascal, Pic, Rabelais, Spinoza, les Van Helmont, Wolff… pour ne citer que les plus connus, ont lu et discuté le Cusain. Au XIXe s., on trouvera encore Schelling, et au début du XXe s. Simmel, Hermann Cohen et même Buber ! Qu’il ne faille pas réduire la philosophie à cette réception et qu’il faille l’étudier en elle-même et pour elle-même ne nous oblige pas pour autant à barrer d’un trait de plume cette réception foisonnante et éclectique.
Nous restons également perplexe devant des affirmations aussi péremptoires que celles-ci : prenant appui sur le texte tardif du Non-autre, et sur une remarque que Nicolas y adresse à Pierre Balbo pour réaffirmer sa croyance en l’antériorité du Pseudo-Denys, qu’il prend encore pour Denys l’Aréopagite, l’auteure oppose Nicolas à l’humanisme renaissant de Lorenzo Valla et d’Enea Silvio Piccolomini (le futur Pie II) et affirme : « En fait, le Cusain reste lié à la tradition platonicienne des XIIe et XIIIe siècles et à la culture monastique du XIIIe siècle, c’est là qu’il cherche ses points de départ ; et, plongé dans sa méditation, il ne se soucie point de lire Platon, Proclus ou le Pseudo-Denys directement à leurs sources, mais il essaierait plutôt de trouver leurs concordances. Ceux qui connaissent tant soit peu l’histoire, ne peuvent qu’être surpris et choqués par les présentations de la pensée des Stoïciens ou des Épicuriens, des Sophistes, de Platon ou d’Aristote, que le Cusain puise à maintes reprises dans les compilations existantes des Vies des philosophes de Diogène Laërce (…) Ses interlocuteurs sont encore et toujours les maitres de la Scolastique tardive et les problèmes sont ceux pour lesquels leur spéculation n’a pas trouvé des solutions. Aussi, entre les Humanistes et Nicolas de Cues existe-t-il une profonde divergence, concernant leurs façons différentes de concevoir et d’utiliser les instruments du savoir (…) il est foncièrement étranger à la vérité historique de la philologie. » L’enjeu de l’affirmation est clair : se démarquer d’une part de Cassirer, d’autre part de Blumenberg. Mais l’argument est problématique : s’il faut se méfier des catégorisations en terme de « Moyen Âge » et de « modernité » dont l’usage est lui-même, nous l’accorderons, à historiser, faut-il abandonner pour autant toute catégorisation ? N’est-ce pas cela aussi, penser, s’orienter dans la pensée, en remettant régulièrement en jeu ces catégorisations ? Or, s’il est vrai que bien des sources de la pensée du Cusain se trouvent dans les écoles de philosophie du XIIe s., l’école de Chartres ou celle de Saint-Victor par exemple, c’est que Nicolas récuse un certain usage spécieux de la scolastique et c’est là d’ailleurs l’essentiel de sa critique de la rhétorique, mais cela ne signifie nullement qu’il ne se soucie pas de lire les philosophes antiques dans le texte. Bien au contraire, certes le néo-platonisme est une source constante de la philosophie médiévale, mais Nicolas ne se contente pas de lire tel ou tel texte transmis : l’étude de sa bibliothèque montre au contraire un souci constant de la justesse du texte transmis : comme l’ont montré de nombreux commentateurs (Klibansky, Wilpert, Beierwaltes entre autres), il multiplie les possessions des traductions diverses des textes néo-platoniciens et les compare entre elles ; c’est vrai également des textes d’Aristote dont il ne se contente pas de lire les florilèges existants en Allemagne, il va même jusqu’à commander diverses traductions. Ce souci d’historicisation et de redécouverte de la lettre du texte est constant et présent dès le début de sa pratique intellectuelle, comme l’a bien montré l’historien Erich Meuthen[17]. C’est ce souci, et la vaste culture de ses sources théologiques puis philosophiques qui en résulte, qui le fait d’ailleurs remarquer dès le concile de Bâle. C’est ce souci qui l’amène à montrer que la Donation de Constantin est un faux, parallèlement à Lorenzo Valla, et sur d’autres arguments. C’est ce souci enfin qui l’amène à opposer la philosophie aristotélicienne dans le texte (qu’il lit de près et dans plusieurs versions) à l’usage qu’en font les scolastiques contemporains. Certes, il continue à croire que le Pseudo-Denys est le disciple de Paul ; certes, il attribue des vues très curieuses à Épicure, mais précisément celles-ci sont strictement contemporaines de sa lecture (très tardive) du texte des Vies des philosophes de Diogène Laërce (et non d’un simple florilège), traduit par Ambrogio Traversari. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne Platon, Aristote et les Stoïciens que Nicolas lit directement et via la tradition. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne les pré-socratiques, pour lesquels Nicolas cherche à s’émanciper de la lecture aristotélicienne en lisant Diogène Laërce. Que Nicolas reste l’enfant de son temps, c’est une évidence — et comment pourrait-il en être autrement ? — encore l’est-il de manière très critique, précisément parce qu’il multiplie et croise ses sources dont il se soucie, avec une fort rare conscience historique et langagière.
S’il fallait en rester là de l’ouvrage de Madame Federici Vescovini, nous serions donc particulièrement sévère. Mais, heureusement, même s’il ne tient pas toutes ses promesses d’introduction à l’ensemble de l’œuvre du Cusain, et si le plan de l’ensemble parait au prime abord assez décousu, ni chronologique, ni systématique, à peine thétique, le livre révèle des moments lumineux de la philosophie du Cusain. C’est vrai en particulier pour l’éclairage des sources padouanes et des sources hermétiques et de sa théorie des signes.
Le premier chapitre s’arrête aux trois infinis (négatif, privatif et contracté/Dieu, le monde et le Christ), après avoir mis en évidence deux sources tout au plus évoquées, mais rarement explicitées, de la Docte ignorance : Bonaventure d’une part, l’école de Padoue où Nicolas a suivi ses études de juriste et où il semble s’être montré curieux de la théorie mathématique des proportions de Blaise de Parme et de Prosdocimo Conti d’autre part. Ces sources sont assez peu étudiées dans les études cusaines et l’auteure adopte ici un point de vue novateur. Le lecteur intéressé par une étude plus complète de la signification de Bonaventure pour la philosophie cusaine pourra également se rapporter aux articles très fouillés de Thomas Leinkauf sur la question[18]. C’est sur la base de cette double impulsion que Nicolas développerait sa critique de la théologie comme science rationnelle et fonderait une recherche connaissante par proportion d’égalité. G. Federici Vescovini insiste dès à présent sur le rôle central de la christologie dans la spéculation philosophique du Cusain, dont la théologie fera l’objet du chapitre 3.
Le deuxième chapitre étudie de manière approfondie une source primaire de la philosophie de Nicolas de Cues, l’hermétisme médiéval, dont l’auteure, bonne connaisseuse de la tradition magico-astrologique du Moyen Âge, développe d’une part l’interprétation philosophique et religieuse, d’autre part l’interprétation cosmologique et anthropologique dans l’œuvre cusaine. G. Federici Vescovini démontre en particulier la connaissance cusaine de la proposition XIV du Livre des XXIV philosophes et en relève l’importance pour la compréhension exacte de la coïncidence des opposés, au-delà des autres sources bien connues (le Pseudo-Denys, Raymond Lulle et Maître Eckhart). Nous regrettons que l’auteure ne prenne pas le temps, dans un ouvrage d’introduction générale à l’œuvre cusaine, d’expliciter ces autres sources. Le lecteur non spécialiste ne les connaît pas nécessairement et risque de rester ici désemparé. Mais, selon G. Federici Vescovini, c’est essentiellement la source hermétique qui permet de saisir comment Nicolas de Cues en vient progressivement à penser Dieu comme une opposition sans opposition, à élaborer un nouveau concept d’égalité par lequel l’homme peut se comprendre lui-même, dans le monde, par lequel finalement il reconnaît Dieu.
C’est pourquoi le livre se déploie ensuite en explicitant, dans un troisième chapitre, la conception cusaine de la théologie. Critiquant la théologie de son temps, telle qu’elle réfléchie par les scolastiques, Nicolas n’entend pas penser connaître Dieu, il considère qu’il faut davantage s’interroger d’abord sur ce que signifie la question de Dieu. En ce sens, la théologie entraine avec elle une révolution gnoséologique : il ne peut y avoir de théologie qui ne pose pas une théorie de la connaissance. La théologie devient alors anthropocentrique, par quoi elle est aussi fondamentalement christologique : le Christ, essentiellement Verbe, essentiellement symbole, copula mundi, par la compréhension de laquelle l’homme, créé par Dieu imago dei, se réalise lui-même, librement et dynamiquement, simulitudino Dei. La théologie cusaine est ainsi et simultanément une théologie de la coïncidence des opposés (Dieu-l’homme, par la médiation christique) et une théologie du présupposé (par laquelle la transcendance divine est indépassable). Ce troisième chapitre qui multiplie les caractérisations de la théologie cusaine est essentiel : alors que très souvent la théologie cusaine est survolée (et on aurait pu craindre qu’il en soit aussi le cas ici après les quelques lignes seulement consacrées au troisième livre de la Docte Ignorance dans le premier chapitre), elle est ici explicitée dans ses multiples facettes et justifie l’architectonique de l’ouvrage.
Logiquement, les chapitres suivants vont alors développer les innovations de la théorie cusaine de la connaissance. Le quatrième chapitre est consacré au rôle privilégié des mathématiques dans cette théorie. Les sources cusaines sont là encore multiples, d’une part médiévales, d’autre part padouanes et bolognaises G. Federici Vescovini revient ici en détail sur l’ancrage de la réflexion cusaine dans la tradition padouane des théories de la proportion ou ratio aequalitatis. Sur cette base, Nicolas va réélaborer le concept d’égalité et comprendre à partir des dialogues du De idiota, et en particulier du De mente, le processus de conceptualisation par nomination par lequel l’homme se connaît et connaît le monde. Progressivement, il va distinguer des rapports d’égalité mathématique, ontologique et linguistique, et développer une logique de la négation dans laquelle si A et ØA s’opposent, d’une part on ne peut pas en déduire nécessairement que ØØA et A sont la même chose et, par-là, d’autre part, cela ne signifie pas non plus la nécessité du tiers exclu. Il convient alors peut-être de concevoir un troisième principe et c’est ce à quoi Nicolas s’évertue : ce principe pourrait être la coïncidence comme rapport de l’égalité. La traduction ontologique de cette question saisie d’abord de manière gnoséologique conduirait Nicolas à introduire dans sa philosophie tardive, à partir du De possest, un tiers : entre l’être et le non-être, il y a la possibilité d’être. L’introduction de ce troisième terme dans la relation dynamique que constitue l’égalité permet de penser le progrès connaissant de l’intellect comme force d’assimilation indéfinie (vis assimilativa). Il y faut de la disposition et il y faut de l’effort. Ici, sans doute sous l’effet conjugué de la fréquentation d’Albert le Grand et des Dominicains allemands, Nicolas parvient à une définition de la connaissance humaine sans adéquation de la res et de l’intellect : la connaissance ne saurait être celle de la quidditas, la connaissance humaine proportionnelle est habitus. Ces pages sont sans doute les plus difficiles de l’ouvrage de G. Federici Vescovini mais aussi les plus stimulantes. Nous regrettons que la démonstration n’en soit pas complètement explicitée.
Le chapitre suivant, très court, est consacré aux conséquences anthropologiques de cette nouvelle théorie de la connaissance développée depuis le De mente. Celles-ci sont ressaisies dans le petit dialogue pédagogique, le De ludo globi, écrit en 1463 afin d’instruire les jeunes comtes de Bavière. La dimension essentiellement morale de l’opuscule n’est cependant pas abordée.
Les sixièmes et septièmes chapitres traitent alors de façon tout à faire remarquable de la vérité saisie dans le langage. Comme le souligne G. Federici Vescovini, le Compendium est un opuscule très souvent négligé par les spécialistes du Cusain, alors même qu’il est essentiel pour comprendre le rapport entre la sensation, la raison et l’intellect, dans la formation des concepts. Or, c’est seulement à comprendre comment le Cusain « parvient à expliciter comment notre esprit forme les images — en tant que notions exprimées dans les signes […] — de ce qui existe et nous est donné dans les sensations corporelles », qu’il peut fonder sa théorie conceptualiste de la connaissance. Si cet aspect de la philosophie cusaine est peu abordé, c’est qu’elle repose pour une large part sur des idées venues des grammaires spéculatives modistes, très éloignées de la logique catégorielle et substantialiste d’origine aristotélicienne, et peu connues, hormis des spécialistes, ainsi que sur la reprise par Nicolas du rôle prépondérant dévolu à l’imagination dans la théorie avicennienne de l’âme. Là encore, l’argumentation de l’auteure est extrêmement dense et trop implicite pour ne pas frustrer le lecteur. Il en va de même pour le prétendu tournant linguistique du Non-autre. Ce texte, très marqué de néo-platonisme, d’une redoutable difficulté, qui accomplit en quelque sorte la révolution logique du Cusain, est trop peu explicité.
C’est d’autant plus dommage que les chapitres suivants consacrés à La Paix de la foi et à la politique ecclésiale, s’ils posent rapidement le problème de la saisie de la vérité dans la diversité des croyances, sont aussi bien trop vite abordés. Il est, certes, difficile de ne pas traiter de ces questions qui, encore et surtout aujourd’hui, rendent célèbre Nicolas pour son prétendu irénisme et sa prétendue tolérance. Mais les assertions en sont très osées, au regard des textes cusains, tant philosophiques que juridiques, et il eût été préférable d’en discuter véritablement[19]. Pour le coup, c’est bien par la notion de vérité conjecturale perspectiviste et non relativiste que nous pensons pouvoir rendre compte à la fois du caractère tout autant restreint que novateur de la conception cusaine du rapport à l’autre, dans et hors l’Église[20]. Le chapitre terminal, consacré à la Chasse de la sagesse, n’en révèle pas plus la profondeur.
Somme toute, l’ouvrage est très intéressant lorsqu’il s’efforce de mettre en évidence ce que Nicolas doit à l’hermétisme médiéval, aux mathématiques padouanes et aux efforts logiques des nominalistes et des terministes dans sa conception de la connaissance humaine, et leurs conséquences pour la compréhension de la question de Dieu. Il est beaucoup moins convaincant comme introduction philosophique à la pensée du Cusain. Il ne revient notamment pas sur les sources néo-platoniciennes, lulliennes et dominicaines allemandes. Et, curieusement, l’ontologie tardive du Cusain, telle qu’elle se donne dans le De possest et dans le De venatione sapientiae, reste à l’arrière-plan, où elle s’esquisse seulement en creux. À cet égard, nous ne pouvons qu’appeler de nos vœux la publication de l’ouvrage magistral de Kurt Flasch (point de vue génétique) ou, dans un autre genre d’introduction, celle de Nicolaus Cusanus. Eine Einführung de Thomas Leinkauf (point de vue systématique).
Les ouvrages collectifs Participation et vision de Dieu chez Nicolas de Cues et L’Humilité chez les mystiques rhénans et Nicolas de Cues, édités respectivement par Isabelle Moulin (Vrin, 2017) et Marie-Anne Vannier (Beauchesne, 2015) constituent paradoxalement des entrées satisfaisantes dans l’œuvre du Cusain. Malgré une disparité quasi inévitable dans ce genre d’ouvrage, leurs propos traitent de manière cohérente et assez exhaustive, selon plusieurs points de vue, d’un objet délimité.
 Isabelle Moulin a édité un très beau volume collectif sur une question centrale dans l’œuvre de Nicolas de Cues, les notions de participation et de vision de Dieu. Son introduction très informée d’une trentaine de pages, « Entre Moyen Âge et Renaissance, Nicolas de Cues et la vraie icône de l’invisible » est une véritable initiation à la vie et l’œuvre du Cusain, situant celui-ci en ses sources (Jean Scot Erigène, les néo-platoniciens Proclus et Denys l’Aréopagite, Albert le Grand, Maitre Eckhart) et en son tournant propre, à l’orée de la Renaissance, et en son originalité singulière. Après avoir rappelé les moments saillants de la vie du Cusain, Isabelle Moulin commence par montrer le rôle essentiel, propédeutique, des mathématiques, dans la découverte de l’intellection pure qui est la fin véritable de la philosophie. Elle revient sur les théorèmes fondamentaux de la Docte ignorance, de l’improportion entre le fini et l’infini, de l’inconnaissance de Dieu et de la vérité absolue, pour déployer la mathématique transomptive qui permet d’atteindre l’idée d’une participation sans mathesis universalis. L ‘intellection pure révèle alors la compréhensible incompréhensibilité de l’Un. Elle rend compte et ouvre à l’héritage apophatique du dionysisme. Elle montre ensuite comment Nicolas se représente la création, lieu du rapport de l’homme à Dieu, à partir encore de la Docte ignorance et des Conjectures : en pensant un univers en mouvement où chaque singularité trouve sa place, en tant que singularité et contraction du Tout, Nicolas amorce une révolution « sur trois plans : le décentrement de la Terre, l’ouverture [ou indéfinitisation] de l’univers, la réévaluation perspectiviste du point de vue. La philosophie cusaine débouche ainsi sur une anthropologie humaniste. La position de tout homme est également digne et centrale. Par quoi il est possible de relier les premiers ouvrages à l’œuvre très célèbre du Cusain, La Vision de Dieu, qui retrace l’expérience de l’omnivoyant, Dieu ou peintre, si l’on se rappelle que l’opuscule est accompagné d’abord d’une copie d’un auto-portrait omnivoyant de Rogier van der Weyden. L’homme s’y découvre « mesure de toute chose » : mais cette pensée relativiste de Protagoras n’acquiert de valeur de vérité qu’à condition de penser « que le regard de l’homme n’a de sens que si, ultimement, il aboutit à Dieu » (p. 33). L’homme n’est central qu’en son décentrement. À partir de là, l’auteure développe la problématique cusaine de la perspective et met en évidence que le rapport de l’homme à Dieu est pensé par le Cusain en termes de participation visuelle et « ne trouve son plein achèvement que dans l’expression trinitaire et christologique » (p. 37). En ce sens, La Vision de Dieu révèle l’humanisme très particulier du Cusain, pour autant que l’humanité y est ouverture à Dieu : « la diversité des points de vue s’unifie non pas tant dans une perspective construite [point de vue cassirerien qui fait de la philosophie cusaine essentiellement une théorie de la connaissance] mais dans la vision de Dieu qui me renvoie à moi-même » (p. 38) Au-delà de la théorie de la connaissance indéniablement présente dans l’œuvre cusaine, il y aurait progression et formation de l’âme, ce qui conduirait à son élévation mystique, dans la tradition dionysienne. Cette introduction est passionnante car elle met bien en évidence que « l’un des points majeurs de l’apport de la pensée cusain réside […] dans une réflexion cognitive qui dépasse la simple conception du rapport sujet-objet, dans un dépassement qui ne ramène cependant pas tout au sujet », ce dont nous avons idée dans l’expérience du décentrement induit dans la réflexion en miroir (et en énigme pour reprendre le leitmotiv cusain de ce verset paulinien (Cor 12, 13)). L’auto-« expérience du sujet débouche [alors] sur une intersubjectivité » indépassable, horizontale (avec autrui) et verticale (avec Dieu) (p. 47).
Isabelle Moulin a édité un très beau volume collectif sur une question centrale dans l’œuvre de Nicolas de Cues, les notions de participation et de vision de Dieu. Son introduction très informée d’une trentaine de pages, « Entre Moyen Âge et Renaissance, Nicolas de Cues et la vraie icône de l’invisible » est une véritable initiation à la vie et l’œuvre du Cusain, situant celui-ci en ses sources (Jean Scot Erigène, les néo-platoniciens Proclus et Denys l’Aréopagite, Albert le Grand, Maitre Eckhart) et en son tournant propre, à l’orée de la Renaissance, et en son originalité singulière. Après avoir rappelé les moments saillants de la vie du Cusain, Isabelle Moulin commence par montrer le rôle essentiel, propédeutique, des mathématiques, dans la découverte de l’intellection pure qui est la fin véritable de la philosophie. Elle revient sur les théorèmes fondamentaux de la Docte ignorance, de l’improportion entre le fini et l’infini, de l’inconnaissance de Dieu et de la vérité absolue, pour déployer la mathématique transomptive qui permet d’atteindre l’idée d’une participation sans mathesis universalis. L ‘intellection pure révèle alors la compréhensible incompréhensibilité de l’Un. Elle rend compte et ouvre à l’héritage apophatique du dionysisme. Elle montre ensuite comment Nicolas se représente la création, lieu du rapport de l’homme à Dieu, à partir encore de la Docte ignorance et des Conjectures : en pensant un univers en mouvement où chaque singularité trouve sa place, en tant que singularité et contraction du Tout, Nicolas amorce une révolution « sur trois plans : le décentrement de la Terre, l’ouverture [ou indéfinitisation] de l’univers, la réévaluation perspectiviste du point de vue. La philosophie cusaine débouche ainsi sur une anthropologie humaniste. La position de tout homme est également digne et centrale. Par quoi il est possible de relier les premiers ouvrages à l’œuvre très célèbre du Cusain, La Vision de Dieu, qui retrace l’expérience de l’omnivoyant, Dieu ou peintre, si l’on se rappelle que l’opuscule est accompagné d’abord d’une copie d’un auto-portrait omnivoyant de Rogier van der Weyden. L’homme s’y découvre « mesure de toute chose » : mais cette pensée relativiste de Protagoras n’acquiert de valeur de vérité qu’à condition de penser « que le regard de l’homme n’a de sens que si, ultimement, il aboutit à Dieu » (p. 33). L’homme n’est central qu’en son décentrement. À partir de là, l’auteure développe la problématique cusaine de la perspective et met en évidence que le rapport de l’homme à Dieu est pensé par le Cusain en termes de participation visuelle et « ne trouve son plein achèvement que dans l’expression trinitaire et christologique » (p. 37). En ce sens, La Vision de Dieu révèle l’humanisme très particulier du Cusain, pour autant que l’humanité y est ouverture à Dieu : « la diversité des points de vue s’unifie non pas tant dans une perspective construite [point de vue cassirerien qui fait de la philosophie cusaine essentiellement une théorie de la connaissance] mais dans la vision de Dieu qui me renvoie à moi-même » (p. 38) Au-delà de la théorie de la connaissance indéniablement présente dans l’œuvre cusaine, il y aurait progression et formation de l’âme, ce qui conduirait à son élévation mystique, dans la tradition dionysienne. Cette introduction est passionnante car elle met bien en évidence que « l’un des points majeurs de l’apport de la pensée cusain réside […] dans une réflexion cognitive qui dépasse la simple conception du rapport sujet-objet, dans un dépassement qui ne ramène cependant pas tout au sujet », ce dont nous avons idée dans l’expérience du décentrement induit dans la réflexion en miroir (et en énigme pour reprendre le leitmotiv cusain de ce verset paulinien (Cor 12, 13)). L’auto-« expérience du sujet débouche [alors] sur une intersubjectivité » indépassable, horizontale (avec autrui) et verticale (avec Dieu) (p. 47).
Les contributions sont ensuite d’inégales valeurs, mais approfondissent dès lors la thématique de la participation et de la vision de Dieu.
Jean-Michel Counet reprend une nouvelle fois La Vision de Dieu en soulignant la répétition de l’expérience proposée aux moines de Tegernsee, une fois collectivement (dans la préface), une fois individuellement (dans le chapitre IV). Cette césure avait déjà été mise en évidence par Michel de Certeau dans La Fable mystique (Gallimard, 1982-2013). J.-M. Counet développe la manuduction cusaine à l’œuvre pour guider le frère et le mener progressivement « de l’analogie sensible de la providence à la théologie négative la plus exigeante et ensuite à la contemplation de l’incarnation » (p. 51). Il s’agit des trois dimensions de la théologie (théologie affirmative, théologie négative et théologie de l’immanence) dans la tradition dionysienne. Le passage d’une dimension à l’autre donne lieu dans le texte cusain à un degré supérieur d’accomplissement de la foi et à un approfondissement du regard que J.-M. Counet explicite.
La contribution de Vincent Giraud est particulièrement stimulante car elle porte sur la question des signes dans le Compendium. Elle vient donc donner un autre éclairage que celui de G. Federici Vescovini sur un texte jusqu’alors peu commenté. V. Giraud entend mesurer « la nécessité et la portée philosophique que revêt l’appel au signe dans la dernière pensée du Cusain ». Il apparaît que c’est par la réflexion sur le signe que l’homme accède « à la manifestation de Dieu comme fin et accomplissement de la vie humaine ». D’une part, la Création est théophanie, c’est-à-dire expression de son auteur divin : elle est le signe de Dieu ; d’autre part, c’est le propre de l’homme que de pouvoir créer des signes — pouvoir par lequel l’homme redouble la Création divine et en forme l’image (c’est le sens de l’analogie avec le géographe, Compendium 22-23). Mais l’image fait elle même signe : l’image, comme reflet, désigne l’original. De sorte que l’homme est aussi et signe et manifestation de Dieu. L’homme par son expression et le ciselage de ses signes travaille sa ressemblance et se produit à l’image de Dieu.
Dans son article « L’un sans l’être. Le statut méontologique de la créature », Hervé Pasqua entend défendre sa thèse à partir des deux opuscules de 1459, le De aequalitate et le De principio : « Nicolas de Cues prend[rait] le parti de penser l’Un sans l’être. Il ne lui rest[rait] plus, dès lors, qu’à analyser le rapport de l’Un avec lui-même » (p. 84). Par-là, se pose alors la question du statut ontologique de la créature. Celle-ci ne serait pas une mais essentiellement multiple et par conséquent, stricto sensu, pur néant. Mais dans cette conception radicale d’une hénologie, nous ne voyons pas comment Nicolas pourrait penser alors possible la remontée connaissante de la Création au Créateur. Ce pur néant ne nous semble pas non plus assimilable au néant eckhartien. En quoi l’Un pourrait-il être créateur, si l’acte de l’Un, pour le dire dans les termes de Pasqua, ne saurait être l’acte d’être ? Pour intéressante qu’elle soit, cette thèse reste très problématique et redoutable dans ses conséquences théologiques mêmes. L’analyse en termes notamment gnoséologiques que fait Harald Schwaetzer dans sa thèse du De aequalitate[21] nous paraît infiniment plus convaincante.
Faisant écho à notre travail de thèse[22], pour lequel il a été rapporteur, Christian Trottmann nous fait l’honneur de le discuter ici. En relevant l’optique de la figure paradigmatique des Conjectures, qui modélise toute entreprise de connaissance, nous y défendions une hénologie perspectiviste des points de vue et rendions compte de la proximité de la théorie de la connaissance avec l’irruption moderne d’un relativisme qui peut dissoudre la vérité de toute connaissance. Or, comme le souligne ici encore Christian Trottmann, chez Nicolas de Cues, « c’est dans la seule vision de Dieu qu’est susceptible de se résorber la dualité de ce regard grand angle sur l’infini contracté de sa Création et celui amoureux et créateur qu’il porte sur chacune de ses créatures qu’il fait ainsi exister » (p. 109) Pour lever toute ambiguïté, il précise ici que cette vision béatifique ne se réalise pas ici-bas mais bien au-delà et que, dès lors, un accès à la parfaite vérité est possible, certain même, dans l’éternité bienheureuse, et que, par conséquent, il ne saurait y avoir de scepticisme absolu chez le Cusain. Nous n’en avons jamais disconvenu : Nicolas est croyant et sa métaphysique de la lumière ne saurait prendre son sens que d’une eschatologie. Mais là, le philosophe, s’il ne veut pas excéder son domaine, doit s’abstenir : si ce mouvement par lequel l’homme connaît ne peut accomplir sa course jusqu’à la certitude de la vérité que dans l’au-delà, ce mouvement doit procéder d’un double don de la nature et de la grâce, et cette théorie de la connaissance repose alors sur la foi, dont le philosophe n’a rien à dire. La question qui peut seulement se poser à lui est alors de savoir si une telle construction gnoséologique a encore un intérêt hors de soi, dans un monde déthéologisé. Notre intime conviction (mais ce n’est qu’une conviction heuristique) est que oui, à condition d’étudier tous les effets que la croyance (y compris la croyance athée) peut avoir sur cette théorie et ses conséquences sociales et politiques. L’athéisme ne détruit pas nécessairement toute confiance en la vérité, et tout scepticisme n’est pas nécessairement absolu.
De ce point de vue, il y a certes nécessité, comme le souligne Jean-Claude Lagarrigue, de donner une place à la foi dans la compréhension de l’œuvre cusaine. Cette place est évidente, bien qu’à déterminer. Cette reconnaissance oblige aussi l’historien de la philosophie : c’est un donné incontournable qui offre sa matière à la réflexion philosophique de l’époque médiévale. Mais l’activité philosophique ne se résout pas pour autant dans la dimension fidéiste de la pensée, même chez un membre éminent du clergé de l’Eglise romaine, surtout lorsque celui-ci a démarqué sa réflexion de toute la théologie contemporaine. Cela reste valable lorsque l’on examine des sermons : certains de ceux-ci peuvent constituer de véritable petits traités. C’est ainsi que, chez Nicolas, certains sermons ont été longtemps classés comme tels, ou que certains traités sont constitués dans des sermons. C’est le cas bien connu du De principio, aujourd’hui publié comme traité, mais aussi du De visitatione et du De sacramentis, publiés aujourd’hui comme sermons (et étant par là négligés, à tort, dans l’histoire de la philosophie). Jean-Claude Lagarrigue a le mérite de s’intéresser à toute l’œuvre du Cusain, y compris donc ses sermons. Il repère un thème central de la prédication cusaine, la cruauté de la crucifixion et la douleur extrême du Crucifié et il montre que, des premiers sermons à ceux de la majorité, le Cusain suit Bonaventure : toutes les puissances de l’âme, la sensibilité, la raison et l’intellect, sont concernées par la douleur maximale et totale, qui se ressent dans les regards échangés de l’humanité et du Christ en croix. Dans cette union compatissante, Nicolas affirme, contrairement à Thomas, que le Christ a enduré la souffrance des damnés (Sermon CCLXXVI, 20-21 [Haubst]). Cette rencontre du crucifié arrive lorsque la pensée accède par réflexion au niveau de l’intellectualité pure : elle se donne certes dans les Sermons (Sermon III, 24 : « c’est par la foi que j’ai accès à toi ») mais aussi dans les ouvrages philosophiques (Docte ignorance III, 11, 244 : « l’intellect est dirigé par la foi […] là où il n’y a point de saine foi, il n’y a point de vrai intellect »).
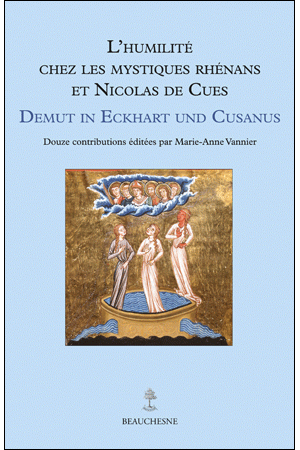 L’Humilité chez les mystiques rhénans et Nicolas de Cues est la première monographie de cette ampleur consacrée à la question. Elle est rédigée en français, allemand et anglais. Marie-Anne Vannier commence par rappeler la signification de la notion dans l’histoire de la philosophie et de la théologie. Maître Eckhart est, après Augustin, l’auteur qui a donné à cette vertu chrétienne par excellence, mère de toutes les autres vertus, une dimension véritablement ontologique. Elle est, pour la créature humaine, le répondant de la kénose du Christ (Ph. 2). Pour Augustin déjà, le Christ n’a pas seulement enseigné, mais également incarné l’humilité. C’est elle qui est la vertu salvatrice, source de la Rédemption. D’autres auteurs, Hildegarde de Bingen (XIIe s., Liber de scivias, 2e vision, § 33) et Thomas d’Aquin (Somme Théologique, IIa, IIae, q. 161), sont évoqués pour comprendre l’évolution du concept entre Augustin et Maître Eckhart. Si l’homme, par l’humilité, doit se reconnaître être créé et devant sa vie au Créateur, et s’il doit, par-là, récuser toute hubris prométhéenne, c’est aussi l’humilité qui lui « donne de monter en Dieu, (et) plus largement elle contribue à la naissance de Dieu dans l’âme, à l’unité avec Dieu » (p. 13). C’est par l’humilité que se révèle le Christ auquel l’homme doit chercher à s’égaler.
L’Humilité chez les mystiques rhénans et Nicolas de Cues est la première monographie de cette ampleur consacrée à la question. Elle est rédigée en français, allemand et anglais. Marie-Anne Vannier commence par rappeler la signification de la notion dans l’histoire de la philosophie et de la théologie. Maître Eckhart est, après Augustin, l’auteur qui a donné à cette vertu chrétienne par excellence, mère de toutes les autres vertus, une dimension véritablement ontologique. Elle est, pour la créature humaine, le répondant de la kénose du Christ (Ph. 2). Pour Augustin déjà, le Christ n’a pas seulement enseigné, mais également incarné l’humilité. C’est elle qui est la vertu salvatrice, source de la Rédemption. D’autres auteurs, Hildegarde de Bingen (XIIe s., Liber de scivias, 2e vision, § 33) et Thomas d’Aquin (Somme Théologique, IIa, IIae, q. 161), sont évoqués pour comprendre l’évolution du concept entre Augustin et Maître Eckhart. Si l’homme, par l’humilité, doit se reconnaître être créé et devant sa vie au Créateur, et s’il doit, par-là, récuser toute hubris prométhéenne, c’est aussi l’humilité qui lui « donne de monter en Dieu, (et) plus largement elle contribue à la naissance de Dieu dans l’âme, à l’unité avec Dieu » (p. 13). C’est par l’humilité que se révèle le Christ auquel l’homme doit chercher à s’égaler.
Emmanuel Faure montre comment l’humilité est déjà reconnue par les Pères du désert[23] (IIIe-VIe s.), comme une vertu déterminante pour la vie chrétienne et son accomplissement (p. 18). Elle constitue « le chemin le plus court pour atteindre la perfection », elle est « le précurseur de toute charité », l’enseignement fondamental du Christ. Sans cette disposition, tous les commandements divins sont vains. C’est en elle que s’origine toute obéissance et c’est pourquoi l’état monastique est un modèle et une école d’humilité. Loin de sa dimension ontologique, l’humilité monacale est morale et sotériologique. Elle révèle la petitesse de l’homme, créé à partir du néant, caractérisé par la faiblesse et la pauvreté, elle est une vertu de la foi : l’humilité en effet est le sceau du Christ, qui a subi l’humiliation de la passion en acceptant la mort la plus ignominieuse (on l’oublie souvent : la crucifixion était la mise à mort réservée aux criminels) ; elle conduit au renoncement de soi et du monde (Dorothée, Didascalie I, 10, 7), au renoncement de sa volonté propre et par conséquence à l’abaissement devant l’autre, par quoi sont réalisées la paix de l’âme et du corps individuels et la paix de la relation fraternelle. Ici, l’humilité n’est pas seulement un effet de la grâce de Dieu, elle est également le fruit du travail de l’homme, elle est l’habitus de l’agir humain. En s’efforçant à l’humilité, l’homme expérimente sa faiblesse et son hétéronomie, sa dépendance vis-à-vis des autres et de Dieu. Par quoi l’homme progresse dans et par l’humilité (Dorothée, Didascalie II).
Dans une étude plus historique que philosophique, Viki Ranff compare l’humble représentation de soi de Hildegarde de Bingen à celle de Nicolas de Cues. Hildegarde, née au XIIe s. et vouée dès sa naissance à l’Église, a compris dès l’enfance que ses dons de visionnaire et de prophétesse lui venaient de Dieu. Dans son humilité sincère, entre la conscience de sa faiblesse et l’importance de ses visions, comment doit-elle agir ? Doit-elle révéler ce qu’elle voit ? La recherche de conseils auprès de Bernard de Clairvaux est encore l’effet de son humilité. Femme se présentant comme illettrée (elle n’a fréquenté ni l’école ni l’université… mais elle écrit en latin), elle ne se sent pas autorisée — mais, se choisir un bon conseiller, un guide (Bernard de Clairvaux est tout de même le maître du pape Eugène III !), n’est-ce pas paradoxalement encore une forme de prétention ? Cette attitude pour le moins paradoxale fait l’objet de la justification de la Protestificatio du Liber de scivias où elle livre ses visions. Inversement, Nicolas de Cues paraît bien prétentieux, tout au moins fier, dans son autobiographie qu’il rédige peu après sa création comme cardinal, en 1449 (Acta cusana I, 2/849). Il y a des raisons à cela : issu d’une famille bourgeoise, non noble, d’un village allemand, il est l’un des seuls quatre cardinaux allemands de son époque[24]. Cette nomination est le fruit de son mérite. Pourtant, sa correspondance avec le cardinal Jean d’Eich montre qu’il apprend l’humilité par ses échecs et ses déconvenues dans les réformes de l’Église et des couvents qu’il a entreprises. Au caractère naturellement humble d’Hildegarde fait face le dur travail d’humiliation du Cusain. Viki Ranff omet cependant que le pape Pie II qualifiera le Cusain à la fin de sa vie de « testa dura », le considérant responsable par son orgueil de son intranquillité foncière qui s’exprime jusqu’au Vatican dans son impuissance à réformer la Curie.
Les quatre contributions suivantes, de Freimut Löser, Jean-Claude Lagarrigue, Jean Dewriendt et Christopher Wojtulewicz, reviennent longuement sur la conception eckhartienne de l’humilité qui constitue le cœur de l’ouvrage.
Freimut Löser montre que dès son premier sermon en langue latine, son Sermon pascal de 1294, Eckhart met l’humilité au centre de sa spéculation : l’homme humble, c’est-à-dire pauvre, ou encore celui qui méprise le monde, obtient la grâce de Dieu car il en est passible, il est capable de la recevoir. De même, dans sa première œuvre rédigée autour de 1294-1296 en allemand, les Discours du discernement, Eckhart, prieur d’Erfurt et vicaire de Thuringe, et qui est donc en contact avec les novices du couvent d’Erfurt, montre comment les vertus chrétiennes que sont l’humilité, « l’obéissance, la pauvreté, la gelazenheit (la sérénité) et la prière », doivent être, non pas d’abord possédées (et reçues), mais acquises par leur mise en œuvre pour elles-mêmes, de manière désintéressée. C’est en ce sens que le péché peut avoir une fonction religieuse : c’est lui qui nécessite l’humilité et l’abaissement de soi-même. Cette conception du péché est particulièrement intéressante, car elle en permet une justification dans le cadre d’une économie parfaite de la Création divine : par le péché, l’homme peut reconnaître l’amour miséricordieux de Dieu. L’humilité est ce par quoi l’homme réalise très humainement cet amour : l’humble abaissement de l’homme constitue son élévation à Dieu. Cette idée se retrouve dans les sermons allemands. Évoquant et citant les Pères du désert, Maître Eckhart montre que la véritable humilité consiste dans l’abaissement et l’abandon de soi, qui constituent une forme d’anéantissement de soi dans la douceur et la confiance. En droit, tout homme peut, par sa pratique, être cet homme humble. Jean-Baptiste, Paul et Marie donnent l’exemple. Dans ce renoncement de soi à soi, l’homme peut découvrir en son propre fond, à l’intérieur de soi, le fond de Dieu. L’humilité révèle alors la véritable essence, divine, de l’être humain — ce qui se donnerait dans l’étymologie commune et connue de homo/humus/humilis. L’influx de Dieu en l’homme humble est alors nécessaire. Ce point, évidemment, n’a pu que choquer les autorités religieuses : car comment la grâce pourrait-elle alors relever de la liberté divine ?
L’article de Jean-Claude Lagarrigue réinterroge l’humilité eckhartienne comme fondement et comme échelle. Dans la tradition chrétienne, l’humilité est pensée comme le fondement de toutes les vertus, au contraire de l’orgueil philosophique, tel qu’il est encore condamné à Paris en 1277 par l’évèque Tempier. Mais l’humilité, selon Eckhart est aussi une échelle qui permet l’élévation vers Dieu, la voie de l’imitatio Christi. On a là deux conceptions différentes de l’humilité, « l’une horizontale, préparatoire et quiétiste, l’autre verticale, opératoire et active. Y a-t-il possibilité de concilier ces deux conceptions ? Outre le contexte particulier des condamnations parisiennes de 1277, et la rivalité entre religieux et philosophes, il s’agit aussi de revivifier à l’époque, le sens ecclésial de l’humilité : s’abaisser, se rendre humble, c’est admettre que l’on n’a pas nécessairement raison de sa manière de croire, et par conséquent faire confiance à l’unité collective et organique de l’Eglise. Quelle est alors la vraie humilité ? Or, distinguer entre la vraie et fausse humilité, en discuter en particulier en dehors des lieux consacrés (couvents, universités), c’est s’exposer au pouvoir ecclésiologique qui accuse de diviser l’Église. Pourquoi celui-ci se sent-il menacé ? La réponse tient dans la détermination eckhartienne de la vraie humilité Celle-ci est soumission à Dieu seul et elle constitue un sol humide, gros de vie. L’humilité est détachement et humus. Par détachement, je récuse mes mauvaises habitudes mais je ressens aussi dans le vide intérieur la présence divine qui transforme ma nature. Humus fertile, je ne suis pas seulement fumier, mais source de vie. En ce double sens, Eckhart n’entend pas être pomme de discorde, il renouvelle le sens du concept classique sans remettre en cause l’autorité ecclésiale (il prendra d’ailleurs le chemin d’Avignon pour comparaitre devant le Pape).
Pour sa part, Jean Devriendt creuse la double nomination, latine et allemande, de l’humilité. Eckhart, on le sait, a écrit tant en latin qu’en allemand, et la Demütigkeit (l’actuel Demut, ou les anciennes demuetigkeit, demuetigkait otmuetikeit, oitmodicheit… ), qui renvoie à la notion de service, ne désigne pas exactement la même chose ou le même aspect que l’humilité (humilitas, humiliatio…). Devriendt fait donc un pointage tout à fait intéressant des occurrences des différents noms dans l’œuvre eckhartienne. L’écart entre les langues et les mots apparaît dans les divers traductions françaises choisies : humilité (état) ou humiliation (acte) par abaissement ? Le terme latin d’humiliatio n’apparaît qu’une fois pour toute, et le verbe humilio renvoie sysématiquement à la kénose du Christ : il ne s’agit donc pas de « la négation de la dignité, mais [d’]un concept théologique basé sur la christologie, la pénitence et la grâce » (p. 82) Par ailleurs, s’ « il n’existe pas d’ouvrage de théologie morale chez Maître Eckhart », stricto sensu, la réflexion sur l’humilité est omniprésente, dans l’œuvre latine comme dans l’œuvre allemande, et l’une renvoie à l’autre, et vice-versa. Il faut donc en faire une analyse conjointe. Partant de là, Devriendt étudie « comment Maitre Eckhart inscrit l’usage du concept dans celui de son temps » afin de comprendre le caractère vertueux de l’humilité, ce qui le conduit dans un deuxième temps à articuler « deux groupes d’affirmations, l’un plaçant la vertu dans l’éthique, dans l’action, et l’autre la déplaçant dans la théologie mystique et la sotériologie, dans l’être déiforme » (p. 85). Il apparaît alors, selon Devriendt, que l’humilité eckhartienne est davantage modestie que pauvreté qui peut conduire à des excès d’ascèse. Chercher à tout prix l’indigence ne saurait être un bien. L’humilité ne saurait contredire ni la vérité, ni surtout l’amour. Elle est « au centre de l’incarnation et de la manifestation humaine du Verbe divin », apparemment vertu morale apparentée à la modestie, dans la tradition aristotélicienne redécouverte à à la fin du XIIIe siècle, mais davantage encore disposition à la vertu, liée à la déiformité ; totale disposition de la grâce et à la grâce.
Christopher M. Wojtulewicz reprend enfin la question de l’humilité d’un point de vue métaphysique. Il le fait à partir des Questions parisiennes. L’expérience de la crucifixion découvre la faiblesse et l’humilité dans le corps du Christ. La Question V considère la nature de la matière dans le corps du Christ sur la croix, tandis que la Question VI traite de la nature du pouvoir de l’homme. Or, la nature de la corruption de la matière s’entend comme résultant de privations, tandis que les pouvoirs de l’homme sont fondamentalement limités par leur désunion. Faiblesse et humilité doivent donc être comprises en lien avec le corps (du Christ, de l’homme, de l’Eglise) comme la source d’une réelle puissance qui associe intimement une sotériologie à une métaphysique de l’incarnation et de la toute-puissance de Dieu.
Quant à elle, Monique Gruber reprend la question de l’humilité chez Henri Suso à partir de ses représentations et relève à nouveau la contradiction interne d’une volonté d’humilité. Cette contradiction est très manifeste dans le désir de l’imitatio Christi : qui suis-je pour vouloir imiter le Christ ? N’est-ce pas là le pire orgueil de l’homme médiéval cherchant à se mortifier, que de vouloir endurer la souffrance, les souffrances morales et physiques, comme le Christ ? Et pourquoi pas à la place du Christ ? N’est-ce pas là surévaluer la force et le pouvoir de sa volonté propre. Il faut voir la vanité de cette volonté, et se laisser aller, balloté comme un « lambeau d’étoffe » dans la gueule d’un chien ; non pas rechercher la souffrance mais l’accepter, dans un détachement absolu, soutenu par la Sagesse éternelle, qui est le Christ, à la fois lehremeister et lebemeister, maître et secours. Là seulement a lieu la conformation au Christ douloureux, dans l’exercice de la prière et autres exercices spirituels, comme ils sont présentés dans Le livre de la Sagesse et dans L’horloge de la sagesse. Là aussi y a-t-il obligation d’enseignement. Aux femmes et aux enfants, les plus humbles. Le frère prêcheur Suso va donc s’adresser à des moniales « les moyens pour parvenir à la béatitude, et d’abord l’humilité et la soumission ». Les Sermons et les Lettres portent trace de cet enseignement. L’humilité et la soumission concomitante peuvent s’y caractériser par le « non-sum » de Jean-Baptiste (Jn 1, 19), en écho au Sermon 52 d’Eckhart (« Je ne veux rien, je ne sais rien, je n’ai rien ») — un abandon intégral en Dieu qui permet la naissance de Dieu dans l’âme de l’être humble. Cet abandon est d’abord celui du corps, puisqu’il est ce par quoi nous sommes homme, c’est-à-dire chair. C’est pourquoi les représentations amoureuses d’abandon au Christ font florès et contribuent à l’abandon de soi dans l’exercice spirituel de la vision, bien que de tels exercices ne doivent constituer aucun spectacle ou mise en scène de soi, contraire à toute humilité. Les représentations picturales donnent à penser et à faire. Mais comment agir la passibilité ? L’acte de voir, à la fois actif et passif, en est un bon symbole. L’union totale au Christ, symbolisé dans le port constant de son image ou de son nom (qui n’en est encore qu’une image, intermédiaire symbolique nécessaire) doit pourtant restée secrète.
Wolfgang Christian Schneider étudie, lui aussi, de façon très complète, l’humilité à partir des diagrammes mystagogiques du Moyen Âge. D’origine antique, où ils servaient à représenter l’ordre des catégories du savoir, ils ont été utilisés au Moyen Âge pour rendre compte de la hiérarchie des vertus dans la vie morale. Or l’humilité est d’abord peu nommée dans les textes de la Bible juive et de la Bible chrétienne. Les premières représentations médiévales figurent donc essentiellement les vertus cardinales. C’est seulement au XIIe s. qu’elle fait son apparition dans les diagrammes mystagogiques. Fondement de la vie spirituelle depuis Origène, elle y prend une place prépondérante, représentée comme la racine, à partir de laquelle s’effectue la montée morale et spirituelle vers Dieu. A partir du XVe s., l’humilitas a cependant progressivement disparu en faveur de la devotio dans les représentations plus imagées que les diagrammes. L’humilitas a été plus théorisée dans les écrits. Il est cependant fort dommage que les très belles illustrations en couleur, support de l’analyse de l’auteur, soient rendues illisibles par leur petitesse.
Deux articles, ceux de Harald Schwaetzer et Johanna Hueck, sont ensuite consacrés au Cusain, dont l’œuvre atteste d’une connaissance précoce et approfondie de la pensée de Maître Eckhart.
Harald Schwaetzer étudie le rôle de l’humilité dans la recherche de la connaissance. A cet égard, il détermine trois moments décisifs de transformation scientifique, pour chacun desquels il choisit un exemple paradigmatique de théorie de la connaissance : le Didascalicon d’Hugues de Saint-Victor, le Dialogue du Laïc sur la sagesse et l’opuscule Sur la visitation du Cusain, ainsi que La Science dans une société libre de Feyerabend (non traduit en français à ce jour). Le Didascalicon donne une place essentielle à la mémoire dans l’érection d’un système encyclopédique des sciences. Hugues de Saint-Victor privilégie la lecture et la méditation communes comme pratiques d’étude. Dans celle-ci, il convient de posséder des qualités de «nature, exercice, discipline ». Par l’exercice et la discipline sont cultivées les qualités naturelles nécessaires à l’acquisition d’un savoir (la mémoire). Or, l’humilité est le principe de la discipline, le commencement et le principe de tout développement intellectuel dans une collectivité humaine qui vise la connaissance de la nature et du monde. Dans son dialogue du Laïc Nicolas de Cues partage avec Hugues de Saint-Victor l’idée que l’humilité est une qualité essentielle pour progresser dans la science et que cette qualité est sociale. Mais le Laïc de Nicolas, qui n’est pas un naïf, refuse une soumission autoritaire au savoir déjà constitué et entend davantage s’instruire dans le livre de la nature. Surtout, l’humilité n’a pas ici pour fonction de cultiver la mémoire, mais de transformer essentiellement l’intellect. L’opuscule peu étudié de La Visitation met cependant en scène un humble chrétien qui doit se souvenir de son illettrisme pour s’efforcer de se connaître sous l’égide de Marie. L’humilité ici sert la conversion de la mémoire. Mémoire et Intellect, sollicités par l’humilité, vont ainsi informer et orienter la volonté propre vers Dieu. De façon surprenante et quelque peu anachronique, Schwaetzer introduit enfin l’épistémologie anarchiste de Feyerabend. Ce dernier critique certes une conception autoritaire de la science qui relève davantage de la croyance vulgarisée que d’un esprit scientifique. Mais Feyerabend déplace aussi la critique en soulignant le divorce dangereusement réalisé entre la science et la vie par l’advenue d’une science des experts. La langue des experts est hermétique à celle du commun des mortels. Dans les deux cas, seule une conversion à l’humilité tant de l’expert que du laïc permettrait la réconciliation de la mémoire et de l’intellect au service de l’humanité.
L’humilité s’avère aussi une question de langue. Nous avons rencontré plusieurs fois ce motif : le Laïc, l’Idiota, celui qui n’a pas été à l’université, voire qui n’a pas appris la langue savante (qui est alors le latin) incarne l’homme modeste, dénué de prétention et d’orgueil de son savoir, il est l’homme humble par excellence. Reprenant les mêmes œuvres cusaines qu’Harald Schwaetzer, Johanna Hueck revient sur cette figure de l’humilité qui défie la prétention imbue du savant de l’université, à la langue bouffie. Dans un geste ambivalent, Nicolas n’a cessé de chercher une nomination aéquate de Dieu et des choses, dans la double conscience de l’insuffisance du langage humain et de l’ineffabilité de Dieu transcendant. Cette conscience aigue emporte avec soi une obligation éthique de dialogue avec les autres. C’est bientôt, dans cet essai incessant de nomination, le langage lui-même qui se saisit comme humble et devient mystique : il révèle alors la réalité d’un espace spirituel compris sans compréhension.
Le volume se conclut en poursuivant l’étude de la notion d’humilitas jusqu’au XVIIe s., en Italie où est bien reçue la mystique rhénane (surtout Tauler, Suso, mais aussi Eckhart) mais dans le contexte de la devotio moderna. A cet égard, Alberto Fabio Ambrosio introduit à l’œuvre du cardinal Pier Matteio Petrucci, Supérieur général de l’Oratoire, et et d’Ignazio del Nente, dominicain, traducteur de Suso, qui sont représentatifs de ce quiétisme italien emprunt de mystique rhénane et faisant alors sérieusement débat. Mais si Petrucci est imprégné de la spiritualité de Tauler, Eckhart et Ruysbroeck, tout autant que celle du Pseudo-Denys l’Aréopagite, il n’en est rien de Nente. Leur conception de l’humilité en est différente. Pour la donner à voir, plutôt que de la démontrer, Alberto Favio Ambrosio donne ici une traduction de quelques fragments de Petrucci, et affirme qu’on assiste chez l’oratorien à « un va-e-t-vient entre une métaphysique mystique et une modalité de pragmatisme spirituel et ascétique » (p. 198). Mais cette contribution reste bien impressionniste. Le point de vue de Nente, par exemple, pourtant annoncé, n’est pas du tout développé et nous restons sur notre faim, ayant espéré un apport complémentaire au grand œuvre de Michel de Certeau, La fable mystique, dans le domaine italien. Il n’en est rien.
Somme toute, c’est là le seul bémol avec l’édition trop réduite des figures dans l’article de Schneider, que nous émettrions concernant ce volume très riche et foisonnant sur l’humilité. L’étude du concept dans l’œuvre eckhartienne est particulièrement complète, et les articles de Gruber et de Schneider sont passionnants, tout comme sont pertinentes les contributions sur le Cusain. L’ensemble est donc instructif.
Jocelyne Sfez
[1] À cet égard, le lecteur pourra se rapporter à notre article, « Actualité de Nicolas de Cues. Publications francophones récentes », Les Études philosophiques, 2013/4, n°107, p. 575-599.
[2] Plusieurs traductions existent à présent de ce texte : celles de Pasqua (Payot, 2007), de Lagarrigue (Cerf, 2010) et de Magnard et al. (GF, 2011). Celle de Lagarrigue me paraît, dans sa littéralité, plus juste que celle de Magnard et al., un peu modernisée. Mais cette dernière est remarquable par ses notes.
[3] Deux traductions existent : celles de Counet (Belles-Lettres, 2011) et Sfez (Beauchesne, 2011).
[4] Deux traductions existent : celles de Pasqua (PUF, 2011) et de Coursaget (Hermann, 2012). La traduction de Pasqua est très problématique. De manière générale, il faut se méfier de l’édition des œuvres du Cusain réalisée aux PUF, le latin océrisé n’a jamais été corrigé et la traduction a été menée trop rapidement. Celle de Coursaget est trop anachronique et modernisée. Le troisième dialogue, le De mente, donné dans la traduction de Maurice de Gandillac à la suite de la traduction française par Pierre Quillet du livre d’Ernst Cassirer, Individu et cosmos à la Renaissance (Minuit, 1983), reste la meilleure et est donc à privilégier.
[5] Deux traductions existent : celle de Galibois (Centre d’études de la Renaissance de l’université de Sherbrooke, 1977) et celle de Pasqua (Téqui, 2008). La première est très correcte.
[6] Deux traductions existent : celle de Minazzoli (Belles Lettres, 20122) et celle de Pasqua (PUF, 2016). La première, bien que parfois un peu loin du texte, est excellente.
[7] Cf. la remarquable traduction de Corrieras (Ipagine, 2012).
[8] Trois traductions existent : celle de Magnard et al. (Vrin, 2007), tout à fait satisfaisante bien que ne suivant pas l’édition scientifique et critique de l’Académie des sciences de Heidelberg ; celle de Pasqua (PUF, 2014), très problématique, tant dans son latin que dans sa traduction ; et la nôtre (Les Belles Lettres, 2017).
[9] Une seule traduction à ce jour : celle de Pasqua (Cerf, 20022). Elle est réalisée sur l’édition scientifique et critique de l’Académie des sciences de l’université de Heidelberg (1944) et ne prend pas en compte la découverte par Klaus Reinhardt d’un manuscrit à la bibliothèque du chapitre de Tolède en 1982. Jean-Marie Flamand et moi-même travaillons à une nouvelle traduction prenant en compte l’édition réalisée par Reinhardt et al. (Aschendorff, 2011) à partir de cette découverte majeure. Sortie prévisible en 2018 aux Belles-Lettres.
[10] Deux traductions existent : celle de Pasqua (PUF, 2015) et la mienne (Les Belles Lettres, 2017).
[11] Une traduction existe : celle de Maurice de Gandillac (0EIL, 1985), qui n’est plus commercialisée. Une nouvelle traduction est en cours par Jean-Marie Flamand et moi-même (Belles Lettres, 2018).
[12] Une seule traduction de ce texte oh combien fondamental dans la théorie cusaine de la connaissance : celle de Pasqua (ICR, 2011). Nouvelle traduction à venir de Jean-Marie Flamand et moi-même (Belles Lettres, 2018).
[13] Deux traductions existent : celle de Pasqua (ICR, 2011) et celle de Bertin (Cerf, 1991) qui est excellente et informée.
[14] La traduction de Bertin (Cerf, 1991) est excellente et informée.
[15] Comment comprendre sinon les fautes de français, récurrentes et innombrables, qui émaillent le texte, les erreurs de traduction, y compris sur les noms propres, souvent écorchés, ou encore les approximations dans les références comme la chronologie, le rendant par endroit confus, sinon incompréhensible ? Quels sont, par exemple, ces « codes » (p. 12) que Nicolas, alors au service du cardinal Orsini, recherche en Allemagne, sinon des codices, c’est-à-dire plus simplement des manuscrits (d’œuvres antiques entre-temps perdues) ? Comment s’y retrouver quand, par exemple, Thierry de Freiberg est désigné une fois par Théodoric de Fribourg (p. 12), une fois par Thierry de Fribourg ( p. 75) ? Au-delà de l’incohérence, l’appellation erronée date du début du XXe s. : Thierry ne venait pas de Fribourg (Freiburg, Bade), mais de Freiberg, en Saxe. Ou encore, qu’est ce que ce « complementum, V » cité n.1, p. 117 ? Ce texte du Cusain est en réalité le Compendium V, 13. La chronologie donnée des évènements biographiques, p. 15-16, ne permet pas de comprendre ce qui se passe et comment l’œuvre s’écrit. Le lecteur intéressé se rapportera aux ouvrages toujours inégalés d’Edmond Vansteenberghe, Le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464). L’action-la pensée, Genève, Slatkine Reprints, 1974 (Paris, 1920) et d’Erich Meuthen, Nikolaus von Kues (1401-1464). Skizze einer Biographie, Münster, Aschendorff 19922 et Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach neuen Quellen. Wetsdeutscher Verlag, Cologne/Opladen, 1958.
[16] Ici encore est colportée la « légende » improbable d’une scolarité de Nicolas chez les Frères de la vie commune à Deventer. Sur cette question, cf. Tom Müller, Der junge Cusanus, Münster, Aschendorff, 2013, p. 46-49 et, bien entendu, Erich Meuthen, « Cusanus in Deventer », Concordia discors. Studi su Niccolò Cusano e l’umanesimo europeo offerti a Giovanni Santinello, Padua, Medievo e Umanesimo, 1993, p. 39-54.
[17] Le lecteur pourra se reporter à Erich Meuthen « Nicolaus von Cues und die Geschichte », Das Menschenbild des Nikolaus von Kues und der christliche Humanismus. Festgabe für Rudolf Haubst zum 65. Geburtstag (éd. M. Bodewig, J. Schmitz, R. Weier), Mayence, MFCG 13, p. 234-352.
[18] Cf. en particulier Thomas Leinkauf, « Cusanus und Bonaventura. Zum Hintergrund von Cusanus’ Gottesnamen “possest” », Recherches de théologie et philosophie médiévales 72, 2005, p. 113-132.
[19] Cf., entre autres, notre article, « La législation antijuive de Nicolas de Cues en Allemagne au XVe siècle », L’Antijudaïsme à l’épreuve de la philosophie et de la théologie (éd. Danielle Cohen-Levinas et Antoine Guggenheim), Paris, Seuil, « Le genre humain », 2016, p. 225-239. Il faudrait également reprendre de plus près l’argumentation de la Cribatio Alchorani. Mais même le De pace fidei est problématique.
[20] Cf. notre ouvrage à venir, Nicolas à l’épreuve du politique, Beauchesne, « Le Grenier à sel », 2018.
[21] Harald Schwaetzer, Aequalitas. Erkenntnistheoretische und soziale Implikationen eines christologischen Begriffs bei Nikolaus von Kues. Eine Studie zu seine Schrift De aequalitate. Hildesheim, Olms, « Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie », 2000.
[22] Jocelyne Sfez, Vérité et altérité chez Nicolas de Cues, une philosophie du reste (thèse de doctorat soutenue le 29.11.2010 sous la direction de Michel Senellart, à l’ENS-Lyon). La première partie en a été publiée sous le titre L’art des conjectures de Nicolas de Cues (Paris, Beauchesne, 2012) à la suite de la publication de la traduction des Conjectures (Beauchesne, 2011). La deuxième partie, sur les conséquences sociales et politiques, doit paraître, augmentée de mes recherches post-doctorales réalisées en Allemagne grâce à la bourse Gustave Monod de l’Institut pour l’histoire en Allemagne (2011), chez Beauchesne, sous le titre Nicolas de Cues à l’épreuve du politique, 2018.
[23] C’est une source avérée des mystiques rhénans et du Cusain. La réflexion théologique et ecclésiale de Nicolas est fortement imprégnée de ses lectures des Pères du désert, entre autres, de Basile de Césarée, Jean Chrysostome et, plus loin, de Jean Climaque.
[24] Jusqu’au XVe s. inclus du vivant du Cusain, il n’y avait eu que quinze cardinaux allemands en tout.