Corine Pelluchon, Pour comprendre Levinas, Seuil 2020. Lu par Sébastien Labrusse
Par Baptiste Klockenbring le 22 juin 2020, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
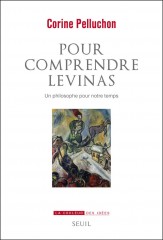 Corine Pelluchon, Pour comprendre Levinas. Un philosophe pour notre temps, Paris, éd. du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2020 (282 pages), lu par Sébastien Labrusse.
Corine Pelluchon, Pour comprendre Levinas. Un philosophe pour notre temps, Paris, éd. du Seuil, coll. « La couleur des idées », 2020 (282 pages), lu par Sébastien Labrusse.
Depuis l’essai de Jacques Derrida, « violence et métaphysique » paru en 1964, les études sur l’œuvre d’Emmanuel Levinas[1] (1906-1995) sont aussi nombreuses qu’éclairantes, que ce soit – pour n’en citer que quelques-unes – celles rassemblées par Jacques Rolland en 1984 dans Les Cahiers de la nuit surveillée, celles réunies par Catherine Chalier et Miguel Abensour en 1991 dans le Cahier de l’Herne[2], ou encore les ouvrages, soit généraux, soit sur une question précise, de Salomon Malka, Lire Levinas, (1984) de Catherine Chalier, Levinas, l’utopie de l’humain, (1993) ou de Paul Ricœur, Autrement. Lecture d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, (1997) ou de François-David Sebbah, Levinas. Ambiguïtés de l’altérité, (2003). Des études ont fait date, qu’il est impossible de toutes citer, telles que celles de Jacques Taminiaux (« La première réplique à l’ontologie fondamentale » dans le Cahier de l’Herne), de Jean-Louis Chrétien (« La dette et l’élection » dans le même Cahier de l’Herne) ou encore de Jean-Luc Marion, notamment « D’autrui à l’individu » publiée dans « Levinas et la phénoménologie », à la suite de Positivité et transcendance d’Emmanuel Levinas, aux PUF, en 2000. À cette liste, bien loin d’être exhaustive, il faut ajouter le livre de Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, qui reprend, en la développant, l’allocution prononcée – même si l’émotion entrecoupait sa voix – le matin du 27 décembre 1995, lors des obsèques de Levinas, devant une toute petite foule d’une dizaine de personnes, dans le carré juif du cimetière de Pantin, où étaient présents l’ami de toujours, Maurice Blanchot, et, outre la famille, quelques-uns de ses disciples, dont Alain Finkielkraut, qui, dans La Sagesse de l’amour, avait su rendre accessible cette pensée particulièrement exigeante.
Était-il donc nécessaire, après tant de livres et d’études, d’écrire un livre de plus ? À l’évidence, Pour comprendre Levinas est un livre qui va bien au-delà d’une présentation, claire et précise, de cet auteur, désormais au programme des classes de terminale. D’une part, cet essai s’inscrit dans la recherche menée depuis des années par Corine Pelluchon dans le domaine de la philosophie morale et de la philosophie politique, et c’est pourquoi, plutôt que de seulement commenter l’œuvre, ou de la reformuler, l’auteur pense en sa compagnie. Depuis le début des années 2000, ses travaux interrogent les questions liées à la bioéthique, à la crise écologique, au statut de l’animal, ce qu’attestent principalement L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie (2009), Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature (2011), ou encore Tu ne tueras point (2013), sur l’actualité de cet interdit fondateur, qui trouve sa source non pas seulement dans le religieux, mais bien dans l’expérience de l’altérité du prochain, dans ce que me dit le visage d’autrui. Les titres des ouvrages de Corine Pelluchon disent déjà sa proximité avec l’œuvre de Levinas – citée souvent en exergue –, et son dernier livre se donne ainsi comme une reconnaissance de dette. D’autre part, le sous-titre – Un philosophe pour notre temps – indique ce que fait ce livre : il ne s’agit pas seulement de rendre Levinas compréhensible, mais d’examiner l’actualité de sa pensée, et c’est en quoi ce travail fait de la philosophie et pas seulement de l’histoire de la philosophie. Il s’agit notamment de lire Levinas – d’interroger sa pensée – en confrontant cette dernière aux questions actuelles, dont celles de l’éthique médicale et de celle de l’animal. Du reste, Levinas nous incite lui-même à évaluer la valeur d’une philosophie en prenant la mesure de ses implications pratiques, puisqu’à propos de Maïmonide, il écrit : « L’aspect véritablement philosophique d’une philosophie se mesure à son actualité. Le plus pur hommage qu’on puisse lui rendre consiste à la mêler aux préoccupations de l’heure[3]. » C’est ainsi que Corine Pelluchon lit Levinas et restitue sa pensée en la mêlant à ces questions : celles de la relation du patient et du médecin, de la crise écologique et de la condition animale, mais aussi la question des alternatives possibles aux philosophies politiques contractualistes et libérales. Ces questions sont les siennes comme celles de l’heure.
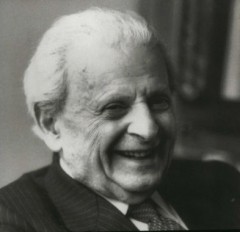 Pour comprendre Levinas : ce livre, qui a d’abord pris la forme d’un séminaire destiné à des étudiants et des soignants, dans le cadre du parcours « Humanités médicales » de l’université Gustave-Eiffel[4], est divisé en huit parties. Après une première partie qui judicieusement propose une biographie intellectuelle, l’auteur examine, selon un ordre qui correspond à celui des publications de Levinas, les thèses les plus centrales exposées surtout dans Totalité et infini, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence et De Dieu qui vient à l’idée. Sont ainsi successivement interrogées les questions de l’altérité, du visage, de la responsabilité, de la liberté, du corps vivant et du corps politique, de la justice, de l’humanisme de l’autre homme et de la religion.
Pour comprendre Levinas : ce livre, qui a d’abord pris la forme d’un séminaire destiné à des étudiants et des soignants, dans le cadre du parcours « Humanités médicales » de l’université Gustave-Eiffel[4], est divisé en huit parties. Après une première partie qui judicieusement propose une biographie intellectuelle, l’auteur examine, selon un ordre qui correspond à celui des publications de Levinas, les thèses les plus centrales exposées surtout dans Totalité et infini, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence et De Dieu qui vient à l’idée. Sont ainsi successivement interrogées les questions de l’altérité, du visage, de la responsabilité, de la liberté, du corps vivant et du corps politique, de la justice, de l’humanisme de l’autre homme et de la religion.
Corine Pelluchon commence donc par une présentation de Levinas, né en Lituanie en 1906, arrivé à Strasbourg en 1923 pour faire ses études de philosophie, qu’il poursuivra à Fribourg auprès de Husserl et Heidegger en 1928-1929, naturalisé français en 1930, date à laquelle il publie sa thèse, Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl ainsi que les premiers articles publiés en français sur Heidegger, offrant ainsi, comme l’a dit Jacques Derrida : « la première ouverture, dès 1930, à travers des traductions et des lectures interprétatives, à la phénoménologie husserlienne qui irrigua et féconda à son tour tant de courants philosophiques français[5]… » Puis ce furent la captivité dans un camp de prisonniers en Allemagne, le retour à Paris, les conférences au collège philosophique de Jean Wahl, la direction de l’Ecole Normale Israélite Orientale, les conférences talmudiques aux colloques des Intellectuels juifs de France, la carrière universitaire tardive, à Poitiers, à Nanterre, puis à la Sorbonne. Une vie, comme il l’écrit dans « signatures », « dominée par le pressentiment et le souvenir de l’horreur nazie[6] » et qui, philosophiquement, reprend et radicalise la méthode phénoménologique, à laquelle il doit la rigueur de sa pensée, qui fait de l’éthique une philosophie première. Si Levinas a découvert la philosophie et l’existence d’abord avec ses maîtres bergsoniens de Strasbourg, puis avec Husserl et Heidegger, sa pensée s’est tout autant nourrie d’une part de la Bible hébraïque, lue dès l’enfance, et d’autre part de la littérature russe notamment. Il est donc – même s’il a remis en question cette formule – autant un philosophe juif[7] qu’un phénoménologue : c’est en se fondant sur la méthode phénoménologique qu’il conduit ses recherches et c’est en soumettant Heidegger à un examen critique qu’il peut – à partir de la phénoménologie et de l’enseignement biblique – répliquer à l’ontologie fondamentale et penser les conditions de l’éthique. Corine Pelluchon l’explique, on ne peut comprendre Levinas sans restituer les tenants et aboutissants de la phénoménologie, ce qu’elle fait dans le chapitre 2 de la première partie, en s’exprimant avec une clarté impeccable. La limpidité de l’écriture donne à ce livre, qui traite d’éthique, sa dimension à rigoureusement parler éthique, dans la mesure où son écriture s’ouvre à l’altérité des lecteurs. On ne peut que lui en être reconnaissant.
La phénoménologie ne pose plus la question « qu’est-ce que ceci ? », mais plutôt : « comment ceci m’apparaît-il ? », et l’intentionnalité est le concept central de la phénoménologie husserlienne : « toute conscience est conscience de quelque chose. » En interrogeant les vécus de conscience – et la manière dont les phénomènes apparaissent à la conscience – la phénoménologie entend révéler ce qu’ils sont, ou plus exactement dévoiler leur sens. « L’acte de la conscience est la noèse, et le noème est le phénomène que constitue la conscience en dévoilant des horizons de sens. » (p. 37) Qu’en est-il d’autrui ? Comme Levinas l’a établi dans son œuvre, autrui ne se donne pas à ma conscience comme les autres phénomènes se donnent. L’acte de connaissance – la noèse – ne peut pas inscrire dans un tout – une totalité – le noème – autrui : ce dernier, dans la manière dont il m’apparaît, n’est donc pas, à rigoureusement parler, un phénomène. S’il est impossible de constituer autrui et donc de le comprendre – comme il est impossible de comprendre l’idée de l’infini – il est en revanche possible de le rencontrer et donc de le saluer – de lui adresser un « salut » au double sens de ce mot. Autrui ne se représente pas, il se présente à moi, s’expose et m’interpelle. La signification de la personne d’autrui n’est pas réductible à ce que j’en vois, et c’est pourquoi nous ne vivons pas nos relations aux autres sur le mode de la connaissance, mais ma relation avec le prochain a essentiellement une signification éthique : « non seulement autrui n’est pas un phénomène mondain, comme la chaise, quelque chose que je peux circonscrire, mais de plus il ne se tient pas dans un horizon ; il est dans la verticalité et fait signe vers un au-delà du monde. […] L’accès à autrui me place dans la situation éthique. » (p. 38-39) Qu’est-ce qu’être dans une situation éthique ? C’est être dans cette situation de passivité où autrui me regarde et me parle. Que se passe-t-il lorsqu’autrui me regarde ? En un sens, c’est un acte perceptif : la personne qui me regarde pourrait détailler les traits de mon visage, et de même, je pourrais dévisager l’autre. Mais, dès lors qu’on adopte l’attitude phénoménologique, on comprend pourquoi l’expérience du regard que je dirige vers autrui ne revient pas à regarder un objet. Pourquoi ? D’abord, parce que l’altérité d’autrui se manifeste par le fait que je ne peux pas comprendre l’autre au sens où comprendre c’est prendre avec, c’est-à-dire englober, assimiler, ramener au même. L’autre m’échappe, en raison de son altérité même, car il est mystère : « En posant l’altérité d’autrui comme mystère défini lui-même par la pudeur, je ne la pose pas comme liberté identique à la mienne et aux prises avec la mienne, je ne pose pas un autre existant en face de moi, je pose l’altérité[8]. » C’est pourquoi on ne peut pas, au sens rigoureux de ce verbe, connaître autrui, car connaître revient à ramener l’autre au même : « Si on pouvait posséder, saisir et connaître l’autre, il ne serait pas l’autre. Posséder, connaître, saisir sont des synonymes du pouvoir[9]. » C’est pourquoi l’Eros « diffère de la possession » et c’est pourquoi la caresse – à laquelle Levinas consacre des pages fulgurantes dans Totalité et infini – est « un désordonné fondamental[10]. » En revanche, ma relation avec un objet se réduit à la perception que j’en ai : il s’agit d’une relation de connaissance, d’appropriation, d’usage. Les choses, à la différence des personnes, sont en mon pouvoir.
Outre de se soustraire à mon pouvoir, l’autre, dès que je le rencontre, me parle : ma relation avec autrui implique un Dire – que Levinas distingue du Dit –, une parole, un dialogue. Autrui me parle et je lui réponds. Or, répondre à quelqu’un c’est déjà répondre de l’autre. Levinas, en repensant à nouveaux frais la responsabilité – puisqu’il montre que ma responsabilité pour l’autre n’est pas mon initiative – repense, avec une radicalité souvent dérangeante, la subjectivité. D’ordinaire, nous sommes responsables de ce que nous faisons, notre responsabilité trouve alors sa source en nous-mêmes, dans notre liberté de sujet. Pour Levinas, ma responsabilité n’est pas mon fait, et comme il l’a dit : « dès qu’autrui me regarde, j’en suis responsable, sans même avoir à prendre de responsabilité à son égard ; sa responsabilité m’incombe[11]. » Ma responsabilité, qui n’est « mienne » que parce qu’elle s’impose à moi dans ma relation au visage de l’autre, qui n’est donc pas choisie, me constitue comme sujet. Et c’est pourquoi, comme le précise Corine Pelluchon : « Le sujet n’a plus son centre en lui-même. Il est concerné par la souffrance de l’autre. Il n’y a pas de responsabilité sans cet investissement-là. Autrui m’interpelle ; il me lance un appel par sa souffrance, par son regard et son individualité qui me saisissent, et « me tombent dessus[12] » pour ainsi dire. Je ne peux pas me défausser sur les autres et sur les institutions. » (p. 98) La responsabilité pour autrui – responsabilité qui va jusqu’à être responsable de sa responsabilité, et donc jusqu’à la substitution – est donc incessible, et, loin d’être abstraite, elle se vit dans l’obligation qui m’est faite de faire face aux besoins matériels de la personne d’autrui – besoin d’abord d’être nourri : « laisser un homme sans nourriture, écrit Levinas, est un crime qu’aucune circonstance n’atténue[13]. » Levinas insiste sur « la matérialité de l’existence et la corporéité du sujet. » (p. 100) Et cette concrétude de la relation avec l’autre qui a faim est le lieu non seulement d’une spiritualité[14] – les besoins matériels de l’autre sont mes besoins spirituels – mais aussi d’une révélation religieuse : « Nous pensons que l’idée-de-l’Infini-en-moi – ou ma relation à Dieu – me vient dans la concrétude de ma relation à l’autre homme, dans la socialité qui est ma responsabilité pour le prochain : responsabilité que, dans aucune « expérience » je n’ai contractée, mais dont le visage d’autrui, de par son altérité, de par son étrangeté même, parle le commandement venu on ne sait d’où[15]. »
De telles déclarations sont de nature à poser la question des implications pratiques de la philosophie de Levinas. Peut-on l’appliquer à ces situations où nous sommes confrontés, parmi les problèmes actuels, aussi bien aux migrants qu’aux malades ? Corine Pelluchon traite notamment de la question de l’hôpital dans sa troisième partie (« Responsabilité, vulnérabilité, et substitution », p. 95-123) et dans sa sixième partie (« Le tiers et la justice », p. 189-207) où elle écrit : « dire que la politique doit toujours être limitée par l’éthique suppose de reconnaître que le respect de l’individu, de sa liberté et de son unicité est par définition fragile. » (p. 191) En effet, il faut, dans la matérialité des relations aux autres, comparer des incomparables – et hiérarchiser des priorités par rapport à des êtres humains. La justice – qui pèse, évalue, compare – doit être guidée par l’éthique : « Voir un visage, c’est déjà entendre : “ tu ne tueras point ”. Et entendre : “ Tu ne tueras point ”, c’est entendre : “ Justice sociale ”[16]. » Si une telle déclaration guidait la politique, agirions-nous dans le sens de plus de justice sociale ? La justice, bien qu’elle consiste à comparer les incomparables, doit se penser à partir de l’unicité du prochain : « il y a toujours dans le monde un tiers : il est aussi mon autre, mon prochain. Dès lors, il m’importe de savoir qui d’entre les deux passe avant […] À la prise sur soi du destin de l’autre est donc antérieure ici la justice. […] Mais c’est toujours à partir du Visage, à partir de la responsabilité pour autrui, qu’apparaît la justice, qui comporte jugement et comparaison, comparaison de ce qui est en principe incomparable, car chaque être est unique ; tout autrui est unique[17]. »
Indéniablement, l’œuvre de Levinas ne s’adresse pas qu’aux philosophes, mais à quiconque, dans son métier, dans sa vie, se trouve confronté au fait de la fragilité humaine, à la vulnérabilité des individus. Et ses concepts fondateurs – le visage, la transcendance d’autrui, le primat de la responsabilité sur la liberté – nous incitent à repenser non seulement la subjectivité mais autant le politique : à penser la justice dans des termes qui ne sont pas ceux de la philosophie contractualiste, et précisément de John Rawls. Sur ce point notamment, l’essai de Corine Pelluchon est riche de propositions aussi personnelles que stimulantes. Dans une philosophie contractualiste, fondée sur la liberté de l’individu et la primauté du moi, « la seule limite à ma liberté, à mon droit sur toute chose pouvant être utile à ma conservation, est la liberté de l’autre être humain et la sécurité. » Dans cette perspective, « la finalité du politique est la conciliation des libertés et des intérêts individuels. » (p. 102-103) Fonder en revanche l’Etat sur la responsabilité envers l’autre conduit à modifier le sens de la liberté. En raison de sa vulnérabilité, autrui « assigne des limites à mon droit d’utiliser tout ce qui est bon pour ma conservation. Ainsi, l’éthique n’est pas seulement ni essentiellement une discipline normative liée à la compréhension de ce qui est bien et mal ; elle est l’acte par lequel je fais de la place aux autres au sein de mon existence. » (Ibid.) Autrement dit, l’Etat contractualiste assure aux citoyens la possibilité de jouir de leurs droits subjectifs, et il garantit la sécurité et une relative stabilité « tant que nous sommes dans certaine abondance », mais il ne garantit pas véritablement la fraternité, il ne fait pas vraiment de place aux personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. » (p. 102-103) Fonder le politique sur la responsabilité serait ainsi une alternative au libéralisme tel qu’il est pratiqué actuellement.
Dans ses dernières formulations, Levinas peut, non sans précautions, recourir à un vocabulaire qui provient du christianisme, l’amour, la charité, et il qualifie sa pensée comme davantage préoccupée par la sainteté que par l’éthique, au sens d’une morale. Corine Pelluchon montre clairement (p. 56-57) tout ce qui sépare l’éthique lévinassienne de l’éthique du care. Il n’y a, derrière ces notions de vulnérabilité et de charité, ni pensée du bien-être de l’autre, ni théologie, mais bien plutôt une analyse de l’ontologie et une conception de l’éthique qui se propose de penser l’antériorité de l’autre sur le moi, la priorité d’autrui, et de penser l’humanité non comme conatus essendi et souci de l’être, mais se révélant dans la capacité à répondre d’autrui – aimer en un sens – ce qui implique un dés-inter-essement – une évasion hors de l’être. La rencontre d’autrui provoque une remise en question de mon bon droit à être. Que se passe-t-il lorsque le moi se saisit lui-même comme non-indifférent à l’altérité de l’autre – et à sa souffrance ? C’est alors qu’il y a attestation de l’humain « dans les saints, et les justes » : « l’humanité de l’humain, n’est-ce pas dans l’apparent contre-nature de la relation éthique à l’autre homme, la crise même de l’être en tant qu’être[18] ? » La critique de l’ontologie par Levinas remet en question la compréhension de l’humain comme être-au-monde et cette critique – qui s’articule dès De l’évasion, l’essai de 1935 – implique de concevoir l’humain non pas comme « un être rivé[19] », mais au contraire advenant à lui-même par sa capacité à s’arracher à la nature et à briser l’enchaînement à soi-même. Et précisément, c’est l’expérience éthique qui produit cet arrachement à soi-même, c’est le dialogue, la parole que l’autre m’adresse qui me conduit à me décentrer de moi-même, du fait que je m’ouvre à l’altérité d’un logos autre que le mien – ce qui s’appelle écouter. « Toute parole est déracinement[20]. » Or, ce décentrement à l’égard de soi-même que me fait vivre la rencontre d’autrui, cette renonciation à la violence qui résulte du fait banal de la conversation, prend aussi la forme d’un dessaisissement de soi : ce n’est pas en tant qu’il est une liberté affrontée à la mienne que l’autre me dessaisit de moi-même, mais c’est du fait de sa fragilité, de la pauvreté et de la nudité de son visage.
Levinas attire notre attention sur la vulnérabilité de l’autre : il y a droiture mais il y a aussi exposition du visage. Le visage est découvert – ou à découvert – et à ce titre vulnérable. Il est « sans défense », sans protection. Aucune armure ne vient protéger autrui. Si le visage interdit de tuer, il est aussi appel au meurtre, et ce pour deux raisons : d’une part, il est donc caractérisé par sa pauvreté essentielle, et sa vulnérabilité l’expose à la violence qu’autrui peut vouloir exercer. « Autrui est le seul être que je peux vouloir tuer. » Et, précise Levinas, le meurtre est « l’incident le plus banal de l’histoire humaine. » Et d’autre part, « le visage est ce qui se refuse à la possession, à mes pouvoirs. » Faisant l’expérience de la résistance totale que le visage offre à la prise, la seule possibilité apparente de soumettre l’autre à mon pouvoir, c’est de le tuer. « Le meurtre seul prétend à la négation totale. […] Le meurtre exerce un pouvoir sur ce qui échappe au pouvoir[21]. » On comprend donc que le visage, c’est ce qui, littéralement, me désarme, parce qu’il est la réalité la plus désarmée qui soit. Il y a donc une autorité qui provient de la personne d’autrui, qui est infiniment démunie, une autorité de ce qui est sans défense.
Ces deux modalités, liées l’une à l’autre, de l’expérience d’autrui – arrachement à l’être et dessaisissement de soi – conduisent à s’interroger : en quoi cette phénoménologie de l’altérité et de la vulnérabilité du prochain peut-elle accompagner la réflexion sur l’effondrement des équilibres naturels et la question animale ? Ces deux questions, qui ne sont pas immédiatement celles de Levinas, sont traitées par Corine Pelluchon, et sont les nôtres en ce temps confronté non pas à une crise – laquelle contient l’idée d’une sortie – mais bien à un effondrement de la biodiversité – à une destruction des vivants non humains – et à une dévastation sans retour des paysages.
Spontanément, nous pouvons nous dire que pour penser les questions environnementales, il vaut mieux se tourner vers Heidegger et sa critique de la technique, vers Hans Jonas et le principe responsabilité, vers Jan Patočka qui se demande si une civilisation technique est une civilisation de déclin, ou encore vers Jacques Ellul, et plus récemment vers Jean Vioulac qui interroge à son tour l’époque de la technique[22]. Et ce d’autant plus que, sans être aveugle à propos des dangers de la technique, Levinas, estime que cette dernière « est moins dangereuse que les génies du Lieu. » Pourquoi ? Parce qu’elle « nous arrache au monde heideggérien et aux superstitions du Lieu. Dès lors une chance apparaît : apercevoir les hommes en dehors de la situation où ils sont campés, laisser luire le visage humain dans sa nudité. Socrate préférait à la campagne et aux arbres la ville où l’on rencontre les hommes. Le judaïsme est frère du message socratique[23]. » Dans ces pages polémiques, comme ailleurs, Levinas exprime sa méfiance à l’égard des attitudes qui tendent à sacraliser la nature et les paysages. Et pourtant, parce qu’il introduit, comme jamais cela n’a été fait avant lui, le thème de la vulnérabilité dans la philosophie, il n’est pas impossible de s’appuyer sur son œuvre pour penser non seulement la vulnérabilité du prochain, mais aussi celle du fait naturel et des animaux. La phénoménologie de Levinas, écrit Corine Pelluchon, « peut inspirer une réflexion écologique que Levinas lui-même n’a pas conduite. » (p. 130) Toutefois, il a pensé, dans Totalité et infini, et précisément dans le chapitre intitulé « intériorité et économie », le monde sensible, le monde des nourritures, et ce faisant il s’interroge sur les conditions qui permettent de vivre sans affamer l’autre : « ma place au soleil, mon chez moi » ne sont-ils pas une « usurpation des lieux qui sont à l’autre homme par moi opprimé ou affamé[24] » ? Une éthique s’élargissant aux questions environnementales s’impose dès lors qu’on prend conscience que « notre usage des nourritures est d’emblée éthique. » De cela – à savoir que « l’acte de manger est un acte éthique, économique et politique » (p. 137) Levinas semble ne pas tenir compte. Toutefois, les limites de sa pensée demeurent ambiguës et c’est pourquoi, malgré des descriptions « incomplètes » de l’acte d’habiter et de se nourrir, « ceux qui souhaitent pratiquer l’éthique en contexte peuvent s’inspirer de lui quand il décrit des phénomènes en se situant au plus près de leur concrétude […]. » (p. 147)
Il n’en demeure pas moins que l’éthique lévinassienne peut apparaître comme rigoureusement anthropocentrée : pour Levinas, seuls les êtres humains ont à rigoureusement parler un visage. Il exclut, semble-t-il, les animaux – aussi vulnérables soient-ils – de l’éthique. C’est du moins ce qu’on peut affirmer en se fondant sur Totalité et infini et Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Toutefois, en d’autres lieux de son œuvre, l’anthropocentrisme de sa pensée n’apparaît pas aussi absolu. Corine Pelluchon se réfère à ce texte de Difficile liberté, « Nom d’un chien ou le droit naturel » dans lequel Levinas – qui a thématisé la notion d’intrigue – raconte l’événement qui s’est produit dans le camp où il a été détenu pendant la guerre : « Nous étions soixante-dix dans un commando forestier pour prisonniers de guerre israélites, en Allemagne nazie. » Et dans cette situation de déshumanisation – « nous n’étions qu’une quasi humanité, une bande de singes » – un chien surgit « nous l’appelions Bobby, d’un nom exotique comme il convient à un chien chéri. » Et c’est ce chien errant qui a attesté la dignité de la personne : « Pour lui – c’était incontestable – nous fûmes des hommes. » Et de ce chien qui célèbre par ses aboiements joyeux l’humanité de ces prisonniers, Levinas dit magnifiquement qu’il était le « dernier kantien de l’Allemagne nazie. » Et même s’il ne disposait pas du « cerveau qu’il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait des chiens d’Egypte[25] », « ceux qui sauvegardèrent, en n’aboyant pas, les Hébreux quittant l’Egypte et s’affranchissant de l’esclavage[26]. » D’un côté, des hommes, les nazis, nient l’humanité d’autres hommes, et les traitent comme des chiens – ou des singes – et d’un autre côté un chien témoigne de la vivacité de la loi morale alors même que les hommes qui l’auraient attestée soit se sont exilés pour échapper à la violence hitlérienne, soit ont été sommés de se taire – Cassirer, qui, à Davos en 1929, s’opposait à Heidegger à propos de Kant[27], avait dû s’exiler, et Jaspers était réduit au silence car son épouse était juive. Il n’y a pas de symétrie entre la démarche consistant à refuser à des êtres humains leur appartenance à l’humanité, et celle qui consiste à rendre hommage à un chien pour qui les prisonniers étaient indiscutablement des hommes. Car Levinas, tout en qualifiant ce chien de kantien, mais en ne projetant pas sur lui des capacités cognitives proprement humaines, le maintient dans sa nature canine. Un homme n’est pas un singe, un singe n’est pas un chien et un chien n’est pas un homme. De surcroit, l’animal pour Levinas et pour le judaïsme n’est pas inférieur à l’homme. Mieux : l’animal – le coq cette fois-ci – peut faire preuve d’un discernement qui le rapproche de Dieu, comme – non sans malice – Levinas l’explique dans l’entretien qui poursuit la réflexion exposée dans Transcendance et intelligibilité : « Est-ce que le psychisme animal n’est pas déjà de la théologie ? Ce serait scandaleux, n’est-ce pas ?... mais dans la Bible l’homme n’est pas un animal raisonnable, il ressemble à Dieu… ce n’est pas aristotélicien du tout ! Et savez-vous que la prière matinale des juifs commence par une série de bénédictions dont la première consiste à rendre grâce de ce que Dieu a conféré au coq le discernement entre le jour et la nuit[28] ? » Enfin, l’animal, moins athée que l’homme, est ce premier venu qu’il faut secourir, comme le rappelle Levinas dans une leçon talmudique. Abraham demande « à Rebecca, future mère d’Israël, un peu d’eau à la cruche ; mais Rebecca abreuvera aussi les chameaux de la caravane “jusqu’à ce qu’ils aient bu tous”, elle abreuvera les chameaux qui ne savent pas demander à boire. » Rebecca fait preuve d’une forme de miséricorde pleine d’humanité, et d’une « responsabilité pour le premier venu – fût-il, si j’ose dire, un peu chameau –, responsabilité débordant la mesure de la demande que le moi entendit dans le visage d’autrui[29]. » Ces surgissements d’animaux, sous la plume espiègle et tendre de Levinas, font comprendre que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ait déclaré : « On ne peut refuser complètement le visage à l’animal. » Et il ajoute : « Il est clair – sans qu’il faille considérer les animaux comme des êtres humains – que l’éthique concerne tous les êtres vivants[30]. » À ce maintien de la différence spécifique entre l’homme et l’animal – qui n’implique pas une reconduction de l’anthropocentrisme de la métaphysique occidentale – il y a deux raisons : d’une part, la diversité des animaux, car s’il y a des vaches qui pleurent quand on les mène à l’abattoir – auxquelles on pourrait reconnaître un visage, caractérisé par sa faiblesse qui implore – il y a aussi, par exemple, des serpents et d’eux – ou d’autres animaux – il semble qu’ils sont tellement énigmatiques qu’on a du mal à voir leur « visage ». Aussi, Levinas remarque-t-il : « Le visage humain est complètement différent, et ce n’est qu’après coup que nous découvrons le visage d’un animal. Je ne sais pas si un serpent a un visage[31]. » D’autre part, il y a bien pour Levinas quelque chose comme un propre de l’homme, qui n’est ni la raison, ni le langage, ni la liberté, mais une certaine manière d’être : « Je ne sais à quel moment apparaît l’humain, mais ce que je veux souligner, c’est que l’humain est une rupture avec l’être pur, qui est toujours une persévérance dans l’être – c’est là ma thèse principale. Un être, c’est quelque chose qui est attaché à être, à son propre être – c’est là l’idée de Darwin : l’être des animaux est une lutte pour la vie ; une lutte pour la vie, sans éthique ; c’est une question de puissance. […] Pourtant, avec l’apparition de l’humain – voilà toute ma philosophie – il y a quelque chose de plus important que ma propre vie, qui est la vie de l’autre. C’est déraisonnable ! Mais l’homme est un animal déraisonnable ! La plupart du temps, ma vie est ce qui m’est le plus cher, la plupart du temps on s’occupe de soi-même. Pourtant, nous ne pouvons pas ne pas admirer la sainteté ; non pas le sacré, mais la sainteté, c’est-à-dire la personne qui, dans son être, est plus attachée à l’être de l’autre qu’au sien propre. Je crois que c’est avec la sainteté que commence l’humanité ; non pas avec l’accomplissement de la sainteté, mais dans la considération de sa valeur[32]. » Pour Levinas, l’humain fait exception dans l’être, il ne coïncide pas avec l’être, ne se soumet pas à sa logique, ce qu’atteste sa capacité à se soucier de l’autre, à se désintéresser de soi, et ce malgré soi, par le fait que rencontrer le premier venu, c’est s’ouvrir à sa transcendance, autrement dit, sortir de soi. Le terme de sainteté rend en un sens plus humains les concepts de substitution, d’otage, de persécution auxquels il recourt pour analyser son concept de responsabilité. Le saint n’est-ce pas celui que nous admirons pour sa capacité à mourir pour autrui ? L’animal, selon Levinas, ne peut pas se vouer à une autre vie que la sienne – mais la vie de l’animal me regarde : son « visage » – en raison de sa fragilité – du moins en ce qui concerne les animaux que nous faisons naître pour les tuer – m’interpelle, ou implore. Nous savons depuis longtemps que les animaux sont doués de sensibilité, et c’est une raison suffisante pour nous obliger à ne pas les faire souffrir. Nous savons aussi que les animaux – certains d’entre eux – disposent de formes de langage, de capacité à fabriquer des outils, de culture, mais les animaux – les chauve-souris et les serpents, les singes et les crevettes – peuvent-ils être déraisonnables au point de davantage s’attacher à l’être de l’autre qu’au sien propre – d’être des saints ? Et pouvons-nous, dans la relation concrète avec un animal, dans l’expérience de notre responsabilité pour lui, accéder à l’autrement qu’être ? Assurément, ce n’est que dans la concrétude de ma relation à l’autre homme que Dieu me vient à l’idée, car « si autrui n’est pas l’infini, il l’exprime et en est la trace. » (p. 249)
Ce livre s’achève sur le sens de Dieu selon Levinas, et, tout en montrant que cette philosophie fait sens indépendamment à toute référence à Dieu, l’auteur rappelle aussi que l’idée-de-l’Infini-en-moi ne me vient que dans et par l’immanence, à savoir quand mes obligations sont remplies, c’est-à-dire lorsque j’aurai nourri ceux qui ont faim. Et Corine Pelluchon laisse pour conclure la parole à un autre, à Jacques Derrida qui avait témoigné de sa « gratitude » en lui disant « adieu » alors que, ne pouvant plus nous répondre, Emmanuel Levinas « répond en nous ». L’un des enseignements que ce livre tire de cette philosophie, qui est venue « déranger, discrètement mais irréversiblement, les pensées les plus fortes[33] », consiste à ouvrir la possibilité, avec Levinas, de penser autrement et au-delà de soi-même, car le sens provient d’une parole autre – avec laquelle dialoguer : la vérité ne se trouve-t-elle pas ailleurs que chez soi ?
[1] L’orthographe du nom de Levinas hésite : tantôt on écrit son nom propre avec un accent, et de plus en plus sans accent, comme le fait Corine Pelluchon et la plupart désormais des commentateurs et des éditeurs.
[2] On trouvera une bibliographie très complète, les études en anglais, en allemand, en italien, en néerlandais, en turc, etc. sur le site https://levinas.fr/emmanuel-levinas/
[3] Emmanuel Levinas, « l’actualité de Maïmonide » dans Épreuves d’une pensée, Cahier de l’Herne, Paris, éd. de l’Herne, 1991, p. 142. Voir l’analyse de François-David Sebbah, Levinas. Ambiguïtés de l’altérité, Paris, Les Belles-Lettres, 2003, et Levinas et le contemporain : les préoccupations de l’heure, Besançon, Les Solitaires intempestifs, et la discussion avec Dan Arbib dans l’émission Répliques d’Alain Finkielkraut :
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/emmanuel-levinas-et-les-preoccupations-de-lheure
[4] Comme le précise Corine Pelluchon p. 7 : « le public, est composé en majorité de gériatres, d’oncologues, de médecins en soins palliatifs, de réanimateurs-anesthésistes, de pédiatres, de psychiatres, de psychologues, d’infirmiers et d’infirmières, de cadres de santé. » Les références des citations extraites de Pour comprendre Levinas seront indiquées par le N° de page entre parenthèses dans le texte, les autres références en notes de bas de page.
[5] Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Paris, Galilée, 1997, p. 23.
[6] Emmanuel Levinas, « Signatures » dans Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Paris, Albin Michel, rééd. Le livre de poche, 1984, p. 406.
[7] Voir les pages que François-David Sebbah consacre à cette question dans son étude, Levinas. Ambiguïtés de l’altérité, éd. cit. p. 133 à 168, dans lesquelles il expose le débat qui a eu lieu entre Levinas et Jean-François Lyotard qui qualifiait Levinas de « penseur juif » – appellation qui a suscité des réserves de la part de Levinas, qui tenait à se plier aux exigences de la philosophie en son sens grec. Il n’en demeure pas moins que sa philosophie est « travaillée par le judaïsme, au sens fort inspirée par lui » (F.-D. Sebbah, p. 136.) Mais elle ne se réduit pas – loin de là – à une sorte de reformulation du judaïsme dans le langage de la philosophie.
[8] Levinas, Le Temps et l’autre, Paris, PUF, 1983, p. 80. Ces lignes sont manifestement dirigées contre Sartre pour qui autrui est un alter ego, défini par sa liberté identique à la mienne et avec laquelle il n’est d’autre relation que conflictuelle.
[9] Ibid., p. 83.
[10] Ibid., p. 81-82.
[11] Emmanuel Levinas, Ethique et infini, Paris, éd. Fayard/France culture, 1982, p. 102.
[12] Corine Pelluchon reprend l’expression utilisée par le neuropédiatre Thierry Billette lors du séminaire.
[13] Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de Poche, « biblio/essais », 1996, p. 180.
[14] À propos de la notion de spiritualité, Emmanuel Levinas écrit : « Rien n’est plus équivoque que le terme de vie spirituelle. Ne pourrait-on pas le préciser en en excluant tout rapport de violence ? » (Difficile liberté, Paris, Albin Michel 1976, rééd. Le Livre de Poche, « Biblio/essais », 1990, p. 18.)
[15] Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, Paris, Vrin, 1982, p. 11.
[16] Emmanuel Levinas, Difficile liberté, éd. cit., p. 21.
[17] Emmanuel Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris, Grasset, 1991, rééd. Le Livre de Poche, 1993, p. 113-114. Levinas ajoute p. 118 : « l’amour doit toujours surveiller la justice. »
[18] Emmanuel Levinas, Hors sujet, Fata Morgana, Fontfroide-le-haut, 1987, p. 63-64.
[19] Corine Pelluchon recourt souvent à cette formule pour exposer la critique lévinassienne de l’ontologie. Voir p. 156 : « sa réflexion apparaît […] comme une alternative à la fois à cette pensée de l’être rivé et aux philosophies de la liberté qui ne sont pas en mesure de nous garantir contre le mal parce que ce sont des philosophies du pour-soi. » Voir également p. 166 : « Levinas propose à la place de cette pensée rivée à l’être le concept d’évasion. » Et p. 268 : « Levinas […] ouvre la voie à celles et ceux qui essaient de trouver une alternative […] aux pensées de l’être rivé qui sont aussi des pensées rivées à l’être. »
[20] Emmanuel Levinas, Difficile liberté, éd. cit., p. 194.
[21] Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, p. 172-173.
[22] Voir respectivement, Heidegger, « La question de la technique » dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1980 ; Hans Jonas, Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technicienne, 1979, trad. franç, Paris, Cerf, rééd. Flammarion 2013 ; Jan Patocka, « la civilisation technique est-elle une civilisation de déclin, et pourquoi ? » dans Essais hérétiques, Lagrasse, éd. Verdier, 1981 ; Jacques Ellul, Le Système technicien, Calmann-lévy, 1997, rééd. le Cherche midi 2012 ; Jean Vioulac, L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique, Paris, PUF, 2009.
[23] Emmanuel Levinas, Difficile liberté, éd. cit., p. 323.
[24] Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, éd. cit., p. 262, commenté par Corine Pelluchon p. 139.
[25] Emmanuel Levinas, Difficile liberté, éd. cit., p. 213-216.
[26] Elisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, p. 680.
[27] Levinas a assisté à ce débat.
[28] Emmanuel Levinas, Transcendance et intelligibilité, Genève, Labor et Fides, 1996, p. 40.
[29] Emmanuel Levinas, À l’heure des nations, Paris, éd. de Minuit, 1988, p. 156.
[30] « Le paradoxe de la moralité : un entretien avec Emmanuel Levinas », avec Peter Hughes, Alison Ainley, trad. Alain David, revue « Philosophie », Paris, éd. de Minuit, 2012, N° 112, p. 13.
[31] Ibid., p. 15.
[32]Ibid.
[33] Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, éd. cit., p. 22.