Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Gallimard 2015, lu par Dimitri Desurmon
Par Romain Couderc le 05 juillet 2018, 06:00 - Esthétique - Lien permanent
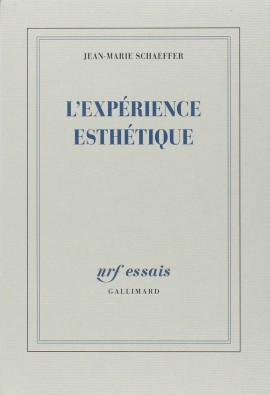
Jean-Marie Schaeffer, L’Expérience esthétique, Gallimard, NRF essais, 2015 (384 p.). Lu par Dimitri Desurmon.
Réinscrire la relation esthétique dans le champ de l’expérience en général et comprendre ce qui fait la spécificité d’une « expérience esthétique » dont l’existence reste à prouver, telle est l’ambition de l’ouvrage intitulé L’Expérience esthétique de Jean-Marie Schaeffer, spécialiste des questions d’esthétique et de la philosophie de l’art, chercheur au CNRS et directeur d’études à l’EHESS.
Ce qui fait l’originalité de cette publication est notamment le recours abondant aux sciences cognitives sans la tentation d’un quelconque psychologisme. Au terme de la réflexion qui part d’une question très classique, nous aboutissons à la conclusion tout à fait surprenante selon laquelle l’expérience esthétique, loin d’être le monopole de l’homme, constitue un moment « d’immanence heureuse » (p. 310) qui fait s’évanouir les questions et inquiétudes de tout être vivant en recentrant son attention sur les ressources mentales dont il dispose pour affronter la contingence irréductible du monde.
Dans la littérature comme dans l’art en général, les récits ou exposés d’expériences esthétiques abondent : ainsi Nescio décrit-il dans « P’tit poète » « l’épiphanie » de Dora qui voit le soir monter de la terre, nous pouvons aussi penser à James Joyce rapportant la rencontre poétique de Stephen Dedalus avec une jeune femme dans le Portrait de l’artiste en jeune homme (pp.16-18). Dans ces différents exemples, l’expérience décrite par l’auteur et vécue par le personnage se teinte d’une couleur toute particulière qui tend à doter la réalité de traits originaux et inattendus. Nous pourrions d’emblée conclure à l’existence d’une expérience esthétique et tenter d’en rechercher les caractéristiques dans ces épiphanies poétiques dont la littérature nous régale. Et si l’art s’était inventé lui-même comme art ? Interrogation toujours tue et pourtant omniprésente dès lors que nous faisons l’expérience de ce qui nous est présenté comme art : vivons-nous quelque expérience particulière qui serait de l’ordre de ce que les grands auteurs nous ont décrit ? L’expérience esthétique, ce contact si particulier avec l’œuvre ou avec un objet du monde, n’est-il pas inventé de toutes pièces par les artistes eux-mêmes ? A cette première interrogation, Jean-Marie Schaeffer répond par la négative. Si l’on considère l’expérience esthétique comme une supercherie de l’art, c’est que l’on maintient le présupposé selon lequel il devrait exister une rupture entre une expérience dite standard et une expérience supposée esthétique auquel cas, puisque deux types qualitativement distincts d’expérience se trouvent posés par avance, nous nous fermons à la compréhension de ce que pourrait être réellement l’expérience esthétique.
Mais la tentative de réintégrer la relation esthétique dans l’expérience au sens large, comme le montre Schaeffer, a échoué : Heidegger et Dewey incarnent les deux facettes de cet échec, le premier ayant réduit toute expérience au rang de relation esthétique à l’être et le second ayant fait de l’art une pure convention, ils se sont empêchés, par rejet du psychologisme, de comprendre la possibilité d’une expérience esthétique au sein de l’expérience. Schaeffer l’explique : il faut une clarification des concepts d’expérience et d’esthétique pour espérer trouver une issue à ce problème. De même, il faut admettre avec Valery que, quand bien même les expériences esthétiques dépeintes seraient toutes fictives, il est impossible de nier l’expérience vécue par le lecteur qui poursuit une entreprise sans but pragmatique défini et qui, en cela, vit une expérience particulière, une expérience esthétique. Schaeffer privilégie donc un sens élargi de l’expérience : « (…) l’expérience est l’ensemble des processus interactionnels de nature cognitive, émotive et volitive qui constituent notre relation avec le monde et avec nous-mêmes, ainsi que l’ensemble des compétences acquises par la récurrence de ces processus. » (p.39) et une distinction entre le concept d’esthétique et celui d’artistique auquel il a trop souvent tendance à être réduit : « J’utiliserai donc le terme « esthétique » dans ce qui suit pour me référer à un type d’expérience (…) à un type de relation aux choses » par opposition à un « type d’objet » (p.44) faisant ainsi de la relation esthétique une expérience à part entière. Mais si la relation esthétique ne relève plus de la présence d’un certain type d’objet ou de certaines de leur propriétés comment peut-elle donner lieu à une expérience de type singulier alors que notre expérience, au-delà de ce qui est expérimenté, est une ?
Le second chapitre, à notre humble avis central et décisif, s’ouvre sur un extrait de « De l’œuvre au texte » de Roland Barthes qui permet à Schaeffer de discuter la notion d’épiphanie employée plus haut. Il montre en effet grâce à ce texte que l’expérience esthétique, même si elle est l’expérience d’une présence radicale, ne peut être pensée hors du temps qui la constitue comme expérience ; l’expérience esthétique n’est pas une sortie du temps, elle est plutôt l’ouverture à une temporalité particulière, car elle relève toujours d’un véritable temps vécu. On comprendra aisément que Schaeffer rejette l’analyse de la relation esthétique comme contemplation. Le texte de Barthes nous révèle aussi que l’expérience esthétique se caractérise par une certaine « dépense » en termes d’attention, Schaeffer parle de « densification du contenu » : les informations sont toujours plus nombreuses et ne tendent pas à converger vers un but unique et prédéfini. Il s’agit donc à présent de déterminer ce qui fait le propre de l’expérience esthétique, est-ce parce que nous avons affaire à un système de signes spécifiques que nous vivons une expérience esthétique ? Cette hypothèse proposée par Goodman est d’emblée rejetée par Schaeffer car elle conduit inévitablement à affirmer que les images « ont plus d’affinité avec l’esthétique » (p.53), ce qui est absurde. Il faut donc se tourner vers l’attention : l’expérience esthétique, c’est l’activation d’un certain type d’attention, quel est-il ? Qui dit analyse de l’attention dit aussi examen de notre relation à un contenu cognitif…
Le deuxième mouvement de ce chapitre, centré sur les sciences cognitives, a pour ambition de distinguer deux facettes de l’expérience permettant à terme de distinguer deux styles d’attention différents, dont l’un est celui de l’expérience esthétique. Nous ne reproduisons pas toute la démarche argumentative, bien trop riche, mais nous soulignons le fait que le propos n’a rien d’assertif. Schaeffer commence par opposer le traitement sériel de l’information au traitement parallèle. Sur la base d’une étude portant sur les jeux vidéos, il démontre que le traitement sériel (i.e. information n nous permet d’anticiper et d’inférer information n+1), qui a pour but de produire rapidement une croyance en focalisant l’attention sur certaines données, est désamorcé en régime esthétique au profit d’un traitement parallèle, où l’attention n’est pas focalisée, elle « balaye » d’abord ce qui lui est proposé, indépendamment de la volonté de produire une croyance. Le premier traitement donne naissance à une attention focalisée (i.e. en situation pragmatique), le second à une attention distribuée qui est celle qui correspond à l’attention en mode esthétique. Il distingue ensuite le traitement ascendant du traitement descendant de l’information : le traitement ascendant est celui qui, depuis un stimulus, pratique une catégorisation rapide de ce stimulus, ce traitement est guidé depuis et par le stimulus vers le concept abstrait, au contraire, le traitement descendant est celui qui diffère la catégorisation afin d’orienter l’attention vers le stimulus, c’est l’attention qui guide ce mode de traitement. Le premier traitement tend à réduire les stimuli à de l’abstrait déjà connu et est guidé par les stimuli, le second permet un apprentissage perceptuel et est guidé par l’attention elle-même qui devient alors son propre moteur : un monde « régi par les stimuli » et un monde « construit par l’attention » (p.85) s’opposent. Toujours dans la continuité de ce qui a déjà été évoqué, Schaeffer distingue le traitement monodique du traitement polyphonique, le traitement polyphonique est celui qui agit en faveur de la richesse d’un contenu esthétique, il accepte les ruptures, les variations, les différents niveaux contrairement au niveau monodique qui agit en régime pragmatique et dans lequel l’unité de contenu informationnel est privilégiée. Ces oppositions mettent l’accent sur deux styles opposés d’attention, l’un que l’on pourrait nommer « convergent » et l’autre « divergent » (p.100).
Style convergent et style divergent, tels sont les deux concepts clefs de ce chapitre, ils sont la colonne vertébrale de la réflexion de Schaeffer. Une fois les différentes stratégies attentionnelles définies, cela ne suffit pas pour affirmer l’existence « de processus attentionnels qui seraient spécifiquement esthétiques » (p.100). En revanche, comme Schaeffer l’a souligné plus haut dans la démarche, l’expérience esthétique se caractérise par la « dépense » qui est faite par celui qui la vit, elle correspond à un style attentionnel non économique, contrairement à l’expérience standard (i. e. en situation pragmatique) où ce qui prime est une optimisation des moyens commandée par une maxime de moindre coût. Par « style attentionnel non économique » nous entendons une attitude qui ne correspond pas à une logique d’efficacité et de rendement proportionnels à l’investissement : e. g. contempler un tableau ou aller au cinéma et rester jusqu’à la fin du film sont des dépenses en termes de temps et d’attention qui ne sont pas « rentables », à moins de le faire pour des raisons précises, comme pour réaliser un devoir, auquel cas l’attention se trouve recadrée pragmatiquement, nous sélectionnons et économisons. Or, il se trouve que lorsque les stratégies de traitement parallèle, de traitement descendant et de traitement polyphonique sont combinées en une série convergente, nous assistons précisément à ce qui se produit au cours d’une « dépense » esthétique : « ces caractéristiques du style cognitif divergent concourent à en faire un traitement cognitif non économique, aboutissant parfois à une surcharge attentionnelle » (p.104). Par opposition au « style convergent », le « style divergent » tend à retarder indéfiniment la catégorisation de l’information au profit de la richesse d’un contenu. Le style convergent correspond à la série convergente des stratégies de traitement qui privilégient une catégorisation maximale et rapide, c’est le style correspondant aux attitudes éminemment pragmatiques. Ainsi se trouvent ramassées dans un seul concept, i. e. style cognitif divergent, en accord avec les sciences empiriques toutes les propriétés que les penseurs ont tenté de donner à l’expérience esthétique sans parvenir à en fournir la synthèse : elle est désintéressée, « dépragmatisée », elle a le souci du détail, elle ne repose pas sur certains traits spécifiques de l’objet considéré, elle produit un apprentissage perceptuel, etc. Cette approche cognitiviste de ce qui fait le propre de l’expérience en mode esthétique, à savoir le style attentionnel divergent, semble incompatible avec l’idée largement partagée selon laquelle ce qui prime au cours d’une telle expérience n’est pas tant le traitement cognitif du contenu que les émotions provoquée par l’objet contemplé. Le troisième chapitre discute cette objection.
« En effet, l’expérience esthétique n’est-elle pas foncièrement une expérience appréciative, et donc émotionnellement engagée ? Et la figure idéale de l’attention conçue comme processus cognitif n’est-elle pas, au contraire, celle d’une attention « détachée » de toute implication émotive ? » (p.113) se demande Schaeffer dès le début du troisième chapitre. L’examen d’une telle objection est incontournable tant l’expérience esthétique semble se caractériser par les émotions qui naissent en celui qui la vit. En s’appuyant sur Proust qui décrit tout au long de La Recherche du temps perdu une série d’expériences esthétiques, et plus particulièrement de lectures, en soulignant la capacité qu’elles ont de susciter des émotions dont on se souvient par rapport au contenu qu’on oublie, Schaeffer entend examiner la pertinence d’une approche cognitiviste de ces expériences. En effet, si l’émotion prime sur la cognition, cela désamorce l’idée centrale selon laquelle l’expérience esthétique relèverait d’un style cognitif et attentionnel spécifique. A vrai dire, un double problème se pose si l’on maintient la distinction radicale entre cognition et émotion. Premièrement, comment maintenir la distinction entre le fait de prendre connaissance et le fait d’évaluer sachant qu’il faut avant tout identifier ce que l’on évalue ? Deuxièmement, Schaeffer réitère l’inquiétude platonicienne : si l’on maintient le caractère prioritaire de l’émotion, considérée comme irrationnelle et distincte de tout processus cognitif, l’attention esthétique ne se trouve-t-elle pas « par nature biaisée, voire instrumentalisée » (e. g. propagande) (p.119)? Comme pour toute interrogation, l’auteur privilégie une clarification des concepts, ici, de celui d’émotion. Nous pouvons distinguer trois types d’émotion : (1) l’émotion comme réaction physiologique à un stimulus donné, « sensations évaluantes de base » (p.120), (2) les sentiments ou affects dépourvus d’objet comme la peur, l’angoisse, la tristesse, etc. qui sont autant de manières de « se sentir » (p.121) et (3) les émotions à contenu intentionnel, celles qui portent sur un objet déterminé que l’on se représente, comme lorsque nous aimons quelque chose car nous pensons que cette chose a certaines propriétés. Schaeffer insiste sur la différence entre ce troisième type et le premier : le (1) se situe sur un plan purement causal, physiologique, le (3) implique une représentation comme médiation entre stimulus et réaction. La frontière entre ces trois types d’émotion est poreuse dans la mesure où toutes les émotions sont faites d’une même structure : elles possèdent toutes un contenu, qui permet de distinguer une émotion d’une autre, un degré d’activation physiologie et une composante hédonique (i. e. évaluation plaisir/douleur) sur laquelle nous reviendrons. Il s’agit maintenant de savoir si l’analyse entamée précédemment est susceptible de rendre compte des émotions en régime esthétique ou plutôt s’il est possible de fournir une approche de ce que sont les émotions en les considérant comme les produits de dynamiques cognitives.
Les émotions, considérées habituellement comme « irrationnelles », sont-elles distinctes de tout processus cognitif ? Il faut d’abord s’entendre sur ce que nous nommons « cognitif ». En effet, si nous affirmons que l’émotion est précognitive, c’est que l’on maintient l’équivalence présupposée entre cognitif et conscient (ou attentionnel) (p.134). Que peut-on donc appeler traitement cognitif ? Il semble que nous puissions affirmer qu’il y a traitement cognitif dès lors qu’il y a un traitement du signal ou de l’information, traitement qui part du stimulus pour aller jusqu’au concept. L’attention n’est donc que l’étape la plus aboutie du processus cognitif. Peut-on maintenir l’idée selon laquelle l’émotion échappe à ce processus de traitement ? Non. Premièrement, il apparaît que dans la plupart des cas, l’émotion possède un certain degré de flexibilité. En fonction de l’accoutumance, de l’habitude, nous parvenons à modifier certaines émotions, c’est bel et bien qu’il existe une forme d’apprentissage lié aux émotions. Deuxièmement, l’émotion est le corrélatif d’une disposition à agir, elle est le produit d’une première évaluation de type cognitif qui distingue ce qui est plaisant de ce qui est déplaisant (valence hédonique). En associant un stimulus à une punition ou à une récompense, il est possible d’altérer une émotion qui semble pourtant être une réaction innée à ce stimulus, cette altération n’atteignant pas pour autant le niveau attentionnel (concept que nous substituerons dorénavant à celui de « conscient ») (p.139). Cette interprétation béhavoriste de l’émotion concorde avec les résultats expérimentaux mais semble ne pas pouvoir rendre compte de la distinction entre vouloir et aimer par exemple (p.140). Et le problème est que, en contexte esthétique, l’émotion est « découplée de toute disposition à agir » (p.140) et qu’elle ne semble donc pas se soumettre à cette logique qui réduit l’émotion au produit d’une évaluation hédonique. De même, si les émotions de type (1) et (3) intègrent un processus cognitif, puisque le type (1) est le produit quasi-direct de l’évaluation hédonique et que le (3) est médiatisé par une représentation qui peut être modifiée (les émotions sont ici culturellement et socialement déterminées), en ce qui concerne les émotions de type (2), puisqu’elles ne sont ni une réaction ni des émotions à contenu intentionnel, c’est plus compliqué, elles paraissent échapper à cette chaîne cognitive, elles semblent la transcender.
Or, ce sont les émotions de ce type (2) qui naissent au cours de l’expérience esthétique, ces émotions qui colorent notre rapport au monde sans porter sur aucun objet particulier. La solution de Schaeffer s’appuie toujours sur les travaux en sciences cognitives : si l’on parvient à montrer que le style attentionnel influe sur les émotions, c’est que les émotions ne naissent pas exclusivement sur cette ligne qui mène du stimulus à l’état conscient mais qu’elles sont aussi la conséquence d’une certaine attention, auquel cas, il serait possible d’expliquer qu’elles puissent exister sans contenu intentionnel. Un nouveau paradoxe émerge pourtant : comment l’attention pourrait-elle agir en retour (feedback) sur les émotions pour générer celles du type (2) alors que toute émotion est le produit d’une évaluation hédonique qui est toujours corrélée à un stimulus ? Qu’est-ce qui est évalué pour la production d’un tel type d’émotion ? Schaeffer observe, avec les principaux auteurs en sciences cognitives, qu’il est possible que l’attention agisse en feedback sur l’émotion : e. g. il est possible de modifier l’expérience olfactive d’une personne en modifiant l’information sémantique qu’elle reçoit au niveau attentionnel, en changeant les étiquettes sous des objets semblables que l’on demande de sentir, l’émotion se trouve modifiée (p.145). Et ce qui est alors évalué n’est plus le stimulus ou son adéquation avec une représentation mais l’activité attentionnelle elle-même. C’est l’activité attentionnelle qui dans l’expérience esthétique reçoit une valence positive. Pourquoi cette réflexion apparemment digressive sur les émotions, quel rapport avec l’expérience esthétique ? Cela permet de comprendre que les émotions ne transcendent pas le niveau cognitif et qu’en ce sens, l’expérience esthétique ne doit pas être envisagée comme une « sortie » de l’expérience standard qui échappe à la connaissance (p.148). Nous pouvons aussi établir à la suite de cela que les émotions produites au cours d’une expérience esthétique ne sont pas des « pseudo-émotions » (e. g. les larmes du spectateur n’ont rien de « pseudo-larmes ») (p.155). Nous comprenons pourquoi l’expérience esthétique ne peut se produire que dans le cadre d’une enclave pragmatiquement déconnectée : l’évaluation hédonique doit avoir pour objet l’attention elle-même (p.161). Enfin, nous parvenons à résoudre avec Schaeffer le « paradoxe du tragique », nous saisissons pourquoi la somme d’émotions négatives est susceptible de produire une émotion globale positive : c’est que ces émotions ne se situent pas au même niveau, les premières sont de type (1) ou de type (3) et l’attention (de style cognitif divergent) agit en feedback sur ces émotions et donne naissance à une émotion positive de type (2) qui est le produit de l’évaluation positive de l’activité attentionnelle elle-même (p.170). Nous invitons le lecteur de ces lignes à se reporter au chapitre et aux pages concernés pour plus d’explications. Par souci d’économie, nous ne pouvons pas fournir ici de développements supplémentaires.
Nous n’en avons pas fini avec le problème de l’expérience esthétique : au cours de l’expérience esthétique, c’est l’activité attentionnelle elle-même qui se trouve évaluée par notre « calculateur hédonique », ce qui produit une émotion positive dépourvue de contenu intentionnel. Pourtant, ce qui reçoit une valence hédonique positive, c’est ce qui nous est favorable sur le plan pragmatique. Ainsi, comment comprendre que l’attention elle-même puisse recevoir une valence positive en contexte esthétique alors qu’elle est coûteuse en termes d’attention et nulle sur le plan pragmatique ? Concernant l’expérience esthétique, « tous ses traits caractéristiques mis en lumière plus en avant ici même concourent au même résultat : ils augmentent la durée, la différenciation, et la complexité de l’expérience attentionnelle, mais donc aussi son coût » (p.178). Alors, pourquoi le plaisir esthétique ? Pourquoi poursuivre une activité qui nous coûte et semble ne déboucher sur aucun gain en termes d’utilité ? L’œuvre d’art serait-elle une énigme et l’expérience esthétique sa résolution (ce qui nous ramènerait à des considérations plutôt aristotéliciennes) ? Cette dernière question peut vite être résolue dans la mesure où résoudre un problème consiste à faire la part des informations pertinentes ; or, nous avons vu que toutes les informations acquièrent une importance égale au cours d’une expérience esthétique. Ajouté à cela, l’attention esthétique n’est pas guidée par un résultat cognitif fixé au préalable, elle ne vise aucunement la formation d’une croyance à l’issue de l’expérience. Cela n’expliquerait pas non plus la genèse d’émotions intenses qui pourtant ne débouchent sur aucune décision et aucun gain. Le problème demeure donc intact : pourquoi ce plaisir esthétique malgré le surcoût engendré par l’expérience esthétique ?
Il convient tout d’abord d’examiner si nous pouvons maintenir une conception hédonique de nos expériences esthétiques, sont-elles tournées vers le plaisir ? Sont-elles une expérience hédonique ? Après avoir passé en revue les différentes positions sur l’art, Schaeffer en conclut que le plaisir, qu’il soit admis, recherché ou condamné, est toujours une composante centrale de toute thèse portant sur l’esthétique. De plus, anthropologiquement, le fait que le plaisir constitue une condition nécessaire à l’expérience esthétique est indéniable même s’il n’en est pas pour autant la condition suffisante, ce que nous pouvons aisément déduire du chapitre 2 (pp.186-187). Nous arrivons alors à trois questions qui doivent à présent orienter la démarche (p.188) : s’agit-il d’un type spécifique de plaisir ? par quoi est-il provoqué ? ce qui le provoque contient-il des propriétés spécifiques ? Mais peut-on assimiler le plaisir à la réalisation d’un désir ? Lors de la réalisation d’un désir, le plaisir est directement corrélé à la présence de l’objet souhaité, autrement dit, ce plaisir ne peut correspondre qu’aux émotions de type (1) et de type (3), et pas de type (2). Plus encore, lors de la réalisation d’un désir, il y a un plaisir lié à l’objet visé mais aussi un choix qui s’opère concernant la reconduction ou l’arrêt de cette réalisation, ce choix fait lui aussi l’objet d’une évaluation hédonique qui ne porte pourtant plus sur un contenu intentionnel mais sur l’attention elle-même. Cette évaluation hédonique « de second ordre » opère comme une évaluation du processus attentionnel lui-même. Nous pouvons alors retrouver les émotions de type (2) et faire la distinction entre vouloir et aimer, aimer ne consistant plus à viser un objet déterminé intentionnellement mais plutôt à éprouver un plaisir lié au processus attentionnel lui-même et à le reconduire. Ainsi, le plaisir esthétique n’est pas un type particulier de plaisir puisque le calculateur hédonique est une « basse continue » qui sous-tend toutes nos interactions avec le monde. Il est cependant produit par une utilisation spécifique de ce calculateur maintenant branché non plus sur un objet mais sur l’attention elle-même (p.194). Ce qui fait tout de même la singularité du plaisir esthétique est que le calculateur hédonique agit de façon hégémonique sur l’attention et sur l’attention seulement (p.198).
Nous avons alors répondu à la première question : le plaisir esthétique n’est pas un plaisir spécifique mais il possède tout de même une singularité qui permet de le distinguer des autres plaisirs où le calculateur hédonique agit de façon hégémonique (e. g. relation sexuelle, gourmandise, etc.). Par quoi ce plaisir est-il provoqué ? Telle était notre seconde interrogation. Nous comprenons que pour que le calculateur hédonique se centre sur l’attention seulement, il faut se situer dans un cadre « dépragmatisé ». En effet, si les interactions utiles avec le monde persistent, le calculateur hédonique reste « branché » sur les contenus intentionnels ou sur les stimuli. Nous saisissons alors pourquoi le plaisir esthétique n’est pas de l’ordre d’un plaisir intense ou plutôt pourquoi ce dernier rompt l’expérience esthétique ou se manifeste en marge d’elle. Un plaisir intense est un rappel au monde et le processus cognitif proprement esthétique se trouve alors mis en défaut car il est alors tout tourné vers une enclave pragmatique localisée (p.204). Mais ce plaisir peut-il être recherché volontairement ? Nous aurions tendance à répondre que oui car nous faisons le choix de nous rendre dans un musée ou d’aller au cinéma. Ce n’est pas pour autant que nous ressentons du plaisir : peut-être est-ce dû au fait que le plaisir esthétique repose sur certaines propriétés de l’objet, propriétés qui enclencheraient alors la dynamique attentionnelle esthétique. Schaeffer examine l’hypothèse selon laquelle le plaisir serait le produit de la fluence d’un contenu. Au plus un contenu serait lisible ou déchiffrable (selon certains traits comme la rime, la rythmique, la symétrie, la familiarité, etc.), au plus il serait favorable à l’entrée dans une expérience esthétique (p.214). Après une longue analyse de cette proposition, notre auteur conclut, sur la base d’une expérience menée en 2004, que « la fluence ne saurait pas être le facteur de la valence esthétique positive » (p.235). En effet, à mesure que la facilité de déchiffrement d’un contenu s’accroit, son intérêt décroit. Ainsi, nous ne pouvons réduire l’activation du plaisir esthétique à la facilité de déchiffrement d’un contenu. Cela semble aussi incompatible avec l’attention de style divergent mise en avant plus haut qui tend à accroitre la complexité plutôt qu’à la réduire. Peut-on trouver le plaisir du côté de la curiosité ? Difficilement : la curiosité signale un manque qui, une fois comblé, débouche sur un état émotionnellement neutre. Il faut, avec Schaeffer, accepter que le plaisir esthétique est produit par une alternance de fluence et de curiosité qui correspond à la boucle entre attention et évaluation hédonique car « l’expérience esthétique est ce cercle et rien d’autre que ce cercle » (p.250). Pour répondre à notre troisième question, ce n’est pas l’objet en tant que tel qui appel au plaisir en régime esthétique ; la sortie du calculateur hédonique est conditionnée par une oscillation entre fluence et curiosité et donc l’attention y joue un rôle fondamental, ce qui nous permet d’affirmer que le plaisir en régime esthétique est en grande partie volontaire car l’attention de style divergent est volontaire (p.247).
L’expérience esthétique est à présent comprise : elle est l’expérience qui se caractérise par un style cognitif divergent qui agit en retour sur les émotions et elle est l’expérience d’un plaisir reconduit en grande partie volontairement par le fait que ce qui plait, c’est l’attention elle-même dans son activité. Reste maintenant à soulever une question majeure en guise de conclusion et d’ouverture : quelle peut bien être la fonction de cette expérience esthétique qui est un fait anthropologique universel ? Cette ultime partie ouvre sur une perspective pour le moins inattendue et, sans nul doute originale. Schaeffer entame le cinquième chapitre avec un exemple : celui des oiseaux-berceau, connus pour leurs nids d’une forme incroyable. Plutôt que de commencer à analyser l’ensemble des comportements esthétiques chez l’homme, peut-être nous est-il possible d’en déterminer les principaux traits en ne le considérant pas comme privilégié au sein du règne animal. Afin de s’accoupler, l’oiseau-berceau mâle emploie une stratégie pour le moins étonnante : il passe plusieurs mois à élaborer une véritable œuvre architecturale, un nid, dans le seul but de séduire une femelle, le nid n’étant plus d’aucune utilité après l’accouplement. Le mâle et la femelle vivent-ils une expérience esthétique ? Si oui, en quoi ? N’est-ce pas faire preuve d’un anthropomorphisme chevronné que de vouloir trouver dans ce comportement un point de départ pour la compréhension de l’expérience esthétique humaine ? Force est de constater que les signes qui fonctionnement selon une sémantique précise dans un cadre pragmatique se voient libérés de leur signification habituelle au profit d’une autre : le nid n’est pas destiné à accueillir les petits, la nourriture disposée autour ne sera pas mangée, les cris poussés par le mâle (cris d’alarme, de défense, de joie, etc.) s’enchainent sans impliquer de réaction adaptée (pp.256-257). Schaeffer répond aux objections de méthode en soulignant qu’il est incontestable que les oiseaux mâle et femelle se place dans une situation déconnectée pragmatiquement et qu’il s’agit pour le mâle « d’attirer l’œil » d’une femelle qui « assiste au spectacle ».
Pourtant, l’oiseau-berceau vise un but précis : la reproduction. Ici s’arrête la comparaison possible avec l’expérience esthétique humaine. Cette comparaison est une homologie structurale et pas une analogie fonctionnelle. L’homologie structurale se définit comme le partage d’un trait commun pour des espèces issues d’une descendance commune sans que ce trait ne remplisse la même fonction. L’analogie fonctionnelle est le partage de finalités pour des espèces issues de descendances différentes (se reporter au glossaire de l’œuvre pour plus d’explications). Ainsi, l’homme possède ce trait commun avec l’oiseau-berceau qu’il rompt avec la sémantique habituelle de certains signes pour les employer à d’autres fins. Ajouté à cela, tout comme l’oiseau-berceau se place dans une situation qui lui coûte, l’homme « dépense » au cours de l’expérience esthétique. Que permettent ces variations sémantiques couplées au surcoût d’une activité ? Pour répondre à cela, il faut se demander ce que signalent les signaux qui se voient détournés de leur sémantique standard. Il est clair que l’oiseau-berceau, dans la posture qu’il adopte, se place en situation de handicap tout comme le paon qui, déployant sa queue, n’a aucune chance de pouvoir s’envoler si un danger le menace. Les deux soulignent par là leurs qualités réelles. De la même manière, dire « je suis fort » n’implique pas directement cette qualité, « en revanche, lorsque le signal qui transmet ce message est la mise en œuvre même de cette force (par exemple dans un combat rituel), je ne peux pas tricher, puisque l’émission du signal est la conséquence directe de la qualité qu’il signale » (p.277). Ainsi, cette mise en déroute de la fonction communicante du langage couplée à une attitude coûteuse implique une honnêteté fondamentale : nous signalons sans symbole une qualité. Et c’est précisément ce qui a lieu lors d’une expérience esthétique. Dès lors, l’expérience esthétique, en rompant avec la nature signifiante du langage et en provoquant un surcoût, semble avoir pour fonction de manifester les qualités réelles, sans détour possible, en toute immanence. Mais que dire alors de la fiction si l’expérience esthétique a pour but de nous révéler des qualités de façon immanente ? La fiction n’est-elle pas l’art du mensonge par excellence, l’art de l’éloignement plutôt que celui de l’expression?
Ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que l’on peut affirmer que la fiction n’est que fiction. Une fiction qui ne se rend pas crédible (et pas réaliste !) par les procédés qu’elle emploie n’amène pas à éprouver une expérience esthétique. Après plusieurs exemples de cette immanence vécue au cours de l’expérience esthétique, Jean-Marie Schaeffer établit que l’expérience esthétique nous permet, somme toute, d’apporter des réponses aux situations d’indécision, elle nous aide à supporter la contingence du monde car elle renoue avec ce dernier sur le plan de l’immanence. Faute d’une solution adéquate, l’expérience esthétique vient pallier les difficultés. « Et dans toutes les cultures les humains ont su tirer profit d’un ensemble de ressources mentales dont la genèse remonte haut dans l’histoire du vivant, pour se ménager des expériences (intermittentes) donnant naissance à des plages de transparence où tout semble tomber en place, simplement et naturellement, ne laissant momentanément plus de lieu pour quelque question ou inquiétude que ce soit. » (p.310) L’expérience esthétique est ce moment d’honnêteté où l’on est amené à éprouver sa propre puissance à travers un contact authentique avec le réel. Schaeffer s’autorise enfin, en guise d’ouverture et de manière provocante, le questionnement sur l’homologie fonctionnelle, i. e. le lien entre relation sexuelle et expérience esthétique, hypothèse qu’il avait rejetée plus haut pour ne pas verser dans le naturalisme brut. Cette question mérite d’être posée : la création et la contemplation nous prennent au ventre (pour ne pas dire au bas-ventre), peut-être faudrait-il y voir le point de jonction entre notre individualité limitée dans le temps et l’éternité de l’espèce ?
Pour conclure cette recension, nous tenons à souligner la précision du propos de l’auteur et la densité des références (ce qui justifie en grande partie la longueur de ce travail), il s’agit là d’un ouvrage brillamment documenté pourvu d’un glossaire regroupant les concepts clefs et les termes techniques. Cette lecture est indispensable pour quiconque souhaite s’intéresser aux questions d’esthétique de façon raisonnée, ouverte et approfondie. Nous terminerons par une ouverture anecdotique qui permettra, nous l’espérons, de faire entrevoir à chacun le grand potentiel de cette démarche. Nous n’avons pu, au cours de cette lecture, nous empêcher de penser à l’attitude de Socrate, notamment à celle qu’il adopte dans les dialogues aporétiques de Platon (i. e. Ménon, Gorgias, Charmide, Hippias majeur, etc.) où la pensée se déploie dans toute son endurance, dans toute sa « divergence » dirons-nous, sans autre but qu’une appréhension quasi-sensible du problème. Socrate en artiste et esthète ? Ne faudrait-il pas voir dans l’expérience esthétique, celle dont parle Schaeffer,l’ambition de toute philosophie qui se doit de proposer, comme cet ouvrage le fait si bien, l’occasion de faire s’évanouir pour un temps les inquiétudes en faisant l’épreuve de la force de la pensée ? Ne devrions-nous pas songer à tracer le portrait du philosophe en artiste et esthète
Dimitri Desurmon (01/06/2015).