J.C. Monod Qu’est –ce qu’un chef en démocratie ? éditions de Seuil 2012 Lu par Baptiste Calmejane
Par Florence Benamou le 17 février 2016, 06:05 - Philosophie politique - Lien permanent
Chers lecteurs, chères lectrices,
Les recensions paraissent et disparaissent très vite ; il est ainsi fort possible que certaines vous aient échappé en dépit de l'intérêt qu'elles présentaient pour vous. Nous avons donc décidé de leur donner, à elles comme à vous, une seconde chance. Nous avons réparti en cinq champs philosophiques, les recensions : philosophie antique, philosophie morale, philosophie esthétique, philosophie des sciences et philosophique politiques. Pendant cinq semaines correspondant à ces champs, nous publierons l'index thématique des recensions publiées cette année et proposerons chaque jour une recension à la relecture. Au terme de ce temps de reprise, nous reprendrons à notre rythme habituel la publication de nouvelles recensions.
Recensions de philosophie politique
`Recensions de philosophie antique
Recensions de philosophie morale
 J.C. Monod, Qu’est–ce qu’un chef en démocratie ? éditions de Seuil 2012.
J.C. Monod, Qu’est–ce qu’un chef en démocratie ? éditions de Seuil 2012.
Dans l’avertissement, Jean-Claude Monod réfléchit sur les ambiguïtés du terme de chef et en justifie l’usage dans le titre de l’ouvrage par la nécessité même de questionner les critères et les conditions d’un charisme favorable à la justice et à la souveraineté populaire. L’introduction de Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? présente une contextualisation historique et une problématisation philosophique de la question du charisme en politique. Jean-Claude Monod y rappelle que le XXème siècle a d’abord été celui des « pathologies du charisme politique ». Il expose la manière dont le marxisme-léninisme, le fascisme et le nazisme mais aussi le libéralisme se sont situés par rapport à la question du chef.
Il s’intéresse plus particulièrement à l’interprétation libérale de l’histoire moderne pour laquelle le pouvoir personnel aurait dû, en tout logique, s’effacer progressivement. Jean-Claude Monod expose ensuite les raisons pour lesquelles il lui paraît nécessaire d’investir philosophiquement la question du charisme politique en démocratie. Au fond, le problème se pose de savoir si le charisme politique et le pouvoir personnel peuvent et doivent avoir une forme et une légitimité démocratiques, ou si au contraire ces deux aspects de la vie politique doivent en démocratie être résorbés dans une structure juridique et délibérative rationnelle et impersonnelle. Jean-Claude Monod résume la question directrice de la façon suivante : « Ne faut-il pas admettre la possibilité et l’existence d’un charisme favorable au fonctionnement, voire à l’approfondissement de la démocratie ? ». Il s’agit alors de préciser que, dans une telle perspective, les critères restent à élaborer qui permettraient une distinction valable entre charisme authentiquement démocratique et charisme démagogique. Dans la deuxième partie de son introduction, Jean-Claude Monod, thématise l’alternative de la possibilité et de l’impossibilité du chef démocratique. Partant de la pensée de Rousseau, il montre l’aporie qu’il y a à penser un chef disposant d’une supériorité sur des gouvernés qui sont en même temps, comme le veut le paradigme démocratique, ses égaux, sinon même ses semblables. Or c’est le concept de charisme (avec celui de vertu) qui a été introduit dans la réflexion sociologique (Max Weber) et politique pour dépasser une telle aporie, si bien qu’il faut considérer que c’est précisément « dans le cadre de la démocratie moderne que le problème du charisme devient crucial » à titre de critère séculier et non naturel de sélection des dirigeants. La situation contemporaine amène cependant à douter de la place du charisme dans une société où l’économique tend à dominer le politique et à l’assujettir à ses propres lois. A la fin de l’introduction, l’auteur explicite la démarche et le plan de son ouvrage.
Au début du premier chapitre, intitulé « Typologies », Jean-Claude Monod rappelle l’origine et le sens chrétiens du pouvoir charismatique (chez Rudolf Sohm) pour, ensuite, exposer les traits constitutifs du charisme selon Weber ainsi que la signification de la domination charismatique par comparaison avec les formes de domination traditionnelle et légale-rationnelle. A cet égard, il faut comprendre que l’analyse wéberienne de la modernité politique fait clairement ressortir une double tendance contradictoire, tendance, d’une part, à la rationalisation bureaucratique et tendance, d’autre part, à l’émergence de formes de charismes politiques liées à la représentation démocratique, aux mouvements de masse, aux moyens de communications modernes, etc. Cette tendance en recoupe une autre, celle de l’homme politique professionnel, qui tend à réduire la politique à la bonne gestion, et celle de l’homme politique porté par une vocation et une conviction qui permettent au contraire l’élargissement de l’activité politique au-delà du simple pouvoir administratif. Selon Monod, il y a chez Weber, d’une part, une position claire sur le lien positif entre démocratie et charisme, à savoir qu’il ne peut y avoir de démocratie que charismatique en ce sens que seuls des leaders charismatiques plébiscités peuvent se faire les porte-voix du peuple, voire du petit peuple et, d’autre part, l’idée que dans cette relation où la démagogie est inévitable le peuple se trouve finalement en position passive, au point que l’exercice direct et effectif du pouvoir par le peuple doit être compris pour ce qu’il est réellement : une fiction. Il s’agit cependant de noter l’absence problématique chez Weber de prise en compte d’une certaine légitimité démocratique sans laquelle l’adhésion des dominés au pouvoir paraît aujourd’hui impossible. In fine, nous trouvons chez Weber le constat d’une persistance du charisme dans le monde politique contemporain ainsi que la valorisation d’un équilibre entre, d’un côté, le parlementarisme, l’organisation en partis, la gestion bureaucratique et administrative de la société et, de l’autre côté, une exigence de personnalisation de l’autorité, condition de possibilité de l’émergence de chefs charismatiques capables de prendre des décisions et d’en assumer la responsabilité, nécessaires pour parer au danger d’une démocratie acéphale, dépourvue autant de décideurs que de responsables. Cependant, si la figure du chef est bel et bien avant tout une figure d’autorité, il s’agit, pour l’analyser de la comparer à d’autres figures de l’autorité. Jean-Claude Monod analyse alors la typologie des formes d’autorité construite au milieu du XXème siècle par le philosophe Alexandre Kojève. Ce dernier identifie quatre types d’autorité en leur assignant un théoricien privilégié : le Père (la scolastique), le Maître (Hegel), le Chef (Aristote) et le Juge (Platon). Ce troisième est défini ainsi : « le Chef se crée Chef par suite d’un projet qu’il propose, c’est-à-dire en fonction d’un changement (plus ou moins radical) de la réalité donnée » [Alexandre Kojève, La notion d’autorité, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de Philosophie », 2004]. Le Chef d’Etat moderne cumule, en particulier en temps de guerre, le statut de Chef (par rapport à des égaux) et celui de Maître (par rapport aux sujets, aux vaincus potentiels ou réels). Ayant exploré quelques points de discussion de l’analyse de Kojève, Monod dégage, contre les conclusions de Kojève lui-même, son mérite principal : permettre la distinction de la figure du Chef des figures du Maîtres (despotisme) et du Père (paternalisme). A conditions de les remanier, les catégories de Kojève peuvent permettre de construire des critères du chef politique démocratique et des sources de sa légitimité à exercer l’autorité. Ne trouvant pas directement dans les analyses de Kojève de quoi étoffer cette construction, l’auteur revient dans un troisième temps de ce premier chapitre à Aristote. Analysant d’abord la conception aristotélicienne du pouvoir du mari sur l’épouse, puis du père sur les enfants, Jean-Claude Monod en arrive à la thématisation de « la relation du chef politique avec ses sujets qui est une relation entre égaux ». Il distingue le chef du tyran et rappelle que la typologie aristotélicienne des constitutions invite à considérer que le chef peut être collectif (aristocratie/oligarchie ; politeia/démocratie) et non nécessairement individuel (monarchie/tyrannie). Deux types de chefferie sont alors récusés par Aristote : la masse des pauvres visant son propre intérêt contre celui de la cité et le surgissement des démagogues à la faveur d’un gouvernement abandonnant le principe de la loi pour recourir à celui du décret. Dans cette perspective, Jean-Claude Monod avance une thèse originale : « les mouvements de progrès et de régression politiques des derniers siècles coïncident avec, respectivement, des détachements (pour les progrès) ou, à l’inverse, des recouvrements (pour les régressions) du “type” du chef politique-démocratique par rapport aux figures du Père, du Maître ou du Juge-Savant ». La mise au jour de ces recouvrements est l’une des tâches centrales de la pensée politique critique.
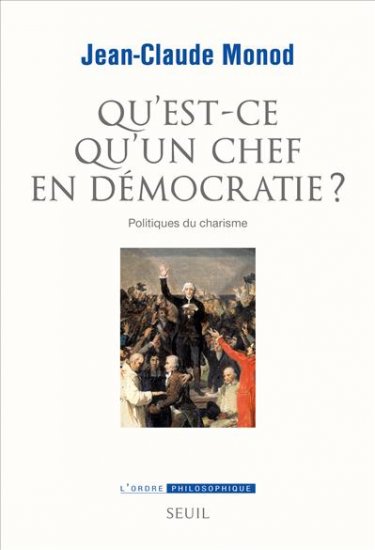
Le chapitre II s’intéresse au « réseau de concepts et de métaphores » dans lequel s’est déployée la réflexion sur le gouvernement démocratique en commençant par la rupture grecque, qui voit advenir, en opposition à la figure homérique du roi, le principe d’une circulation du commandement, dans laquelle le chef démocratique ne reçoit qu’une partie d’une souveraineté cyclique qui le voue à passer du commandement à l’obéissance (analyse de l’institution de l’archontat) et dont le charisme se trouve de facto relativisé. Cependant la rupture avec le charisme royal unique peut se développer dans deux directions : celle d’une diffusion du charisme ou bien celle d’un gouvernement découplé de toute considération de charisme. La première admet l’idée de chefs charismatiques démocratiques, tandis que le second insiste davantage sur le principe d’un gouvernement de la Loi et d’une circulation du pouvoir entre tous les citoyens. Cette seconde orientation peut elle aussi être divisée en deux directions : l’une privilégiant la loi de la distribution du pouvoir par le hasard, l’autre concevant la loi comme limite de l’exercice du pouvoir personnel du souverain. Dans ce cadre, certains penseurs contemporains de la démocratie représentative libérale, tel Agamben, dénoncent l’illusion radicale et idéologique d’un prétendu « règne de la loi », masque de l’exercice réelle de la violence par les dominants sur les dominés. En opposition à ce règne de la loi, on trouve la célébration athénienne du nomos démocratique, dont l’élaboration et l’application supposent l’égalité des citoyens. Autocélébration idéalisée dont on peut cependant se demander si elle ne cache pas la distinction et l’inégalité des conditions sociales et culturelles par lesquelles ce prétendu pouvoir démocratique se trouve masquer, en réalité, une forme pastorale de pouvoir. C’est alors, s’inspirant des recherches de Michel Foucault, à l’analyse des transformations historiques de la métaphore pastorale depuis l’Ancien Testament jusqu’à l’art de gouverner libéral que se consacre Jean-Claude Monod. Ce dernier se démarque cependant de Michel Foucault en rappelant que l’avènement de l’idée démocratique moderne s’est accompagné en même temps d’une mise en question radicale de la forme de pouvoir pastorale, le peuple refusant de se considérer et d’être gouverné comme un troupeau. L’auteur s’attarde alors sur la signification de la fascination foucaldienne pour la figure d’Ali Chariatti et la “révolte” (les guillemets sont de l’auteur) théologico-politique entreprise par l’ayatollah Khomeiny. Revenant à l’histoire politique occidentale, l’auteur montre comment la logique de la révolution démocratique, telle que l’analyse notamment Claude Lefort, a mené à une “désincorporation” parallèle à la sécularisation du pouvoir politique, corrélative d’un passage d’une forme de charisme attachée au sacre à une forme de charisme attachée au serment, qui rompt avec la structuration verticale et l’origine transcendante et religieuse du gouvernement politique. Le gouvernement démocratique, en ce sens, se doit moins d’incarner que de représenter le peuple. La problématique consiste alors à déterminer si la logique de la représentation implique que le représentant soit doté d’un charisme et/ou d’une compétence exceptionnel(s) ou bien si au contraire il convient que chacun soit ou puisse être désigné par un mécanisme aléatoire qui garantisse la participation effective du peuple au pouvoir. Il s’agit de rappeler à cet égard que pour toute une tradition antique et classique, aussi bien démocratique qu’antidémocratique, l’élection relève davantage d’un mécanisme aristocratique là où le tirage au sort rend effectivement possible l’exercice direct du pouvoir par les membres du peuple. Jean-Claude Monod analyse alors les rapports multiples, complexes et ambivalents entre représentation politique et régime démocratique. Bien qu’ayant ponctuellement mis en place des mécanismes et des expérimentations participatives, les démocraties du monde occidental restent fondées sur l’élection de chefs. Qu’est-ce qu’un chef ? La chefferie est-elle une structure anthropologique universelle ? En quel sens, le cas échéant, la comprendre ? Si quelque chose comme une figure du chef peut se dessiner à titre de catégorie universelle, c’est seulement à condition d’en comprendre la très forte hétérogénéité socio-culturelle. Ainsi le chef Kanak se présente davantage comme un visage destiné à présenter, rendre sensible, à la façon d’une tête dont le rôle serait d’incarner et de transmettre. Le chef y est celui « qui préside à l’échange des dons » et non celui qui ordonne et commande. Or cette fonction du chef peut trouver un sens dans les démocraties modernes, où l’élu propose une détermination de la juste répartition des richesses. De même, le « chef sans pouvoir » (hors temps de guerre) des indiens tupi-guarani analysé par Pierre Clastres trouve sa seule autorité, non dans l’usage de la force et d’un pouvoir de commandement, mais dans un prestige attaché à certains dons, autorité de persuasion et de conviction, et non de violence et de coercition. A cet égard, cette relation du chef aux membres du groupe permet dans le cadre d’une réflexion sur la démocratie de rappeler que le pouvoir vrai ne se trouve pas tant chez les chefs en tant qu’ils commandent que dans la société elle-même en tant qu’elle trouve dans le chef un porte-parole, un porte-voix et un agent privilégié susceptible d’inciter, d’encourager à l’action et de tracer des orientations pour la collectivité.
Le chapitre III, « Retours, rechutes ou relances ? La quête des grands hommes et l’émergence de l’homme moyen » interroge la valorisation occidentale de « la prétention à “faire l’histoire” » que nous attribuons, plus particulièrement, à certains grands hommes. Il s’agit de repenser l’action historique comme résultant, non seulement de l’activité de dirigeants, mais aussi d’un ensemble d’interactions plus ou moins anonymes, celles des “hommes moyens“ (les guillemets sont de l’auteur). C’est à l’école des Annales, héritière de Michelet et de Marx, que l’on doit cette attention portée à la vie des peuples, laborieuse, lente, anonyme mais décisive, par opposition à une histoire à la fois élitiste, masculine et guerrière. Or, il est légitime, sinon nécessaire, de faire l’hypothèse que cette nouvelle manière de faire l’histoire est elle-même liée au processus historique de démocratisation de la société. Au sujet du rapport entre démocratie et historiographie, Jean-Claude Monode propose ensuite une analyse, inspirée de Hannah Arendt, du lien originel entre polis démocratique et émergence du récit historique. Par opposition à la figure aristocratique du héros, Jean-Claude Monod explicite la manière dont une certaine tradition républicaine et démocratique a inventé la notion de « grand homme » en lien consubstantiel avec celle de mérite et de méritocratie. Au plan philosophique cependant l’idée de grand homme est davantage associée aujourd’hui à la conception hégélienne, dont il faut néanmoins saisir le sens exact : le grand homme est celui qui, mû par ses intérêts, passions et désirs personnels et subjectifs est toutefois le mieux capable de capter l’Idée de son temps, d’incarner le principe de son époque, de dégager ce qu’il y a d’universel et d’essentiel dans son siècle, et de le réaliser. Comment à cet égard comprendre l’articulation chez Hegel entre l’idée que le grand homme est celui qui œuvre à la progression de la conscience de la liberté de l’Esprit et le privilège qu’il accorde en même temps au personnage de Napoléon, dont ont pu se réclamer aussi bien les romantiques du XIXème siècle que les pires autocrates du XXème siècle ? C’est à l’étude des tensions caractéristiques du personnage que se livre l’auteur dans les pages suivantes, concluant sur ce paradoxe du grand homme moderne, parti de rien, d’origine sociale ordinaire, et devenu capable, en vertu même des mutations de la guerre démocratique, qui mobilise tous les citoyens, de sacrifier des milliers, voire des centaines de milliers d’anonymes, de petits, d’hommes moyens. Raison pour laquelle le modèle napoléonien a pu être l’objet d’une critique radicale par Robert Musil, pour qui les mutations de l’histoire ne sont jamais le fait de tels prétendus grands hommes et de leurs décisions (masquant par ailleurs leurs ambitions narcissiques derrière les apparences trompeuses des “nobles causes” et des ”motifs héroïques“) mais le résultat de l’effet conjugué de l’action des grands et de celle, plus profonde, plus directe, plus décisive des petits. A ce motif épistémologique et historiographique de rejet du privilège accordé aux grands hommes peut se conjuguer le motif éthique et politique des dévoiements « de l’admiration légitime pour une personnalité éminente » et de « la récupération idéologique et nationaliste qui est parfois la manifestation des trahisons de l’esprit des-dites personnalités » (Nietzsche semble, à cet égard, l’exemple le plus paroxystique). Dans le même esprit Bolzano propose une critique saisissante de la justification rationaliste et idéaliste des actes criminels des grands dirigeants au nom d’un prétendu ordre parfait de l’auto-déploiement de l’Esprit dans l’histoire, l’histoire du XXème siècle ayant sans doute définitivement achevée de déconsidérer les tentatives de rationalisation globale des crimes de l’histoire. Il s’agit cependant d’analyser et de reconnaître à sa juste valeur la persistance du besoin de grands hommes dans les États démocratiques modernes, êtres capables de porter des réformes comme d’incarner des principes de progrès et manifestant à titre de qualité primordiale une réelle « capacité à la non-résignation ». Jean-Claude Monod analyse ensuite les différentes formes de grandeurs politiques et leurs possibles incompatibilités. Parmi les problèmes que pose le rapport entre charisme et grandeur politique se trouve celui que Bolzano soulevait de savoir si le succès populaire doit être considéré comme la confirmation objective d’un charisme intrinsèque et coextensif de “qualités extraordinaires” selon l’expression de Weber. Ce problème se pose certes à l’aune des réussites populaires des leaders fascistes et nazis, mais aussi, a contrario, à celle du “succès politiques” de personnages précisément dépourvus de qualités extraordinaires, représentants d’une forme de médiocrité bureaucratique (Staline vu par Zinoviev et Bourdieu) ou traditionnel (Louis XIV vu par Norbert Elias), totalement contraire à l’“intuition charismatique” (expression de Bourdieu). Reprenant les catégories de Norbert Elias, on peut à cet égard se demander si la singularité du chef nazi ne réside pas dans « la fusion du schéma de l’autocrate charismatique et de l’autocrate bureaucratique ». On peut en douter : tant Hannah Arendt que Klaus Mann refusent à cet égard de voir en Hitler autre chose qu’un personnage relativement médiocre, dénué de ”qualités extraordinaires”, fussent-elles amorales ou immorales. Au contraire Kershaw juge-t-il judicieux l’usage de la notion de charisme pour définir la figure d’Hitler au sens où elle ne renvoie pas à une qualité inhérente à la personne du “Führer” mais doit être comprise comme une caractérisation de la perception de ses partisans. Cette question a été relancée plus récemment par l’ouvrage de Ludolf Herbst, Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deutschen Messias (Francfort-sur-le-main, Fischer, 2010). Monod analyse ensuite le rapport qui peut être établi entre l’avènement d’un chef charismatique et la recherche de boucs émissaires par une partie du peuple, concluant sur ce critère politique normatif : « un charisme pathologique est un charisme dont la contrepartie est l’invention constante de boucs émissaires ». Il n’est d’ailleurs par rare que l’homme charismatique capable un temps de catalyser le ressentiment populaire devienne lui-même le bouc émissaire du désir de pouvoir attisé et frustré dans le peuple. La compatibilité entre structure étatique-bureaucratique et apparition de personnalités charismatiques tient souvent au besoin éprouvé par les masses, dans une situation de crise grave, de trouver un homme capable de les en sortir. On peut, dans cette perspective, reconnaître et analyser la diversité des charismes de sortie de crise et identifier certaines figures positives (par exemple Roosevelt, Lincoln ou Luther King) du charisme et de la rencontre historique entre un peuple ou une partie de celui-ci et un leader visant le progrès social. La fin du troisième chapitre porte sur les conditions d’un charisme démocratique, excluant toute idée de dictature, aussi bien de droite que de gauche : l’êthos de la transformation sociale en vue d’une réduction des inégalités et d’un progrès de la justice ; le refus d’échapper aux contraintes du contrôle démocratiques et la volonté, au contraire, de faire participer ce charisme au renforcement des valeurs fondatrices de la démocratie ; l’abandon du charisme unique, concentrée au sommet, et le déploiement, à l’inverse, d’une circulation du charisme.
Le quatrième chapitre s’intitule « Trouble dans l’autorité et transformation de la démocratie ». Il pose le problème de savoir comment les effets du charisme politique et sa possibilité dans le cadre des transformations récentes de la souveraineté politique en relation avec les phénomènes de la mondialisation, de la médiatisation et des formes nouvelles, non institutionnelles et déterritorialisées, de participation à la discussion politique. Jean-Claude Monod commence par analyser la contestation par le nouvel ordre démocratique moderne du modèle d’autorité patriarcal et phallocentrique à partir d’une reprise de certains éléments de l’analyse par Derrida du passage de la domination politique paternaliste au modèle, plus démocratique, mais toujours phallocentrique, du modèle fraternaliste, et enfin de la déconstruction de celui-ci par la critique radicale de la domination masculine à la fin du XXème siècle. Dans un second temps, l’auteur s’intéresse longuement au moment freudien d’analyse des fondements psychologiques du besoin d’autorité posé et pensé d’abord et le plus souvent (même si Jean-Claude Monod refuse pour sa part d’y voir un invariant anthropologique, refus que justifierait la dynamique égalitaire occidentale) comme besoin d’autorité « paternelle ». Deux interprétations peuvent alors être dégagées : celle du déplacement direct de l’investissement libidinal vers le meneur comme vers un père ; celle de l’identification des individus à la foule des menés elle-même dans laquelle la personne trouve la possibilité d’une fusion et d’une communion. L’autre problème que pose la lecture de Freud est celle de savoir si les conséquences politiques de son analyse de la vie psychique du pouvoir seraient foncièrement autoritaires, comme on l’avance en général. Pour contester cette lecture d’un Freud favorable à l’idée d’un ordre symbolique masculin immuable, Jean-Claude Monod restitue certaines des interprétations dynamiques et évolutives de la pensée freudienne par Marcuse. Dans une troisième étape, l’auteur, entamant une discussion critique avec les recherches d’Ernest Laclau, s’intéresse aux deux formes de démocratie, « hégémoniques » et « radicales » et à leur tension féconde. L’auteur prend ici position contre une visée révolutionnaire radicale, affirmant que « les réponses au sentiment actuel de dépossession démocratique ne passent pas (…) par la destruction du cadre de la démocratie libérale-représentative, qui est le fruit d’au moins trois siècles d’expérience constitutionnelle et institutionnelle, mais par une dialectique qui mette ce cadre en tension avec ces modes de réinvention d’une démocratie plus directe, à partir de l’occupation et de la création d’espaces concrets, de zones d’expérimentations démocratiques où puissent s’opérer la réouverture de discussions radicales sur les fins de la cité et les modalités de reconquête d’une “proximité” dans la décision ». De tels espaces démocratiques contournent la figure et le besoin du meneur sans pour autant dissoudre l’activité politique. Plutôt qu’à une opposition entre démocratie de collectifs temporaires et auto-organisés et « démocratie représentative hégémonique » l’auteur veut penser une relation dynamique et dialectique nécessaire, légitime et positive. C’est dans le cadre de cette dialectique que peut s’insérer la figure d’un chef charismatique démocratique, citoyen égal aux autres citoyens mais capable de mettre en œuvre ces quatre fonctions « d’expression des principes, de représentation d’un collectif, de responsabilité assumée pour un certain champ de décision politique et de capacité d’“entraînement” que nous lui avons reconnue au fil des analyses antérieures ». Ensuite, Jean-Claude Monod s’intéresse aux diverses relations historiques qu’ont entretenues et qu’entretiennent encore les formes d’autorité dans les sphères de la famille et du travail, la transformation de leurs structures, sous la forme du déclin de la puissance paternelle et de l’avènement d’un nouveau type de domination “managériale” au travail, avec les possibles mutations du charisme politique. Les phénomènes de médiatisation et de privatisation des hommes publics ont rendu impossible l’émergence d’un charisme démocratique tel que l’appelle de ses vœux l’auteur. L’exhibo-cratie, comme étalement de la jouissance du pouvoir et de la richesse par les hommes publics, la télé-démocratie et l’hyper-quotidianisation du charisme qu’elle provoque constituent autant de phénomènes incompatibles avec l’émergence d’un charisme démocratique telque l’auteur le conçoit. Afin d’approfondir ce dernier point, l’ouvrage propose de constituer et d’étudier quatre paradigmes de charisme démocratique : le charisme de fondation, le charisme de résistance et de libération, le charisme de justice, enfin le charisme d’égalité. Le charisme de fondation ne s’oppose pas au principe de l’institution et de la légalité mais participe à la constitution d’une légalité et d’une institution capables de maintenir certaines “qualités” sociales, éthiques et politiques au-delà de la personne même du fondateur. Le charisme de résistance ou de libération « consiste dans la capacité à imposer une ligne de rupture par rapport à une oppression ou à une occupation et à mobiliser contre celle-ci des forces d’abord disparates ». Le charisme de justice « consiste dans l’invention d’une forme de règlements des conflits qui permet d’apurer un passé de haines sans le faire tomber dans l’oubli, mais en le “travaillant” [au sens freudien du terme] de façon à le surmonter ». Ce charisme peut converger et rejoindre un charisme de réconciliation et un charisme de refondation. Enfin le charisme d’égalité « relève de la manifestation éclatante de l’inanité de la postulation d’inégalité entre “races” ou entre “sexes”, [et] s’atteste dans la lutte contre l’exploitation et contre les inégalités de groupes, de genres et de classes ». Jean-Claude Monod analyse ensuite le cas de deux chefs charismatiques contemporains, Barack Obama et Luiz Inacio Lula da Silva. Il consacre la fin de ce chapitre à une analyse plus approfondie des ambivalences du personnage de Barack Obama en interrogeant la question de la déception, peut-être inhérente, que peuvent susciter les leaders charismatiques dans les conditions actuelles de l’exercice du pouvoir politique. Les dernières pages de l’ouvrage sont consacrées à la conclusion, dans laquelle l’auteur reprend et synthétises les enjeux, les problèmes et les thèses principales qui ont été dégagés et travaillés dans le livre.
L’ouvrage de Jean-Claude Monod est d’abord précieux en ce qu’il interroge le mouvement et l’institution démocratiques sous l’angle du charisme politique. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, le problème des formes non démocratiques de pouvoir politique charismatique trouve aussi place dans le développement. A ce propos, l’élaboration conceptuelle du charisme démocratique est d’autant plus convaincante qu’elle se fait par une analyse différentielle des autres formes conceptuelles et historiques, non démocratiques ou antidémocratiques, de pouvoir personnel. Sur la question plus centrale des conditions de possibilité de l’émergence d’une articulation positive entre chef charismatique et pouvoir du peuple, le livre présente plusieurs intérêts, dont le premier est de s’efforcer de dégager et d’expliciter les problèmes (et les enjeux) théoriques et pratiques que posent une telle articulation. Le propos présente aussi l’intérêt de restituer, dans le cadre de sa propre dynamique, d’une façon libre et parfois critique, toute une série d’analyses philosophiques d’auteurs classiques ou contemporains ayant réfléchi sur ce problème. Prenant le risque de définir des critères normatifs de déploiement d’un charisme proprement et authentiquement démocratique et de définition d’un chef porteur d’un projet progressiste et émancipateur, l’ouvrage présente l’intérêt de défendre de façon argumentée des positions politiques claires, avec lesquelles le lecteur peut se trouver en désaccord, mais qui permettent de réfléchir d’une façon concrète et directe aux formes légitimes ou illégitimes de relations entre pouvoir politique, institutions démocratiques et émergence de dirigeants charismatiques. On notera aussi le souci de l’auteur d’illustrer systématiquement un propos théorique solide et charpenté par des exemples historiques concrets et analysés avec précision et rigueur.