Barbara Cassin, La Nostalgie, Quand donc est-on chez soi ?, lu par Stéphane Jach et Jérôme Jardry
Par Jérôme Jardry le 15 avril 2015, 06:00 - Métaphysique - Lien permanent
 Barbara CASSIN, La Nostalgie, Quand donc est-on chez soi ? Éditions Autrement, Paris, 2013.
Barbara CASSIN, La Nostalgie, Quand donc est-on chez soi ? Éditions Autrement, Paris, 2013.
Où se sent-on chez soi et pour quelles raisons ? Barbara Cassin répond à cette question suscitée par son histoire personnelle, et l’ « hospité » corse, en s’appuyant sur la lecture de L’Odyssée, de L’Enéide et de textes de Hannah Arendt. Barbara Cassin s’appuie sur ces textes pour évoquer l’envie de revenir, malgré les obstacles, à l’endroit où l’on s’enracine.
 Même pour un temps bref, pourtant essentiel à la survie. C’est
le sens de la nostalgie, qui dit la douleur du retour, c’est-à-dire la douleur quand on est loin et les peines
qu’on a pour rentrer. L’Odyssée est
d’ailleurs « le poème même de la nostalgie ». Ainsi B Cassin mentionne-t-elle
Ulysse qui met si longtemps à retrouver Pénélope et être reconnu par elle, et
qui peine d’ailleurs à reconnaître son île d’Ithaque, et passe une nuit dans
son lit –creusé dans une souche d’olivier profondément enraciné, nuit longue
prolongée par les dieux, avant que de partir pour une nouvelle quête au terme
de laquelle doit intervenir le pardon de Neptune. L’olivier de la chambre
nuptiale dit l’ « enracinement » qui est propre à celui qui est
chez lui, mais en même temps le risque de devenir « déraciné ».
« Nostalgie » n’est pourtant pas un mot grec : il est forgé par
le médecin suisse Jean-Jacques Harder, pour dire le mal du pays et lui aurait
pu être substituées « philopatridomania »
(la folie de l’amour de la patrie) ou « pothopatridalgia » (la douleur du désir-passion de la patrie,
cf. p. 19), qui auraient été moins de nature à s’inscrire dans un vocabulaire
courant et à nommer une expérience courante et même universellement reconnue.
« Ce livre interroge, avec la nostalgie, le rapport entre “patrie”, exil
et langue maternelle » : la langue allemande est ainsi le seul
ancrage que conserve Arendt lors de son exil américain.
Même pour un temps bref, pourtant essentiel à la survie. C’est
le sens de la nostalgie, qui dit la douleur du retour, c’est-à-dire la douleur quand on est loin et les peines
qu’on a pour rentrer. L’Odyssée est
d’ailleurs « le poème même de la nostalgie ». Ainsi B Cassin mentionne-t-elle
Ulysse qui met si longtemps à retrouver Pénélope et être reconnu par elle, et
qui peine d’ailleurs à reconnaître son île d’Ithaque, et passe une nuit dans
son lit –creusé dans une souche d’olivier profondément enraciné, nuit longue
prolongée par les dieux, avant que de partir pour une nouvelle quête au terme
de laquelle doit intervenir le pardon de Neptune. L’olivier de la chambre
nuptiale dit l’ « enracinement » qui est propre à celui qui est
chez lui, mais en même temps le risque de devenir « déraciné ».
« Nostalgie » n’est pourtant pas un mot grec : il est forgé par
le médecin suisse Jean-Jacques Harder, pour dire le mal du pays et lui aurait
pu être substituées « philopatridomania »
(la folie de l’amour de la patrie) ou « pothopatridalgia » (la douleur du désir-passion de la patrie,
cf. p. 19), qui auraient été moins de nature à s’inscrire dans un vocabulaire
courant et à nommer une expérience courante et même universellement reconnue.
« Ce livre interroge, avec la nostalgie, le rapport entre “patrie”, exil
et langue maternelle » : la langue allemande est ainsi le seul
ancrage que conserve Arendt lors de son exil américain.
La question de la nostalgie articule plusieurs concepts opposés : l’hôte (hostis) condense celui qui accueille et celui qui s’invite. Étranger et ennemi, aussi, l’hôte est en même temps celui qui est chez lui chez un autre, dans un autre lieu. C’est aussi le paradoxe de l’inquiétante étrangeté : on ne ressent pas cette angoisse dans un lieu radicalement inconnu mais au contraire dans un lieu qui devrait être familier et qui ne l’est plus, ou plus totalement. Apatride et encore planté dans le sol, quel statut le déraciné a-t-il ? C’est encore une fois Ulysse : parti d’Ithaque, son chez lui est la Méditerranée, la mer de l’errance, et il est « partout chez lui ». Dans L’Odyssée, Ulysse est le déraciné par excellence.
En écho à cette réflexion, naît celle qui est consacrée à Énée, lequel s’enracine dans le Latium en adoptant la langue des latins et ne cherchant pas à refonder une nouvelle Carthage forcément abâtardie. La question de langue, si déterminante, est questionnée encore : il faut bien rappeler que la langue définit un peuple, ses contours et parfois sa représentation de lui-même. La langue est cette fois-ci fondatrice.
La perspective de Hannah Arendt vient apporter un nouvel
éclairage : la langue maternelle, apprise dans son enfance, est celle qui
porte et détermine le plus (pensons à Julien Green et l’américain de sa mère, à
Elias Canetti, La Langue retrouvée ou
encore à La Nostalgie heureuse d’A.
Nothomb qui évoque cette même question de la langue maternelle) :
« C’est la langue maternelle, et non pas celle de la terre de ses pères,
qui constitue sa patrie » (p. 86). En ce sens, « toute Odyssée –tout
exil et toute errance– s’entend comme « mise en récit de l’assignation
d’identité » (p. 87) ou comme le dirait Lacan « fixion », le
récit qui « fixe ». Le « chez soi » se définit par et dans
une langue. Le grec et le latin se constituent ainsi comme langues de culture,
mais également comme signes identitaires (p. 79). Et le latin, comme le grec,
s’impose comme « une autre langue de civilisation » et comme
« la langue d’une autre civilisation ».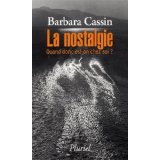
La langue maternelle est l’imbrication même de la culture et de la nature, et c’est l’appartenance à un peuple. L’abandonner pour une nouvelle langue, celle de l’exil, a ses limites. Mais la confronter aux nouvelles langues est le moyen le plus sûr de cerner mieux les contours du monde, sans se limiter intellectuellement ni se mettre en danger. Ainsi les questions d’appartenance, de nostalgie et de mal du pays mettent-elles en abyme la philosophie elle-même, comme Ulysse, partout chez elle, parce qu’en même temps nulle part. La pluralité des langues permet l’interrogation sur l’essence des choses. La pluralité met en évidence « l’équivocité chancelante du monde » (p. 121), et cette équivocité chancelante, qui est celle-là même des exilés, devient finalement une norme de la condition humaine.
Stéphane Jach et Jérôme Jardry