Victor Hugo, De l’utilité du beau et autres textes, Manucius 2018, lu par François Collet
Par Baptiste Klockenbring le 16 avril 2019, 06:00 - Esthétique - Lien permanent
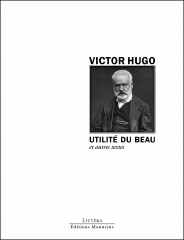
Victor Hugo, De l’utilité du beau et autres textes, éditions Manucius, 2018. Lu par François Collet.
« Dans (ses) premiers poèmes, Victor Hugo pense encore, au lieu de se contenter, comme la nature, de donner à penser. »
Proust, Le côté de Guermantes.
Cet ouvrage rassemble trois textes de Victor Hugo, tous trois tirés des Post-scriptum de ma vie. Dans ce livre posthume, ainsi que dans son William Shakespeare de 1864, on trouve en quelques sorte un condensé de ce que l’on pourrait appeler l’esthétique de Hugo. On y voit l’articulation de notions décrivant une poétique, et des considérations métaphysiques sur l’âme et la destinée humaine.
Après une note liminaire de l’éditeur, le plan de l’ouvrage consiste en trois parties :
1) Utilité du beau (pp.11-35).
2) Du génie (pp.37-47).
3) Le goût (pp.49-92).
1) Utilité du Beau :
Cet article développe un paradoxe stimulant sur l’accord entre beauté et utilité.
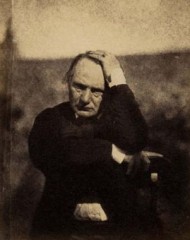 On connaît la fameuse déclaration de Théophile Gautier, défenseur de " l’art pour l’art ", dans la préface de Mademoiselle de Maupin :
On connaît la fameuse déclaration de Théophile Gautier, défenseur de " l’art pour l’art ", dans la préface de Mademoiselle de Maupin :
"Tout ce qui est utile est laid… L’endroit le plus utile des maisons, ce sont les latrines.". En vérité, il n’y pas vraiment de débat sur la beauté de l’utile au sens de ce qui sert sur le plan pratique. En revanche, Hugo soutient dans cet article que le beau est utile, au sens de ce qui est avantageux, de ce qui apporte un bienfait.
L’expérience esthétique, justement parce qu’elle est contact et dialogue avec une œuvre qui ne sert à rien, est le moyen – gratuit, désintéressé- d’une fin qui est utile. L’auteur poursuit en soulignant que rien de ce qui est beau (= grand) n’est inutile.
L’admiration est une émotion, mais c’est justement là sa « puissance civilisatrice » (p.15). La voie qui mène de la perception à la contemplation puis à l’admiration ouvre à une émotion qui comprend par elle-même une vertu éthique et politique. C’est la raison d’être, rappelle le poète, des arts libéraux et des humanités, le commerce des grandes œuvres produisant consciemment ou inconsciemment la civilisation des mœurs.
Hugo va illustrer sa thèse en prenant citant deux exemples : les grands poètes latins du 1er siècle avant J.C., Horace et Virgile.
Horace, immense poète et homme de cour, sectateur zélé d’Auguste, le premier empereur romain, sacré (Premier Citoyen en droit, mais seul empereur en fait) après le suicide de Marc Antoine, dernier épisode de la guerre de succession de Jules César. Hugo nous présente un Horace qui écrit si librement, « est esclave devant César », passant sous silence tout événement contemporain et toute considération morale ou politique. On songe évidemment à Hugo, admirateur critique de Napoléon le grand, et poète exilé après le coup d’Etat de 1851 par Napoléon le petit.
Aucun courage politique donc chez ce poète larvaire et obséquieux. Mais là n’est pas le problème : la lecture d’Horace vous élèvera, parce que son œuvre est belle. Or le beau manifeste le vrai, écrit Hugo, car, et c’est encore un paradoxe fécond, le beau, c’est la forme, et la forme c’est le fond. « Confondre forme et surface est absurde » (p.18). Peu importe la médiocrité psychologique ou éthique de l’auteur, ses faiblesses biographiques : si c’est un grand auteur, son style se place entre son lecteur et lui, et élève ce dernier : « on devient délicat à toucher ce divin style ; et le plus barbare en sort civilisé. Louis XVIII, philosophe relatif, disait : c’est Horace qui m’a rendu libéral. » (p. 21). Simplicité, légèreté, grâce, tel est le vers d’Horace, et « c’est de la sagesse d’oiseau » (p. 20).
Virgile : Hugo présente une longue citation des Géorgiques pour souligner le décalage entre l’idée, le fond (le sujet est médiocre, qui développe une écœurante flatterie où Octave-Auguste est comparé à l’astre des astres) et la forme, immense et noble. La poésie comme telle transcende et le tyran et le flatteur. Le sujet (la louange courtisane) est dépassé par la forme – elle n’est que la surface du poème. D’où cette conclusion paradoxale : le fond du poème, c’est sa forme. C’est ce qui se produit lorsqu’on est en présence de la beauté. L’œuvre est belle quand la beauté est portée par la forme, quel que soit le fond – fut-il repoussant physiquement (comme dans la célèbre Charogne de Baudelaire) ou moralement (quand un grand poète s’abaisse à flatter un tyran).
La beauté, c’est la fusion de l’idée et du style, et Hugo va au bout de cette affirmation en écrivant qu’ « une idée n’a qu’une expression. » (p. 27). Idée et mot sont inséparables, et ceux qui croient faire une analyse littéraire en les distinguant ne sont que « les vivisecteurs de la critique ».
La raison en tient à une certaine psychologie de la connaissance. S’agissant de la beauté, qui est une modalité de l’absolu, on commence toujours par sentir ce que l’on pense ; on ne comprend réellement que ce que l’on a d’abord saisi par le sentiment. C’est le cœur de l’analyse esthétique, hérité du XVIIIème siècle, qui donne à voir l’harmonie de ce qui est perçu et de ce qui est pensé.
L’auteur termine sur une distinction propre à éclairer l’équivalence entre beau, infini, et idéal, en distinguant deux types d’idéal : l’idéal antique, où le sentiment du beau est lié au sentiment du fini, et l’idéal moderne/chrétien, où le sentiment du beau est inhérent à une expérience de l’infini.
Le charme de l’ordre maîtrisé, c’est l’antique, la beauté de ce qui est lumineux et circonscrit : la méditerranée ; l’expérience de l’horizon ouvert et vaste, splendide aventure, grande ébauche de l’immensité : l’Océan. (p. 34).
2) Le génie :
Hugo part de l’admiration comme expérience fondatrice, celle qui fait sentir le génie sans avoir besoin d’une définition préalable. Le génie se rencontre et s’éprouve, et produit un effet en retour, car (…) il est impossible d’admirer un chef-d’œuvre sans éprouver en même temps une certaine estime de soi. » (p. 39). Il faut et il suffit pour cela d’avoir assez de grandeur pour admirer le génie.
Comment le reconnaître, à sa forme d’éclair, comme quelque chose d’éblouissant et surhumain. Hugo oppose la percée du génie, le trou par lequel « l’infini apparaît » (p. 40) Ainsi ce trou est opposé à toute lacune – à ce qui manque à une œuvre pour être un moyen d’accès au sentiment océanique de l’infini – un mélange de démesure et de proportion.
Le génie est aussi celui qui revient vers les hommes. Rejeté par la « grosse foule « et le petit public » (p. 41) – à ne pas confondre avec le peuple – il offre la lumière via le verbe, sans le savoir, sans projet ni conscience. Mais il revient vers le commun des hommes, ses semblables, car les génies sont humains, « la matière pèse sur eux, et eux aussi ils gravitent. » (p. 45). Hugo a donc une conception messianique du génie en quelque sorte. Et le messie de l’art voit parfois son élection s’exprimer dans une infirmité (cécité d’Homère, surdité de Beethoven…) – signe matériel et charnel de leur absolue singularité et de leur grandeur. Comme une justice immanente, ou une concession faite à la jalousie des médiocres – ceux qui n’auront pas compris que l’admiration d’un grand auteur élève – car « comprendre, c’est approcher » (p. 39).
3) Du goût :
Ce long article allie plus que jamais l’art du paradoxe, la virtuosité lexicale, et cette didactique qui ne cesse jamais d’être une poétique. Le goût est appréhendé du point de vue du créateur, du point de vue du spectateur/du lecteur, il est analysé comme un sommet de ce qu’il y a de plus humain en l’homme, et aussi dans sa dimension politique.
L’auteur part de l’affirmation d’une impossibilité : on ne saurait définir le goût – au sens où il serait circonscrit par un concept normatif. Inactuelle, imprévisible, transgressive, autoréalisatrice, l’œuvre de goût, géniale et belle, peut cependant être identifiée à un monde. En effet, Hugo le désigne grâce à l’opposition de l’ordre et du chaos : « Pas un atome de l’art n’est à l’état de chaos. Tout obéit à une loi. Le goût, c’est l’ordre. » (p. 51). Car si l’art est prodige, il n’est pas monstre (p. 51).
Hugo poursuit en anticipant sur une objection possible : comment définir par l’ordre une notion inséparable d’une création absolument originale et libre, qui s’autorise justement tous les désordres ? La raison est morale plus qu’esthétique. C’est qu’il n’y a point de mal dans le beau » (p. 52), car l’art est un « dissolvant transfigurateur » (ibid.), et « le fumier l’aide à créer sa rose » (ibid.). Hugo donne l’exemple du nu dans la peinture. La nudité dans l’art n’est jamais exhibition – le tableau fait « taire la chair et chanter l’âme. » (Ibid.).
On est renvoyé à l’expérience par laquelle le génie et le beau sollicitent un public en le créant : la contemplation. Le traitement hugolien de cette notion implique l’élévation comprise dans le commerce des grandes œuvres. Il y a toujours un assainissement dans l’art, car qui contemple admire et qui « admire monte » (p. 52). On retrouve le thème de la force civilisatrice de l’art (cf. article Utilité du beau).
Une analogie politique est ensuite développée. Le génie a besoin du goût, comme le peuple a besoin du droit. Mais si le peuple, par hypothèse (pp. 54-55 : tableau utopique d’une société qui serait le règne des fins, pour parler comme Kant), s’était élevé au plus haut degré de conscience et de civilisation, il n’aurait même plus besoin du droit. La seule injonction résiduelle serait l’instruction, via un enseignement gratuit et obligatoire (= « le droit de l’enfance à la lumière » p. 54).
Le goût serait l’ordre minimum sans lequel il n’y aurait pas réellement d’expérience esthétique du génie. Il faudrait sinon que le contemplateur soit lui-même un génie. Le goût ? « Un perpétuel conseil que se donne le génie (p. 56), c’est-à-dire à la fois une impulsion et un frein, une aspiration et un scrupule, une faculté de se diriger l’inspiration. Cette dernière est le signe d’une volupté spirituelle, car pour l’esprit, être inspiré c’est « être en travail », et être en travail c’est être en extase. Dans ce phénomène, Hugo compare goût et conscience, car le goût est indissolublement particulier et général. Il y a chez Hugo comme chez Hume l’idée que le jugement personnel peut être un critère sûr, à condition d’être libéré des préjugés (cf. « le goût est à la poésie ce que la conscience est à la vérité. » p. 56).
Mais il faut distinguer le grand goût du goût banal : le vrai goût, le goût créateur se caractérise par la génialité, c’est-à-dire par la singularité, s’opposant par-là aux « grosses niaiseries du goût banal » (p. 64). Le vrai goût échappe totalement au commun tout en exhibant l’universel (Hugo dirait plutôt l’infini) grâce à une forme nouvelle, indifférente aux normes contraignantes. Le vrai goût choque, irrite, se permet toutes les libertés, même la vulgarité, l’insolence, la familiarité (les grossièretés si elles sont d’Homère, les sauvageries si elles sont de Shakespeare, etc…) mais « une fiente d’aigle révèle un sommet » (p. 68).
Ce « grand goût » consiste en une « acception » (sic) de toute réalité augmentée de ce droit d’ajouter en quoi consiste la souveraineté intellectuelle. C’est l’harmonie miraculeuse de la proportion et de la démesure. Elle s’incarne dans le génie primitif – et non pas seulement original – car il n’imite jamais (p. 78). Ses devanciers ne sont pas ses guides. Le refus des règles permet à l’original d’échapper aux lieux communs et à toute scolastique, mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante pour définir le grand goût. Le génie primitif exerce sa souveraineté sans souci des règles, et donc ne copie rien, est imprévisible. Le génie conquiert, et le goût opère des choix : cette harmonie interdit l’opposition classique du goût de génie.
Hugo termine l’article sur l’articulation entre art et politique – et plus précisément sur le pouvoir de la littérature. Les fuite de lumière de la littérature sont partout, la littérature « commence par former le public, après quoi, elle fait le peuple. Ecrire, c’est gouverner ; lire c’est adhérer » (p. 90).
Mais le goût français hérité du XVIIème siècle (Louis XIV et Boileau) doit se transformer en goût européen pour survivre et de revivifier. Hugo prône la continuation de l’esprit français, et non stricto sensu du goût français. Car le goût moderne est européen au sens où il faut hériter de <Rabelais comme de Dante et de Shakespeare. C’est ainsi qu’il prévoit/prédit le XXème siècle. De fait, il a eu raison. Et même le cauchemar totalitaire du XXème siècle le confirme, qui aura été une négation de l’humanité par la négation des humanités.
Commentaire :
Le Beau, le génie, le goût : le dénominateur commun de ces notions est la vertu civilisatrice et émancipatrice de l’expérience esthétique. Elle est indispensable à l’homme jusques et y compris dans son destin politico-historique.
Dans cet ensemble d’article, le philosophe peut trouver des formulations fulgurantes pour une esthétique qui, formulée de façon poétique, et dans le refus même d’une science du beau, développe une véritable cohérence conceptuelle, fondée sur des paradoxes apparents repérés, analysées et dépassés (ex : fond = forme) – comme dans une leçon de philosophie.
On peut le lire et en avoir un usage philosophique (vérifiant par-là la thèse de « l’utilité du beau »), comme la prose poétique de Mallarmé. Un texte irréductible à la construction dialectique, mais essentiel à la compréhension des enjeux liés à l’art et à la littérature.
Hugo parle d’esthétique comme le lieu d’une expérience où se révèle une connaissance sensible, sans vouloir construire une théorie. Toutefois, on peut faire un rapprochement avec l’Æsthética de Baumgarten, tout entière axée sur cette connaissance sensible, ou sur la dimension sensible de la connaissance – et c’est aussi la base de l’idée kantienne d’une sensibilité a priori (au fondement de l’Esthétique transcendantale de la Critique de la raison Pure).
Mais le propos de Hugo serait à rapprocher davantage de la Critique de la Faculté de juger, qui est moins une théorie des objets à partir de leur représentation qu’une théorie du sujet qui met au jour l’irréductibilité du jugement esthétique et à la sensation et au jugement de connaissance. Hugo écrit que le beau est ouverture à l’infini, qui passe d’abord par un sentiment, que la pensée doit saisir ensuite – ce qui s’appelle dès lors comprendre. L’artiste et le spectateur partagent, chacun à se place, un sort commun- s’élever à la rose par la transfiguration du fumier pour reprendre une image hugolienne. On retrouve là la voie du savoir, qui est indissociablement saveur et sagesse, infusion de l’une dans l’autre, sensibilité au sens noble.
François Collet.