Frédéric Lordon, La société des affects, éd. du Seuil, lu par Marie-Christine Ibgui
Par Baptiste Klockenbring le 09 avril 2014, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
 Frédéric Lordon, La
société des affects. Pour un structuralisme des passions, éditions du Seuil, septembre 2013.
Frédéric Lordon, La
société des affects. Pour un structuralisme des passions, éditions du Seuil, septembre 2013.
En guise d'introduction, F. Lordon part du constat que les désirs et les affects ont originairement constitué l'impensé des sciences sociales, définies comme sciences des faits sociaux et non psychologiques. Mais il note que le retour de l'individualisme et le recul du structuralisme s'accompagnent d'une redécouverte des émotions. Il se propose quant à lui de tenir ensemble ces éléments de la vie sociale que sont la détermination des structures et les émotions, mais en les débarrassant de tout subjectivisme. C'est pourquoi F. Lordon, revenant à Spinoza, propose dans cet ouvrage les principes d'une science sociale philosophique, d'après l'idée directrice d'un structuralisme des passions, déterminées par les institutions de façon à les reproduire, mais capables aussi de les renverser.
En guise d'introduction, F. Lordon part du constat que les désirs et les affects ont originairement constitué l'impensé des sciences sociales, définies comme sciences des faits sociaux et non psychologiques. Mais il note que le retour de l'individualisme et le recul du structuralisme s'accompagnent d'une redécouverte des émotions. Il se propose quant à lui de tenir ensemble ces éléments de la vie sociale que sont la détermination des structures et les émotions, mais en les débarrassant de tout subjectivisme. C'est pourquoi F. Lordon, revenant à Spinoza, propose dans cet ouvrage les principes d'une science sociale philosophique, d'après l'idée directrice d'un structuralisme des passions, déterminées par les institutions de façon à les reproduire, mais capables aussi de les renverser.
Dans la première des
quatre parties de ce recueil, intitulée « recroisements »,
F. Lordon soulève la question de savoir quelle doit être la langue
des sciences sociales. Pour être scientifiques, celles-ci doivent
moins renoncer à l'usage d'une langue commune et se soumettre, comme
l'économie, à la formalisation mathématique, qu'elles ne doivent
d'après lui, renouer avec la philosophie, en cherchant dans le
concept leur véritable moyen d'appartenir au «genre science ».
Cela suppose, reconnaît l'auteur, que soit dépassée l'histoire
conflictuelle des relations entre philosophie et sciences humaines. A
leur mésentente incarnée par P. Bourdieu, F. Lordon oppose le
modèle de Durkheim, dont le travail interdisciplinaire préfigure
les nombreux rapprochements contemporains entre les deux disciplines,
notamment à l'initiative de la philosophie d'inspiration marxiste,
lorsqu'elle emprunte le chemin de la critique sociale.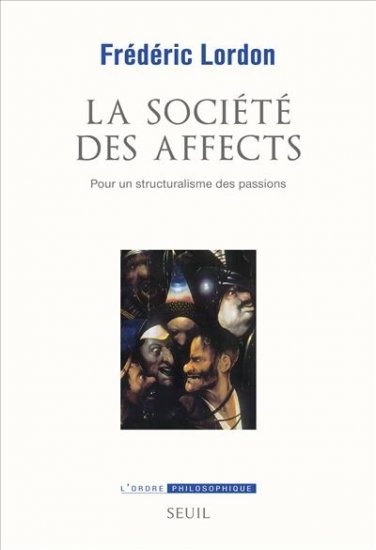
F. Lordon poursuit sa réflexion sur les rapports entre sciences sociales et philosophie et s'intéresse à la question de savoir si les premières peuvent trouver leur unité théorique, mieux encore que les sciences physiques, en s'érigeant comme un système axiomatisé, sur la base du modèle Arrow-Debreu d'équilibre général. En réalité, il note que les sciences sociales ne sont pas, par nature, vouées à être axiomatisées, mais qu'elles peuvent chercher leur unification par des concepts. C'est ainsi qu'elles peuvent s'adosser à la philosophie, comme activité productrice de concepts et, par le spinozisme, la science sociale peut trouver un nouveau moyen de systématiser sa théorie de l'action. En effet, la théorie néoclassique qui postule a priori l' « efficience des marchés » et la rationalité de l'acteur économique voit, en raison de l'effondrement de ces derniers, son hégémonie renversée par la neuroéconomie qui souligne, au contraire, l'importance des émotions dans les décisions des acteurs économiques. C'est pourquoi, l' économie politique peut selon F. Lordon emprunter à Spinoza son concept de « conatus », comme postulat d'une nouvelle théorie sociale de l'action, extrait de l'ontologie spinoziste dont il est dérivé, tout en restant fondé par elle.
Dans la deuxième partie, intitulée « structures », F. Lordon emprunte tout d'abord à P. Bourdieu l'idée d'« une double vérité du travail » qui ne se réduit pas à la vérité objective de l'exploitation, mais comporte aussi une vérité subjective. Mais ce dernier n'étant pas allé assez loin dans l'exploration de la vérité subjective, F. Lordon pense trouver dans les concepts spinoziens de désir et d'affects de nouveaux postulats, qui tiennent mieux compte de cette vérité, pour fonder les sciences sociales. Il s'agirait donc de penser le désir comme l'essence de l'homme et, ce dernier, comme affecté ou mû par des causes extérieures. C'est ainsi que le corps salarié est un corps désirant, mû dans l'économie capitaliste naissante, par l'aiguillon de la faim et la crainte de la misère, c'est à-dire par des affects tristes. En revanche, sous le régime d'accumulation fordiste, le salarié est mu par un désir acquisitif d'objets marchands, c'est-à-dire par des affects joyeux qui ont contribué à justifier et à stabiliser le capitalisme. F. Lordon explique ensuite que parallèlement à cette détermination de l'action par le désir d’acquisition, correspond la formation d'un imaginaire consumériste de la marchandise, qui contribue à valoriser la consommation et à l'ériger en norme de vie. Ainsi se trouverait dépassée l'opposition entre l' explication par les causes (les affects) et la compréhension du sens, ici donné par l'imagination dont les habitudes herméneutiques sont liées à des passions communes, c'est-à-dire d'origine sociale. Or l'auteur note que l'imaginaire du capitalisme s'est renouvelé en passant du fordisme au néolibéralisme. Il a fait entrer les salariés dans un nouveau régime de mobilisation, non plus par les affects joyeux de la consommation, mais par ceux de la réalisation de soi, pour aligner les désirs de l'individu sur ceux du capital ou de l'institution. Celle-ci réprime donc moins le désir qu'elle ne l'informe et ne le détermine, par des affects communs, mais qui peuvent très bien se réfracter de façon différente selon la complexion de chacun. Ainsi le structuralisme des passions permet d'articuler sociologie et psychologie, individu et société, global et local. Le structuralisme des passions explique également que l'institution ne doive sa stabilité qu' à un rapport de forces entre un affect commun favorisant l'obéissance et un affect contraire conduisant à l'indignation et à la sédition. Par conséquent, il montre bien qu'il n'y a pas d'institution qui soit à l'abri des crises. En renouant ainsi avec l'histoire et en se définissant comme « structuralisme dynamique », il permet d'expliquer les mouvements de contestations et de révoltes, non comme l'irruption d'une liberté imprévisible, mais comme un infléchissement dans une direction nouvelle du jeu de forces entre affects d'obéissance et affects séditieux. C'est pourquoi, contrairement à Hobbes, Spinoza ne pense pas que les individus puissent déléguer leur droit naturel au souverain, en entrant dans la société civile, puisque le droit naturel de chacun, comme puissance inaliénable, continue à s'exercer dans l'ordre institutionnel et peut même se retourner contre lui.
Or F. Lordon constate que l'économie ne pense pas la catastrophe, mais seulement la crise. Pour les néoclassiques, le système des marchés laissé à lui même ne connaît pas la crise ; celle-ci ne peut donc venir que de chocs exogènes ou « chocs d'offre » et elle reste liée à la conjoncture chez les keynésiens, que les mesures de relance ne parviennent pourtant pas à juguler. F. Lordon note que la théorie de la Régulation a le mérite de montrer que les structures du capitalisme varient et que les crises correspondent à la transition d'une de ses époques à une autre, lorsque le régime d'accumulation du capital est devenu contradictoire. La crise, « c'est quand ça change » et non « quand tout va mal ». Mais si le régime néolibéral d'accumulation du capital est entré en crise, seule l'étude des affects collectifs, dans le cadre d'une science sociale spinoziste, peut nous permettre de comprendre quand il y a pleinement crise. Or celle-ci n'est pleinement constituée que lorsqu'elle induit des mouvements politiques capables de transformer le régime d'accumulation institué, donc lorsque l'idée-affect qu'il y a crise est suivi d'un passage à l'acte. Mais il est difficile, reconnaît F. Lordon, de savoir si par exemple les conséquences durables de la crise des subprimes de 2007 donneront lieu à un mouvement politique d'ampleur, comparable à une « catastrophe », c'est-à-dire de fixer en général, pour le corps social, le seuil de l'intolérable, en réalité très variable.
Dans la troisième partie, consacrée aux « institutions », F. Lordon constate que le terme d’institutions a remplacé celui de structures, ces dernières s’étant rendu coupables de l’éviction du sujet, de l’individu, dont les actions justement donnent sens à l’histoire et aux institutions. Parallèlement à cette substitution de termes, F. Lordon signale que la domination par la violence symbolique ne fonde plus la légitimité, mais que celle-ci repose sur l’accord suscité par l’institution à laquelle les sujets adhèrent de façon consciente et réfléchie. Or il se propose dans cette partie de penser le maintien ou la crise des institutions autrement que sur la base de cette légitimité que les sujets sont censés leur accorder. C’est pourquoi, il trouve une fois encore chez Spinoza une définition de l’institution qui ne soit pas fondée sur le modèle contractualiste de l’accord des sujets. En effet, selon Spinoza, l’individu n’y est pas un sujet-acteur, mais un « conatus », c’est-à-dire un effort ou encore un élan de puissance, orienté par des affects, qui le conduisent à poursuivre les sources de joie et à repousser les causes de tristesse. C’est donc le désir qui institue les valeurs poursuivies ou non par l’individu ; celles-ci ne sont pas librement choisies par lui, mais résultent de l’effet (plus ou moins utile et agréable) produit par des causes extérieures sur sa propre constitution affective. Cette analyse permet d’expliquer ce qui peut motiver le renoncement à l’exercice de son conatus exigé par l’institution. En effet, ce renoncement, en raison des affects tristes qui l’accompagnent, ne peut s’expliquer que s’il est compensé par des affects joyeux produits par la sécurité qu’apporte l’entrée dans l’état civil. En aucun cas, l’individu n’en est l’auteur, il est seulement déterminé à se plier ou à se soustraire à l’institution par des affects comme la crainte et l’espoir. La soumission au souverain est donc le résultat d’un rapport de forces entre les complexions affectives des individus et la puissance institutionnelle de l’État, toujours susceptible de recourir à la force pour sanctionner la désobéissance. F. Lordon en déduit que si l’institution se maintient en vertu du jeu des puissances et des affects, la question de sa légitimité morale ne se pose pas, car une institution n’est légitime que si elle n’est pas renversée. Mais, ajoute F. Lordon, cela ne signifie pas que tous les régimes institutionnels s’équivalent selon Spinoza. Ce dernier permet, au contraire, de les juger à partir des affects qu’ils produisent. Or si ces derniers sont tristes, c’est qu’ils diminuent la puissance d’agir des individus et que ceux-ci sont soumis par la crainte de la mort. En revanche s’ils sont joyeux, c’est que l’État permet à la multitude d’espérer de vivre libre et dans la concorde. Ainsi l’auteur illustre-t-il ces différents régimes d’affects à travers la comparaison de la régulation du prendre par les institutions répressives du droit qui condamnent l’appropriation sauvage, et par les institutions de sublimation du Don/contre-don décrites par M. Mauss, qui présentent l’avantage sur les premières de procurer au conatus des affects joyeux. L'auteur conclut donc que chacun indexe la légitimité de l'institution à son conatus et à ses propres affects joyeux. Or comme celle-ci affecte différemment les individus, chacun pourra se réclamer de son bon droit, c'est-à-dire d'un droit naturel inaliénable pour la juger légitime ou non et, éventuellement, lui résister ou la repousser comme un mal, si les affects qu'elle produit sont tristes. C'est un même principe qui explique comment une coalition de mécontents peut toujours se former contre l'institution qui entre alors dans une crise de légitimité, c'est-à-dire de puissance ou d'autorité.
Après avoir montré que la légitimité n'existe pas, puisqu'elle n'est que le résultat d'un rapport de forces toujours fragile, F. Lordon se demande donc comment l'institution s'impose aux individus, d'où lui vient son autorité, ou encore son efficacité symbolique. Pour répondre à cette question, l'auteur se tourne, une fois encore, vers la théorie spinoziste de la puissance comme pouvoir d'une chose de produire des effets sur une ou plusieurs autres choses. Or si les institutions ont ce pouvoir d'affecter de façon homogène les comportements des individus, c'est en raison de la puissance de la multitude, par laquelle les hommes s'affectent les uns les autres, individuellement et collectivement. Le fait de la puissance n'est jamais qu'une autoaffection du corps social. Par mimétisme, en effet, les individus se trouvent affectés de la même façon par des choses qu'ils vont s'accorder à trouver bonnes ou mauvaises et c'est de la composition de leurs affects individuels en affects communs que l’État va tirer son autorité, c’est-à-dire son pouvoir de définir le légal ou l'illégal, comme s'il s'agissait de normes érigées par lui, alors qu'il ne s'agit que d'affects communs. C'est donc par la captation d'un affect commun que se fait reconnaître le pouvoir de l’État, comme celui de toute institution. En dernière instance, c'est toujours de la puissance de la multitude et non de quelque extériorité transcendante que l'institution reçoit son efficacité. Mais du fait que le fondement de l'autorité est immanent au corps social lui-même, il reste fragile et arbitraire ; le pouvoir peut donc toujours être renversé par la multitude, si l'affect commun qui l'a engendré est défait par l'indignation. Autrement dit, ce qui fonde l'institution peut aussi la détruire et l'état civil ne met jamais définitivement fin à la guerre. Mais cette dernière n'abolit jamais complètement l'état civil non plus ; elle contribue plutôt à remplacer certaines valeurs ou institutions par d'autres apparaissant comme plus légitimes. F. Lordon se propose ainsi de vérifier ces mécanismes de remise en cause de la puissance institutionnelle dans les manifestations d'insubordination salariale ou ouvrière, destinées à faire advenir un ordre alternatif bien plus qu'à dissoudre toute institution. Enfin, rappelle F. Lordon, Spinoza permet d'articuler l'ordre du sens (dont les institutions relèvent d'après Boltanski, auquel l'auteur fait référence, puisqu'elles ont comme caractéristique centrale de le faire advenir) et celui des puissances-affects, en montrant que si les énoncés de la véridiction institutionnelle ont le pouvoir de persuader les foules qui y adhèrent, c'est parce que, justement, elles les affectent. En conclusion, la théorie spinoziste des affects permet encore de comprendre que, même derrière les phénomènes d'ordre symbolique, il faut chercher des rapports de forces ou des faits de puissance.
F. Lordon introduit la dernière partie de son ouvrage consacrée aux « individus » , en s'inscrivant dans le prolongement des analyses de P. Bourdieu sur la domination, mais en se proposant de les poursuivre dans le champ, insuffisamment exploré par ce dernier, du rapport salarial. F. Lordon reprend donc la question posée par Bourdieu de savoir comment le dominé acquiesce à la domination, et la réinterprète en termes spinozistes : comment est affecté le corps dominé pour désirer sa propre domination ? Le structuralisme des passions présente en effet l'avantage d’articuler trois approches successives de la domination, analysée d'abord par la philosophie politique, puis par le marxisme à travers l'exploitation capitaliste, puis de façon plus récente, comme locale et non plus globale, c'est-à-dire comme diffuse dans tout le monde social. Car c'est le même mécanisme de production d'affects ou de désirs qui permet de comprendre comment l' « imperium » peut produire l' « obsequium », y compris dans le rapport salarial. F. Lordon rappelle en effet comment le capitalisme, en remplaçant les affects joyeux extrinsèques du fordisme, suscités par la consommation, par les affects joyeux intrinsèques, produits par la réalisation de soi, a solidement réussi à imposer sa domination, conformément au principe de la philosophie politique de Spinoza, d'après lequel il est plus efficace de gouverner à la joie qu'à la crainte. En revanche, F. Lordon récuse l'emploi des termes de consentement ou de servitude volontaire pour rendre compte de cette domination, puisqu'elle n'est que le résultat d'un déterminisme passionnel, par des affects joyeux ou tristes et, en aucun cas, du libre arbitre des individus. Revenant sur la production d'un salariat content, F. Lordon note que pour faire accepter la division sociale du travail, en réalité autoritaire, il faut la doubler d'une division du désir, assignant à chacun ce qu'il lui est permis de désirer, ou d'espérer, afin d'ajuster l'individu aux contraintes de la division du travail, par la production de croyances imaginaires concernant sa propre capacité ou incapacité à « réussir ». Le structuralisme des passions explique donc comment le psychologique exprime le social et fait droit à l'individu, mieux que ne le fait l'habitus, comme principe générateur des comportements individuels d'après Bourdieu, mais auquel il manque une théorie des affects pour comprendre comment il agit sur la complexion de chacun. Pour illustrer cet engendrement de l'action des individus, F. Lordon explique donc comment l'imaginaire néolibéral imprègne tous les esprits, y compris de ceux qui semblent en remettre en cause les valeurs, les hors-la loi, car eux aussi ressemblent à des entrepreneurs, prêts à courir des risques pour optimiser leurs profits. De même, F. Lordon précise que les vecteurs par lesquels s'insinue cet imaginaire sont parfois inattendus et il cite en exemple les magazines féminins dans lesquels s'impose l'idéologie du moi libre, autosuffisant et responsable de sa félicité, comme noyau dur du néolibéralisme. Or F. Lordon dénonce cette croyance, en critiquant par exemple l'impératif kantien du « penser par soi-même », dont l'individu, comme mode fini, est incapable, car aucune de ses pensées ne lui appartient exclusivement et ces dernières devraient être appréhendées par une science sociale de la communication des idées, plus que par une philosophie cartésienne du sujet-substance. Mais l'auteur critique également la volonté antilibérale de changer le monde individuellement, car elle procède encore de l'imaginaire néolibéral, c'est-à-dire de la croyance dans le pouvoir que les vertus individuelles auraient de moraliser le monde. Or l'exemple de la moralisation de la finance est à ce titre le démenti empirique le plus cynique de ce genre d'utopie, condamnée à l'impuissance. Ce n'est pas en réalité la bonne volonté qui conduit les hommes à agir moralement, mais ce sont des conditions sociales particulières, souvent privilégiées, qui favorisent la formation d'affects altruistes ou vertueux. Ceux-ci ne pourront pas s'universaliser grâce à un engagement seulement individuel, comme le préconise une politique de la vertu souvent culpabilisante, mais lorsque des coalitions plus importantes, réunissant des gens ordinaires et pas forcément « formidables », seront capables de mener une vraie politique de transformation sociale. De façon plus générale, F. Lordon identifie comme un paradoxe caractéristique de la pensée libérale la rhétorique qui consiste à vanter les mérites de l'individu autosuffisant, alors que la production capitaliste a poussé la division du travail à son paroxysme et que toutes les légendes de « self made men » occultent la part de spoliation originelle et de collaboration qui leur auront permis de « briguer » un profit dont, ensuite, ils s'arrogent seuls le mérite. F. Lordon rappelle que tout pouvoir, y compris celui de l'Etat, a pour origine cette captation de puissances extérieures. Et il note que Durkheim en a eu l'intuition, en montrant que le charisme d'un homme ne provient que de la puissance dont la multitude l'investit et non de ses mérites, contrairement à ce que donne à croire l'idéologie néolibérale, pour mieux justifier les inégalités sociales par des mérites inégaux. L'auteur conclut donc son travail en appelant de ses vœux un nouvel imaginaire, antilibéral, antisubjectiviste, qui ne nous ferait plus aspirer à d'autres félicités qu'à celles qui nous viennent des autres et qui ferait de l'insuffisance, au lieu de l'autosuffisance illusoire, la source d'affects joyeux produits par une nécessaire et constructive interdépendance.
En proposant une refondation des sciences sociales sur la philosophie spinoziste, F. Lordon opère un décloisonnement stimulant et constructif des sciences humaines et s'inscrit en faux contre contre une division du travail, imposée aussi dans le champ théorique, entre d'un côté la philosophie et les sciences sociales de l'autre. Outre que cette division conduit la sociologie à méconnaître ce qui fait d'elle une science et sa dette à l'égard des concepts, elle condamne aussi la critique sociale à l'impuissance faute d'une compréhension réelle des mécanismes à l’œuvre dans le monde social. Or le structuralisme des passions, extrait de la philosophie spinoziste par F. Lordon, permet non seulement de dépasser les limites de la théorie néoclassique, pour rendre compte de l'action effective des individus dans la société, mais il permet également de revitaliser la critique sociale, en s'attaquant au noyau dur de l'idéologie libérale. Car c'est seulement en s'appuyant sur une anthropologie antisubjectiviste que F. Lordon pense trouver des armes intellectuelles efficaces pour lutter contre le postulat de l'homme libre et seul responsable de lui-même. L'auteur défend au contraire l'idée spinoziste que l'individu comme mode fini est déterminé par des causes extérieures et que c'est seulement le déterminisme passionnel qui permettra de comprendre par quel mode opératoire l'individu sera soumis à l'institution ou lui résistera. C'est en expliquant comment le contentement ou l'indignation dépendent eux-mêmes de la façon dont l'imaginaire néolibéral s'insinue dans les esprits afin d’asseoir durablement sa domination, que F. Lordon parvient aussi à donner les clés de sa déconstruction ou de son renversement possibles.
« La société des affects » constitue donc autant un programme de recherche que d'action. Grâce au structuralisme des passions, il offre un horizon de recherches et de découvertes pouvant conduire la science sociale à démasquer la part d'illusion contenue dans la rhétorique « postmoderne » ou « hypermoderne » (qui procède encore de l'imaginaire néolibéral), présentant l'individu, comme étant à lui même sa propre norme, fragilisé par son isolement, désorienté face à la toute-puissance du marché et sans les contrepoids institutionnels de la Tradition (État, Religion, famille). Au contraire, la finitude de l'individu sur laquelle insiste F. Lordon n'est pas due à son isolement monadique, mais à son insuffisance et à sa dépendance à l'égard de la société et elle ne conduit pas au pessimisme. Au contraire, F. Lordon renoue même avec un certain optimisme humaniste, d'après lequel « rien n'est plus utile à l'homme que l'homme », car la faiblesse de l'individu fait la force de l'homme. Son « imbécillité » est la condition de son bonheur, car elle le pousse à échanger ou à communiquer pour coopérer et augmenter ses forces, à partager ses affects et ses désirs pour qu'ils ne soient pas déçus ou impuissants, mais pour qu'ils restent joyeux. Renoncer à l'humanisme subjectiviste ne revient donc pas à renoncer à tout humanisme, et rejeter toute croyance dans le libre arbitre ne signifie pas renoncer à tout effort pour se libérer d'un désir-maître, produisant plus d'affects négatifs que positifs. Loin de conclure à l'impuissance auquel un déterminisme physicaliste pourrait conduire, F. Lordon nous donne les concepts nécessaires pour penser la puissance d'agir des individus sur les institutions, puisque celles-ci n'ont sur eux que le prestige qu'ils leur prêtent. En montrant qu'elles n'ont pas de légitimité objective, il nous invite à concevoir la possibilité de les transformer pour les rendre plus adéquates à des désirs plus raisonnables et moins utopiques, reposant sur une meilleure compréhension de l'homme et de sa finitude. En refondant les sciences sociales sur la philosophie spinoziste, F. Lordon montre enfin que la philosophie, comme activité productrice de concepts, permet de penser le présent et peut même aider à en infléchir les transformations, dès lors qu'elle se présente comme une théorie systématique de l'action, à la différence des sciences sociales, qui se se contentent trop souvent d'une description empirique parcellaire. Le monde peut-il, en effet, être transformé positivement s'il n'a pas été correctement décrit et si l'homme n'a pas compris jusqu'où et, dans quelles limites, il en a le pouvoir ?
Marie-Christine Ibgui