Eric Chevillard, Juste ciel, Editions de Minuit, 2015, lu par Héloïse Adam
Par Michel Cardin le 12 juin 2015, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
 Eric Chevillard, Juste ciel, Editions de Minuit, 2015.
Eric Chevillard, Juste ciel, Editions de Minuit, 2015.
« Inqualifiable ! » C’est ainsi qu’Albert Moindre, fraîchement décédé et rendu dans l’au-delà, résume sa nouvelle situation. Pourtant, loin de couper la chique à l’auteur, ce constat fait naître une parole foisonnante et drôle, qui s’attaque à des difficultés philosophiques notoires : l’union de l’âme et du corps, l’existence du mal, le sens de la vie, énigmes pluri-séculaires dont le romancier secoue vigoureusement la poussière.
Pour autant, les promesses de la quatrième de couverture - qui vante « un témoignage de première main » sur le Royaume des cieux et fait miroiter « des réponses à nombre de nos interrogations » - ne seront pas tenues... Avec des accents wittgensteiniens, Chevillard se moque de nos vertiges métaphysiques, en révèle la nature purement langagière et offre au lecteur avide d’absolu les réponses qu’il mérite : énumérations infinies, jeux de langage, esquives poétiques.
Juste Ciel commence, comme il se doit, par la mort accidentelle de son héros, renversé par une camionnette transportant des olives. A cet événement inaugural succède la migration de l’âme d’Albert Moindre vers un au-delà balisé d’étapes administratives : la Salle d’Attente, le Bureau des Elucidations, l’Observatoire, le Service des Réclamations puis celui des Rétributions.
Découvrant ce parcours impersonnel, Moindre demeure perplexe. Le Royaume
ne ressemble en rien aux représentations magnifiées que nous en faisons ici-bas.
Nul angelot, nulle prairie, mais un décor ringard qui accuse le manque
d’imagination d’un créateur techniquement en retard sur sa créature : banquette
usée, ambiance « standard », les portes des bureaux se
matérialiseront successivement par le biais d’hologrammes « assez grossiers
», et l’absence de corps est compensée par un halo ectoplasmique qui a tout
d’un mauvais effet spécial. En un mot, ce Ciel est décevant et si, comme
l’indique le titre, il est « juste », c’est sans doute au sens restrictif
d’« à peine suffisant » et en somme plutôt médiocre ; sa conception semble
d’ailleurs avoir été soumise au principe du moindre effort et rapidement Albert
s’y ennuie, preuve qu’en se débarrassant de son enveloppe charnelle la pensée
ne se désempêtre pas aussitôt de l’humaine condition.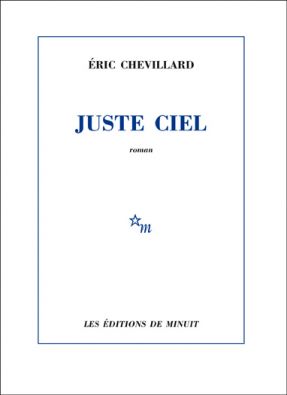
La suite confirme ce diagnostic : d’une manière obsessionnelle digne de Michaux, l’écrivain met en scène une conscience humaine chevillée au souvenir de son corps. On attendait beaucoup de l’entendement enfin délivré des erreurs des sens et des errements de l’imagination, enfin extrait de la gélatineuse boîte crânienne où, de notre vivant, il navigue comme « nuitamment dans une mangrove marécageuse »... Or, le voici qui consacre sa nouvelle agilité à des considérations navrantes et des exercices vains : « Il tente de faire la roue... Il va maintenant tenter de produire un son... de voler ...de cracher... d’effectuer une danse ».... Le tout « (en pensée du moins) » est-il systématiquement précisé. Formule qui concentre l’impression partout déployée dans l’ouvrage d’un amoindrissement et d’une humiliation de la pensée, incapable de se suffire à elle-même et peu digne de son immortalité. Ne sachant ce qu’il est venu faire dans cet éther, ce « cogito pétrisseur » teste donc inlassablement ses membres fantômes et prend conscience que, quand la chair manque, ce sont beaucoup de nos mots qui perdent leur sens : « Peut-on être mutine sans un nez retroussé ? » se demande par exemple Albert au contact de l’âme de Clarisse. Rien d’étonnant, donc, à ce que la montée au ciel soit contemporaine d’un « changement de champ lexical ». Loin de nous faire entrer dans le royaume du concept, l’absence de corps pousse au néologisme : crachiluve, floustensoir, visquescent ... autant de tentatives pour décrire le nouveau rapport au corps et au monde que font naître leurs ersatz célestes.
Certaines attentes seront cependant récompensées : ainsi Albert se voit-il offrir les réponses à toutes les questions qu’il s’est posées durant son existence. Malheureusement, la trivialité des préoccupations qui l’agitaient ici-bas nous met face à des révélations semblablement triviales : « Eucalyptus, c’est le mot que tu avais sur le bout de la langue le 12 juillet 1981 à 18h37 ». Suit une liste d’informations toutes aussi anecdotiques et inutilement détaillées les unes que les autres. « Des faits. Ici, rien que des faits », revendique la voix omnisciente : par conséquent, elle n’offre qu’un vrac absurde et interminable d’assertions décousues. Aucune généralité, mais une avalanche d’événements singuliers dont l’énumération se prolonge lorsqu’Albert accède à l’« Observatoire». On est alors saisi par la vanité de cette soif de connaissance, dont l’aboutissement n’est pas une science ordonnée et cohérente mais la mise bout-à-bout de tous les énoncés possibles. Nulle nécessité mais le règne de l’imagination qui énumère inlassablement jusqu’à épuiser le réel, voire l’excéder par des suppositions de plus en plus douteuses sur les petits détails qui font le monde : « le heurt d’un bobsleigh et d’un rickshaw », « l’innocent qui creuse un tunnel pour se glisser dans la prison », « un rire dans une poche »... L’omniscience selon Chevillard revient ainsi à rendre tout énoncé vrai puisqu’il y a toujours à tout moment un événement capable de l’illustrer - serait-ce poétiquement. La contre-vérité « le soleil est liquide », proposée par notre héros, est ainsi immédiatement assortie de la vision d’un rayon ardent frappant la banquise et faisant monter le niveau de la mer...
Le problème de l’existence du mal au sein de cette réalité foisonnante est enfin abordé lorsque Moindre est dirigé vers le « Service des Réclamations », vain gueuloir où il peut donner libre cours à ses récriminations. Outre le regret indigné que son manuscrit Les larmes d’Adèle n’ait jamais été publié, il se plaint d’une réalité qu’il trouve bien mal conçue. Dieu, artisan prétendument supérieur et nommé ici « Pieuvre omnipotente » - par où l’on voit que sa supériorité est toute relative puisqu’il ne s’agit que d’avoir huit bras au lieu de deux - n’aurait-il pas pu mieux faire ? C’est ici le bon sens qui parle : « si la queue du lézard repousse, pourquoi pas la jambe de mon voisin amputée dans un accident de chantier ? », « Deux pieds, c’était pour multiplier le risque d’égarer une pantoufle, je suppose ? » Bon sens poétique cependant, où correspondances et analogies font droit et où l’imagination l’emporte toujours sur la logique: « Fallait-il vraiment que l’idée du canon se forme dans le cerveau de l’homme - la gelée de coing tremble tout autant et ne conçoit pas d’armes » ? Est alors déroulé sous nos yeux le fantasme d’un monde où, entre autres perfectionnements, la poule ayant des dents pour moudre le grain, l’affamé trouverait « dans le même nid de paille l’oeuf et la mouillette ». On pense au Chant I du De rerum Natura quand Lucrèce, imaginant ce qu’aurait pu être la réalité si quelque chose pouvait se former à partir de rien, propose un monde où « tous les arbres pourraient porter toutes les productions », et où les hommes seraient « assez grands pour traverser la mer à gué ». C’est un tel pouvoir de créer ex nihilo et de remédier à un réel insuffisant que Chevillard revendique pour la littérature.
Nous ne révélerons pas l’issue du dernier chapitre qui se déroule au « Service des Rétributions». On y découvre l’ultime, incontestable et arbitraire hiérarchisation des artistes et penseurs s’étant succédés dans l’histoire : Jules Laforgue devance Arthur Rimbaud et Blaise Pascal n’est qu’un vulgaire imposteur... On y apprend également que la justification de l’existence de Moindre tient tout entière dans sa capacité à entretenir et réparer les ponts transbordeurs; compétence technique tout à la fois indispensable et ridicule, qui moque la suffisance du personnage et le condamne à être le rouage insignifiant d’un monde conçu comme vaste ingénierie.
Héros peu séduisant, Albert Moindre est donc le prétexte à une divagation plus poétique que romanesque Et pour cause : si son âme peine à s’élever, c’est aussi que Chevillard rechigne à se faire le narrateur de cette ascension. Le statut du romancier est mis à mal dans cet ouvrage par un consciencieux travail de sape qui va de l’usage dévoyé de la logique à la remise en cause de l’ensemble du dispositif narratif : sommes-nous bien au Ciel ? L’âme de Moindre a-t-elle réellement survécu ? Ces 142 pages ne nous livrent-elles pas plutôt les derniers soubresauts d’une pensée en décomposition, continuant brièvement à délirer sur sa lancée, comme les pattes du canard courent quelques mètres après qu’on lui a coupé le cou ? C’est l’auteur lui-même qui doute, nous plaçant dans une position inconfortable et stimulante. De ruminations obsessionnelles en échappées inattendues, Chevillard produit ainsi un texte qui invite autant à rire qu’à penser.
Héloïse Adam