Richard Wagner, Écrits sur la musique, Gallimard, 2013, lu par E. Chelzen
Par Cyril Morana le 09 juillet 2014, 15:42 - Esthétique - Lien permanent
 Ecrits
sur la musique de Richard Wagner
Ecrits
sur la musique de Richard Wagner
Trad. de l'allemand par Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Jean Launay.
Préface de Richard Millet
Annotations des traducteurs
Hors série Connaissance, Gallimard, 2013
Ces Ecrits sur la musique regroupent des textes de Richard Wagner
devenus introuvables en France. Sont d’abord présentés l’ensemble des textes
consacrés au maître de Bonn, l’illustre devancier, et en particulier le très
passionnant Beethoven (1870). La Communication à mes amis (1851) leur
succède, qui porte sur la conception wagnérienne du drame musical à travers la
présentation des opéras composés à cette date. Enfin, dans la Lettre sur la musique (1860), Wagner
reprend les thèses développées dans ses principaux ouvrages théoriques[1][1].
Sont d’abord présentés l’ensemble des textes consacrés au maître de Bonn, l’illustre devancier, et en particulier le très passionnant Beethoven (1870). La Communication à mes amis (1851) leur succède, qui porte sur la conception wagnérienne du drame musical à travers la présentation des opéras composés à cette date. Enfin, dans la Lettre sur la musique (1860), Wagner reprend les thèses développées dans ses principaux ouvrages théoriques[1][2].
a) Beethoven
Nous nous arrêterons tout d’abord sur le Beethoven, véritable œuvre d’une centaine de pages qui cherche à montrer l’importance décisive de ce compositeur au sein de l’histoire de l’art[2][3]. Wagner y développe une philosophie de la musique qui doit tout à Schopenhauer. Insistons ici essentiellement sur ce qu’il en retient, dans la perspective de son essai sur Beethoven, comme de son propre projet d’artiste.
La conscience a deux versants : elle est en partie la conscience du Moi propre, lorsqu’elle est tournée vers l’intérieur, et elle est dans une autre mesure conscience du monde extérieur, lorsqu’elle est tournée vers les objets qui l’entourent. Cette double orientation se conçoit mieux encore si on la ramène à la physiologie sur laquelle elle est appuyée. C’est que le monde extérieur est le monde lumineux examiné par la vue, à l’état de veille. Au contraire, le monde intérieur et obscur est mieux appréhendé pendant le rêve, dans une sorte de « lucidité somnambulique ». Or, ce n’est plus la vue mais l’ouïe qui permet d’accéder à ce monde souterrain des affects ; c’est dans un cri par exemple, que le rêveur s’éveille, projetant ainsi dans le monde extérieur une infinitésimale trace de ce qu’il a vécu dans le rêve. Le son semble bien constituer l’expression la plus directe de la Volonté.
Mais il faut aller plus loin ; ce que nous avons saisi dans le sommeil profond, la Volonté, nous n’y avons accès qu’indirectement, par la « traduction » que constitue le rêve prenant place peu avant le réveil. C’est seulement ce dernier qui parvient finalement à la conscience éveillée, et dont nous pouvons garder le souvenir. La musique joue exactement ce même rôle ; elle nous entraîne dans le monde du son, et nous parle une langue que nous comprenons parce qu’elle constitue l’écho de la Volonté du monde, le rappel du monde intérieur des sentiments. Le compositeur nous entraîne par sa musique vers notre Moi, il fait de nous, les auditeurs, un peuple de rêveurs éveillés devenus pour un temps presque insensibles aux stimuli du monde extérieur.
C’est cette plongée de la musique vers l’En-soi qui fait proprement le génie de Beethoven. Avec lui, la musique n’est plus un art d’agrément évoluant selon les caprices de la mode, des attentes du moment. Bien au contraire, les mélodies de Beethoven ont ce caractère implacable qui les rend sublimes, révélant quelque chose d’essentiel de la réalité humaine. Et c’est pourquoi, la musique ayant été si loin dans cette révélation de l’essence intime du monde, elle a souvent tendance à écraser la poésie, lorsque son discours vient s’y adjoindre. C’est le cas par exemple de l’Hymne à la joie, dans le quatrième mouvement de la Neuvième symphonie, « car ce qui nous étreint lorsque s’élève la voix humaine, ce n’est pas le sens des paroles, mais le caractère de cette voix humaine elle-même »[3][4]. C’est alors que se font jour les préoccupations de Wagner : comment porter l’œuvre d’art jusqu’au point de convergence de la musique et de la poésie, où l’une et l’autre se nourriraient mutuellement ?
C’est le drame shakespearien qui nous fournit un début de réponse. Car Shakespeare a réalisé dans son art quelque chose de comparable à Beethoven. Il a fait du drame la forme poétique capable d’exprimer, tout comme la musique, cette essence du monde. C’est ainsi que les personnages shakespeariens nous entrainent, loin de toute figure artificielle vers l’homme réel. Ils nous semblent aussi imposants que les éléments de la nature et nous font entrevoir la vie elle-même, dans son accomplissement nécessaire. On le comprend alors, le drame musical devra réaliser la synthèse parfaite de ces deux formes d’art susceptibles de révéler la Volonté du monde. Le projet de Wagner est partout présent en creux, et le lecteur ne peut s’empêcher de penser que malheureusement, aussi aboutis et géniaux que soient les opéras de Wagner, il n’a jamais pu trouver son Shakespeare, et encore moins s’y substituer.
La
fin du texte apparait quant à elle assez datée : Beethoven est censé avoir
incarné « l’esprit allemand sauvant l’esprit humain de sa profonde
déchéance »[4][5]. On peut résumer ces quelques pages très
rapidement : à la France le « bon goût », la mode, l’Apparence,
à l’Allemagne l’Essence. Evidemment, il faut avoir en tête que ce texte date de
1870, mais il faut reconnaitre qu’au regard de la puissance théorique de son
développement, la conclusion est un peu faible.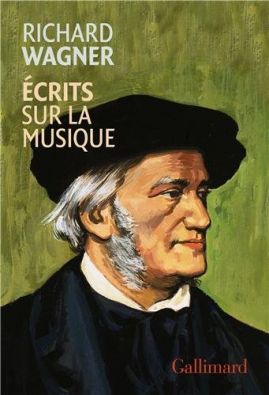
b) La Communication à mes amis et la Lettre sur la musique.
Les deux autres écrits présentés ici ont un caractère plus libre, mêlant constamment le théorique et l’autobiographique. Dans Une communication à mes amis (1851), il s’agit de mette en évidence l’intention de l’artiste, et les moyens progressivement mis en œuvre tout au long de sa trajectoire personnelle pour la réaliser.
Arrêtons-nous donc sur cette intention. Pour Wagner, il est tout d’abord nécessaire que l’artiste s’émancipe des formes figées par la tradition, ce qu’il appelle l’art monumental. Il lui faut au contraire détruire les « statues de marbre » pour se tourner vers la palpitation de la vie. C’est ainsi que la musique exerce son emprise : loin de toute réflexion intellectuelle, elle nous plonge immédiatement dans le bouillonnement des sentiments, dans leur vivante dynamique. Le projet wagnérien, drame musical ou « œuvre d’art de l’avenir », est tout entier dans cette tentative.
La suite du texte retrace donc le parcours par lequel, depuis les premiers opéras jusqu’aux derniers grands projets (le Ring y figure en bonne place, mais il a alors pour nom La mort de Siegfried), Wagner quitte progressivement la forme imposée par l’Opéra pour s’avancer vers le Drame.
Ce que Wagner reproche à l’Opéra traditionnel (italien et français, principalement), c’est de proposer un divertissement essentiellement constitué de quelques temps forts, les grands airs, entrecoupés de récitatifs sans grand intérêt. L’histoire n’est qu’un prétexte ; il faut avant tout préparer les numéros vocaux grâce auxquels les chanteurs feront étalage de leur virtuosité et susciteront les clameurs du public. Wagner tente un renversement : donner toute son importance à l’action, à ce qui se passe sur scène, demander aux interprètes d’être d’abord des acteurs, et non seulement des chanteurs. Un grand mythe, comme celui de Lohengrin, est choisi parce qu’il nous dit quelque chose d’essentiel sur l’être humain. Ensuite, la musique est là pour faire surgir cette dynamique des sentiments en même temps que le livret leur donne un objet bien déterminé. La mélodie devient infinie, elle constitue la sève du drame tout entier.
La fin du texte revient sur l’amitié entre Wagner et Liszt. On y voit le grand compositeur hongrois abandonner ses prouesses pianistiques pour se consacrer avec passion à la direction des œuvres de son ami, notamment de Tannhäuser. L’admiration de Wagner est émouvante ; il trouve enfin en cet autre musicien et interprète une « patrie pour son art »[5][6].
La Lettre sur la musique (1860), adressée à Frédéric Villot, un admirateur français, condense quant à elle en une soixantaine de pages les thèses présentées dans les principaux ouvrages théoriques de Wagner. Il s’agit d’abord de penser les relations de l’art avec la vie publique. C’est l’objet de L’art et la révolution où il faut comprendre les raisons expliquant que l’opéra soit devenu un art d’agrément, de distraction, ainsi que les conditions pouvant permettre la résurgence d’œuvres occupant une place centrale dans la Cité, comme c’était le cas du théâtre grec où le peuple assemblé attendait d’un Eschyle ou d’un Sophocle les productions les plus sublimes.
Ensuite, Wagner évoque L’œuvre d’art de l’avenir, où il s’agissait de penser l’œuvre totale (la Gesamtkunstwerk), réunissant toutes les branches particulières des Beaux-Arts, désormais séparées. C’est bien sûr le « drame complet » qui est susceptible de réaliser cette synthèse de tous les arts.
Enfin, il revient sur la définition de ce drame complet en évoquant quelques aspects d’Opéra et drame. Si l’enjeu se trouve dans les rapports qu’y entretiennent poésie et musique, nous retiendrons particulièrement la généalogie que Wagner propose du drame musical. Commençant de manière on ne peut plus rousseauiste en admettant l’hypothèse selon laquelle « la première langue humaine doit avoir eu avec le chant une grande ressemblance »[6][7], il voit dans le perfectionnement des langues un développement de leur aspect conventionnel. Tournées vers l’abstraction, servant les desseins de l’entendement, elles perdent peu à peu leur puissance d’expression des sentiments. C’est dans cette zone délaissée que la musique prend corps, trouvant son origine dans la danse. Dans les symphonies les plus complexes, on trouve encore des structures renvoyant à ces danses primitives, Or, il ne faut pas oublier que la danse populaire exprimait aussi une action, souvent une histoire d’amour, où l’on retrouvait « les mouvements de l’âme les plus intimes »[7][8]. Ces mouvements intimes de l’âme ne sont rien d’autre que le ressort de l’action dramatique, ceux que l’on retrouvera dans le drame wagnérien. Là encore, contre toute forme d’artifice et de convention, l’œuvre d’art a pour fonction d’exprimer ce qu’il y a de plus concret, de plus authentique dans la vie.
Ces Ecrits sur la musique permettent de prendre une connaissance assez complète de la philosophie de l’art de Wagner. Précisons qu’aucun de ces écrits ne contient de propos nauséabonds comparables à ceux que nous trouvons, par exemple, dans Le judaïsme et la musique. L’œuvre en prose de Wagner ne peut s’y réduire, bien évidemment, mais on ne peut pas non plus faire comme si cela n’existait pas. Concernant les trois principaux textes présentés ici, aucune traduction n’est récente. Cependant elles sont toutes trois limpides, et leur intérêt justifie amplement cette réédition.
E. Chelzen
[8][1] La traduction du Beethoven est de Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1970). Celle de la Communication à mes amis est due à Jean Launay (1976). La Lettre sur la musique est une reprise de la traduction de Challemel-Lacour (1860).
[1][2] La traduction du Beethoven est de Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1970). Celle de la Communication à mes amis est due à Jean Launay (1976). La Lettre sur la musique est une reprise de la traduction de Challemel-Lacour (1860).
[2][3] Nous nous contenterons de mentionner ici les autres textes de ce groupement consacré à Beethoven : Une visite à Beethoven (1840), très courte fiction mettant en scène un jeune compositeur se rendant à Vienne à pied dans l’espoir de rencontrer le maître devenu sourd, le Compte-rendu de l’exécution de la Neuvième symphonie à Dresde (1846), enfin les programmes rédigés à l’occasion de l’exécution de la Neuvième symphonie (1846), de la Symphonie héroïque (1851), et de l’Ouverture de Coriolan (1852).
[3][4] Wagner, Ecrits sur la musique, Gallimard, 2013, p. 143.
[4][5] Idem, p.119.
[5][6] Idem, p.333
[6][7] Idem, p.372
[7][8] Idem, p. 397