Hourya Bénis Sinaceur, Cavaillès, éd Les Belles Lettres, lu par Lény Oumraou
Par Jérôme Jardry le 03 septembre 2014, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
Hourya Bénis Sinaceur, Cavaillès, éd Les Belles Lettres. 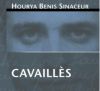
Hourya Bénis Sinaceur a consacré plusieurs études à Cavaillès, dont la principale est l’ouvrage publié en 1994, Cavaillès, philosophie mathématique. Elle dit cependant adopter ici un nouveau point de vue, complémentaire des études précédentes. Le but est de montrer comment Cavaillès est parvenu au programme de philosophie du concept dans son « livre testament », Sur la logique et les fondements de la science. Il s’agit de tisser le réseau des relations complexes qui lient ce programme aux philosophes auxquels Cavaillès a été amené à se confronter – Spinoza, Kant, Hegel et Husserl pour l’essentiel.
L’ouvrage comporte neuf chapitres. Le premier tente de dresser, à grands traits, le portrait du philosophe, à travers son parcours, « de l’école à la guerre », selon le titre du chapitre. Fils et petit-fils de militaire, né dans une famille protestante, républicaine, et dreyfusarde, Cavaillès obtient la licence de philosophie en 1921 et est reçu premier, en 1923, au concours d’entrée à l’ENS, qu’il a préparé seul ; il obtient l’agrégation de philosophie en 1927. Ses thèses, dirigées par Léon Brunschvicg, sont soutenues en 1938. Ni la guerre, ni les actes de résistance, ni l’enfermement, ne purent le détourner d’une activité philosophique qui prit fin le 14 février 1944, lorsqu’il fut fusillé à Arras. Le présent ouvrage paraît à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa mort.
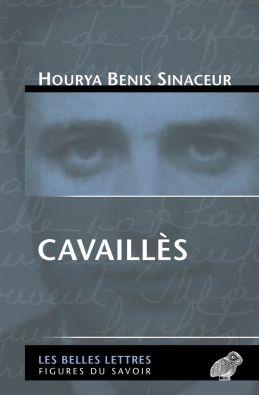
Dans le Chapitre 2, l’auteure pose ce qu’elle nomme des « repères », c’est-à-dire des notions qui jalonnent la démarche de Cavaillès, et en définissent, pour ainsi dire, l’esprit général. Tous expriment, plus ou moins directement, l’inspiration spinoziste de sa pensée, même s’il s’agit, comme le dit H. Sinaceur, d’un « Spinoza dialectisé » par Brunschvicg. Ainsi le rationalisme de Cavaillès est-il spinoziste en ceci que raison et sensibilité y sont unies, et que la nécessité y est inséparable d’une exigence morale. Ce que la démonstration mathématique présente comme une nécessité s’est d’abord présenté, au mathématicien, comme une exigence, un appel à une solution, émanant du problème lui-même, appel auquel il fallut répondre par un effort, que H. Sinaceur rapproche du conatus – car il s’agit d’un effort pour se libérer des contingences, et accueillir la nécessité. C’est une exigence du même ordre qui anima l’engagement de Cavaillès dans la Résistance. Ainsi confie-t-il à Raymond Aron, à Londres : « Nous sommes en tout menés. Menés mais non contraints et forcés, menés comme par la lumière ». Comme chez Spinoza, la liberté est conçue non comme négation du déterminisme, mais comme autodétermination.
Le Troisième chapitre précise la manière dont Cavaillès conçoit l’activité philosophique. Cette conception est résumée par le titre des deux sous-parties du chapitre : philosopher c’est comprendre, et comprendre c’est agir. En parlant de compréhension, Cavaillès, tout comme Dilthey, veut échapper à la fois à l’apriorisme anhistorique et à l’empirisme historique. Mais pour le philosophe français, la compréhension n’est pas réservée aux sciences humaines. Elle réside plutôt dans le begreifen kantien, car la philosophie est connaissance rationnelle. L’essence de la raison est de comprendre synthétiquement ce que l’entendement discerne et distingue. D’où le rôle accordé, dans ses deux thèses de 1938, au concept « d’intuition centrale » d’une théorie, qui donne l’unité et l’esprit de celle-ci, et qui trouve son expression la plus explicite dans l’axiomatisation de cette théorie. Si donc, philosopher c’est comprendre, c’est en saisissant la nécessité interne de ce que l’on comprend. La compréhension relève donc davantage de la connaissance du troisième genre de Spinoza que de l’herméneutique.
Cavaillès se tourne ainsi vers les contenus de pensée, c’est-à-dire le sens, considéré comme autonome par rapport à son expression linguistique, ou à l’acte mental qui le saisit. Mais cette objectivation des contenus de pensée n’en fait pas des réalités anhistoriques subsistant dans un ciel platonicien – sur le modèle des pensées frégéennes. Au contraire, « Cavaillès allie l’objectivisme sémantique à l’histoire » (p 72). Le contenu est historique et se déploie dans un procès spécifique, idéal, dégagé de sa naissance empirique ; « les contenus s’autoengendrent les uns à partir des autres à un rythme nécessaire et imprévisible » (p 72).
Ici s’annonce le lien entre comprendre et agir : la mathématique ne se présente pas comme un texte à interpréter, mais comme un acte à reproduire, un faire, qu’il faut refaire. On ne peut comprendre la mathématique qu’en agissant. Elle est une matière à travailler, et cette matière se travaille par des gestes qui sont autant d’actes de pensée sur des objets de pensée, ceux-ci n’étant à leur tour que des séquences de tels gestes.
Poursuivant sa marche vers la philosophie du concept, H. Sinaceur présente, dans le quatrième chapitre, la « théorie de la raison » de Cavaillès. Celui-ci affirmait, lors de la Séance de la Société française de philosophie de 1939, que « la connaissance mathématique est centrale pour savoir ce qu’est la connaissance ». En comprendre la nature, c’est en suivre le développement. L’enchaînement des notions mathématiques, dans leur progression historique, prend la forme d’une généralisation, qui se présente elle-même sous deux aspects. Celui de l’idéalisation, d’une part, qui consiste, comme le décrivait le mathématicien Hilbert (1862-1943), à ajouter des éléments « idéaux », et d’étendre les opérations à ces éléments, de manière à écarter les cas où ces opérations ne sont pas applicables ; ainsi, la soustraction n’est pas toujours possible entre deux entiers naturels – d’où l’extension aux entiers ; la division n’est pas toujours possible entre deux entiers – d’où l’extension aux rationnels ; l’extraction de racine carrée n’est pas toujours possible sur les réels – d’où l’extension aux complexes.
À ce premier type d’extension-généralisation s’ajoute la thématisation, comme lorsque, partant d’opérations particulières – addition ou multiplication sur les entiers, par exemple – on en étudie les propriétés formelles (associativité, commutativité, etc), introduisant ainsi une considération abstraite d’opérations générales et de leurs propriétés, qui servent de base à la définition de diverses structures abstraites (par exemple, la structure de groupe, ou la structure d’anneau). L’idée de thématisation est d’inspiration husserlienne. Comme le rappelle H. Sinaceur, thématiser c’est « constituer en objet explicite et central du regard transcendantal une entité présente de manière marginale ou potentielle dans l’horizon du champ des objets intentionnels » (p 97). Ainsi, le sens posé – les contenus de pensée – renvoie à un sens posant – le processus de génération du sens posé ; mais le sens posant devient lui-même sens posé pour un autre acte.
Le Chapitre V est consacré à l’intentionnalité husserlienne. Ce sont notamment les thèses de Logique formelle et logique transcendantale qui sont discutées. Bolzano avait mis l’accent sur la démonstration comme « âme de la science », selon l’heureuse expression de Cavaillès. La démonstration est, en effet, l’exposition des relations logiques liant objectivement les propositions, les unes aux autres, et c’est par leurs relations mêmes que celles-ci forment une science. De son côté, Husserl affirme la solidarité entre cette apophantique formelle, qui vise les relations logiques entre des propositions, et l’ontologie formelle, qui se tourne vers les objets et les structures corrélatives de l’apophantique. Ce sont bien, pour Cavaillès les deux faces de l’infrastructure de la science. Mais Husserl prétend les fonder sur une logique subjective, qui ramène à la conscience. Son présupposé le plus constant est d’affirmer que toute conscience d’objet est, en même temps, prise de conscience de soi – en quoi consiste, précisément, la structure intentionnelle de la conscience. Husserl cumule alors trois positions rejetées par Cavaillès : la perspective fondationnelle, le logicisme anhistorique et le subjectivisme transcendantaliste.
C’est que pour Cavaillès, comme pour Bolzano, la connexion des concepts fait de la science « un objet sui generis, original dans son essence, autonome dans son mouvement ». La différence entre les deux approches est particulièrement soulignée par H. Sinaceur lorsqu’elle cite un mot de Merleau-Ponty – héritier de Husserl – à l’adresse de Jean- Toussaint Desanti – héritier de Cavaillès : « Je ne crois pas possible, disait-il, une philosophie du concept, mais seulement une philosophie de l’accès au concept ». Or, pour Cavaillès il ne pouvait être question d’accès au concept car, comme pour Spinoza, il n’y a pas d’hiatus entre être et connaître, entre la vérité et sa reconnaissance.
C’est dans leur histoire que s’affirme l’autonomie des mathématiques, et des produits de la raison. Et c’est la méthode historique suivie par Cavaillès qui est abordée dans le Chapitre VI, intitulé « Raison et histoire ». Cavaillès cherche à déterminer les modalités de production mathématique à partir de l’analyse de leurs produits. Il a pour modèle l’ouvrage de Brunschvicg, Les Étapes de la philosophie mathématique (1912). Le but est d’élaborer une théorie de la raison qui en intègre la dimension historique, et les effets de la contingence. Il s’agit, dit H. Sinaceur, d’apercevoir sous l’accidentel un devenir objectif, ce même devenir que le mathématicien s’approprie en poursuivant l’œuvre de ses prédécesseurs. Les mathématiques révèlent une logique de la succession historique qu’il convient de comprendre. Ce qui fait dire à H. Sinaceur que « le devenir mathématique est mathématiquement justifié ».
Le Chapitre VII souligne que ce devenir est à la fois « imprévisible et nécessaire ». Dans la première partie du chapitre, H. Sinaceur revient sur la nature du contenu qui est en devenir. Elle rappelle que Cavaillès rejette « l’hypothèse de l’en soi », c’est-à-dire le réalisme des idées, selon lequel les vérités mathématiques doivent correspondre à des entités séparées du monde physique, et irréductibles au monde mental. Certains idéalistes admettent tout au plus une genèse empirique de la connaissance des idées, dont l’existence est cependant antérieure à cette connaissance. Cette alliance du réalisme des idées avec un empirisme de la connaissance trahit une erreur commune : la supposition que l’être est antérieur au connaître.
Aux yeux de Cavaillès, si la connaissance mathématique est expérience effective, parce qu’effectuante, elle est expérience sans mathématicien, activité de création sans acteur et sans créateur, « histoire sans personnages » (p. 163). Comme on la vu, la pensée mathématique n’est pas contemplative, mais transformatrice des contenus. Cependant les actes et gestes à la base de ces transformations sont objectivement commandés par la structure des contenus sur lesquels ils opèrent. La rationalité est ainsi immanente à ces contenus, non à la conscience.
Le devenir des mathématiques tient à ce que de nouveaux concepts et de nouveaux objets sont introduits et exigés par les problèmes posé. Mais, cette nouveauté est vraiment une nouveauté, dans la mesure où il n’est pas possible de tirer les nouvelles notions de la seule analyse des notions données. C’est ce qui rend le développement historique des mathématiques à la fois nécessaire et imprévisible. Il ne s’agit pas d’une nécessité logique, mais dialectique. De ce point de vue, H. Sinaceur parle d’un « lien non revendiqué » de Cavaillès à Hegel (p. 170). Car il est vrai qu’il faut un renversement de la position hégélienne pour affirmer ainsi le caractère dialectique du développement mathématique : Hegel reprochait à la démonstration mathématique de rester extérieure à ce qu’elle établit. Cavaillès y reconnait, au contraire, le mouvement même du concept.
C’est dans l’avant-dernière phrase de Sur la logique et la théorie de la science que Cavaillès lance un appel à une philosophie du concept. Dans le Chapitre VIII, H. Sinaceur cite deux sources de ce programme : d’une part, la mathématique conceptuelle (begrifflische Mathematik) de Hilbert et Noether ; d’autre part, Hegel, auquel Cavaillès emprunte l’idée du dynamisme du concept. La première a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de l’algèbre moderne, et la mise en avant de l’étude des structures (l’algèbre cessant d’être définie comme théorie des équations). Quant à la référence à Hegel, on aura compris que, tandis que le philosophe allemand avait prétendu dépasser Spinoza en posant la substance comme sujet, Cavaillès récuse l’intervention de la subjectivité, et reste ainsi spinoziste jusque dans sa philosophie du concept.
Mais en restant spinoziste – chronologiquement en deçà de Hegel – Cavaillès rejoint Marx – au-delà de Hegel. H. Sinaceur va jusqu’à dire que son approche est matérialiste ; mais il s’agit de la matérialité du contenu. Le sujet n’est acteur que dans la mesure où il effectue un processus dont l’initiative vient de l’objet. « Le sujet est un medium par qui s’actualisent les lois de l’objet » (p. 191). C’est pourquoi on peut parler d’une dialectique pratique : le travail du mathématicien consiste « à réviser perpétuellement les contenus porteurs de la nécessité de leur dépassement » (p. 192). Cette nécessité est celle par laquelle, comme chez Spinoza, les idées engendrent les idées, ou encore les concepts s’auto-engendrent.
La dernière partie du chapitre vise à montrer comment ces thèses apportent un éclairage à l’opposition classique du concept et de l’intuition. L’intuitif, en effet, n’est pas tant le donné que l’autonome, ce qui se présente à la pensée mathématique avec ses exigences propres, auxquelles elle se doit de répondre.
Au terme de cet exposé de l’évolution de la pensée de Cavaillès, Sinacœur rappelle, dans l’ultime chapitre, que malgré la brièveté de sa carrière, et le coup d’arrêt tragique qui lui fut donné, son œuvre n’en a pas moins suscité une importante postérité. Canguilhem, qui fut l’ami de Cavaillès, voyait en elle l’annonce, vingt ans à l’avance, du structuralisme français. Il est certain, du moins, que le travail de Cavaillès s’inscrit dans ce mouvement de pensée qui n’oppose pas l’histoire à la structure, et qui tend à « désubjectiver la pensée », selon l’expression de H. Sinaceur. Il est à noter que dans le domaine, qui fut le sien, de la philosophie mathématique, on peut citer, parmi ses héritiers, Jean-Toussaint Desanti, Gilles-Gaston Granger ... et Hourya Bénis Sinaceur. C’est sans doute cette dimension, omniprésente, de la dette et de l’héritage qui fait la force de cet ouvrage.
Lény Oumraou