Jean Furtos De la précarité à l'auto-exclusion, Editions Rue d'Ulm/Presses de l'École Normale Supérieure, 2009, par Laurence Lacroix
Par Cyril Morana le 26 juin 2015, 03:01 - Psychanalyse - Lien permanent

Jean Furtos, De la précarité à l'auto-exclusion, Éditions Rue d'Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2009
Jean Furtos est psychiatre et chef de service en psychiatrie au
centre hospitalier Le Vinatier à Bron, près de Lyon. Il a fondé en 1995
un observatoire qui travaille avec les intervenants de première ligne de
la clinique psychosociale qui est devenu en 2002 l'Observatoire
national des pratiques en santé mentale et précarité.
Il est aussi
le directeur de la publication du bulletin national Rhizome, et a publié
en 2008, chez Masson, les cliniques de la précarité.
Ses
recherches, Jean Furtos les a présenté le 8 avril 2009 lors d'une
conférence-débat organisée par l'Association Emmaüs et qui eu lieu à
l’École Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Celle-ci a donné lieu a une
publication aux éditions Rue d'Ulm/Presses de l’École normale
supérieure, et s'intitule "De la précarité à l'auto-exclusion".
Ce qui caractérise le travail de Jean Furtos c'est qu'il tente de saisir et de mettre en évidence, à même la clinique qui se présente à lui, ce qui caractérise les nouvelles formes de pathologie mentale. Or, il lui apparaît qu'une de ces formes est celle qu'il nomme "auto-exclusion". Celle-ci a partie liée avec la précarité, et c'est ce lien entre précarité et auto-exclusion que Jean Furtos s'attache à exposer et à démontrer.
Sa conférence débute par une constatation faite par une des infirmières de son service – Mademoiselle Picard – constatation déroutante et dans laquelle se fonde un sentiment d'impuissance professionnelle : les gens – nous dit Mademoiselle Picard - ne souffrent plus comme avant.
Qu'est-ce que cela signifie? Cette remarque nous contraint à prendre en compte que la pathologie mentale évolue, qu'elle change, qu'elle ne se maintient pas dans les structures qui sont les siennes. Ce pourquoi certaines formes de structures psychiques, certaines formes de souffrance psychique, peuvent dérouter le personnel soignant lorsqu'ils y sont confrontés. Mais comment justifier ce changement propre à la pathologie mentale? qu'est-ce qui fait que la pathologie d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui?
Jean Furtos répond en liant la structure psychique du sujet au type de société dans laquelle il évolue. Si l'auto-exclusion apparaît ainsi comme la nouvelle forme de la pathologie mentale, c'est dans ce qui caractérise notre société contemporaine qu'il faut aller en chercher la cause. Jean Furtos nous amène ainsi à prendre conscience que la mondialisation du marché économique et le choix des politiques menées dans nos sociétés, certes démocratiques, mais essentiellement industrielles et libérales, donnent naissance à une nouvelle économie psychique dont le syndrome de l'auto-exclusion n'est que le révélateur. Jean Furtos s'inscrit ainsi dans la lignée freudienne pour qui le pathologique n'est pas à concevoir comme ce qui serait en marge du normal mais bien comme ce qui en manifeste bruyamment et ostensiblement les normes implicites.
Pour comprendre cette nouvelle économie psychique, et par là même cerner ce qui caractérise l'auto-exclusion comme nouvelle forme de pathologie mentale, Jean Furtos travaille à clarifier la distinction conceptuelle qui s'inscrit entre auto-exclusion et précarité.
Dans un premier temps, en effet, on pourrait croire qu'exclusion et précarité se répondent : c'est parce qu'un homme vivrait dans des conditions précaires – matériellement précaires, c'est-à-dire instables et incertaines – qu'il pourrait se voir exclu du système s'il ne parvient plus à s'y insérer financièrement. En ce sens, la précarité ne serait que le caractère d'une situation économique et existentielle propre à certains individus et visant à se voir dépassée. En soi, la précarité serait contingente et qualifierait la situation d'hommes exclus du système social.
Or, penser en ces termes, c'est commettre une erreur d'analyse. Celle-ci s'inscrit dans une mécompréhension de la portée ontologique du concept même de précarité. Reprenant le concept freudien de désaide et de détresse infantile, Jean Furtos nous rappelle que la précarité est ce qui caractérise l'espèce humaine. Elle est la définition même de notre nature humaine qui n'est que manque et incomplétude. Et elle se manifeste pleinement dans le nourrisson qui meurt si on ne s'occupe pas de lui.
Mais Jean Furtos nous fait aussi remarquer que cette précarité infantile est déterminante pour la constitution de l'humain. En effet, le terme de précarité provient du latin precari qui signifie « supplier pour avoir ». En ce sens, le nourrisson, par ses cris, demande ; et le fait qu'il demande et qu'il y ait des personnes tutélaires qui entendent sa demande va créer pour lui les premières relations sociales. Les relations surgissent en effet à partir de la précarité, à partir de la détresse à laquelle on répond, à laquelle on donne, ce qui produit de la confiance quand cela se passe suffisamment bien.
La précarité apparaît donc comme ce qui caractérise la nature humaine. Et c'est bien parce qu'il y a un entourage stable, suffisamment attentionné et présent pour répondre aux manques et aux faiblesses de l'enfant que celui-ci peut parvenir à dépasser ce stade de détresse infantile et se bâtir une personnalité fondée sur la confiance en soi, en autrui et dans l'avenir. Une structure sociale solide, fiable, assurant l'entraide individuelle, est donc la réponse que l'humanité a su apporter à sa propre détresse.
Mais, à cette précarité, que Jean Furtos nomme « ordinaire » ou encore « banale », se juxtapose une précarité plus intellectuelle que caractérise la philosophie cartésienne et qui ouvre l'ère de la modernité. En effet, pour pouvoir penser par soi-même, encore faut-il être capable de remettre en cause ce qui vient de la tradition et d'étendre sur tout le savoir passé la méthode d'un doute généralisé. La précarité s'étend dés lors à toute nos certitudes, et nous laisse dans l'attente d'une refondation ferme et assurée de notre savoir. Or, si penser par soi-même, c'est trouver en soi-même et par soi-même les fondements de la vérité, alors se comprend que la naissance du monde moderne soit aussi celle de l'individualisme et rende ainsi raison d'une atomisation libérale du corps social. Cependant, nous pouvons remarquer que la foi en la raison, qui caractérise le siècle des Lumières, permet de penser l'instauration d'une nouvelle forme de lien social qui vient s'inscrire sous le sceau de la rationalité. Celle-ci permet alors de penser ensemble, d'avoir des controverses, bref, d'avoir un lien social interactif.
Cependant, à ces deux formes de précarité - que sont celles de notre être et de notre pensée – nous devons aujourd'hui en adjoindre une troisième. Celle-ci se définit comme précarité sociale et installe la peur de la perte au cœur du sujet. On assiste alors à une fragilisation psychique du sujet le laissant seul et démuni. De là vont naître les nouvelles formes de pathologies psychiques.
Pour mieux les comprendre, il convient néanmoins d'approfondir les caractéristiques de cette nouvelle précarité.
Celle-ci ne concerne plus tant l'individu, que la structure sociale elle-même. Elle est la conséquence de la mondialisation du capitalisme financier, qui a mis le monde en mouvement. Le flux héraclitéen emporte aujourd'hui les flux de capitaux, de marchandises et celui des hommes eux-mêmes. On peut que constater que ses effets sont en total contradiction avec les Droits de l'homme, ou, au mieux, en sont indépendants. Or, quand la question de l'homme n'est plus prise en considération, cela ne peut rester sans incidence sur l'élaboration même de notre structure psychique.
Il faut ici rappeler que l'analyse de la précarité ontologique nous a conduit à reconnaître la nécessité d'un environnement fiable et attentif pour répondre à la détresse humaine. C'est en ce sens que la société, comme structure stable de référence, apparaît comme le pôle complémentaire indispensable à l'équilibre psychique de l'homme. Or, c'est justement ce pôle social stable, sur lequel l'homme pouvait se reposer et par lequel il se voyait assuré qu'une aide lui serait apportée en cas de besoin, qui se voit aujourd'hui fortement ébranlé.
Cet ébranlement nous est tout d'abord rendu sensible par une modification en profondeur de notre rapport à la temporalité. C'est ce que Jean Furtos nomme « l'urgentification du monde ». C'est un affaissement du temps qui donne le sentiment d'une accélération du temps, hors du temps long. Toute chose se fait dans l'urgence. Quelque soit le métier, et même sans métier, nous sommes toujours dans l'urgence. Dans cette grande précarité, il faut se débrouiller, se dépêcher de fournir des papiers, de suivre des procédures, etc.. Il faut toujours résoudre les problèmes dans l'immédiat. Cette urgentification du monde nous coupe donc de la continuité temporelle, elle rompt le cours du temps pour inscrire celui-ci dans une logique de l'immédiateté. Se comprend dés lors que les filiations se perdent et que les transmissions culturelles s'émoussent. Cependant, en perdant le sens de la filiation, l'homme perd aussi l'inscription de sa place dans la lignée familiale, dans la communauté régionale, dans la communauté politique à laquelle il appartient. Cette disparition du sentiment d'appartenance entraîne à sa suite les référents par lesquels - ou contre lesquels – les individus se construisent. L'urgentification du monde radicalise donc l'atomisme social, il fait des individus des êtres séparés, scindés les uns des autres, que ce soit dans la dimension verticale de l'héritage de traditions ou que ce soit dans la dimension horizontale du vivre ensemble.
Cette destruction du lien social ne tient pas seulement à une accélération de la temporalité. Elle est la conséquence aussi des politiques actuellement menées qui produisent sur le terrain un véritable clivage entre le fait et le droit, générant ainsi des rapports de violence larvée entre les différents membres de la société. Pour illustrer ce point, qui me paraît central pour justifier le délitement social auquel nous assistons, je cite Jean Furtos qui analyse les effets réels engendrés par la loi Dalo, votée le 5 mars 2007 et qui institue le droit au logement opposable, qui fixe à l’État une obligation de résultats et non plus seulement de moyens.
« Dans la loi Dalo, avoir un hébergement puis un logement est un droit opposable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux d'hébergement ni de logements. On ne peut que proposer aux demandeurs : « Revenez dans six semaines, revenez dans six mois. » Il en est de même quand on dit aux gens : « il faut que vous trouviez du travail ». Il n'y a pas de travail ! Ou « Nous allons vous trouver un logement ». Il n'y a pas de logement ! Il se passe pour la loi Dalo ce qui se passe pour les demandeurs d'asile : des hommes et des femmes sont dans l'attente, dans des situations intenables, aux prises avec des procédures administratives qui, pour beaucoup, ne mènent nulle part. Cela rend les gens furieux ou bien les plonge dans l'apathie. »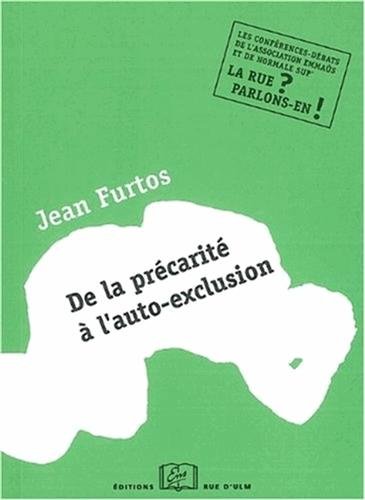
Une telle déstructuration du pacte social ne peut rester sans incidence sur la structuration du psychisme humain. Comme le notait Jean Furtos au début de sa conférence, tant que l'homme reste dans la révolte et dans la revendication collective de justice sociale, l'équilibre psychique se maintient. Il n'en va pas de même lorsque les gens plongent dans l'apathie ou dans des formes extrêmes de découragement. On assiste alors à un désinvestissement progressif du lien social, entraînant le sujet à un repli sur soi. Ce qui caractérise une telle fermeture du sujet est son incapacité progressive à demander de l'aide, qui différencie d'ailleurs la précarité pathologique de la précarité normale. En effet, dans la précarité normale, quand le sujet est en difficulté, il demande de l'aide. Cette demande devient impossible dans le cas de la précarité pathologique.
Cette distinction permet de définir la notion de pathologie. Est pathologique, tout syndrome qui empêche de vivre, c'est-à-dire qui empêche d'aimer, de penser, de parler, d'agir et de se situer dans la suite des générations et dans une entité plus vaste que soi-même.
Or, des situations d'impuissance et de conflits potentiels peuvent développées, au sein d'un personnel administratif, les conditions propres à l'apparition de symptômes révélateurs d'une précarité de type pathologique, ce que constate Jean Furtos analysant les effets psychiques de la loi Dalo :
« Un soir, chez elle, cette assistante sociale s'est mise à pleurer, à être mutique. Ses enfants lui ont demandé ce qu'elle avait. Elle a fini par leur parler des difficultés qu'elle rencontrait à son travail. Elle a décidée de continuer à travailler. Mais va-t-elle s'en sortir ? Elle est en première ligne.
La loi Dalo est une loi qui a des intentions louables, mais les moyens qui permettraient de l'appliquer sont inexistants. Du coup les gens se mettent en colère. Dans le contexte du droit au logement opposable, cette assistante sociale était devenue un pion du grand échiquier étatique et un gars voulait lui casser la figure car elle représentait un système qui ne tenait pas ses promesses. »
L'inconséquence politique en vient donc à fragiliser la cohésion sociale, et par là même, à fragiliser psychiquement chacun de ses membres. La déstructuration du rapport de confiance que l'individu entretenait au corps social se manifeste psychiquement par une perte de confiance généralisée, caractérisant la précarité psychique contemporaine.
Cette perte de confiance se répartit en trois grands domaines :
tout d'abord, le sujet perd confiance en lui-même et à le sentiment qu'il ne vaut plus rien, qu'il est un déchet, avec ou sans métier. La déstructuration du lien social entraîne donc les mêmes problèmes pour ceux qui ont un travail que pour ceux qui sont chômeurs de longue durée. On appelle cela les pathologies du narcissisme, ou la mélancolisation.
Ensuite, la violence générée par des structures sociales en impasse produit une perte de la confiance en autrui, caractérisée par les politiques sécuritaires que nous rencontrons : celui qui est dangereux, c'est l'autre, l'étranger, le malade mental, le jeune des banlieues. Il y a une focalisation sur l'individu dangereux. C'est le retour du vécu paranoïaque du XIXème siècle avec sa notion de « classe dangereuse », mais avec l’atomisation de l'individu en prime.
Et enfin, nous assistons aussi à une perte de confiance en l'avenir, qui se manifeste essentiellement dans ce qu'on appelle le « syndrome du survivant ». Quand il y a des licenciements dans une usine ou une entreprise du tertiaire, on pourrait croire que ceux qui restent sont rassurés. Or, tous ne le sont pas. Certains pensent : à quand mon tour ? Cette forme de précarité consiste en une perte de confiance dans l'avenir. On n'y croit plus. La perte de confiance dans l'avenir est donc une perte de la foi, qui n'est pas simplement à entendre comme foi en Dieu, mais aussi comme foi en l'humanité, foi en soi-même, foi dans les relations humaines. Avoir foi, c'est aller vers l'avenir sans peur.
On voit donc bien que la déstructuration du tissu social engendre une fragilisation du sujet qui peut se manifester par des troubles mineurs et pluriels, mais qui peut engendrée chez certains sujets des troubles du comportement et du psychisme majeurs caractéristiques d'une nouvelle forme de pathologie mentale. C'est ce que Jean Furtos nomme « le syndrome d'auto-exclusion ». Celui-ci se caractérise par une disparition du sujet, un évanouissement du sujet. Ou, pour le dire encore autrement, le sujet devient évanescent à lui-même.
Comment justifier cela ?
Si on a vu la manière concrète par laquelle les politiques actuellement menées déstructuraient le lien social, et s'il nous suffit de constater le délitement social qu'entraîne la logique de déréglementation de la mondialisation des échanges, il nous faut encore comprendre comment les individus, les sujets, trouvent à y répondre. La difficulté qui est la nôtre réside dans le fait que le morcellement du corps social dresse les individus les uns contre les autres et ne permet plus – ou difficilement – la lutte commune pour l'instauration politique d'un monde commun. Les sujets – isolés les uns des autres – n'ont trouvé aujourd'hui d'autres solutions que celles du repli sur soi. C'est l'auto-exclusion qui se justifie psychiquement par une auto-anesthésie.
On touche là le cœur de la démonstration de Jean Furtos. La nouvelle pathologie mentale est une pathologie non plus de l'excès – comme dans la manie – non plus du manque – comme dans la mélancolie – mais de l'anesthésie, ce que révèle l'auto-exclusion. L'auto-exclusion repose ainsi, et avant tout, sur une volonté de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus souffrir. Ou, pour le dire plus exactement, c'est en vue de ne plus souffrir que le sujet en vient à ne plus vouloir sentir, à ne plus vouloir voir, à ne plus vouloir s'investir. Ce pourquoi cette nouvelle pathologie mentale s'est d'abord manifestée parmi les gens vivant dans la rue, parmi les exclus de la société. Mais l'exclusion n'est pas d'abord une réalité matérielle. Elle s'enracine dans un sentiment qui provient de la non reconnaissance sociale de la détresse du sujet. Elle produit alors le sentiment de ne plus appartenir au groupe des humains. L'une des manières de réagir à ce sentiment d'exclusion est de pratiquer « l'auto-exclusion », qui consiste à se dire : je quitte ce monde, je ne veux plus appartenir à ce monde, je ne lui fais plus confiance. On ferme la porte, on rentre en soi-même et on s'auto-aliène à l'intérieur de soi.
L'auto-exclusion se caractérise donc par une auto-anesthésie qui se décline sur trois modes :
on assiste tout d'abord à une anesthésie du corps : les gens ne sentent plus ni leur corps ni leurs organes. Par exemple, il y a des personnes en grande exclusion qui ne sentent pas les troubles de la peau, ou les débuts de gangrène.
On constate ensuite que le sujet a une capacité à émousser ses émotions, à s'endurcir au point de ne plus ressentir ni haine ni joie. C'est ce que Jean Furtos nomme « la congélation du Moi »
qui s'accompagne, dans un troisième temps, d'une inhibition partielle de la pensée.
Ces signes qui caractérisent l'auto-exclusion en ont longtemps rendu le diagnostique difficile. En effet, ils ressemblent, sans en être, à ceux de la dépression, de la schizophrénie déficitaire, ou parfois encore à ceux de la démence, dont les structures psychique de clivage mettent en cause l'unité même du sujet.
Or, dans le syndrome de l'auto-exclusion, le sujet est toujours présent, non clivé, même s'il est anesthésié. C'est un mécanisme existentiel de défense qui peut aller jusqu'au désespoir absolu, désespoir dont, à partir d'un certain moment, le sujet ne peut même plus parler.
Se comprend dés lors l'importance de mettre en place un juste diagnostique différentiel qui ne confonde pas l'auto-exclu et le schizophrène. Pour cela, il nous faut saisir, voir, comprendre, les signes par lesquels se manifeste le syndrome de l'auto-exclusion. Ils sont au nombre de trois :
Le premier signe de ce syndrome se présente d'abord à l'observation comme paradoxal. Voyons en quoi.
En tant qu'il met en place des procédés visant à anesthésier le sujet, le syndrome de l'auto-exclusion apparaît ainsi comme la manière qu'a trouvé le sujet de répondre au caractère excluant du social. Il y a là une logique paradoxale qui détermine le caractère paradoxal du comportement du sujet. Ceci se manifeste tout d'abord par une incapacité qu'à le sujet à demander de l'aide, alors même qu'il en a le plus besoin.
Une telle incapacité peut, dans un premier temps, être interprétée comme une volonté de rester digne, même dans l'adversité. Cependant, dans le syndrome de l'auto-exclusion, cette incapacité à demander de l'aide est liée au fait que plus vous allez aider des auto-exclus, moins bien ils vont aller. Cette réaction paradoxale s'appelle « la réaction thérapeutique négative ». Il y a là un dysfonctionnement du lien relationnel qui interpelle les aidants et qui est difficile à admettre, pouvant du reste engendrer une réaction de rejet.
Le second signe paradoxal par lequel se reconnaît le syndrome de l'auto-exclusion est celui de la rupture active des liens. L'errance devient une manière d'aimer à distance, une manière d'aimer en fuyant celui ou celle avec qui on est en lien. De la même manière, le sujet perd toute capacité à honorer sa parole, ses promesses, ses engagements. Il perd ainsi ce que Jean Furtos nomme « la bonne honte », qui repose sur des valeurs partagées qui nous empêche de faire n'importe quoi.
Le troisième signe par lequel se reconnaît le syndrome de l'auto-exclusion est lié à une décadence corporelle. C'est ce que Jean Furtos nomme « l'incurie à domicile ». Les gens se négligent, ils accumulent les choses sans arriver à distinguer ce qu'il faut jeter de ce qu'il faut garder. Leur appartement devient une poubelle. Certains parlent alors du « syndrome de Diogène ».
Maintenant que nous avons mis en place les causes sociales du syndrome de l'auto-exclusion, que nous avons mis au jour son élaboration psychique comme mécanisme de défense, ainsi que les comportements existentiels qu'ils génèrent, comment peut-on y répondre ? Comment le traiter et comment aborder les patients qui en sont atteints ?
C'est par ces questions portant essentiellement sur la thérapeutique que Jean Furtos termine sa conférence. La réponse peut paraître à première vue déconcertante venant d'un membre du corps médical. Alors même qu'on s'attendrait à une réponse de type pharmacologique, Jean Furtos nous propose une réponse éthique : c'est par le respect que se soigne le syndrome de l'auto-exclusion. Je cite Jean Furtos : « l'antidote de l'exclusion, c'est le respect ».
Après réflexion, le remède peut se comprendre. En effet, c'est parce que la structure sociale s'est déshumanisée – ou, pour le dire encore autrement, c'est parce que la structure sociale s'élabore sans prendre en compte l'homme comme principe et fondement de sa constitution – qu'a pu apparaître le syndrome de l'auto-exclusion. Lutter contre l'auto-exclusion réclame dés lors que soit fait place à un retour à des relations véritablement humaines. Cependant, si la logique théorique semble aller de soi , il n'en va de même dans les faits. Je laisse encore une fois la parole à Jean Furtos :
« Le respect. Voilà un mot sur lequel il y a un consensus ! Mais le respect ne va pas de soi, il a besoin d'être redécouvert. On a beaucoup de mal à respecter le fait que les gens en auto-exclusion se font du mal au lieu de se faire plaisir. C'est intolérable. C'est une ascèse que d'accepter que quelqu'un puisse se faire du mal, parce qu'à un moment de sa vie il en a besoin ; d'accepter de le côtoyer et d'en souffrir soi aussi, tout en limitant les risques de destructivité autant que possible.
Je vous ai parlé de la congélation du Moi, mais je n'ai pas parlé du malaise de celui qui aide. En effet, nous sommes en présence de personnes qui ne peuvent plus souffrir leur souffrance au sens propre, qui s'anesthésient pour ne plus souffrir.
Où passe la souffrance ? Elle passe en autrui. Le premier signe de la clinique psychosociale, c'est que la souffrance des gens fait souffrir ceux qui sont en relation avec eux. »
Il n'est donc pas facile de respecter les gens quoi qu'ils fassent, quelle que soit la manière dont ils se présentent. Pour accompagner des gens qui sont dans l'auto-exclusion, il faut accepter des comportements qui de notre point de vue, sont destructeurs, des comportements paradoxaux, et continuer à tenir la relation.
Pour finir son exposé, Jean Furtos nous revient à la racine du mal : la cause de la nouvelle pathologie mentale réside dans une structure sociale instituée par les flux générés par la mondialisation tant économique, financière que culturelle. Celle-ci sape les liens par lesquels les hommes construisaient un monde commun, stable, et sur lequel ils savaient pouvoir compter en cas de besoin. C'est cette atomisation du sujet qui laisse celui-ci démuni et fragile face à la brutalité du système social mis en place.
Pour répondre à cette précarisation sociale du sujet, la culture ne nous offre pour l'instant que les textes des Droits de l'homme. Mais ceux-ci, que ce soit le texte de 1789 ou celui de 1948, s'ils disent bien ce qu'il ne faut pas faire à l'homme, ont cependant cette infirmité de ne pas faire une politique. La question qui s'ouvre maintenant à nous est celle de savoir comment on peut procurer au monde une nouvelle organisation sociale qui soit compatible avec les Lumières et le fait que les droits de l'homme ne sont pas une politique. Comme nous le rappelle Jean Furtos pour conclure son exposé, « nous en sommes [actuellement] là. »
Laurence Lacroix