Stéphanie Ruphy, Pluralismes scientifiques. Enjeux épistémiques et métaphysiques, Hermann, 2013. Lu par François Chomarat
Par Karim Oukaci le 05 février 2014, 06:00 - Épistémologie - Lien permanent
 Stéphanie Ruphy, Pluralismes scientifiques, Enjeux épistémiques et métaphysiques, Hermann, 2013.
Stéphanie Ruphy, Pluralismes scientifiques, Enjeux épistémiques et métaphysiques, Hermann, 2013.
L'épistémologie du XXe siècle s'est longtemps placée sous la bannière de l'unité de la science, que ce soit avec le projet de l'empirisme logique d'une Encyclopédie Internationale de la Science Unifiée, ou en prenant pour modèle de démarche scientifique la quête de l'unification des interactions fondamentales par les physiciens. Un « tournant pragmatiste » s'est engagé depuis un peu plus d'une dizaine d'années, allant de pair avec l'affirmation de thèses pluralistes et le rejet du réductionnisme physicaliste.
Indiquons ici quelques dates comme points de repère : en 1958, dans un article important, Paul Oppenheim et Hilary Putnam défendaient encore l'unité des sciences comme hypothèse de travail (« Unity of Sciences as a working hypothesis ») ; mais, dès 1974, Jerry Fodor reposa la question de l'autonomie des « sciences spéciales » (article traduit sous le titre : « Les sciences particulières ; l'absence d'unité de la science : une hypothèse de travail » au sein du recueil édité par Pierre Jacob : De Vienne à Cambridge, Gallimard, 1980). Patrick Suppes soulignait, quant à lui, en 1978 (« The Plurality of Science »), la divergence croissante des terminologies entre sous-disciplines, chacune développant son propre « jargon ». Fallait-il prendre cette pluralité persistante au sérieux ?
Les principaux protagonistes contemporains de ce débat dans le camp des « pluralistes » ont pour leur part voulu en tirer des conséquences ontologiques. Citons ici particulièrement Nancy Cartwright, avocate d'un « Monde Tacheté » (The Dappled World, 1999), John Dupré qui défend un « pluralisme ontologique radical » (The Disorder of Things, 1993), ou encore Helen Longino (The Fate of Knowledge, 2002) et Sandra Mitchell (Unsimple Truth, 2009). L'importance de ce débat tient au fait qu'il ne se limite pas à une série d'affrontements théoriques, puisqu'il y va d'une justification philosophique de l'organisation de la recherche : l'hégémonie, épistémologique comme financière, de certaines disciplines est donc en jeu.
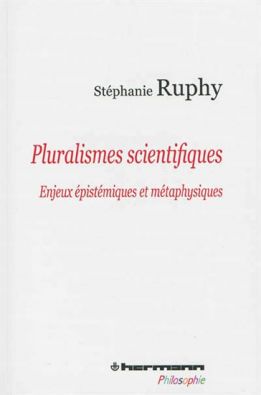
C'est à un examen clair et précis des termes de ce débat que nous convie Stéphanie Ruphy, dans cet ouvrage publié par Hermann en mai 2013. Professeure à l'Université Pierre Mendès-France à Grenoble, elle possède une double formation, à la fois en astrophysique (doctorat obtenu en 1996 sous la dir. de Nicolas Epchtein, « Contribution à l'étude de la distribution spatiale des étoiles du disque galactique à l'aide des données DENIS », U. Paris VI) et en philosophie (PhD en 2004, sous la supervision de Philip Kitcher, « Philosophical implications of the unity/disunity of science debate », Columbia U.)
Elle a traduit en 2010 aux Presses Universitaires de France, l'ouvrage de Philip Kitcher : Science, vérité et démocratie (Science, Truth and Democracy, Oxford U.P, 2001). Une anthologie de textes sur l'épistémologie féministe des sciences, sous sa direction, est en préparation chez Vrin.
Son approche propose une discussion critique serrée des différentes positions des acteurs tout en avançant des thèses personnelles. Elle tire parti de ses travaux en astrophysique : le pluralisme scientifique est ainsi étudié et évalué dans toutes ses dimensions, et particulièrement dans le cadre des « sciences d'observation » souvent négligées par les philosophes, plus enclins à faire porter leur attention épistémologique sur les théories physiques fondamentales.
C'est ainsi que trois grandes directions sont successivement abordées, dans les trois grandes parties de l'ouvrage :
- la question de la pluralité des objets et, par voie de conséquence, des langages et méthodes scientifiques, autrement dit : existe-t-il différentes sortes de choses, qui ne soient connaissables que de différentes manières ? (ch. 1 : « Langages, méthodes et objets », p. 17-75)
- l'examen de la pluralité des structures théoriques, soit la question de savoir si la non-réductibilité des théories scientifiques entre elles permet de soutenir l'argument d'un monde irréductible à une structure unique d'intelligibilité, voire d'un monde intrinsèquement pluriel (ch. 2 : « Structures, relations et ordre métaphysique », p. 77-155)
- enfin celui de la pluralité des stratégies représentationnelles et explicatives, la question de la convergence ou non des modèles mobilisés par les scientifiques, à savoir : quel type de réalisme peut-on encore soutenir, si l'on accepte cette pluralité comme indépassable (ch 3 : « Représentations, explications et taxinomies », p. 157-249)
Nous aborderons chacune de ces trois parties, en essayant de mettre en avant les moments saillants où apparaissent les thèses propres de S. Ruphy.
Première Partie
Le constat d'une diversité dans les sciences apparaît au premier abord comme une évidence. Diversité des objets étudiés, des modes ou procédés d'étude, des terminologies, constituent autant de traits observables de leur diversité synchronique, à laquelle il faut ajouter tout ce qui relève de leur diversité diachronique et de leur constitution historique. Cependant, la question de droit reste à poser : existe-t-il différentes sortes de choses, qui ne soient connaissables que de différentes manières ? (p. 20) L'auteure présente son propre « pluralisme feuilleté » après avoir examiné les deux premières possibilités d'une unification du langage scientifique, puis de la méthode scientifique.
Pluralisme et unification linguistique
Les thèses de Carnap (et dans une moindre mesure d'Otto Neurath) sont examinées en premier lieu. Pluralisme et unification n'apparaissent pas antithétiques ici, puisqu'il s'agit – à l'inverse de la position des « pluralistes » contemporains – de ne pas fonder l'unification du langage scientifique sur une unification plus forte, ontologique ou métaphysique. Bien au contraire, on sait que le pluralisme de Carnap est à entendre au sens de la neutralité d'un « principe de tolérance » envers différents positions métaphysiques entre lesquelles il n'y a pas lieu de choisir : réalisme, idéalisme ou phénoménalisme. S. Ruphy met ainsi l'accent sur le fait que l'unification linguistique des sciences, liée à la traductibilité des langages scientifiques divers dans un seul langage de base, n'implique pas nécessairement d'autres types d'unification : par exemple, l'unité linguistique n'implique pas l'unité des lois scientifiques (p. 27).
Si l'on peut donc souscrire à la portée politique et sociale de ce projet des empiristes logiques, dans la mesure où il porte un idéal d'intégration non-hiérarchique des sciences par connexion des domaines, coopération et accord sur un langage commun (« les termes métaphysiques divisent, les termes scientifiques unissent », p. 31), il n'est peut-être pas possible d'aller plus loin. Force est de constater que, chez Carnap lui-même, un pluralisme irréductible subsiste : dans sa perspective, ce n'est qu'après avoir adopté préalablement un cadre linguistique, que des questions ontologiques peuvent être posées - ce qui va de pair avec l'acceptation d'une pluralité de cadres possibles (ces cadres étant exclusifs et synchroniques, cf. p. 41-43). Accepter ou non une forme de langage relève d'un libre choix dont les enjeux sont avant tout pragmatiques.
La position pluraliste de Carnap (dont on pourrait toutefois souligner qu'elle ne s'accentue que progressivement jusque vers les années 1950) pourrait donc s'énoncer ainsi : si toute ontologie est interne, relative au choix de ce que Carnap nommait a linguistic framework ou appareillage linguistique, le pluralisme est compatible avec une unification du domaine d'objets. En effet, à l'intérieur du cadre choisi, le langage utilisé se réfère nécessairement à un seul et même type d'objet (p. 44). Mais comme cela n'implique pas de thèse plus forte au sujet du monde lui-même, il ne s'agit donc pas pour Stéphanie Ruphy d'un « pluralisme philosophique substantiel ».
Aujourd'hui, cependant, il ne semble pas que cette unification linguistique soit encore de mise ; et il faut prendre son parti de la multiplicité des terminologies scientifiques en vigueur (p. 44).
Limites de l'unification méthodologique
Encore d'actualité par contre, cette autre unification vise à défendre la validité d'une seule et unique logique de la justification à l'œuvre dans les sciences et servant de critère de démarcation entre science et non-science. On connaît les débats entre l'inductivisme et le falsificationnisme (p. 45) ou encore les discussions autour de l'approche bayésienne très en vue aujourd'hui (p. 46). Mais le débat n'a pas été tranché jusqu'à maintenant.
On peut alors admettre que l'unification méthodologique aurait plutôt pour but d'établir un canon guidant l'élaboration des résultats et non leur justification : des analyses de Thomas Nickles (p. 48-49) ont pu montrer qu'avec la spécialisation accrue des disciplines, les méthodes sont devenues plus locales, donc dépendantes de la spécificité de leur objet.
Ce qui amène S. Ruphy à privilégier l'approche de Ian Hacking par les « styles de raisonnement scientifique » (p. 50). Prolongeant les travaux de l'historien des sciences A. C. Crombie, Hacking a insisté sur la différence entre des conditions préalables relevant de nos capacités cognitives (qui sont des produits de l'évolution par sélection naturelle) et l'apport proprement dit des différents styles scientifiques, produits d'une histoire culturelle de longue durée et consolidés par des « techniques de stabilisation » caractéristiques, chaque style définissant ses propres critères de validité et introduisant ses propres objets. Il y a bien, en ce sens, unité de la logique générale sur laquelle faire fond, mais pluralité historique des styles effectivement à l'œuvre dans les sciences constituées (p. 51-54), chaque style introduisant de nouveaux types de vérité (p. 59). Dans cette optique, découverte et justification ont partie liée.
Cette approche a le mérite d'éviter les deux écueils inverses du relativisme et de l'éternalisme : chaque style définit le type de proposition qui peut avoir une valeur de vérité ; mais il ne définit pas quelle est cette valeur, car c'est le monde qui le fait. On pourrait dire à la manière de Deleuze qu'il ne s'agit pas d'affirmer la relativité du vrai, mais la vérité du relatif (voir sur cette question importante les pages 54 à 57).
En ce sens, les gènes, les nombres complexes ou encore une population caractérisée par sa médiane et sa dispersion ne sont pas des entités déjà là dans le monde avant l'apparition du style spécifique qui les introduit.
Par rapport à la position de Carnap, on peut dire qu'avec cette conception, chaque nouveau style introduit un débat ontologique possible sur le statut des entités introduites (l'ontologie n'est donc pas qu'une question de postulation linguistique). Par exemple, le style axiomatique ouvre au platonisme, le style taxinomique au nominalisme, le « style de laboratoire » au réalisme scientifique, un peu comme s'il existait une sorte de trouée de l'intérieur des styles pour en éprouver les limites, ou un mouvement transverse toujours possible, mais sans la possibilité de s'appuyer sur un regard extrinsèque de surplomb, un style de tous les styles. La position pluraliste s'énonce alors ainsi : « Il n'y a pas de tribunal ontologique absolu » (p. 63).
Pluralisme feuilleté et enrichissement ontologique
S. Ruphy développe pour son propre compte largement cette position en une belle page sur l' « enrichissement ontologique » procurée par les sciences, expression par laquelle elle se propose de penser la relation entre les « objets introduits par les styles scientifiques » et les « objets déjà là » auxquels la science s'intéresse également (comme les étoiles ou les feux de forêt).
Elle définit ici ce qu'elle baptise un « pluralisme ontologico-méthodologique feuilleté » (p. 64 et sq.). Soit l'exemple des feux de forêt : on peut affirmer que l'objet scientifique « feu de forêt » est ontologiquement plus riche que le feu de forêt de l'expérience commune, car la mobilisation de différents styles de raisonnement à son sujet « a élargi et diversifié la classe des propositions susceptibles d'être vraies ou fausses à son sujet » (p. 65). Il s'agit d'un processus d'enrichissement ouvert et révisable(enrichissement des entités prises en compte et pas seulement des aspects d'un seul et même objet déjà donné) - ce qui implique qu'il n'y a pas d'ontologie univoque ou fermée du monde, ou encore – suivant cette suggestive formulation : « l'intensification de la réalité scientifique d'un objet n'est jamais achevée et définitive » (p. 65).
Ce pluralisme feuilleté se caractérise alors par quatre traits : la transdisciplinarité, la synchronicité, la non-exclusivité, le caractère cumulatif. L'important ici est la constitution d'une nouvelle figure de la pluralité des sciences, non plus comparable à un patchwork, mais à ce que l'on pourrait appeler un composite, mettant l'accent sur l'usage simultané ou superposé de différents styles de raisonnement pour obtenir, de façon transdisciplinaire, des connaissances nouvelles (p. 66-70). L'auteure considère d'ailleurs que cette conception est plus en phase avec les pratiques scientifiques contemporaines.
D'où aussi cette réponse à la question posée au départ : y a-t-il plusieurs types de choses, connaissables de plusieurs manières ? La réponse est positive, en ce qui concerne les entités introduites par les styles, négative pour ce qui concerne les objets déjà là. D'où également une nouvelle démarcation entre science et non-science, fondée sur la prise en compte de l'autojustification et de la stabilisation de chaque style sur la durée (p. 70-75)
Deuxième Partie
Cette partie s'attaque au problème du réductionnisme : quelles relations établir entre les théories élaborées dans les diverses branches des sciences ? Et, par voie de conséquence, quels liens poser entre les phénomènes traités par les théories en question ?
Au-delà des considérations sur les relations inter-théoriques locales (par exemple entre la biochimie et la biologie moléculaire), l'auteure se demande ce que les arguments antiréductionnistes globaux arrivent à démontrer : s'il existe de fait différentes sortes d'investigation du monde, doit-on en conclure que le monde est ainsi fait qu'il ne peut en être autrement ?
Echec de fait ou de droit du réductionnisme ?
Les antiréductionnistes combattent la réduction comme stratégie explicative, soit parce qu'elle ne fournit pas d'explication, soit parce qu'elle n'est pas même possible. S. Ruphy va examiner ces deux lignes d'attaque :
Pour ce qui concerne l'autonomie des niveaux d'explication (p. 83-93), son argumentation consiste à renvoyer dos à dos deux présupposés inverses : s'il est légitime de s'opposer à la prédominance des explications du niveau supérieur par le niveau inférieur, en tant que simple présupposé métaphysique, il faut alors rejeter cet autre présupposé selon lequel il y aurait, dans la structure causale du monde, des raisons pour lesquelles il faudrait faire appel nécessairement à la macroexplication, procurant ce que la microexplication ne peut pas donner. Le point faible consiste à produire un argument anti-réductionniste général, qui n'est plus temporellement qualifié, et court le risque de fermer définitivement la porte à toute réduction possible ultérieurement dans quelque domaine que ce soit.
Pour ce qui concerne la faisabilité d'une réduction, on retrouve la problématique de la multiréalisabilité (p. 95-99) ; et la réponse suit à peu près le même cheminement : « la validité d'une affirmation d'irréductibilité dépend du contexte épistémique » (p. 100).
En somme, les avocats du pluralisme n'en restent malheureusement pas à des questions méthodologiques, car ils veulent produire une véritable justification de l'absence d'unité. Les thèses de John Dupré notamment, qui prône un « pluralisme non-discriminant » (promiscuous realism), sont discutées dans cet ordre d'idées, pour montrer à quelles limites elles se heurtent. Voulant fonder la validité de découpages multiples du monde, cet auteur rejette l'existence d'espèces naturelles entendues comme des essences en science ; mais il ne rejette pas l'existence d'espèces réelles dépendant de nos théories ou objectifs - sauf qu'une entité individuelle peut être membre de plusieurs d'entre elles sans que l'on puisse tenir l'une comme plus fondamentale que les autres : en biologie, les relations permettant de classer des individus ensemble sont bien là, mais supportent différentes classifications possibles dont aucune n'est plus fondamentale que les autres. Dupré rejette plus généralement, comme une croyance non fondée, la thèse de la complétude d'un niveau unique, comme par exemple la complétude causale au niveau microphysique. Pour lui : « La question de savoir combien d'ordres il peut s'avérer exister dans le monde est entièrement ouverte » (texte cité p. 116). Cependant, selon S. Ruphy, le réductionnisme ne requiert pas l'existence d'espèces naturelles ; et la prémisse de Dupré est faible (p. 104, p. 117-119).
Plus généralement, la question que veut poser S. Ruphy est bien la suivante : l'échec du réductionnisme implique-t-il un désordre ontologique ? (p. 119). Elle admet pour sa part un certain agnosticisme qui ne va pas jusqu'à pouvoir se transformer en affirmation positive.
Cependant, c'est à ce niveau que la discussion engagée nous paraît la plus intéressante. Il est dommage qu'elle ne soit pas plus développée (voir pages 119-120), car il reste une importante question à traiter selon nous : si l'on voit bien à quels types de résultats peut conduire la démarche réductionniste, on aperçoit mal ce qu'il en est de la fertilité effective ou seulement possible d'une démarche anti-réductionniste dans les sciences. Mais cela débouche selon nous sur cette autre interrogation : ces deux présupposés sont-ils réellement inverses l'un de l'autre, ou ne se placeraient-ils pas plutôt sur deux plans distincts, l'un visant des résultats fournissant une explication nouvelle, l'autre visant une intelligibilité accrue ? Plutôt qu'au sujet de l'ontologie, le pluralisme en jeu ici ne serait-il pas au sujet des finalités de la science, admettant qu'il en existe plusieurs qui sont irréductibles sans être antithétiques : prédire, expliquer, comprendre ?
Relativité du désordre
S. Ruphy passe directement à ce qu'elle considère comme l'argument le plus décisif contre les positions ontologiques au sujet de l'ordre ou du désordre du monde. Il s'agit d'examiner les thèses de Nancy Cartwright sur le désordre nomologique (p. 120 et sq.).
Dans son attaque contre l'universalité des lois scientifiques, N. Cartwright rejette ce qu'elle nomme le réductionnisme horizontal. Si elle admet par exemple la vérité des lois de Newton dans le cas de « systèmes réglés » qui se prêtent en quelque sorte sans reste à leur application, elle remet en cause leur applicabilité universelle. Le monde serait fait de poches d'ordre sans être globalement ordonné. Mais peut-on décider en toute généralité si un système est réglé ou non, si c'est une bonne « machine nomologique » selon la terminologie de N. Cartwright ? S. Ruphy argumente que cela dépend des questions que l'on pose au système. Soit un billet de banque soulevé par le vent (p. 126-128), apparent contre-exemple confronté au système solaire, modèle apparent de système bien réglé. Si la question qu'on lui pose est celle de l'altitude finale du billet, et non du détail de sa trajectoire, c'est le billet qui constitue une machine nomologique. Tandis que, la prise en compte de la trajectoire à long terme des petits corps du système solaire (les astéroïdes) mettant en échec les lois de Newton, le système solaire n'est plus considéré comme une machine nomologique. Nous ne pouvons donc définir la conformité ou non des situations du monde réel à nos théories, indépendamment de nos attentes et de nos motivations (p. 129)
Ce qu'elle formule de manière assez forte : « Le domaine de ce dont une théorie physique peut rendre compte ne peut être conçu en un sens ontologique » (p. 130).
Pour poser l'existence d'un monde tacheté, encore faudrait-il pouvoir affirmer qu'il y a des morceaux de monde ordonnés. Or, on doit se contenter d'admettre qu'un système nous apparaît réellement ordonné, quand la mécanique dont nous disposons est performante pour répondre aux questions que nous jugeons intéressantes de lui poser (ce pourquoi le mouvement du billet de banque nous apparaît, à la lumière de nos questions et des lois de Newton, comme désordonné. Cf. p. 131).
Une compatibilité ontologique ouverte ?
Finalement, si l'on veut construire une ontologie dépendante de la science, il faut accepter qu'elle se place sous la dépendance de l'histoire de la science et des questions qu'elle pose. Ce qui introduit une « double relativité » (p. 140). L'auteure irait assez dans le sens de Teller (« How we dapple the world », Philosophy of Science, 71, 2004) qui conçoit une ontologie pluraliste comme une collection de descriptions idéalisées complémentaires plutôt que conflictuelles (voir aussi certains textes de Michel Bitbol).
Mais n'existerait-il pas un autre type d'unité, liée à la notion d'harmonie, plutôt qu'à celle d'identité ?
Il existe en effet une longue tradition de réflexion sur l'analogie en physique (voir particulièrement les considérations de Maxwell). Un exemple récent rappelé ici est le concept de transition de phase pour traiter de la supraconduction, de la magnétisation spontanée ou de la création de défauts topologiques dans l'univers, objets d'étude relevant de domaines fort distincts a priori. On connaît également les arguments de Pierre Duhem : par le biais des équations, une similitude algébrique se découvre, alors que les phénomènes traités sont dissemblables. Tout cela va dans le sens d'une économie intellectuelle, qui fait grand usage de l'analogie.
Cette ressemblance formelle ne va, cependant, pas jusqu'à une véritable intégration, car l'analogisme suppose une différence de nature et ne renforce donc aucune unité ontologique (cf. p. 151-152).
On doit cependant aussi avoir à l'esprit le succès d'unifications inter-théoriques synthétiques (p. 152), comme la construction de la théorie électrofaible de Glashow, Salam et Weinberg, qui ont pu intégrer les descriptions théoriques des interactions électrofaibles et électro-magnétiques, ou bien la réussite de Maxwell lui-même pour l'intégration des deux champs, électrique et magnétique. Cependant, dans le premier cas, les particules porteuses des interactions restent distinctes ; et, pour le cas de l'électromagnétisme, si les phénomènes optiques sont bien des cas particuliers des phénomènes électro-magnétiques, chaque champ conserve son indépendance. Une unification synthétique peut donc aller de pair avec une réduction partielle. À la suite de Margaret Morrison (Unifying Scientific Theories, 2000, CUP), S. Ruphy nous invite à distinguer unification théorique et unification ontologique. Bref, il faut regarder au cas par cas la validité de telles « unifications », avant de parler d'unification ontologique effective (p. 153).
En conclusion, c'est bien le caractère interne au développement des sciences des questions de réductibilité, qui fait l'objet de la démonstration de l'auteure. Par rapport à un contexte épistémique contingent, on ne peut affirmer définitivement l'irréductibilité d'une théorie à une autre et asseoir une métaphysique sur cette irréductibilité. Même si des arguments métaphysiques peuvent être pertinents dans certains cas, ils ne peuvent qu'affaiblir la portée méthodologique normative des arguments anti-réductionnistes. Si l'on veut prendre les sciences au sérieux, il faut admettre que l'image du monde qu'elles délivrent est relative à la contingence des questions qu'elles posent au monde.
Troisième Partie
Ce qui est ici en question, c'est l'existence d'une pluralité de représentations d'un phénomène donné (qu'il s'agisse de modèles, de simulations numériques, de mécanismes explicatifs ou encore de systèmes taxinomiques). Tout part, là encore, d'un constat d'une pluralité représentationnelle de fait. Mais il s'agit d'évaluer les différentes attitudes possibles relativement à ce constat. La position de l'auteure revient à montrer qu'il reste difficile de concilier ce pluralisme avec un réalisme qui s'appuierait sur une forme d'analogie cartographique : il peut exister plusieurs cartes du même territoire - ce qui n'empêche pas le progrès de la cartographie. Cependant, représentations cartographiques et représentations scientifiques sont-elles identifiables ? S. Ruphy va montrer les limites de cette analogie.
De la cartographie des phénomènes ? Pluralisme et progrès
S'agit-il de s'opposer aux prétentions d'une théorie du Tout ? On peut alors se demander si la cible des tenants du pluralisme n'est pas un « ennemi imaginaire », dans la mesure où l' « idée d'une collection complète de représentations de tous les aspects du monde naturel n'a guère de sens » (p. 161).
Par contre, le débat semble plus consistant s'il s'agit de partir de la contextualisation inéliminable de nos représentations, notamment par leur dépendance à nos intérêts épistémiques ou pratiques (p. 162).
Ne devrait-on pas remplacer, pour prendre en compte la pluralité des représentations d'un phénomène sans rejeter toute prétention réaliste, le critère strict de l'adéquation par un critère plus souple, comme celui proposé par H. Longino de la conformation, celle-ci n'étant bonne qu'à un certain degré ou que relativement à certains buts ? (p. 164) S. Ruphy argumente en faveur de la légitimité restreinte d'une interprétation exclusivement pragmatique de ce contextualisme, en s'arrêtant sur le modèle de la carte pour le réinterpréter de façon plus fine (il s'agit au départ d'un argument en faveur du pluralisme, développé surtout par Ph. Kitcher, cf. p. 164 « l'analogie cartographique »). Nous savons en effet qu'il ne peut exister que plusieurs projections cartographiques, toutes légitimes dans les limites des objectifs que l'on se donne. Cela irait dans le sens de la conformation telle que définie ci-dessus. Cependant, si l'on confronte un plan de métro de Londres et un plan de métro de Paris, pour reprendre l'exemple de la page 165, le premier ne se donne pas pour but – contrairement au second - que la disposition spatiale relative des stations sur le plan reflète leur disposition spatiale dans l'espace physique de la ville. On peut donc affirmer que, si l'on utilise ces plans comme des plans de ville, c'est-à-dire selon un certain usage qui ne correspond pas à l'utilité présumée du plan par ses auteurs, le plan parisien est plus réaliste que le plan londonien. Il faut ici bien distinguer entre les conventions de lecture et les contenus intentionnels (c'est-à-dire les types d'entités et de relations que la carte se propose de représenter). Une fois ces paramètres pris en compte, rien ne nous empêche de juger de la bonne conformité relativement à un usage : ce plan m'a-t-il permis d'aller correctement d'une station de métro à une autre, par exemple ? Il y a donc bien un sens à parler d'un progrès dans la cartographie, sans que, pour autant, il faille définir ce progrès comme une convergence progressive vers une seule et unique carte, cf. p. 167. Mais peut-on se contenter de cette conformation pragmatique pour ce qui concerne cette fois-ci les représentations scientifiques ?
Deux nouvelles interrogations sont alors à mentionner :
- comment évaluer cette conformation dans le cas d'une carte pour laquelle on voit mal ce que serait un bon usage ? L'auteure donne, en note p. 166, l'exemple de cartes représentant des densités de population, quoique, sur ce type d'exemples, on puisse lui objecter qu'on peut leur supposer un usage bio-politique d'État, etc. Finalement, la question que l'on pourrait formuler, et que S. Ruphy ne va pas jusqu'à rendre explicite, est la suivante : y a-t-il des intérêts purement cognitifs - ce que la tradition formulait : y a-t-il un savoir désintéressé, une Theoria ?
- est-on contraint de choisir entre des représentations multiples, si l'on considère que chacune est porteuse d'informations complémentaires aux autres ?
Pour cette deuxième question, S. Ruphy distingue tout d'abord soigneusement entre les cas de représentations compatibles et les cas de représentations incompatibles, notamment quand les différentes théories en lice opèrent un découpage différent de l'espace causal (cf. p. 168-176, « Pluralité compatible vs. Pluralité incompatible »). Selon elle, la non-intégrabilité dans un seul et unique cadre commun ne signifie pas l'incompatibilité des descriptions (p. 175). S. Ruphy reprend ici l'argument qu'elle avait mobilisé pour le problème de l'ordre du monde : à l'aune de certains de nos intérêts épistémiques, un seul et unique modèle peut suffire à répondre à nos questions. La pluralité est donc elle-même relative à nos intérêts et ne peut être, là encore, affirmée dans l'absolu. La condition pour qu'un choix reste nécessaire, qu'il y ait alors compétition de modèles et pluralité provisoirement acceptée, est qu'il y ait identité des questions et divergence dans les réponses. Mais nous pouvons accepter une pluralité de contenus intentionnels (p. 171).
Cependant, l'argument le plus pertinent à nos yeux reste le troisième et dernier qu'elle développe, celui qui déplace le problème vers une question de catégorisation. Car on pourrait se contenter, soit d'un perspectivisme accommodant (celui qu'elle attribue à Giere par exemple, p. 171) ou encore d'une tolérance méthodologique à l'égard de la pluralité (p. 172-173). Mais on peut aussi poser la question de droit : qu'appelle-t-on pluralité de représentations d'un même phénomène X ? L'auteure est ici au plus près d'un questionnement transcendantal (p. 176-180). Elle considère que nous devons décider si nous avons affaire à deux comptes rendus de deux phénomènes distincts, ou bien à deux comptes rendus d'un seul et unique phénomène. Elle note que la circularité reste indépassable dans ce cas. En effet, dans le domaine scientifique, le terme de phénomène désigne une catégorie de processus individuels. Or, l'évolution de nos connaissances peut toujours amener à une refonte de nos catégories. La décision dont il est question n'est donc pas de même nature qu'avec des entités individuelles : c'est la révision de nos catégories qui peut nous faire considérer deux phénomènes distincts là où nous n'en saisissions qu'un seul auparavant. S. Ruphy donne l'exemple de l'explosion de supernovae, aujourd'hui redéfinie comme deux phénomènes distincts : « l'effondrement d'une étoile sur son compagnon stellaire de type naine blanche, ou l'éjection des couches externes d'une étoile massive », p. 178. Or, c'est bien ce qui distingue les représentations scientifiques des représentations cartographiques, ces dernières représentant une entité unique. Pour résumer l'ensemble de ce mouvement argumentatif, on pourrait dire que c'est bien parce que nous voulons toujours tirer de nos représentations actuelles plus que ce qu'elles nous apprennent pour le moment (donc à cause de la téléologie qui anime la recherche), que nous devons accepter la pluralité des représentations des phénomènes, car nous ne savons pas encore tout ce qu'il y a dans le monde, sauf à développer une ontologie procédant par une voie distincte de celle des connaissances scientifiques.
De la limite des modèles et des simulations numériques
Les modèles et/ou simulations numériques ont pris une grande importance dans les pratiques scientifiques contemporaines, avec une certaine ambition réaliste non dénuée d'ambiguïté quand il s'agit de présenter à la une d'un magazine une « image » issue d'une modélisation comme s'il s'agissait d'une donnée d'observation. S'appuyant sur le cas de l'astrophysique, S. Ruphy veut attirer notre attention sur leur dépendance vis-à-vis du chemin de modélisation (p. 183).
Le premier exemple discuté dans cette partie du livre est la simulation numérique de l'évolution de l'univers baptisée « The Millenium Run » (p. 184 et sq.).
Sans être compétent dans la matière, on comprend à la lecture de ces pages que l'élaboration de cette simulation repose sur une stratification de modèles enchevêtrés, tous nécessaires pour arriver à faire le lien en plusieurs étapes entre la théorie physique régissant l'évolution à grande échelle de l'espace-temps (depuis les équations d'Einstein du champ de gravitation jusqu'à la classe des modèles cosmologiques standards dits « Friedmann-Lemaître ») et les données observationnelles, via des « modèles phénoménologiques » intégrant eux-mêmes diverses modélisations de processus physiques, certains paramètres étant ajustés aux propriétés observées par essais et erreurs (p. 185-187).
La question est : des modèles alternatifs sont-ils disponibles à chaque étape de cette élaboration ? Dès le départ, le doute sur cette question vient du fait qu'un certain nombre d'hypothèses apparaissent, comme celle de l'isotropie de l'univers à grande échelle, qui ne sont pas empiriquement justifiables. On pourrait en dire de même de l'hypothèse de l'inflation (p. 188-189) ou encore de l'existence de la matière noire. Il semble bien que des interprétations alternatives des observations au pouvoir explicatif comparable, existent dans ces deux derniers cas (par exemple, celui des défauts topologiques au lieu de l'inflation).
Ainsi donc, depuis les choix théoriques fondamentaux jusqu'aux décisions plus « locales », le chemin de la modélisation apparaît non univoque ; et les décisions prises à chaque étape constituent autant de contraintes pour les étapes suivantes - ce qui amène S. Ruphy à parler de la contingence d'une telle simulation (p. 194-195).
Le second exemple discuté par l'auteure est celui des modèles galactiques (p. 195-208), caractéristiques des modèles composites d'objets physiques complexes, procurant à la fois une description de leur structure et permettant de poser des contraintes sur des scénarios d'évolution. S. Ruphy met l'accent sur le fait qu'une pluralité de modèles incompatibles risque bien de perdurer dans ce type de cas. En effet, l'ambition réaliste du modèle entraîne une incorporation de plus en plus grande de sous-modèles (la démarche procédant par essais et erreurs), lesquels finissent par ne plus être testables indépendamment les uns des autres. Le modèle est donc composite par son ambition réaliste même (p. 203, ou encore p. 209 : « Plus une modélisation intègre d'ingrédients pour être davantage réaliste, plus est perdu le contrôle de sa validation »).
La question était donc bien : la capacité d'un modèle à rendre compte de nouvelles données est-elle un bon indice de son adéquation aux processus physiques sous-jacents ? S. Ruphy penche pour la négative, en nous invitant in fine à une certaine prudence épistémique (p. 210-212).
La leçon des classifications stellaires
L'enquête du livre se termine sur la question des « espèces naturelles », fort discutée dans le débat épistémologique contemporain, le plus souvent à partir de la biologie. Si l'enjeu était au départ de reposer la question de l'ordre naturel, l'état du débat va plutôt dans le sens d'un pluralisme au deuxième degré ! En effet, comme S. Ruphy nous le rappelle (p. 247), « les concepts d'espèce naturelle élaborés par les philosophes attentifs aux développements scientifiques sont loin de former eux-mêmes une espèce naturelle de la philosophie des sciences ». Il existe à l'heure actuelle une multiplicité de doctrines des espèces naturelles, allant d'un essentialisme fort jusqu'à des formes d'économie taxinomique relative à nos objectifs. Le problème de la circularité se retrouve ici : à la lueur des développements post-darwiniens, « philosophes et scientifiques ont eu à cœur "d'assouplir" les conditions d'appartenance à une classe de sorte que les espèces biologiques puissent encore prétendre au statut d'espèce naturelle » (p. 248-249). De sorte que des positions philosophiques s'appuyant sur le développement des connaissances scientifiques ne semblent proposer que d'incessants ajustements de concepts.
Que nous apprend le cas des classifications stellaires, moins couramment examiné que celui des espèces vivantes ?
Tout d'abord, il nous invite à reconsidérer le découpage le plus souvent admis des domaines scientifiques, entre un paradigme de « science dure » associé à la physique soutenant le monisme réductionniste, et une périphérie – dans laquelle on rangerait les sciences du vivant - pour laquelle un certain pluralisme est tenu pour acceptable. Si l'œuvre taxinomique est plutôt ce qui rapproche d'habitude les sciences d'observation du modèle « dur », S. Ruphy en conteste ici l'interprétation structurale usuelle (la cohérence d'une taxinomie irait dans le sens de la réalité de l'ordre représenté), pour mettre en avant une lecture pragmatique. Ainsi, si le tableau périodique manifeste l'unité des intérêts épistémiques des chimistes et si – par contre -, ces mêmes intérêts restent divergents entre différents domaines des sciences du vivant (p. 239), « les pluralistes disposent avec la taxinomie stellaire d'un cas effectif dans le domaine physique de dépendance des classifications aux intérêts épistémiques des classificateurs » (p. 240).
En second lieu, il incite à désancrer la question des taxinomies de la problématique métaphysique de l'ordre naturel, pour lui reconnaître toute sa fécondité au sein de chaque domaine ou sous-domaine de sciences : la pluralité des classifications reflète la « pluralité effective, d'une discipline à l'autre, des types de catégories scientifiquement utiles ». Le débat devient alors interne à chaque discipline. Mais la rançon à payer est l'abandon pur et simple de la question philosophique, semble-t-il.
Bilan, ou : du principe de raison suffisante
Par cet ouvrage précis et longuement mûri, éclairé de plus par une pratique scientifique effective, Stéphanie Ruphy nous incite à réfléchir, outre sur la validité des assertions pluralistes ou monistes en philosophie des sciences, sur le sens même d'une philosophie des sciences aujourd'hui.
En un sens, il s'agit d'une forme de critique de la raison impure, où le pluralisme est retourné contre lui-même pour réfléchir à ses propres limites : dans la philosophie transcendantale de Kant, il s'agissait de partir d'un fait de la raison, l'existence de la science newtonienne, pour en établir ses conditions de possibilité ; ici, nous sommes bien plutôt confrontés à l'absence de LA Science - absence à partir de laquelle certains voudraient pouvoir conclure à l'existence d'un monde pluriel, bariolé, à l'inexistence du puzzle unique du monde. Stéphanie Ruphy se livre à l'examen critique de cette position, pour défendre, quant à elle, une autre forme de pluralisme qui ne serait pas sans affinité avec un primat de la pratique. En effet, à suivre son argumentation, la réduction reste toujours possible, car on ne peut affirmer catégoriquement que le monde soit pluriel ; mais, force est de constater qu'il faut se contenter généralement de faire comme si, le continent-sciences subsistant irréductiblement à l'état d'archipel fort morcelé. On peut parler alors d'un agnosticisme ontologique qui laisse une place au réductionnisme en tant que pratique légitime mais toujours située.
Il reste possible de parler d'un pluralisme faible. Nous le définirions ainsi : en l'absence d'un point de vue surplombant permettant d'énoncer une ontologie externe, c'est-à-dire indépendante des connaissances élaborées par les sciences positives, il n'en reste pas moins que l'existence d'une pluralité des sciences et le constat de leur déploiement indéfini dans l'histoire rendent leur ontologie interne ouverte - ontologie pour laquelle nous devons garder un esprit de tolérance et d'expérimentation comme l'aurait dit Quine. Le pluralisme faible n'est donc pas l'affirmation de l'absence d'un seul monde hors-science, mais l'affirmation de la pluralité des mondes scientifiques.
Il nous semble légitime de nous demander si les limites de cette entreprise ne tiennent pas à sa position en faveur d'une « métaphysique naturaliste » à la Quine, dans la mesure où – récusant toute autre position métaphysique – elle ne peut qu'aboutir à montrer, à l'intérieur de ce cadre qui a en quelque sorte présupposé la réponse, que les options ontologiques sont tout aussi contingentes que les théories scientifiques auxquelles elles se sont arrimées.
Mais que penser d'une forme d'unité analogique des sciences ? Doit-on abandonner, sous une forme ou une autre, le principe de raison suffisante ? Pour ne pas renoncer entièrement à toute perspective rationnelle, l'idée même de la justification de principes plausibles mais non testables (pour reprendre l'expression de Ellis de la page 188) ne renverrait-elle pas à une forme d'unité dans la pluralité, organisée autour de principes directeurs, de telle sorte qu'on pourrait défendre selon cette configuration un pluralisme cohérent, pour reprendre mais en un autre sens l'expression bien connue de Bachelard qui qualifiait ainsi le projet de la chimie moderne ?
On aimerait également tirer de cet ouvrage des conclusions quant au statut spécifique des sciences sociales. Mais, selon nous, l'autre horizon ouvert par cet ouvrage est de revenir sur la séparation des traditions épistémologiques, entre la philosophie analytique des sciences et une philosophie des sciences à la française. Relevant plutôt de la première dans sa manière, ce livre prend, néanmoins, parti pour une approche finalement non naturaliste des sciences, dans la mesure où la plupart des arguments de l'auteure font appel à leur historicité pour résoudre des questions de fond, particulièrement pour ce qui concerne la construction des styles scientifiques. Une solution de continuité persiste donc, séparant l'acquisition des connaissances dans les différentes sciences de toute méthode générale d'acquisition et de justification de croyances vraies sur le monde ; et cela nous rappelle certaines thèses de la philosophie historique des sciences.
François Chomarat.