Cicéron, Les Devoirs, Les Belles Lettres, 2014, « Classiques en poche », lu par Cyril Morana
Par Cyril Morana le 28 avril 2014, 06:00 - Éthique - Lien permanent
 Cicéron, Les
Devoirs, Les Belles Lettres, 2014, nouvelle traduction de Stéphane Mercier,
« Classiques en poche »
Cicéron, Les
Devoirs, Les Belles Lettres, 2014, nouvelle traduction de Stéphane Mercier,
« Classiques en poche »
Ce traité est intéressant à plus d’un titre dans la mesure où il est le dernier des écrits de Cicéron et parce qu’il résume l’ensemble des idées éthiques du philosophe peu de temps avant sa mort. Il est sans doute, avec les Tusculanes, son chef-d’œuvre philosophique.
Moins régulièrement traduit que d’autres œuvres du philosophe romain, Les Devoirs n’avaient connu qu’une réédition récente en poche dans une traduction ancienne légèrement révisée[1]. En voici à présent une nouvelle édition-traduction qui propose le texte traduit ainsi que l’original latin en regard. La pensée de Cicéron s’y présente achevée, sous la forme d’une somme en même temps que d’une adaptation d’une œuvre du stoïcien Panétius justement consacrée au devoir (kathêkon), mais une adaptation plus ou moins libre (Stéphane Mercier parle d’ « optique stoïcienne ouverte » à cet égard).
Pour les stoïciens, rappelons-le, la philosophie a comme visée essentielle la recherche de la vertu, laquelle renvoie à l'action droite et raisonnable par excellence; l'action n'est vertueuse que dans la mesure où elle est conforme à la nature; cette conformité à la nature implique une soumission de la raison humaine à la raison universelle ; s’accorder avec la raison ou l’ordre divin de la nature revient alors à s’accorder avec soi-même. L'étude de la nature (la Physique) a pour fin véritable une action raisonnable fondée sur sa connaissance, de même que l'apprentissage de la logique est subordonné à la connaissance et à la pratique de la vertu. Le stoïcisme est donc une philosophie dont l'horizon est éminemment éthique et dont la finalité apparaît comme l'apprentissage du bien-vivre. Ce bien-vivre implique que le sage soit indépendant des choses extérieures : son bonheur tout entier en dépend. Le « non-sage », non seulement est malheureux, mais il est considéré comme fou, misérable et « insensé », autrement dit un être qui ne s’appartient pas lui-même. Aussi, l’humanité doit-elle être divisée en deux classes distinctes : d’un côté, les sages impassibles qui ont toutes les perfections et jouissent seuls du bonheur véritable, de l’autre, les « insensés », qui vivent perpétuellement aux prises avec les passions et la douleur.
Cette philosophie, qui vaut pour les anciens Grecs et dans une certaine mesure pour quelques romains nostalgiques de la grandeur de la pensée contemplative grecque, doit être adaptée aux nouvelles conditions de vie qui sont celles de la Rome antique du Ier siècle : le monde change, les esprits se veulent moins férus de théorie et réclament du pratique. Le sage est progressivement devenu une sorte idéal improbable, sinon peu réaliste, et il faut lui substituer une nouvelle figure, plus abordable et plus proche des limitations de la nature humaine. Ainsi, l’orthodoxie stoïcienne affirme-t-elle que la vertu seule suffit au bonheur ? Cicéron ajoute que santé, force et richesse y contribuent également largement ! Le sage doit supporter la douleur ? Dans l’absolu, certes, réplique l’Arpinate, mais l’impassibilité stoïcienne est un horizon inaccessible, tout comme la sagesse absolue, et la douleur reste effectivement un mal. La distinction entre sages et insensés ? On doit l’assouplir et proposer une morale plus adéquate aux possibilités réelles d’une humanité bornée dans ses pouvoirs, une morale qui aide l’individu à développer sa propre personnalité. Stéphane Mercier rappelle justement dans son introduction : « le sage (…) est un horizon, un idéal au sens platonicien : voilà pourquoi Cicéron ne s’attarde guère sur son cas, sinon pour considérer ce à quoi chacun peut et doit viser ». Aussi, Cicéron va-t-il introduire une division entre des vertus intellectuelles et des vertus pratiques. Concrètement, si la vertu intellectuelle affirme par exemple que la sagesse est de « vivre conformément à la nature », la vertu pratique préconisera de vivre conformément aux impulsions de notre nature.
Cicéron veut en vérité traiter d’un sujet universel : l’homme. Se
demander, ainsi qu’il le fait, quels sont les devoirs des individus, c’est plus
profondément interroger la nature humaine et sa condition. Que doit faire
l’homme ? Chaque individu possède une nature en propre, et cette nature
doit être identifiée et constamment suivie. Nous devons ainsi cultiver nos dons
naturels et les dispositions particulières qui sont les nôtres, telle est la
véritable sagesse qui consiste à suivre la direction personnalisée indiquée par
la nature pour mieux s’accomplir soi-même. Toutefois, les hommes ne sont pas
simplement des individus, ils participent en même temps d’un grand ensemble
naturel, la société universelle, que nous avons le devoir d’entretenir et de
protéger. 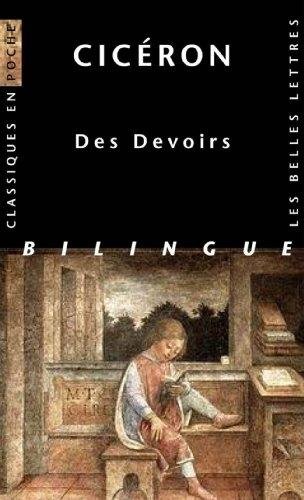
Ce que Cicéron désigne par officium renvoie à la nécessité d’accomplir les fonctions qui nous sont propres, les actions appropriées, et en particulier celles qui regardent la société, puis, bien sûr, celles relatives au bien-être personnel et au bonheur individuel. Au livre I, l’honnête, critère de l’action morale (mais plus, comme le kalon grec, un critère esthétique) dont parle régulièrement Cicéron, n’est autre que l’accomplissement des devoirs avec tempérance, prudence, force et justice, justice qui n’est autre que la vertu principale qui englobe toutes les autres. Il est des impératifs qui sont le résultat de notre condition individuelle et sociale auxquels nous devons nous plier si nous voulons nous épanouir. Au livre II, l’utile sera tout ce qui peut contribuer à effectuer ses devoirs, indépendamment du plaisir qui peut parfois les accompagner mais ne saurait en constituer un mobile. Cicéron peut, par la suite au livre III, affirmer que tout ce qui est honnête est utile, maxime pratique qui invite à cultiver l’honnête davantage que la vertu, suprême mais inaccessible, que vantaient jusqu’alors les stoïciens. L’homme accompli est simplement un honnête homme, ce qui coïncide davantage avec sa nature que l’exigence d’en faire un « sage ». Les Devoirs proposent donc « un code de vie à la fois souple et exigeant, précis et pourtant toujours actuel » souligne Stéphane Mercier, qui a raison d’y voir un ouvrage à la portée étendue et au discours universel.
La traduction proposée par SM, à partir de l’édition classique du
texte par Maurice Testard, est fluide et précise. Elle restitue avec élégance
et rigueur la belle prose latine de Cicéron et s’efforce de tirer le meilleur
parti d’un texte par endroit pas toujours bien composé ou achevé. Un répertoire
biographique (tout à fait nécessaire) accompagne la lecture de l’œuvre, on
regrette par contre l’absence de bibliographie, même succinte, et d’un index
rerum. Des notes sont proposées mais pas en surnombre, elles ne gênent pas la
lecture, et l’enrichissent régulièrement.
Cyril Morana