Jacqueline Lichtenstein, Les raisons de l’art, Gallimard, NFR Essais, 2015. Lu par Jean Colrat
Par Jérôme Jardry le 02 mars 2016, 06:00 - Esthétique - Lien permanent
Chers lecteurs, chères lectrices,
Les recensions paraissent et disparaissent très vite ; il est ainsi fort possible que certaines vous aient échappé en dépit de l'intérêt qu'elles présentaient pour vous. Nous avons donc décidé de leur donner, à elles comme à vous, une seconde chance. Nous avons réparti en cinq champs philosophiques, les recensions : philosophie antique, philosophie morale, philosophie esthétique, philosophie des sciences et philosophique politiques. Pendant cinq semaines correspondant à ces champs, nous publierons l'index thématique des recensions publiées cette année et proposerons chaque jour une recension à la relecture. Au terme de ce temps de reprise, nous reprendrons à notre rythme habituel la publication de nouvelles recensions.
Recensions de philosophie politique
Recensions de philosophie antique
Recensions de philosophie morale
Avec Les raisons de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Jacqueline Lichtenstein, professeur de philosophie de l’art à l’Université Paris 4-Sorbonne, vient fonder théoriquement une pratique de
 la philosophie de l’art qui s’était illustrée dans ses deux principaux ouvrages, La tâche aveugle : Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge moderne, (Gallimard, NRF Essais, Paris, 2003) et surtout La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l'âge classique, (Flammarion, Paris, 1989). La singularité et l’un des principaux intérêts de ces deux essais étaient la mobilisation d’un corpus théorique délaissé, voire méprisé par les esthéticiens, au nom de leur trop faible valeur spéculative.
la philosophie de l’art qui s’était illustrée dans ses deux principaux ouvrages, La tâche aveugle : Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge moderne, (Gallimard, NRF Essais, Paris, 2003) et surtout La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l'âge classique, (Flammarion, Paris, 1989). La singularité et l’un des principaux intérêts de ces deux essais étaient la mobilisation d’un corpus théorique délaissé, voire méprisé par les esthéticiens, au nom de leur trop faible valeur spéculative.
Les Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture en sont le meilleur exemple, et l’on doit à l’auteur leur récente édition intégrale[1]. Durant ces séances académiques, le dispositif était le plus souvent minimal : un artiste parlait d’une œuvre à d’autres artistes, au nom de l’autorité d’un savoir dont peu auraient contesté jusqu’au milieu du xviiie qu’il appartienne de droit aux artistes. Puis vint cette révolution épistémologique que constitue, vers 1750, l’apparition de l’esthétique, de l’histoire de l’art et de la critique d’art, dont un effet majeur fut de déclasser ce savoir pratique pour le reléguer au rang de fausse conscience. Kant serait l’exemple caricatural, selon Jacqueline Lichtenstein, de cette ignorance insouciante et quasi revendiquée des choses de l’art, même s’il faut bien reconnaître qu’il ne prétend guère parler d’art. De cette pratique de l’art qui se conçut longtemps comme une logique sinon la logique de l’art, où le savoir s’élève depuis l’intérieur du processus créatif (c’est d’abord en ce sens qu’il faut entendre le tire Les raisons de l’art), la philosophie n’aurait rien à savoir, et c’est pourquoi l’intérêt que lui porte Jacqueline Lichtenstein lui valut parfois, comme elle le rapporte plaisamment, d’être considérée comme une philosophe de l’art ne faisant pas de philosophie. La tentative de légitimer ici cette méthode est donc non seulement un plaidoyer pro domo mais surtout un essai polémique en vue d’une autre entente de ce que peut être la philosophie de l’art, radicalement distinguée de ce qui s’est le plus souvent institué en esthétique. Au-delà des partages disciplinaires, l’ambition de l’ouvrage est peut-être plus vaste : ne pas se satisfaire de l’ordre établi entre histoire de l’art, esthétique et philosophie de l’art, et interroger sur la nature et les conditions du savoir approprié aux œuvres et du savoir qu’elles produisent.
Chapitre premier : Le critique, l’historien, le philosophe.
Ce chapitre nous place à l’instant littéralement critique, selon l’auteur, où, avec Kant, la philosophie décrète vaine toute tentative de faire de l’esthétique une science de l’art et détourne l’étude depuis l’œuvre vers le spectateur, pour lui donner comme objet principal un jugement de goût à l’étrange universalité sans raison. La rationalité philosophique imposerait que l’on cesse de se pencher sur la pseudo rationalité des raisons de l’art pour se consacrer à la seule logique de l’expérience esthétique. L’œuvre d’art, ainsi réduite au rang de cause occasionnelle du plaisir, sortit du champ d’objets de la philosophie de l’art. Même si, comme le montrent ces premières pages, l’esthétique naissante avec Baumgarten n’avait pas ce tranchant et n’avait pas oublié qu’elle était née au sein d’une poétique (une poïétique donc), et même si cette science nouvelle mit longtemps à s’imposer, en France particulièrement, c’est bien ainsi qu’elle finit par prévaloir et qu’elle prévaut encore dans l’enseignement secondaire, si l’on en croit le jugement sévère exprimé par l’auteur lors d’une récente conférence[2].
Ces ordres de discours, nouveaux en 1750, que sont la critique d’art et l’histoire de l’art (si on la fait vraiment commencer avec Winckelmann) auront un rapport plus complexe avec ce savoir rejeté par l’esthétique philosophique. Qu’il s’agisse de Diderot évidemment, ou de Winckelmann (dont l’auteur rappelle la proximité sinon l’appartenance au cercle des artistes), le discours sur les œuvres est encore celui de quelqu’un qui n’est pas extérieur au temps de la création artistique. Mais ce n’est pas le cas de La Font de Saint-Yenne, qui se légitime de n’être que « Public »[3], et c’est finalement là aussi cette faculté de juger au nom de la seule expérience esthétique qui s’imposera comme la règle puisqu’il n’y a justement plus de règles dans l’art.
Chapitre 2 : Le plaisir et la règle.
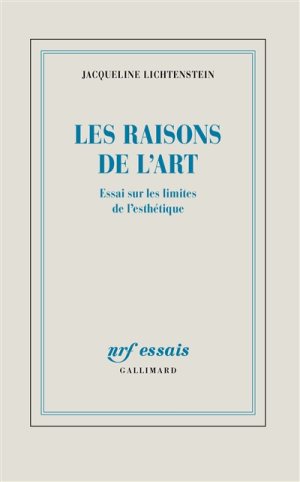 Ce chapitre va alors montrer en quoi consiste
cette opération de dérégulation de l’art, dont Kant serait encore la figure
centrale. Elle se formulerait ainsi : « 1. Le goût ne peut jamais
être déterminé a priori ; 2. Or
la règle est une détermination a
priori ; 3. Donc le goût ne peut être déterminé par des règles »
(p. 60). En puisant aux propos d’artistes (Bernin, Le Brun, Corneille surtout),
l’auteur montre qu’ils ont l’expérience de règles bien différentes de ces principes
a priori qui s’imposeraient
nécessairement à la production du beau, auxquels Kant veut les réduire pour
mieux en montrer l’inexistence. Ce sont des principes plus souples, peu ou pas
normatifs, guidés par le métier autant qu’ils cherchent à l’orienter, faits
pour être mis en question par ceux-là mêmes qui doivent les appliquer, dans des
débats dont les minutes constituent justement les raisons de l’art.
Ce chapitre va alors montrer en quoi consiste
cette opération de dérégulation de l’art, dont Kant serait encore la figure
centrale. Elle se formulerait ainsi : « 1. Le goût ne peut jamais
être déterminé a priori ; 2. Or
la règle est une détermination a
priori ; 3. Donc le goût ne peut être déterminé par des règles »
(p. 60). En puisant aux propos d’artistes (Bernin, Le Brun, Corneille surtout),
l’auteur montre qu’ils ont l’expérience de règles bien différentes de ces principes
a priori qui s’imposeraient
nécessairement à la production du beau, auxquels Kant veut les réduire pour
mieux en montrer l’inexistence. Ce sont des principes plus souples, peu ou pas
normatifs, guidés par le métier autant qu’ils cherchent à l’orienter, faits
pour être mis en question par ceux-là mêmes qui doivent les appliquer, dans des
débats dont les minutes constituent justement les raisons de l’art.
Mais la mineure du syllogisme ainsi atteinte, le sens de la majeure se modifie. Oui, le goût n’est pas déterminé a priori, aucun artiste, aucune poïétique n’ont jamais affirmé le contraire et Kant n’innove pas. Mais s’il y a un sens à parler de règles de l’art, alors le goût n’est plus seulement cette faculté d’avoir ou non de la préférence et de dire oui ou non au beau, il est aussi le lieu du discernement des raisons du beau, faculté active dans la production de l’œuvre comme dans sa réception. Que la philosophie de l’art soit une analytique du goût, pourquoi pas, mais à la condition de redonner au goût sa double dimension de préférence et de discernement qu’il avait jusqu’à Kant, chez La Rochefoucauld en particulier. L’homme de goût ne dit pas seulement s’il aime ou pas, il s’explique avec l’œuvre et veut la comprendre en vérité. Il n’y a, surtout, pas à séparer plus que de raison ces deux moments du goût (préférence et discernement) car c’est dans ce jeu rationnel devant l’œuvre que se construisent la création de l’œuvre comme le plaisir du spectateur. Ce sont peut-être les meilleures pages de ce livre, lorsque l’auteur montre que le plaisir n’est pas un état mais un acte.
Chapitre 3 : L’ignorant ou le spectateur désintéressé.
Affirmer que la justesse du goût n’implique aucune connaissance des raisons que l’art se donne en se faisant et se défaisant, c’est donner l’autorité du jugement à ceux qui n’ont pas de connaissance en la matière ou pas d’intérêt à défendre dans le champ. Aussi infinis qu’indifférenciés en droit et en fait, ils constituent le public au sens moderne.
Jacqueline Lichtenstein montre d’abord la position équivoque des Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719) de Du Bos. Il est déjà du temps de l’esthétique quand il affirme que le public juge mieux, par le sentiment, que les gens du métier, de sorte que le sentiment est nécessaire et suffisant au jugement. Mais le public est encore chez Du Bos une élite sociale, éclairée et cultivée, et son jugement émane davantage d’un goût de comparaison que d’une sentimentalité irréfléchie. Reste tout de même avec Du Bos, ce geste décisif pour l’esthétique à venir, un demi-siècle plus tard, de donner l’autorité à la réception plutôt qu’à la création. Ce point de vue l’emportera, comme le montre, vers 1750, la confrontation, par écrits interposés, du prototype de critique moderne qu’est La Font de Saint Yenne et de Charles Antoine Coypel, académicien et premier peintre du roi. Ce dernier défend encore au milieu du siècle le privilège du discours pour les peintres et « les vrais connaisseurs », qui se distinguent par leur proximité avec les artistes et non par le supposé statut de « public éclairé » auquel Coypel n’accorde aucune confiance. Ce « vrai connaisseur » définit ce que l’on appelait alors « amateur », tel que le comte de Caylus l’incarne en personne et le dépeint dans les conférences qu’il avait le droit de tenir à l’Académie, ès qualitésd’amateur. Le discours de Coypel ou de Caylus est sans doute l’ultime chant de la théorie classique de l’art. Et si les praticiens continuèrent à parler et à écrire au xixe et au xxe, Jacqueline Lichtenstein remarque habilement que l’on ne sait que faire de leurs dires, rangés comme « écrits d’artiste », étant désormais entendu que ceux qui prétendent savoir parce qu’ils font, témoignent justement par là qu’ils ne savent rien de la singularité de ce qu’ils font.
Chapitre 4 : Pour une critique de la théorie pure.
Jacqueline Lichtenstein appelle « théorie pure » cette façon dont une théorie de l’art, sous l’effet de la philosophie analytique, a trouvé une place légitime au sein de la philosophie, en se définissant comme une théorie du concept d’art et non comme une théorie des œuvres d’art. Si le xxe a rétabli la pertinence d’une théorie de l’art, ce n’est donc pas pour revenir vers cette connaissance dont Kant affirmait la vacuité. La théorie de l’art au sens contemporain, qui ne voudrait connaître de l’art que le concept, perpétue la disqualification de la théorie de l’art dont cet ouvrage prend la défense. Il n’est pas étonnant de trouver en exergue de ce chapitre un des aphorismes caractéristiques de Konrad Fiedler (1841-1895) : « Esthétique n’est pas théorie de l’art. L’esthétique s’occupe d’explorer une certaine sorte de sentiments. L’art parle en premier lieu à la connaissance, en second lieu au sentiment. » En considérant que le plaisir lié au sentiment du beau est inessentiel au point de vue de l’art parce que contempler n’est pas jouir mais connaître, Fiedler sépare la théorie de l’art de l’esthétique et lui redonne l’autorité. C’est beaucoup selon Jacqueline Lichtenstein, mais pas assez dit-elle, car l’anti-kantisme de Fiedler ne remet pas en cause, face à l’œuvre, la différence entre jugement de goût et jugement de savoir, expérience du beau et connaissance de l’œuvre, et c’est à la condition de dissocier art et plaisir que Fiedler rend possible un savoir objectif sur l’art. Paul Valéry, qui constitue pour l’auteur une référence majeure de ce savoir-artiste, serait plus éclairant lorsqu’il affirme que « le sentir, le saisir, le vouloir et le faire, sont liés d’une liaison essentielle »[4]. Il ne suffit évidemment pas d’être artiste pour valoriser ce savoir qui puise à l’expérience de la création et le chapitre s’achève en montrant que la Théorie des couleurs de Goethe est un des meilleurs exemples du rejet de ce mode de connaissance.
Chapitre 5 : Le philosophe et l’historien de l’art : un dialogue impossible ?
En rappelant la thèse pascalienne du bon ordre (il est dans l’ordre que le fort se fasse craindre et le beau se fasse aimer, mais tyrannique que le fort veuille être aimé pour sa force ou le beau craint pour sa beauté), le dernier chapitre des Raisons de l’art cherche à établir la philosophie, l’esthétique et l’histoire de l’art dans leur ordre. La discussion entre l’historien de l’art Meyer Schapiro et Heidegger est ici plus qu’un exemple. Le débat est connu, en particulier par le commentaire qu’en fit Derrida dans La Vérité en peinture. Il tourne autour d’un tableau de Van Gogh décrit par Heidegger décrit dans L’Origine de l’œuvre d’art. Le tableau figure des souliers dans l’usure desquels Heidegger voit Van Gogh laisser se dévoiler le rapport entre ces souliers, produits du monde paysan, et la terre. Ignorant ce que peuvent être « dévoiler », « monde » ou « terre » selon Heidegger, l’historien de l’art s’inquiète, écrit au philosophe pour savoir de quel tableau précisément il parle. Il soupçonne que ces souliers sont ceux de Van Gogh plutôt que de paysans. La réponse vague que lui accorde Heidegger ne fait pas illusion : le tableau qu’il prétend décrire, c’est lui qui le dépeint, imaginairement. Derrida a, selon l’auteur, beau jeu de montrer que la vérité du discours heideggerien n’a rien à faire de la précision historienne qui veut connaître le vrai propriétaire des chaussures. L’essentiel est ailleurs : dans le fait que cette philosophie de l’art que prétend être, malgré tout, L’Origine de l’œuvre d’art,se construit en se détournant de la réalité des œuvres. Comme les exemples imaginaires dont la philosophie analytique s’est presque fait une méthode, nous serions ici devant une philosophie de l’art qui sort de son ordre en prétendant parler de l’art par autre chose que les œuvres d’art. C’est davantage qu’un plaidoyer pour une attention aux œuvres et au savoir positif dont elles peuvent faire l’objet, car ce savoir ne doit pas être conçu selon l’auteur comme un simple préalable à la connaissance philosophique de l’art. Ce sont plutôt deux temps d’un seul et même savoir, qui se relancent indéfiniment. C’est un savoir sans doute difficile à imaginer et à développer, mais c’est ce savoir-artiste auxquelles Les raisons de l’art veulent donner raison, et qui constituait aussi l’entreprise de Jacqueline Lichtenstein dans ses précédents ouvrages.
Même si les dernières pages suggèrent ce que pourrait être une esthétique ajustée à son ordre, ce livre est essentiellement un traité d’anti-esthétique kantienne. L’auteur s’y oppose à l’idée qu’avec la beauté, la raison n’aurait autre chose à faire que se tourner vers l’analyse de l’expérience subie par le sujet. Jacqueline Lichtenstein montre comment se sont mises en place au milieu du xviiie les conditions et les premiers effets de cette révolution épistémologique qui cristallise dans la troisième Critique autant qu’elle s’y invente. Et l’on peut, me semble-t-il, radicaliser l’importance accordée par l’auteur à cette mutation qui s’opère avec Baumgarten, Batteux et Winckelmann vers 1750. Car ce n’est pas seulement la théorie du sentiment de plaisir (l’esthétique), l’histoire de l’art et la critique qui s’inventent alors, mais aussi la notion moderne d’art, faite pour apparenter conceptuellement des pratiques dont le commun caractère de beaux-arts n’avait jusqu’alors jamais donnée l’idée qu’elles puissent constituer une catégorie homogène et exclusive Et les beaux-arts flottaient, épars, parmi arts libéraux et arts mécaniques. Le savoir-artiste qui fut alors déclassé constituait-il vraiment une théorie de l’art, ou plutôt une collection de poïétiques picturales, musicales, littéraires ? De sorte que, paradoxalement, c’est par l’invention du concept d’art que ce savoir des œuvres fut expulsé. Cette anti-esthétique pourrait donc aller jusqu’à se dire une anti-artistique, mais les raisons des œuvres dites d’art font un titre moins cinglant que Les raisons de l’art.
Le refus de l’esthétique kantienne n’est pas nouveau. Cette esthétique qui s’est solidement implantée, dans l’enseignement en particulier, fut très tôt contestée. C’est à Königsberg, dans la chaire que Kant occupait peu avant, que Herbart a voulu établir les conditions d’une connaissance vraiment scientifique des raisons du beau et le xixe verra se développer en ce sens un formalisme et une esthétique scientifique dont on commence à connaître l’importance[5]. On peut aussi considérer l’esthétique de l’école cousinienne comme le refus de s’en tenir au moment kantien.
Mais Jacqueline Lichtenstein choisit ici une autre voie de contestation, celle d’une poïétique dont les deux premiers principes seraient : 1) le savoir des hommes de l’art n’est pas vain quand ils prétendent parler des raisons de l’art, 2) ce savoir peut être philosophique (et pas seulement technique, historien, pré-compréhensif). C’est au contraire l’esthétique qui est philosophiquement vaine et artistiquement nulle dès lors qu’elle cantonne l’étude à l’expérience subjective. Sauf à reconnaître que cette expérience de plaisir est elle-même informée par les raisons de l’art, ou qu’elle doit apprendre à l’être, de telle sorte que si Konrad Fiedler a, dans un premier temps, raison contre Kant de dissocier artistique et esthétique, il faut savoir surmonter ce clivage au nom de ce qui constituerait le troisième principe de la théorie qui se construit ici : le plaisir est une expérience savante qui doit passer par les voies de la création. Dans l’abondance des philosophies de l’art contemporaines, ces Raisons de l’art constitueront une position certes minoritaire, mais désormais clairement identifiable.
[1]Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture, Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel (éd.), édition critique intégrale, 6 tomes, 12 vol., Paris, ENSBA, 2007-2014.
[2]« Samedi(s) autour d’un livre », Centre Victor Basch, Université Paris 4-Sorbonne, 21 mars 2015.
[3]La Font de Saint-Yenne, Étienne, Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France, avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre, in Œuvre critique [1747], Étienne Jollet (éd.), Paris, ENSBA, 2001.
[4]Paul Valéry, Discours sur l’esthétique [1937], in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 1298.
[5]Voir à ce sujet : Formalisme esthétique. Prague et Vienne au xixe siècle, dirigé par Carole Maigné, Paris, Vrin, coll. « essais d’art et de philosophie », 2013 ; et Vers la science de l’art. L’Esthétique en France, 1857-1937, Jacqueline Lichtenstein, Carole Maigné, Arnauld Pierre (éd.), Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2013.