Entretien avec Jean-Marc Rouvière : la morale comme événement
Par Karim Oukaci le 06 septembre 2017, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
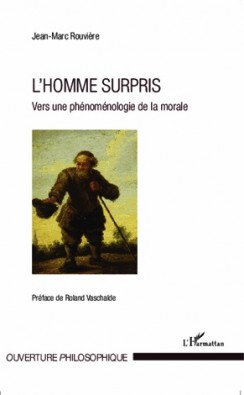
Jean-Marc Rouvière est philosophe, poète, et il est chrétien. Ses ouvrages posent une question qui engage le destin de l'homme dans sa dimension la plus concrète : y a-t-il une parole en nous qui soit autre que le langage de la raison, et qui permette de placer devant tout dispositif éthique ou juridique une expérience morale primordiale ?
- Avec L'Homme surpris (2013), vous avez proposé une analyse très précise de l'acte moral...
- La morale naît de la surprise, c’est-à-dire de la rencontre imprévue d’une situation déconcertante qui met chacun de nous comme en suspension au-dessus de toutes ses références éthiques et juridiques. Notre conscience est littéralement prise au dépourvu, saisie par la situation, elle n’est plus que livrée à elle-même. Cet homme décentré et démuni contraste avec l’homme tranquille, pourvu des doctes conclusions des comités d’éthiques et des obligations légales des codes juridiques. La surprise, c’est la conscience qui n’a plus le temps d’avoir et d’être conscience de soi.
- Une conscience étonnante...
- Jankélévitch l’a bien souligné, seul l’homme, et non l’animal, possède cette « conscience au carré ». Et dans l’instant de la surprise, nous sommes comme en dehors de notre humanité. C’est par la brièveté minimale de l’instant que notre réaction quasi réflexe relève de la morale et d’aucune délibération d’ordre éthique ou légal. Mais contrairement à Jankélévitch, je ne pense pas qu'il y ait en matière de vie « morale » d’occasions à saisir ou d’occurrences à capturer : bien au contraire, ce sont les occasions et les occurrences qui nous saisissent et nous capturent.
- Éthique et droit semblent, pourtant, avoir pris aujourd'hui la place de la morale.
- Remarquons qu'une telle substitution linguistique s'observe dans le langage courant où des mots semblent des substituts les uns des autres, des synonymes que l'on emploie sans distinction, au prétexte, par exemple, que l’un viendrait du grec et l’autre du latin. Il en va ainsi de « chose » et « objet » ou bien sûr de « morale » et « éthique ». Il est facile de constater que dans bien des interventions publiques l’orateur commence par choisir « éthique » ou « morale », puis pour éviter les répétitions se met à utiliser l'un ou l'autre sans plus les différencier. C'est de cette pseudo équivalence que j'ai essayé dans L'Homme surpris – sur la base de ma définition de la morale - de montrer l'inconsistance.
- C'est-à-dire ?
- L'instant moral est premier par rapport à la durée éthique. L'éthique et le droit ne sont pas des concurrents de la morale : ils appartiennent non seulement à une autre temporalité celle du temps de la raison raisonnante, mais ils ont la propriété d'être des institutions indispensables pour la vie en société. L'éthique est du côté du collectif et la morale du côté de l'individu. Mon livre est une invitation à reconsidérer l'enchaînement vertueux morale-éthique-droit, à l'aune d'une définition rigoureuse de la morale. Car si l'éthique et le droit sont par nature et fonction du côté du bien commun, la morale est tout entière réaction-à : elle n'a pas de rôle judicatif au regard du bien ou du mal. L'Homme surpris privilégie une approche événementiale de la morale, au sens d'une ouverture pour moi du monde d'autrui.
- Dans Adam ou l'innocence en personne (2009), vous définissiez déjà l'acte moral comme « un faire sans savoir-faire »...
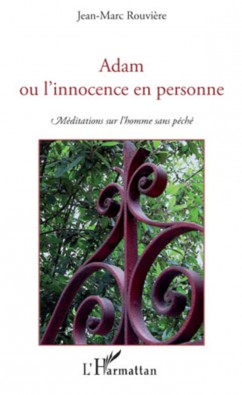
- D'une part, le « savoir-faire » suppose un apprentissage spécifique, une technique que l'on acquiert de la même façon que d'autres peuvent également l'acquérir. Il est partie prenante de l'éthique et du droit que tout un chacun peut, voire doit maîtriser, au moins a minima, dans l'exercice de son métier ou sa vie de citoyen. D'autre part, il se caractérise par une forte dimension procédurale faite d'une élaboration et d'une pratique (le Code pénal s'accompagne d'un Code de procédure pénal). Rien de tel pour ce qui est de la morale dans le sens que je propose : elle n'est qu'affaire de conscience et de spontanéité personnelles. Si chacun de nous doit partager avec ses concitoyens les cadres éthiques et juridiques de notre société (quitte à les contester et à le renouveler), le contenu de notre réactivité morale n'est strictement en rien codifié et en rien prévisible. Il est vrai que notre réaction est sans doute le fruit d'une éducation familiale et sociétale ; mais au moment où se présente le casus moralis, il n'est plus temps d'écouter sa conscience délibérer. Il est déjà presque trop tard, il n'y a plus de distance entre elle et moi. Je n'ai pas le temps d'affirmer : « je prends position », mais seulement de constater : « j'ai pris position ». Ensuite, vient ou non le temps éthique pour accomplir le geste généreux.
- Qu'appelez-vous le casus moralis ?
- Il s’agit d’une expression que j’emprunte au vocabulaire ancien de la théologie morale. Je lui donne une acception qui est par sa soudaineté l’équivalent du coup de foudre en amour, d'un appel auquel on ne peut pas ne pas répondre. Lorsqu’il survient, il nous oblige envers et malgré nous-même, comme la rencontre inopinée de l’être qu’on aime dès le premier croisement de regards. La réponse morale ou amoureuse à cette rencontre hors du commun ne doit rien à notre bonne volonté ; au contraire, c’est à elle que nous devons d’être charitables ou amoureux. Nous ne savons rien de l’autre homme que nous croisons, et lui ne sait rien de nous. Cette ignorance mutuelle est au fondement de notre trouble intérieur. Elle en est la condition de possibilité.
- Vous prenez le cas du mendiant qui tend la main...
- Commençons par remarquer que si vous respectez à la lettre les lois et règlements de la république, aucune autorité ne vous reprochera quoi que ce soit. Vous finirez votre existence en parfait citoyen digne de la considération de vos contemporains. Vous aurez notamment, dans un pays comme la France, participé tout au long de votre vie d’adulte au financement de la solidarité sociale à hauteur de vos capacités contributives. Dès lors, vous aurez une excellente raison de ne pas aider le mendiant qui tend la main. La logique est de votre côté : « La solidarité ? Il y a les prélèvements sociaux pour ça ! ». Malgré tout, comme tout un chacun si bon contribuable soit-il, vous verrez cette main tendue et vous n’échapperez pas à une réaction morale, qui se conclura soit par le don d'une pièce soit par rien. Notons que ce rien doit encore être classé dans la catégorie de l’acte moral, qui n’est pas réservée aux seuls actes généreux et nobles. La réaction au casus moralis peut déboucher tout autant par un rejet de l'appel à l'aide que par un geste de compassion ; elle n'en restera pas moins « morale ».
- Vous parlez aussi d'un « humanisme sans homme »...
- Je tiens à cette expression non seulement parce qu'elle est un brin provocante, mais parce qu'elle va de pair avec ma définition de la morale. Si le mendiant vous touche, c'est par la seule situation dans laquelle il se trouve car rien ne dit pour autant qu'il n'est pas le dernier des salauds. On retombe ici dans l'ensemble des raisons ou du moins des incertitudes qui vous poussent très logiquement et cyniquement à n'être charitable avec personne. C'est la condition humaine du mendiant qui est à la source de mon acte moral, et nullement l'individu lui-même. Peu importe qui est en vérité cet homme, peut-être est-il sans la moindre qualité ; seule sa vie de misère inacceptable est en mesure de provoquer ma réaction.
- Pensez-vous que la souffrance soit la grande oubliée de la réflexion philosophique contemporaine ?
- Il est vrai que ces dernières décennies la souffrance et la douleur ont été, et de mieux en mieux, prises en charge par la psychologie clinique et la médecine palliative. Mais je ne dirai pas que la souffrance est tombée dans l'oubli : elle demeure sur la scène philosophique, via notamment la phénoménologie de la vie et plus récemment la philosophie du soin (« Ethics of Care »). Ainsi, pour Michel Henry, mort en 2002, la souffrance, comme la joie, est un affect fondamental, une modalité de la vie qui met chacun de nous en contact avec lui-même. Rappelons à ce propos que Henry a souligné que les sciences qui nous guérissent et soulagent de bien des maladies sont des sciences du vivant. Pour le dire sèchement : un médecin ès qualités ne sait rien de la vie même s’il connaît beaucoup du vivant. Henry reprenait à son compte dans C'est moi la vérité (1996) ce que le grand biologiste François Jacob écrivait en 1970 dans La Logique du vivant : « on n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires » qui se consacrent à la physique et à la chimie, laissant la réflexion sur la « vie » aux philosophes. Pour dire les choses simplement, cette répartition des tâches entre sciences dures et philosophie correspond au fait que le vivant est du côté de l'objet visible, mesurable et reproductible alors que la vie n'a rien de ces attributs.
- La modernité a-t-elle besoin que l'on réfléchisse philosophiquement sur les concepts du christianisme ?
- Le christianisme n’est pas d’abord du côté du concept. Il n’est pas une idéologie même au sens le plus noble du terme. Au regard de notre vie sociale, être chrétien consiste à partir de la foi en la Révélation évangélique en une pratique, une manière d’agir et de se comporter avec soi et autrui. Et nos sociétés modernes, démocratiques et républicaines qui doivent beaucoup au christianisme n’en ont pas fini de le penser. L’Église vit à la suite du Christ, qui a dit haut et fort : « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division » (Luc 12, 49-53). Elle a le souci d’évoluer, et on connaît peu d’institutions religieuses ou laïques, pour ne pas dire aucune..., qui par nature se tiennent prêtes à la réforme. « Ecclesia semper reformanda », disaient déjà des théologiens médiévaux.
- Et pour la philosophie elle-même ?
- L'attention à la pensée chrétienne tellement prégnante dans notre culture est une nécessité d’ailleurs technique pour tout philosophe, qu’il soit croyant ou non. A cet égard, Jean-Luc Marion a montré que pour comprendre en profondeur l’apport de la pensée cartésienne, il était impératif d’avoir une bonne connaissance des enjeux théologiques de son époque, parce que Descartes discute, au moins implicitement, pied à pied dans certains de ses écrits, avec des théologiens dominants du XVI° siècle comme les jésuites Suarez ou Vasquez.
- Allez-vous jusqu'à partager la sévérité de Michel Henry, qui condamnait la modernité comme « un phénomène historique qui bascule à chaque instant dans son propre néant » ?
- Parler de « modernité », c’est effectivement considérer l’histoire - quelle qu’elle soit, heureuse ou malheureuse - comme une fuite en avant : lorsque une modernité tombe dans le néant, une autre se lève qui à son tour connaîtra le même sort, et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps. De la modernité du temps, on peut dire la même chose que de sa suspension : oui, mais... pour combien de temps ? Je crois que la néantisation qu’évoque Michel Henry est aussi celle qu’il dénonçait il y a trente ans dans son virulent essai La Barbarie qu’il caractérisait par les succès des pouvoirs totalitaires, l’implacable substitution robotique-travail humain, l’épandage d’une pseudo culture médiatique avachie et avachissante, etc. Son diagnostic n’a guère été démenti. Mais n’aurait-on pas du mal à discerner une seule époque et une seule société où l’humanité échappait, mutatis mutandis, à telle ou telle de ces calamités collectives ?
- Vous pensez donc que le concept de salut ait encore un sens pour nous...
- Pour un chrétien, le Salut est au cœur de la foi. Il est la grâce que Dieu propose non pas à quelques-uns qui l'auraient méritée par une vie exemplaire, mais à tous les hommes, à la seule condition que nous acceptions de recevoir ce don divin qui consiste selon le Christ à faire la volonté du Père et non la nôtre. On rejoint, toutes choses égales par ailleurs, la situation du mendiant et du passant : le premier invite le second à poser un acte de charité ; mais faut-il encore que celui-ci accepte cette invitation. C'est bien le miséreux qui offre le premier, et qui m'offre l'essentiel : que je donne à autrui.
- Même pour les athées ?
- A leurs façons, les athées se placent aussi dans un appel au salut via des idéologies prometteuses de la cité enchantée. Le marxisme ne portait-il pas l'espérance de la fin de l'aliénation de l'homme par la révolution prolétarienne et l'instauration d'une société sans classe ? Le salut politique a d'ailleurs également tenté et égaré les croyants. Au XX° siècle, une partie du catholicisme français a cru trouver sa voie politique en pactisant avec Vichy ou en étant compagnon de route du Parti communiste... Rechercher ici-bas la société sainte, c'est aller droit au totalitarisme, le salut ne peut passer que par le choix libre des individus.
- Mais dans une forme plus actuelle ?
- Suite aux cadavres des idéologies conçues comme des réponses toutes faites à des questions mal posées, on constate dans la réflexion actuelle un regain d’intérêt pour le concept de « bien commun ». Cette évolution de la pensée n’est sans doute pas étrangère au constat que « la maison brûle » comme disait le président Chirac. Le « salut » aurait-il quitté les idéologies politiques pour passer du côté de la sauvegarde de notre bien commun, la Terre ? Cet impératif catégorique passe déjà par des atteintes nécessaires à nos laxismes industriels et consuméristes. Sur ce point, je renverrai au beau livre du Père Gaston Fessard Autorité et bien commun, aux fondements de la société (1944) et aux nombreuses recherches des économistes contemporains sur les notions de propriété, biens publics et de bien commun.
- Vous avez publié récemment un recueil poétique, La Terrasse des offrandes. Quel rôle la poésie joue-t-elle dans votre pensée ?
La poésie a été mon premier mode d’écriture, non pas à la prime adolescence mais lors de mes années universitaires. J’ai été séduit par des poètes français du XX° siècle comme Pierre Reverdy, Joë Bousquet ou Pierre Jean Jouve. Cette séduction m’a conduit à me lancer dans la composition de petits recueils dont un premier ensemble a été publié en 2016 dans La Terrasse des offrandes, le second le sera prochainement, ainsi mes « œuvres complètes » poétiques seront enfin disponibles !... Mais j’ai cessé d’écrire de la poésie lorsque j’ai pris goût encore plus fortement pour la philosophie. Ce sont deux domaines très différents qui n’influent pas, en tout cas chez moi, l’un sur l’autre. Le travail du concept me paraissant bien distinct de celui du mot. Le seul point commun serait celui de la recherche du terme juste. D’une façon générale, je ne crois pas que la poésie gagne à philosopher et la philosophie à poétiser. Mais il s’agit certainement de deux voies singulières qui parfois mènent au même but. On sait par exemple que Hölderlin fut un poète utile à Heidegger. En France, Francis Ponge et son Parti pris des choses (1942) ont suscité un intérêt certain du côté de la phénoménologie caractérisée par l'ambition d'un « retour aux choses mêmes », avec Sartre (L’homme et les choses, 1944) et plus récemment Henri Maldiney, Derrida ou Jean-François Courtine.
Bibliographie
Philosophie
Le silence de Lazare, méditation sur une résurrection, Desclée de Brouwer, 1996.
Brèves méditations sur la création du monde, L'Harmattan, 2006.
Adam ou l’innocence en personne, méditations sur l’homme sans péché, L’Harmattan, 2009.
L'homme surpris, vers une phénoménologie de la morale, collection Ouverture philosophique, L'Harmattan, octobre 2013.
Vladimir Jankélévitch, l'empreinte du passeur (ouvrage collectif issu du colloque de Cerisy-la-Salle 2003), Le Manuscrit, 2007.
Présence de Vladimir Jankélévitch, le charme et l'occasion (actes du colloque ENS-Ulm 2005), Beauchesne, 2010.
Poésie
La terrasse des offrandes, Christophe Chomant Éditeur, 2016.
Les passerelles oubliées, Christophe Chomant Éditeur, à paraître en 2017.