Dominique Schnapper, Travailler et aimer, Odile Jacob, 2013. Lu par Alain Champseix
Par Karim Oukaci le 27 juin 2014, 06:00 - Sociologie - Lien permanent
 Pourquoi écrire des mémoires – Mémoires est le sous-titre de l’ouvrage –
pour quelqu’un qui n’aime guère parler de soi ? En réalité, il s’agit de tracer
un itinéraire sur fond d’événements politiques, intellectuels mais aussi
personnels afin de montrer comment un individu, nécessairement singulier, a pu
en venir à la sociologie
Pourquoi écrire des mémoires – Mémoires est le sous-titre de l’ouvrage –
pour quelqu’un qui n’aime guère parler de soi ? En réalité, il s’agit de tracer
un itinéraire sur fond d’événements politiques, intellectuels mais aussi
personnels afin de montrer comment un individu, nécessairement singulier, a pu
en venir à la sociologie
Pourquoi écrire des mémoires – Mémoires est le sous-titre de l’ouvrage – pour quelqu’un qui n’aime guère parler de soi ? En réalité, il s’agit de tracer un itinéraire sur fond d’événements politiques, intellectuels mais aussi personnels afin de montrer comment un individu, nécessairement singulier, a pu en venir à la sociologie. Le vrai sujet du livre est donc la nature de cette science et il convient de ne pas confondre des mémoires avec une autobiographie.
On peut ainsi comprendre pourquoi le livre est constitué par un entretien conduit par quelqu’un d’autre, Sylvie Mesure en l’occurrence, après de nombreux échanges de courriels. Il faut bien sûr tenir compte, donc, du peu de goût de l’auteure pour l’examen de soi mais aussi de certaines précisions qu’elle donne comme des faits à méditer : difficulté d’évoquer sa propre vie quand on est fille d’une personne célèbre (Raymond Aron), éducation en un temps où il n’était pas habituel de se mettre en avant et de prôner le caractère libérateur de la parole. Nous soutiendrions volontiers que cet ouvrage sur la sociologie est aussi un ouvrage de sociologie. Il faut, en effet, savoir relativiser les valeurs d’une époque – serait-elle la nôtre : il est nécessaire de ne pas les considérer comme naturelles, voire éternelles et Dominique Schnapper n’a jamais caché que l’entretien était un des outils de cette discipline (cf. La Compréhension sociologique, PUF, nouvelle édition de 2012).
Le plan de Travailler et aimer reproduit les étapes principales de l’itinéraire intellectuel.
- Chapitre 1 : Formation
- Chapitre 2 : L’après-68 dans le monde académique (1970-1985)
- Chapitre 3 : Les années fructueuses (1986-2000)
- Chapitre 4 : Entre l’Ecole des hautes études et le Conseil constitutionnel (2001-2012)
- Chapitre 5 : Une génération
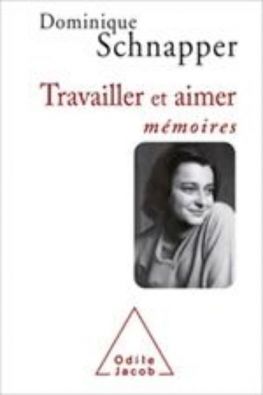
Chapitre 1. Un des principaux intérêts de ce chapitre consiste à montrer que, comme toute science, à son départ tout du moins, la sociologie n’est pas prédéfinie. A la suite de son père, mais différemment de lui en raison de la place accordée à l’enquête, Dominique Schnapper a contribué à l’élaborer. Certes, quelques classiques existaient bien comme Tocqueville ou Durkheim pour ne citer qu’eux mais de là à son existence académique, il y avait loin. Plusieurs obstacles durent être franchis grâce, il faut bien le dire, à un sens de la liberté éprouvé dès l’enfance et par la suite : séparation d’avec le père qui joignit la France libre dès 1940, exil au Maroc avec une mère inquiète la même année, départ pour Londres en 1943, mariage avec un historien de l’art qui, enfant, dut compter sur ses propres forces et ses lectures, son père ayant été arrêté par la Gestapo et sa famille ayant vécu dans la clandestinité pendant l’Occupation. Il faudrait également évoquer l’isolement de Raymond Aron après la guerre en un temps où il ne faisait pas bon être anticommuniste dans les milieux intellectuels français.
Nous ferons allusion à deux obstacles principaux pour simplifier. Le premier tient à l’engouement de Dominique Schnapper pour la philosophie qui, malgré les maîtres de haut vol dont elle reçut l’enseignement comme Dina Dreyfus et Henri Birault, l’inquiéta par le risque de verbalisme qui menace toujours cette discipline. Elle se tourna, pour cette raison vers Sciences-Po où les études la déçurent pour une raison inverse : l’absence totale d’ambition intellectuelle des enseignants et un pragmatisme peu engageant. Il fallait donc allier les deux : la recherche spéculative et l’attachement à l’expérience. « Il ne s’agissait pas de renoncer à la philosophie, mais d’essayer de partir de la connaissance de la réalité sociale pour éclairer des questionnements philosophiques » (p. 34). Tout se passerait donc comme si la sociologie était la vérité de la philosophie ce qui, à tout le moins suppose, que celle-là ne peut ignorer celle-ci. Ce n’est en tout cas pas un hasard si, jusqu’à Bourdieu, les sociologues français eurent une formation philosophique. Nous tâcherons de revenir un peu plus loin sur cette question. Quant à l’autre obstacle, il tient à ce qui fut d’abord une chance : la rencontre avec Pierre Bourdieu lequel put créer, grâce à Raymond Aron, ce qui faisait défaut jusqu’alors, à savoir un centre de recherche sociologique. Le vide académique et l’absence de moyens pour des investigations véritables étaient enfin surmontés. Cependant, le glissement progressif de Bourdieu vers le dogmatisme, l’intolérance, la vassalisation de la sociologie à l’égard de stratégies politiques mais, aussi, des pratiques intellectuelles guère honnêtes renforcèrent, certes, le désir de Dominique Schnapper de ne pas céder à la tentation d’une explication unique du fait social mais la réduisirent, également, à être marginalisée.
Chapitre 2. Indifférente, par goût, à tout carriérisme, l’objectif principal, pourtant, de si nombreux universitaires, elle put, en un sens, d’autant plus profiter de sa mise à l’écart par les autres sociologues que l’amour conjugal et le bonheur familial faisaient contrepoids. Par ailleurs, ses activités de chercheuse et d’enseignante au sein du Centre de recherches historiques dirigé par François Furet la comblaient. Ces conditions furent favorables au développement de ses apports propres à la sociologie. Pour en citer quelques uns : double refus d’écarter les statistiques et de ne s’en tenir qu’à elles, nécessité, donc de ne pas mettre hors circuit la réflexion, même philosophique (p. 76) ; importance de l’histoire pour comprendre l’imprégnation par le social de la vie des individus et impossibilité d’appréhender la nature de différentes identités (immigrés, juifs, chômeurs) sans voir qu’elles ne peuvent former des communautés autonomes en raison de la dimension politique des hommes dans les sociétés démocratiques modernes. Nous écrivions : « en un sens » car il ne faut pas oublier, qu’après 1968, les acteurs dominants du monde académique, communistes ou « gauchistes » d’obédience, ne considéraient pas leurs adversaires comme des personnes avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord mais comme des traîtres et des ennemis. Le jugement était d’ordre moral et l’objectif était de condamner. Dominique Schnapper connut, aussi, pour cela en partie, la dépression. La vie intellectuelle n’est pas coupée de la vie tout court, surtout quand elle rencontre des obstacles qui paraissent insurmontables. La virulence d’une telle époque a disparu, de façon déclarée tout du moins.
Chapitre 3. A partir de 1980, tout change : le milieu intellectuel s’apaise pour des raisons qu’elle analyse, ses travaux commencent à être reconnus par les spécialistes et même au-delà, elle devient directrice d’études à l’EHESS. Elle ne cache pas que la reconnaissance professionnelle donne de l’assurance et que les institutions supérieures ont du bon aussi de ce point de vue. Mais l’événement majeur fut sa nomination à la Commission de la nationalité. Ce fut l’occasion, pour elle, de démontrer scientifiquement, contre bien des préjugés et toute une tradition, qu’il n’y a pas de sociologie qui pourrait ignorer ou prétendre absorber la politique, qu’il y a « une communauté de citoyens » qui transcende tout autre communauté et toute différence économico-sociale même si elle n’existe jamais à l’état pur. Une telle communauté, bien que nécessaire, subit plusieurs menaces : qu’en est-il d’elle quand s’estompe la force des États-nations et quand se développe « la démocratie providentielle » qui renforce aussi bien l’individualisme que le communautarisme ? La démocratie suscite ses propres éléments destructeurs comme Tocqueville l’avait bien mis en évidence. Il n’en reste pas moins que sans lien politique, il ne peut y avoir société. De telles idées, étayées de la façon la plus complète dans divers ouvrages dont plusieurs connurent un succès non négligeable, furent souvent mal perçues : on les taxa souvent de républicanisme partisan et les milieux politiques de bords opposés ne firent que semblant de s’y intéresser. C’est être sociologue aussi que de se mettre, certes, au service de la communauté politique mais de reconnaître, également, que, la plupart du temps, les médias d’une part et les politiques d’autre part ne se soucient guère aisément de la vérité bien qu’ils en aient impérieusement besoin. Il s’agit d’être intellectuellement opiniâtre et non benoîtement optimiste. Sur le plan personnel, cette période fut marquée par le décès des parents et la maladie fatale du mari.
Chapitre 4. Se mettre au service de la société, accepter, par conséquent, de nombreuses fonctions institutionnelles, est une chose, faire de la politique en est une autre. A rebours de ce que pensaient Marx ou Bourdieu mais, aussi, bien qu’en un sens opposé, Raymond Aron (théorie du « spectateur engagé »), le sociologue a pour fonction de comprendre non d’agir. Que cette compréhension puisse ne pas être sans effet est bien sûr souhaitable mais ce n’est pas son affaire. Ce serait plutôt, en principe, celle du citoyen. Justement, ce quatrième chapitre est plus directement consacré à la nature de la sociologie. Dominique Schnapper fait d’abord référence à ses expériences personnelles : sans trop d’illusions sur son rôle au sein du Conseil constitutionnel, elle vit qu’elle pouvait l’étudier, s’aperçut que des hommes pourtant très politisés subissaient la contrainte du droit et, comme membre du jury décernant le prix Balzan, elle put constater de près l’influence des préjugés nationaux même sur de grands chercheurs et comment le sérieux académique peut malgré tout se manifester. Mais elle se réfère surtout à cet ouvrage auquel elle tient tant : La Compréhension sociologique. Face à la pure théorie d’une part et l’amateurisme des essais brillants d’autre part qui tout deux sont aveugles à l’égard de leurs conditions socio-historiques propres, elle défend la nécessité d’analyser les conduites humaines à partir d’idéaux-types (notion élaborée par Max Weber) bien construits et d’enquêtes, éventuellement renforcées par des statistiques, qui permettent de les faire varier, parfois de les corriger, en tout cas de les incarner. L’idéal-type peut être un concept comme la pauvreté ou « une individualité historique » comme le capitalisme ou la société industrielle. Il ne s’agit là ni de réalités ou de principes indépassables mais de moyens de réflexion. C’est une affaire de méthode.
Chapitre 5. Il est question du passé, du futur et du présent dans ce dernier chapitre. A propos du premier, Dominique Schnapper se réfère à l’héritage intellectuel de Raymond Aron mais, aussi, à celui de son mari qui a pu participer à la formation de nombreux étudiants. Antoine Schnapper a contribué, grâce à son travail et à sons sens de l’indépendance, à développer l’histoire de l’art, expression à deux termes : il fut à la fois historien et « connaisseur » des œuvres. Il était, ainsi, aux antipodes des Voix du silence. Pour ce qui est du futur, nécessairement prospectif, l’auteure se montre modeste et prudente. Elle a le sentiment d’avoir favorisé le sens de la rigueur en sociologie sans, pour autant, faire école mais elle se demande, également, si la « démocratisation de l’enseignement » ne se traduit pas par une baisse du niveau du débat public. Le présent, marqué par le chagrin et la difficulté de vivre seule mais, aussi et encore, le travail, le lien à double sens avec les enfants et les petits-enfants, l’amitié est, entre autres choses, l’occasion de conduire une réflexion sur sa vie : était-elle comme prédestinée à être ce qu’elle est, pour des raisons sociales notamment, ou bien a-t-elle pu devenir elle-même grâce à la rencontre de celui qui allait être son mari ? C’est indécidable même si la seconde solution a sa préférence. Il est difficile d’être dogmatique avec la vie. La sociologie a sans doute besoin de cette précaution philosophique si facilement négligée.
On ne peut parler de ce livre sans s’arrêter sur son titre, inspiré d’une phrase de Freud : Travailler et aimer. La première notion offre plusieurs niveaux de lecture. Il y a, d’abord, un niveau purement personnel. Dominique Schnapper a toujours aimé travailler. Pour elle, le travail intellectuel est source de bonheur alors même qu’il suppose tout une discipline de vie marquée par l’habitude certes, mais pas l’austérité. Hors de question, par exemple, de travailler le soir. Entre le rigorisme monacal et le désordre romantique, une tout autre voie existe. On peut trouver là une bonne protection contre « l’angoisse existentielle » (p. 216) qui ne serait donc, le plus souvent, que le résultat de la paresse. Il y a, ensuite, un niveau purement sociologique : à l’encontre de l’idéologie de la « fin du travail » (cf. la fin du chapitre 2 et Contre la fin du travail), elle démontre que les sociétés démocratiques modernes impliquent une communauté de travailleurs : comment prendre part à la société politique si l’on perd la dignité que seul le fait de travailler confère ? Si l’on ne veut plus de travailleurs autant dire qu’on ne veut plus de démocratie. Il faut être conséquent. En filigrane, il faudrait, enfin, tenir compte du niveau philosophique : que serait une vie humaine sans travail ? Mais si une vie sans travail est terrible – celle qui s’est tant préoccupée de la situation des chômeurs en sait quelque chose -, une existence sans amour l’est tout autant. Travailler sans aimer est aussi inenvisageable qu’aimer sans travailler. Là encore le romantisme a tort. Seulement, ce n’est pas parce qu’ils sont indissociables qu’ils sont identiques. Leur lien ne se laisse comprendre que sur ce fond de non-identité : une conjonction de coordination les relie et les distingue. « Et » n’est pas « est ». Même si on peut aimer travailler, on ne travaille pas plus à aimer qu’on ne travaille sous la seule influence de l’amour. L’amour est-il, pour autant, pure grâce ? N’y a-t-il pas entre amour et travail un rapport plus profond ? Ce livre de Dominique Schnapper nous fournit des éléments. Sa propre vie montre d’abord que, sans travail, elle n’aurait pu s’accorder avec ce grand travailleur que fut son mari. Ensuite, c’est justement en privilégiant le travail, notamment intellectuel, que bien des obstacles à l’amour et à l’amitié sont levés comme la jalousie professionnelle ou le carriérisme. Elle eut le bonheur de ne pas les connaître en un milieu où ils règnent souvent en maîtres. On ne peut être l’ami d’âmes impures. Enfin, justement parce que le travail a été au centre de la vie familiale dès l’époque de ses parents, il n’y a jamais eu de contradiction entre les deux : préférer l’intérêt de ses enfants à telle perspective de carrière ou même à un travail quelconque n’a jamais été un sacrifice (p. 212-213). L’amour et le travail se renforcent l’un l’autre quand ils ne s’opposent pas et ils ne s’opposent pas quand ils sont au centre de la vie.
Seulement, pour en arriver-là, l’auteure précise qu’elle a pu bénéficier d’une éducation qu’elle qualifie elle-même de « bourgeoise » tempérée par un humour tout britannique. La sociologie aurait-elle donc le dernier mot ? Elle rappelle, cependant, qu’au sein de la bourgeoisie, la carrière académique et, plus encore, l’ambition purement intellectuelle ne sont guère prisées. Elle a donc obéi à une exigence plus élevée et, pour cela même, plus universelle. Nous voulons croire que c’est celle des philosophes. Ainsi y a-t-il des gens qui demeurent philosophes tout en faisant autre chose que de la philosophie et dans cela même qui diffère de la philosophie – dans la sociologie par exemple, quand d’autres ne feront jamais de philosophie bien qu’ils s’en réclament.
Alain Champseix