Jean-Michel Le Lannou, L’Excès du représentatif, Hermann 2015, lu par Jean Colrat
Par Michel Cardin le 03 juillet 2019, 06:00 - Philosophie générale - Lien permanent
 Jean-Michel Le Lannou, L’Excès du représentatif, coll. « Philosophie », Hermann Éditeurs, octobre 2015 (98 pages). Lu par Jean Colrat.
Jean-Michel Le Lannou, L’Excès du représentatif, coll. « Philosophie », Hermann Éditeurs, octobre 2015 (98 pages). Lu par Jean Colrat.
L’ouvrage que Jean-Michel Le Lannou a publié en octobre 2015 est la meilleure introduction à la connaissance de son œuvre en même temps qu’une forme d’accomplissement d’un travail ambitieux.
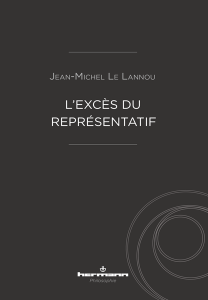 L’auteur s’impose désormais comme une pensée originale dans le champ de la philosophie française, comme avait su le reconnaître le colloque qui lui fut consacré en 2012 à l’ENS-Ulm[1]. Il s’agit de son cinquième ouvrage, toujours aux éditions Hermann, depuis La Puissance sans fin (2005), et déjà un sixième opus est à ajouter, paru il y a quelques jours. Cette voix semble avoir atteint son plan de fertilité, où elle se déploie maintenant en restant toujours au plus près de ce qui fait son souffle, aisément identifiable. Elle s’impose avec assurance, comme le montre ce nous par lequel elle s’exprime souvent, qui n’est pas seulement un nous d’auteur mais un nous plus vaste qui prétend valoir pour une époque.
L’auteur s’impose désormais comme une pensée originale dans le champ de la philosophie française, comme avait su le reconnaître le colloque qui lui fut consacré en 2012 à l’ENS-Ulm[1]. Il s’agit de son cinquième ouvrage, toujours aux éditions Hermann, depuis La Puissance sans fin (2005), et déjà un sixième opus est à ajouter, paru il y a quelques jours. Cette voix semble avoir atteint son plan de fertilité, où elle se déploie maintenant en restant toujours au plus près de ce qui fait son souffle, aisément identifiable. Elle s’impose avec assurance, comme le montre ce nous par lequel elle s’exprime souvent, qui n’est pas seulement un nous d’auteur mais un nous plus vaste qui prétend valoir pour une époque.
Les premières lignes d’un article consacré à Bachelard et Bergson exprimaient de façon serrée l’intuition centrale de cet œuvre : « Il y a en nous, et c'est la tâche de la philosophie que de le reconnaître, un désir qui ne s'arrête pas à la déficience que nous sommes. Surgissant, il fait paraître notre identité, de fait, ou supposée - être homme - comme restrictive. Que sommes-nous selon lui ? La limitation qu'il aspire à dépasser. À l'humain, en accueillant le désir de l'immensité, nous découvrons que nous ne nous réduisons pas. Qu'exprime cette aspiration ? L'espoir de déposer l'humain dorénavant éprouvé comme détermination, momentanée et surtout trop étroite. Que nous apprend cette exigence ? Que nous n'existerons véritablement que dans et par la fidélité à cela qui, en nous, tend au dépassement de toute restriction[2]. » Nous sommes le lieu d’un désir infini qui tend à dépasser tout ce qui pourrait prétendre le contenir, y compris notre identité d’homme. L’Excès du représentatif reprend cette intuition centrale et fait de la représentation, toujours particulière et particularisante, la matrice de toute limitation. Ce titre doit donc s’entendre en un double sens, dont l’affirmation croisée trame l’ouvrage : le représentatif est excessivement dominant et contre cela, nous devons être capable d’excéder le monde de la représentation - et l’on pourrait certainement dire selon l’auteur : excéder le monde, c’est-à-dire la représentation.
Chapitre 1 : Représentation/désir
L’Excès du représentatif énonce dès l’ouverture cette thèse : « En notre véritable désir nous aspirons à la puissance » (p. 5). Rien de fini ne saurait satisfaire le désir humain, dont la vérité serait plutôt une essentielle insatisfaction : aussi nombreuses que soient les conquêtes de nos désirs, leur somme ne fera jamais assez. Le désir est infini, il n’est désir qu’à l’être infiniment. L’immensité et l’intensité, quasi concepts chez l’auteur, sont les modalités du désir. Qu’il puisse se satisfaire de quelque figure, finie, toujours particulière, est moins le signe de la puissance de cette figure que de l’impuissance de ce désir. Le Lannou pourrait emprunter à Raoul Vaneigem son titre Nous qui désirons sans fin, mais ce serait pour voir dans ce sans fin le débordement de tout objet fini par le désir, et non le passage incessant d’une figure désirée à une nouvelle, toujours insatisfaisante, enfermée dans l’ordre du fini que le désir immense transgresse.
L’Excès du représentatif est écrit contre tout ce qui peut prétendre satisfaire le désir, contre tout consentement au fini : l’image, la figure, la représentation. À toute critique, hégélienne par excellence, qui opposerait qu’il n’y a de désir que de la particularité finie, seule réelle, l’auteur oppose qu’une telle thèse loin de justifier l’amour du fini n’en est que la conséquence auto-légitimatrice. Certes, la possibilité pour le vivant de s’arrimer à la vie suppose un resserrement initial sur les besoins particuliers, mais le désir devient adulte et même trans-humain à proportion de son pouvoir de transgresser toute particularité dans laquelle il pourrait se complaire[3]. Ce refus de tout ce qui pourrait réduire l’être désirant à la culture de ses propriétés est bien davantage que la pluralisation des moi, c’est un principe de dés-individuation ou d’impersonnalisation. Ravaisson plutôt que Taine, pour inscrire l’auteur dans une lignée qu’il revendique. Le Lannou va jusqu’à considérer que cette libération du désir dans sa puissance peut seule prétendre avoir valeur de révolution, dans des pages qui font lointainement écho au Marcuse de L’Homme unidimensionnel. En attendant que cette révolution prenne un sens politique, c’est l’art et la philosophie qui sont les possibilités essentielles de l’excès du représentatif : « Refusant l’enfermement dans la représentation, art et philosophie ouvrent, en leurs pratiques spécifiques, la nouvelle aspiration à l’intensité » (p. 37). Les deux chapitres suivants vont le montrer.
Chapitre 2 : Représentation/art
Le deuxième chapitre veut montrer comment l’art, qui fut - et reste - le plus souvent dévoué à l’amour des représentations finies, des images, peut être aussi une des plus hautes possibilités pour le désir d’immensité. Selon la logique de son essai, Le Lannou oppose amour de l’image et amour de l’art, figure et forme : « Le refus de figurer, l’abandon des images, instaure l’art. Telle en est même la définition : est art ce qui se refuse à la figuration » (p. 34). Il l’est sous la forme de l’abstraction la plus radicale, c’est-à-dire la plus formelle. C’est ce qui était déjà apparu dans La Forme souveraine[4], et Soulages était alors la référence principale parce que sa peinture s’est d’emblée établie loin de l’image, toujours particulière, à la différence des pionniers de l’abstraction (Kandinsky, Mondrian ou Malevitch) qui avaient dû dépasser dans leur œuvre leurs propres commencements figuratifs. Avec Soulages, un tableau n’est jamais un signe, pas même un signe abstrait, comme c’est le cas avec ce symbolisme abstrait dont Maurice Denis donnerait le coup d’envoi. La peinture répond au désir infini, excède le représentatif, lorsqu’elle est véritablement abstraite. C’est ce que veut établir ce chapitre.
Depuis la Poétique, il est établi selon Le Lannou que l’art doit être image, signe d’une absence, soumission du visible à un sens invisible au profit duquel il devrait se nier : « le désir de représentation, celui de la fiction, exprime l’amour non de ce qui est, non de la présence, mais de ce qui n’est pas. Aimer les images, c’est aimer la fiction, c’est ainsi aimer le néant » (p. 41). Amour des images, désamour du sensible. Cet amour ou ce désir de la représentation sont les formes morbides du désir : « Qu’aime-t-on en aimant les figures ? Les traits ontologiques propres à la représentation, ceux de la déficience et de la faiblesse. En la désirant, on veut tout autant la séparation que l’extériorité, la transcendance que l’impuissance. Tous les traits opposés à l’intensité et à l’immensité » (p. 44). Ou plus nettement : « la vie aime son absence, c’est-à-dire la représentation » (p. 51). Après avoir montré comment un art qui se prétend au service de la vie qu’il porterait à la représentation reste rivé à l’impuissance parce qu’il est représentatif (critique de Michel Henry et de Kandinsky), Le Lannou affirme que si c’est dans la musique surtout que l’on peut espérer sortir du représentatif et du signifiant, la peinture peut échapper à l’impératif représentatif et devenir une expérience de pleine présence, lorsqu’elle est capable de devenir productrice de « formes pures », c’est-à-dire selon l’auteur de formes délivrées du souci de signifier un non-sensible absent, formes entièrement affirmatives de leur présence sensible. À ces formes seulement devrait revenir le nom d’art, qui désigne alors une puissance opposée à la fiction et à la représentation. Elles luttent contre l’ordre quotidien du visible, toujours pris dans un processus de signification, pour enfin donner au désir d’intensité une évidence sensible à la mesure de son infini besoin : « l’art opère l’intensification du sensible, en le faisant échapper à la déficience du représentatif » (p. 62). La musique, davantage que les arts plastiques, en donnerait l’expérience dans la mesure où elle serait par nature étrangère à la signification et à la représentation, alors que la peinture et la sculpture ont dû s’en libérer et ne sont devenues pleinement art qu’en devenant abstraites.
L’esthétique de Le Lannou est une anti Poétique, qui 1) pose que le texte d’Aristote élève en norme notre goût excessif pour les images, 2) fait de l’image le lieu d’une déficience et 3) affirme, pour en finir avec le pseudo-art mimétique, la possibilité d’un sensible pur, dont le formalisme radical, plus musical encore que plastique, serait la voie dégagée. Chacune de ces trois affirmations peut faire problème, mais leur association construit une théorie de l’art affirmée, identifiable et indissociable d’une philosophie, comme c’était le cas avec Ravaisson dont l’auteur prolonge ici souvent l’esthétique. Mais, à la différence du spiritualiste français conservateur au Louvre, ce n’est plus dans l’expérience, largement fantasmée, de la statuaire antique que le désir d’infini trouve sa possibilité, mais du côté de l’abstraction formelle la plus radicale. C’est Mondrian plutôt que la Vénus de Milo : « Le Home ne doit plus être plastiquement fermé, séparé. La rue non plus. Bien qu’ils aient une fonction différente, ils doivent former une unité […] il faudra considérer le Home et la rue comme la ville, qui est une unité formée de plans composés dans une opposition neutralisante par laquelle toute séparation et exclusion est annihilée […] Et l’homme ? Il ne doit être rien en soi, lui non plus, mais une partie du tout. Ainsi, oubliant son individualité, il vivra heureux dans ce paradis créé par sa volonté[5]. »
Chapitre 3 : Représentation/philosophie
« Dans le penser, la révolution qui libère du figuratif produit la philosophie » (p. 36). Comme l’art dans l’ordre du paraître sensible, la philosophie est l’excès du représentatif dans l’ordre du penser. C’est ce que veut établir le troisième et dernier chapitre. Il le fait aussi radicalement que le chapitre précédent affirmait qu’il n’y a d’art que purement formel : il n’y aurait de pensée philosophique que par « l’abandon du désir de représentation » (p. 69). Autrement dit : penser n’est pas représenter, et cela se produit dans la philosophie. La thèse, au sens fort du terme, est ici évidemment un refus de toute philosophie de la conscience, mais elle est davantage : l’intempestive affirmation d’un idéalisme absolu, qui fait système. Toute particularité finie, toute figure, toute représentation n’est qu’un aspect momentané d’une puissance infinie que la pensée doit savoir laisser se déployer : « L’excès du représentatif conduit comme à sa vérité à l’exigence d’impersonnalisation » (p. 92). Le Lannou s’inscrit dans la continuité de Plotin, de Leibniz affirmant que « les corps ne sont que des esprits momentanés » ou, encore, de Ravaisson : « Au pôle supérieur de l’absolue activité, comme au pôle inférieur de la passivité absolue, la conscience, ou du moins la conscience distincte, n’est plus possible. Toute distinction et toute science s’absorbent dans l’impersonnalité[6]. »
« Philosopher est pour se défaire de soi, pour se supprimer en tant que fini » (p. 85). Penser s’accorde alors à l’infinité du désir, il est cette infinité pensante. Il serait insensé de prétendre par là-même cesser d’être effectivement la particularité, l’ensemble des propriétés, que nous sommes. Il s’agit de légitimer l’insatisfaction de principe face à toute finitude, légitimer le désir infini, intense, immense : « Nous préférons le désir d’immensité à la particularité que factuellement nous sommes » (p. 91). Affirmer cela, savoir l’imposer dans l’ordre du discours, serait l’activité philosophique. Si thèse il y a, c’est la position d’un désir qui veut ici s’affirmer dans une irrécusable légitimité. Dans ses dernières pages, L’excès du représentatif peut se lire comme tentative d’excéder le Phèdre. Si le désir doit savoir trouver en lui la force de dépasser l’amour des corps particuliers (corps vivants mais ici aussi bien corps des images), ce n’est pas pour se satisfaire de l’amour des idées, encore particulières et représentatives, mais pour se porter au-delà, jusqu’au désirer infiniment. Là seul le désir est vraiment désir, c’est-à-dire infini, et peut prendre son vrai nom : amour (si l’on pose qu’il n’y a d’amour qu’infini). Quand penser devient amour infini de l’être infini, alors s’accomplit l’idéalisme absolu en lequel être et penser coïncident. La philosophie serait la pensée quand elle devient cette auto-affirmation de l’infini.
Si l’ouvrage est ambitieux et intempestif, c’est parce qu’il pose une définition exclusive de ce que doit être penser ou philosopher. Intempestif car l’œuvre de Le Lannou apparaît désormais comme l’héritière d’un certain idéalisme dont on croyait que Ravaisson avait donné les derniers mots : « Tout tend à l’union, à l’unité, quoiqu’en passant par la distinction. C’est qu’au fond tout est un […] et que les choses vont de l’unité à l’unité. Une unité qui spontanément se partage pour se reprendre et se reconstituer. Ainsi se reproduit dans la nature entière le développement de l’activité primordiale pour le rétablissement final du mystérieux un-multiple dans un mariage sacré[7]. » Ambitieux parce que, contre Hegel et peut-être Ravaisson, il ne veut pas même concéder à l’amour du particulier la nécessité pour l’être de se particulariser, et refuse d’y voir autre chose qu’une concession à soi-même d’un amour impuissant. Pas la moindre faveur n’est accordée au travail du négatif. C’est le plus singulier dans cet ouvrage, une forme de défi que la très récente publication de La Puissance d’être vient relever.
Jean Colrat
[1] Forme et infini. Etudes sur la philosophie de Jean-Michel Le Lannou, dir. Alexandre Lissner et Alexandre Cohen, Paris, Hermann, 2013.
[2] Le Lannou Jean-Michel, « Bergson et Bachelard », in Bachelard et Bergson, dir. Frédéric Worms et Jean-Jacques Wununberger, Paris, Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2008, 306 pages, p. 73.
[3] La Puissance sans fin (Paris, Hermann, 2005) s’interrogeait sur ce qui pourrait s’annoncer d’une telle libération du désir dans le développement de la techno-science.
[4] La Forme souveraine. Soulages, Valéry et la puissance de l’abstraction, Paris, Hermann, 2008.
[5] Piet Mondrian, « Néoplasticisme. Le Home – La rue – La ville », in Internationale Revue i10, 1927 (texte daté 1926) ; repris dans Les ateliers de Mondrian, dir. Cees W. de Jong, Paris, Hazan, p. 140-153 ; ici p. 153.
[6] Ravaisson, De l’habitude, [1838], Paris, Rivages Poche, 1997, p. 66.
[7] Testament philosophique, dans Revue de métaphysique et de morale, janvier 1901, Paris ; cité ici in Paris, Allia, 2008, p. 41.