Seidengart Jean (dir.), Vérité scientifique et vérité philosophique dans l’œuvre d’Alexandre Koyré, Les Belles Lettres, 2016, lu par Jonathan Racine.
Par Baptiste Klockenbring le 19 octobre 2018, 06:00 - Épistémologie - Lien permanent
Lorsque l’on cite Koyré, on se réfère d’abord, incontestablement, à des travaux d’histoire des sciences : les Etudes galiléennes, par exemple. Mais les ouvrages de Koyré ne sont pas seulement une source d’information extrêmement précieuse dans ce champ très technique qu’est l’histoire des sciences. L’auteur défend constamment une thèse, qui est rappelée dans l’introduction de cet ouvrage collectif : le caractère inséparable de la science et de la philosophie (p. 10).
C’est cette thèse qui permet de comprendre que le célèbre ouvrage Du monde clos à l’univers infini comporte des analyses aussi bien de Galilée et Newton, que de Nicolas de Cues et Giordano Bruno.
Les spécialistes d’histoire des sciences discutent depuis longtemps les analyses de Koyré, et l’on sait que certains points ont fait l’objet de profondes révisions, par exemple le statut de l’expérience chez Galilée : les travaux de S. Drake, notamment, semblent invalider définitivement l’idée que les expériences de Galilée devraient le plus souvent être considérées comme des expériences de pensée.
Mais au-delà de ces discussions, il faut se confronter au véritable discours philosophique de Koyré : bien saisir la portée philosophique de ce discours, tel me semble un des intérêts de cet ouvrage, particulièrement bienvenu alors que la seule monographie consacrée à Koyré en français semble être celle de G. Jorland, parue en 1980.
Etant donné ce que l’on vient de rappeler concernant le caractère inséparable de la science et de la philosophie, on pourra considérer le découpage de l’ouvrage quelque peu artificiel : la première partie est intitulée « Koyré philosophe », et la troisième « Koyré historien de la philosophie », seule la seconde s’occupant apparemment de « philosophie et histoire des sciences ». Mais cela est de peu d’importance dans la mesure où chaque article possède son unité, et où il est bien question, à chaque fois, de science et de philosophie.
Le premier chapitre, « Entre-deux-guerre : Koyré en France, en Allemagne et dans d’autres contextes », a un statut un petit peu particulier par sa dimension biographique : l’article souligne l’importance du séjour à Göttingen où il côtoie Husserl et des disciples de celui-ci comme Scheler ; mais c’est à Paris, après sa thèse d’Etat sur Boehme, que Koyré devient un historien des sciences dans les années 30. On se rend compte que ses thèses les plus caractéristiques sont élaborées à cette période, comme en témoigne ce passage d’une conférence de 1936 : « à l’espace physique d’Aristote se substitue l’espace abstrait de la géométrie (espace archimédien) et le cosmos de la physique médiévale disparaît. C’est cette transformation des fondements qui permet et provoque l’éclosion de la physique classique (galiléenne et cartésienne) et non le donné expérimental, qui d’ailleurs n’est aucunement augmenté » (De la mystique à la science. Cours, conférences et documents, p. 39, cité p. 28)
Néanmoins les contacts avec l’Allemagne, ainsi que les liens avec Scheler, conservent toute leur importance. Pour l’auteur de ce chapitre, c’est la fréquentation de Scheler qui aurait « porté Koyré à s’intéresser à la sociologie de la connaissance », et « qui a contribué aussi à faire de Koyré un historien de la science analytique, rigoureux, mais également capable de replacer les théories dans le contexte social de leur époque » (p. 46).
Kojève constitue une autre rencontre importante faite lors de voyages en Allemagne. Tous deux ont collaboré à la Zeitschrift für Sozialforschung, la revue fondée par Horkheimer. On y découvre que Koyré maîtrise parfaitement les problématiques sociologiques : il publie ainsi dans cette revue un Bilan de la sociologie française contemporaine (p. 52).
L’article se conclut sur l’activité militante de Koyré face l’antisémitisme.
Le deuxième chapitre, « Unité de la pensée et intuition ontologique », est dû à G. Jorland, dont j’ai rappelé qu’il était l’auteur d’une monographie sur Koyré. Le titre de l’article s’inspire d’un extrait du texte de candidature au Collège de France : « dès le début de mes recherches, j’ai été inspiré par la conviction de l’unité de la pensée humaine, particulièrement dans ses formes les plus hautes » : ces formes les plus hautes, ce sont la philosophie, certes, mais aussi la religion et la science. Selon l’auteur, c’est à l’occasion de sa thèse de doctorat sur Boehme qu’il en vient à concevoir l’unité de la pensée comme unité de la théologie, de la philosophie et de la science. Il faut souligner la portée anti-positiviste de cette approche unitaire : « ce que le positivisme étalait dans la diachronie comme autant de stades de l’évolution de la pensée, la théologie, la métaphysique et la physique, Koyré a entrepris de l’embrasser d’un même regard dans la synchronie » (p. 62). On entrevoit une des thèses qui sous-tend tous les travaux d’histoire des sciences de Koyré : une pensée scientifique se déploie toujours à l’intérieur « d’un cadre d’idées, de principes, d’évidences axiomatiques, qui appartiennent en propre à la philosophie » (p. 62). D’où l’impossibilité de séparer la science de la philosophie.
Appelons ces idées et principes une intuition ontologique. Dès lors, « le travail de l’historien, quelle qu’en soit la discipline, revient selon Koyré à ressaisir l’intuition ontologique d’un penseur, qu’il soit mystique, philosophe ou scientifique, et à reconstruire sa pensée à partir de là » (p. 63).
L’auteur propose ensuite d’examiner la mise en œuvre de cette affirmation : il présente tout d’abord des exemples étudiés par Koyré lui-même, Galilée et la loi de la chute des corps, et Descartes et le principe d’inertie. Puis il nous propose l’application de cette démarche à trois autres exemples, en s’efforçant de ressaisir l’intuition ontologique de Lavoisier, de Marx et de Pasteur.
Dans le troisième chapitre, A. Angelini part d’une conférence peu connue de Koyré sur Jean Hus (publiée seulement en 2008), pour effectuer, selon le titre du chapitre, un « parallèle méthodologique entre l’histoire des sciences et l’histoire des idées ». Pour effectuer un tel parallèle, l’auteur cite un passage de l’essai de Koyré « La gravitation universelle, de Kepler à Newton » (dans les Etudes newtoniennes) : « pour l’historien de la pensée scientifique, l’échec est souvent plus instructif encore que la réussite, car ce sont seulement ces ratages qui nous permettent de nous apercevoir de l’existence, de la puissance, des résistances qu’il a fallu surmonter » (Etudes newtoniennes, p. 11, cité p. 79). On peut appliquer à Hus cette vision de l’histoire comme « entrelacement d’idées, à l’intérieur duquel l’importance historique des vaincus n’est pas moindre que celle des vainqueurs » (p. 79).
La suite de l’article expose comment, selon Koyré, ce « théologien modeste » a subverti l’ordre médiéval.
Le quatrième chapitre s’intéresse à la discussion par Koyré d’un texte de P.-M. Schul, Machinisme et philosophie, discussion que l’on trouve publiée dans les Etudes d’histoire de la pensée philosophique dans l’article « Les philosophes et la machines », et qui est prolongé dans l’important article « De monde de ‘l’à-peu-près’ à l’univers de la précision ». Alors que dans le premier article, Koyré entretient une distance mesurée à l’égard de l’analyse « psychosociologique » de l’émergence du machinisme que propose Schul, à laquelle il reconnaît néanmoins « une grande part de vérité » (Etudes d’histoires de la pensée philosophique, p. 323), dans le second article, le propos se place, nous dit l’auteur, « au-delà de toute perspective psychosociologique » (p. 107). Que faut-il entendre par ‘psychosociologique’ ? Schuhl s’intéresse à un changement de mentalité à l’égard des arts mécaniques, dont les protagonistes peuvent être aussi bien les bâtisseurs de cathédrales, que Léonard de Vinci, Boyle ou Diderot.
Pour quelles raisons le machinisme n’est-il pas né en Grèce il y a vingt siècles ? Est-ce une question de mentalité et que faudrait-il entendre par là ? La réponse se trouve-t-elle dans des analyses sociologiques sur la renaissance des villes et le développement des arts ? Koyré change de perspective en affirmant que « la science grecque ne pouvait pas donner naissance à une technologie véritable » (Koyré, cité p. 108) parce qu’il lui manque une physique véritable. Cela tient à l’importance de la division entre monde sublunaire et monde supralunaire : « le monde moderne accomplit un véritable geste révolutionnaire lorsqu’il se propose d’étendre le concept de la mesure et donc de la précision au monde sublunaire » (p. 109). Si la révolution technologique est dépendante de cette révolution scientifique, par contre « la pensée technique du sens commun ne dépend pas de la pensée scientifique » (Koyré, cité p. 109).
La suite de ce chapitre confronte l’analyse de Koyré, qui met en œuvre une histoire ‘immanente’ de la science, à celle de Kuhn, autour notamment de la contribution de Bacon et la place à accorder au contexte culturel.
Ce chapitre nous introduit déjà à ce qui est le thème de la seconde partie, qui mérite bien d’être centrale : l’histoire et la philosophie des sciences.
Dans le premier chapitre de cette seconde partie, le spécialiste de philosophie médiévale J. Biard s’intéresse à la question du vide au Moyen Âge et au problème continuité / discontinuité en histoire des sciences. Le texte qui est analysé est l’article « Le vide et l’espace infini au XIVe siècle », qui se présente comme une réponse à Duhem. Il s’agit également ici d’interroger cette discussion Duhem / Koyré. Rappelons que Duhem, de manière très provocante, proposait comme date de naissance de la science moderne les condamnations de 1277 d’Etienne Tempier (ces condamnations auraient entraîné une rupture avec l’aristotélisme chez certains auteurs).
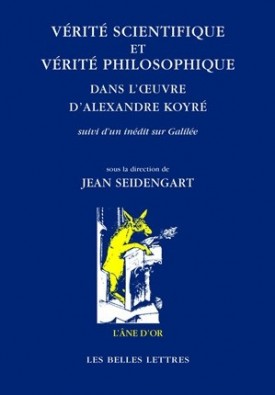 L’article propose de reprendre la question à partir d’un corpus maintenant mieux étudié : Biard reprend en effet, comme il le signale lui-même, des éléments développés dans un volume collectif sur La nature et le vide dans la physique médiévale. En conclusion, l’auteur nous donne une vision plus nuancée de l’aristotélisme médiéval, perçu comme obstacle à la fois par Duhem et Koyré. Cela permet de d’affirmer de manière convaincante que « le long effort de pensée qui précède l’émergence de la science classique ne se réduit pas […] à un face-à-face entre ‘aristotélisme’ et ‘platonisme’ »
L’article propose de reprendre la question à partir d’un corpus maintenant mieux étudié : Biard reprend en effet, comme il le signale lui-même, des éléments développés dans un volume collectif sur La nature et le vide dans la physique médiévale. En conclusion, l’auteur nous donne une vision plus nuancée de l’aristotélisme médiéval, perçu comme obstacle à la fois par Duhem et Koyré. Cela permet de d’affirmer de manière convaincante que « le long effort de pensée qui précède l’émergence de la science classique ne se réduit pas […] à un face-à-face entre ‘aristotélisme’ et ‘platonisme’ »
Dans le deuxième chapitre de la seconde partie, J.-J. Szczeciniarz, à qui on doit un savant ouvrage sur Copernic et la révolution copernicienne ainsi qu’un ouvrage sur le géocentrisme, propose de revenir sur la figure de Copernic dans l’œuvre de Koyré.
Cet article est aussi le lieu de quelques rappels sur la conception de l’histoire, ou plus précisément sur la manière dont, selon Koyré, « l’histoire est le lieu de réalisation de la rationalité » (p. 163).
Brenner mobilise ses compétences sur l’épistémologie française au tournant du 19ème et du 20ème siècle pour s’intéresser au rapport de Koyré avec ses prédécesseurs à travers l’opposition positivisme / réalisme (mais cette thématique reste finalement à l’arrière-plan dans le développement de l’article). Il s’agit donc de contextualiser l’œuvre de Koyré, de la resituer dans l’histoire. L’auteur trouve ainsi chez Tannery (que cite Koyré) l’esquisse d’un « programme que ses successeurs, dont Koyré, s’efforceront de remplir » (p. 174). Après ce rappel, l’article aborde la question incontournable du débat avec Duhem, dont on sait qu’il a minimisé l’importance de Galilée.
A propos de Galilée, Koyré a fortement insisté sur le ‘platonisme’ de celui-ci : l’auteur revient donc sur « le rôle du platonisme en histoire des sciences ».
Enfin il faut se pencher sur les liens avec Bachelard, l’auteur décelant une « alliance [qui] marquera profondément l’épistémologie française dans sa spécificité : platonicienne, réaliste, discontinuiste et historienne » (p. 182).
 L’article de B. Bensaude-Vincent s’intéresse à « Koyré disciple de Meyerson », en rappelant que cette relation à Meyerson est généralement occultée. Elle analyse donc les éléments biographiques attestant de cette relation. On ne saurait minimiser l’importance de cette dette intellectuelle, puisque Koyré semble « attribuer à Meyerson le tournant qu’il effectue au cours de sa carrière de l’histoire des religions vers l’histoire des sciences » (p. 191).
L’article de B. Bensaude-Vincent s’intéresse à « Koyré disciple de Meyerson », en rappelant que cette relation à Meyerson est généralement occultée. Elle analyse donc les éléments biographiques attestant de cette relation. On ne saurait minimiser l’importance de cette dette intellectuelle, puisque Koyré semble « attribuer à Meyerson le tournant qu’il effectue au cours de sa carrière de l’histoire des religions vers l’histoire des sciences » (p. 191).
Mais au-delà de ces données historiques et biographiques, elle relève que Meyerson et Koyré ont en commun d’avoir « tous deux éprouvé la fragilité des distinctions modernes entre science et religion ». Ils partageraient une même conviction concernant l’unité de la pensée humaine, ainsi que l’attention à son cheminement (y compris ses ‘erreurs’).
L’article de Bensaude-Vincent se conclut en émettant un doute, suscité par son analyse des rapports avec Meyerson sur l’unité de la ‘tradition française d’épistémologie’ : « ces deux penseurs immigrés en France brouillent la belle ordonnance du paysage national ». L’article suivant, de Fruteau de Laclos, permet d’approfondir ce point, en mobilisant à nouveau la référence à Meyerson : « Koyré appartient-il à la tradition épistémologique française ? ».
On rappelle tout d’abord que cette ‘tradition épistémologique française’ s’emploie à « rendre raison de l’avènement situé et daté des inventions rationnelles », à l’encontre des approches anhistoriques des savoirs. Dès lors, n’est-il pas évident que Koyré appartient à cette tradition ? Mais l’auteur de l’article entend cerner plus précisément ce qu’il en est des rapports à Bachelard et Meyerson notamment, quitte à revenir finalement sur le caractère ‘français’ de cette approche historique. En effet, après avoir défendu l’image d’un « Koyré meyersonnien » (malgré les critiques de Koyré à l’encontre du continuisme en histoire des sciences), l’auteur dégage « une singulière tradition franco-analytique : Meyerson, Koyré, Kuhn » (p. 213). L’auteur ne s’arrête pas là et prolonge son investigation d’une manière plus surprenante à travers une dernière partie intitulée « la phénoménologie comme méthode d’investigation historique ». Néanmoins, il s’agit d’une « interprétation originale de l’entreprise phénoménologique » : « l’étude des sciences est l’analyse des structures humaines engagées dans les théories, et leur repérage est rendu possible par les innovations husserliennes comprises comme avancées méthodologiques ».
Le rapport à Kuhn, évoqué dans le chapitre précédent, est l’objet central de l’article de M. Ferrari. Celui-ci s’ouvre en rappelant que Kuhn a reconnu sa dette intellectuelle à l’égard de Koyré. Ce qui n’exclut évidemment pas des divergences : les principales concernent tout d’abord la composante expérimentale de la science moderne, minimisée chez Koyré (on se souvient de la formule très frappante : « la bonne physique se fait a priori »), ensuite l’absence d’intérêt, chez Koyré, pour la dimension sociale de la construction scientifique.
Pour préciser les rapports Kuhn / Koyré, il faut évidemment analyser la notion de révolution scientifique. Or si La révolution copernicienne de Kuhn, qui paraît la même année que Du monde clos à l’univers infini, développe des thèmes très proche de ceux de Koyré, il faut noter que La structure des révolutions scientifiques opère un déplacement important par rapport à ce dernier ouvrage. En effet, il ne s’agit plus « d’histoire des sciences au sens de Koyré, mais [d’]une problématisation de la dynamique des théories scientifiques », particulièrement attentive au fonctionnement de la communauté scientifique. Mais cela ne signifie certainement pas que l’influence de Koyré n’est pas présente dans cet ouvrage, comme s’attache à le montrer la fin de l’article.
La troisième partie, « Koyré historien de la philosophie » s’ouvre sur un article de Redondi, auteur d’un livre très remarqué sur Galilée : « Une revanche de Platon laissée dans l’ombre : Koyré et le Dieu de Galilée » (au passage, relevons que le titre de cet article est une parfaite illustration du caractère artificiel d’une séparation entre Koyré historien des sciences et Koyré historien de la philosophie!).
L’idée d’interdépendance entre les concepts philosophico-théologiques et ceux d’ordre physico-mathématique constituerait l’héritage le plus novateur de Koyré – novateur à tel point que Koyré lui-même n’aurait reconnu la valeur de cette intégration entre métaphysique, théologie et science qu’au terme de son parcours. C’est ce qu’il s’agit de montrer en suivant l’évolution de Koyré sur un point particulier, la doctrine galiléenne de la création de l’univers.
Pour traiter cette question, l’auteur remonte à Copernic, où il décèle une nouvelle alliance entre astronomie mathématique et créationnisme chrétien : dans la « proportion mathématique régissant la structure cosmique, Copernic contemple la perfection de la création divine de l’univers » (p. 249). Mais il ne propose aucune hypothèse sur la manière suivant laquelle Dieu a réalisé cette harmonie, tandis que Kepler et Galilée envisageront « des hypothèses précises sur le processus cosmogonique ayant déterminé cette loi proportionnelle fondamentale de l’ordre des planètes ». La section suivante décrit l’usage du Timée par Kepler et Galilée.
Selon l’auteur, Koyré n’aurait tout d’abord vu dans cette cosmogonie platonicienne du Dialogue de Galilée qu’un moyen de combattre la philosophie naturelle aristotélicienne. Puis, il aurait pris de plus en plus au sérieux cette référence platonicienne et l’idée que les considérations de croyance religieuse jouaient un rôle important dans la science galiléenne.
E. Faye nous propose ensuite un article sur « pensée et infini : la lecture philosophique de Descartes par Koyré, son évolution, sa réception et ses enjeux ». Selon lui, il y a une évolution nette, qui n’exclut pas des continuités, dans la façon dont Koyré lit Descartes en 1922 (Essai sur l’idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes) et en 1937 (Entretiens sur Descartes) : dans le premier texte, Descartes est présenté comme un continuateur de la tradition médiévale, dans le second, il fait référence à l’ombre de Montaigne.
A propos du premier texte, Faye souligne que Koyré a le mérite d’envisager Descartes comme un grand métaphysicien (alors que pour Gilson, la métaphysique cartésienne avait surtout une dimension stratégique et instrumentale, visant à rendre acceptable sa physique). Il reproche ensuite à Koyré d’avoir faussé la conception cartésienne de la connaissance de l’être infini, tout en reconnaissant qu’il a perçu ce qu’il y a de novateur dans la pensée cartésienne de la positivité de l’être infini. Le point essentiel est toutefois que Koyré pointe que, chez Descartes, la réflexion sur l’infini porte la marque de ses travaux mathématiques : nous avons ainsi affaire à une interprétation de la pensée métaphysique qui conjugue « l’influence d’une tradition philosophico-religieuse et celle d’une pratique scientifique » (p. 268).
Faye retrace ensuite la postérité curieuse de ce texte, traduit en allemand notamment par Edith Stein et cité par Husserl. Or, c’est précisément la positivité de l’infini mise en avant par Koyré qui inspire la critique de Heidegger par E. Stein. Elle reproche en effet à Heidegger de « recule[r] devant ce qui donne sens à l’être et ce que vise toute compréhension de l’être : l’infini sans quoi rien de fini, ni le fini comme tel, n’est saisissable » (p. 276 – il s’agit d’une citation de Stein, Phénoménologie et philosophie chrétienne, p. 121). La lecture de Koyré aurait également pu influencer Lévinas.
Si en 1922 Koyré insiste sur les rapports entre Descartes et la scolastique médiévale, en 1937 il écrit : « l’adversaire, c’est aussi, et peut-être surtout, Montaigne. » Or, ce qui est récusé sous le nom de Montaigne, selon Koyré, c’est une pensée qui s’en tiendrait à la finitude. Ceci permet à Faye d’établir un lien entre la lecture de Descartes et le rapport de Koyré à la pensée heideggerienne de la finitude.
La lecture de Descartes par Koyré est également au centre de l’article d’A. Guimaraes Tade de Soares sur « Koyré et l’idée de monde chez Descartes ». L’auteur se penche sur l’affirmation de Koyré selon laquelle Descartes opérerait une destruction complète du cosmos. Cette destruction serait corrélative d’un mouvement de retour à soi : « Après Descartes, il faut toujours commencer par la conscience » (p. 293). Et ce retour nous reconduit à Dieu, à l’infini, dont on trouve l’idée dans la conscience. On retrouve l’imbrication des idées scientifiques, religieuses et philosophiques.
Le dernier article du volume est dû au coordinateur J. Seidengart et est intitulé « Le projet philosophique de Koyré : une histoire de la cosmologie scientifique ». La pensée cosmologique classique est en effet un des domaines de prédilection de Koyré, où se manifeste « l’unité de la pensée humaine ». En effet, la révolution cosmologique serait, pour Koyré, à la fois « le point de départ et le point d’arrivée d’une transformation d’ordre intellectuel […], qui est survenue dans la manière de penser les rapports de l’homme à Dieu et à l’univers » (p. 304).
Quant à la caractérisation de la révolution cosmologique constitutive de l’instauration de la science moderne, Koyré retient deux critères bien connus : la destruction du Cosmos fini et géocentrique ; l’infinitisation et la géométrisation de l’espace physique. Or ces deux critères, bien qu’énoncés dans Du monde clos à l’univers infini, « ne sont pas directement présent à l’œuvre chez les auteurs qu’il évoque dans sa célèbre synthèse » (p. 306). Plus que de critères, il faudrait y voir « deux termes extrêmes qui viennent délimiter ou encadrer […] son histoire de la cosmologie classique ». L’auteur repère alors une tension entre « ses études historiques particulières et sa philosophie générale de la science classique ».
La suite de l’article nous propose un rappel de quelques traits essentiels de l’histoire de la révolution cosmologique selon Koyré, un rappel qui ne cache pas que les analyses de l’ouvrage Du monde clos à l’univers infini peuvent nous laisser perplexes dans la mesure où la révolution scientifique peut y apparaître « introuvable » selon un mot de Coumet.
L’article se termine en se posant la question de savoir « si Koyré voyait dans la science contemporaine un simple prolongement de la révolution scientifique des 16ème et 17ème siècles ». La question se pose dans la mesure où Koyré semble avoir considérablement minimisé l’importance de la coupure épistémologique effectuée par la physique du 20ème siècle. Koyré tient ainsi à considérer la physique d’Einstein comme inspirée par une méditation métaphysique, comme cela pouvait être le cas pour Leibniz, par exemple. Néanmoins l’auteur nous rappelle que la pensée de Koyré reste nuancée quant au problème de la continuité : « n’est-il pas vain, en général, de vouloir établir, dans la continuité du devenir historique, des divisions quelconques ? […] Il ne faut pas, cependant, abuser de l’argument de la continuité » (Koyré cité p. 318).
Le volume se clôt avec un inédit de Koyré présenté par J. Seidengart. Il s’agit d’un cours sur Galilée, donné au lycée Louis-le-Grand en 1946, donc à une époque où Koyré a déjà publié ses travaux érudits sur Galilée.
En conclusion, ce volume est une mine d’informations dans la mesure où il contient non seulement des présentations et des discussions subtiles des travaux de Koyré et de l’élaboration progressive de sa pensée, mais également des éléments de réflexion stimulants sur des penseurs comme Meyerson, par exemple.
Jonathan Racine.