John Stuart Mill, Sur le Socialisme, Belles Lettres 2016, lu par Jean-Baptiste Bertin
Par Florence Benamou le 19 juillet 2017, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
John Stuart Mill, Sur le Socialisme, trad. Michel Lemosse, bibliothèque classique de la liberté, Les Belles Lettres, Paris, 2016.
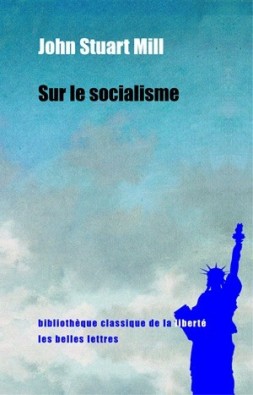
En début d’année, les éditions Les Belles Lettres ont publié la première traduction française d’On Socialism, bref texte posthume paru en 1879, 6 ans après la mort de John Stuart Mill, qui regroupe les notes rédigées à partir de 1869 par le philosophe anglais en vue d’un ouvrage de fond sur le sujet, qu’il n’aura pas le temps de terminer. Entre notes de lecture et ébauches de chapitres, qu’il aurait sans doute éditées, cet « essai » n’en constitue pas moins une lecture consistante et profitable encore aujourd’hui, grâce à la clarté stylistique et conceptuelle et à la probité intellectuelle de Mill. Il analyse avec lucidité les méfaits de la société capitaliste tout en parvenant à prévoir les risques politiques et économiques associés au socialisme.
Libéral – au sens où il défend la liberté individuelle contre les hiérarchies et normes sociales traditionnelles – et progressiste – il vient de publier son grand ouvrage féministe The Subjection of Women et promeut le suffrage universel –, Mill est déjà une figure connue et reconnue de la gauche anglaise – il est député du Parti libéral entre 1865 et 1868 –, lorsqu’il entreprend d’étudier et d’évaluer le socialisme. Dès la révolution de février 1848 il lit les auteurs socialistes comme Owen, Louis Blanc (avec lequel il devient ami lorsque celui-ci est exilé en Angleterre) et Fourier. Il y est surtout incité par le scandale que constitue la misère persistante des classes laborieuses malgré la croissance économique de la société capitaliste anglaise et face à l’opulence de la bourgeoisie. Misère et inégalité qui ont pour conséquence l’absence de liberté de ceux qui n’ont pas eu la chance de naître en héritant – situation que Mill qualifie de « quasi-esclavage ». Au point que le socialisme peut apparaître comme la suite logique de son engagement pour la liberté, comme en témoignent ces lignes de son Autobiography : « Notre idéal ultime de progrès allait bien au-delà de la démocratie et nous rangeait catégoriquement sous la bannière socialiste ».
Mais la lecture d’On Socialism amène à nuancer cette affirmation. Le rapport au socialisme de Mill reste problématique. S’il a manifesté une sympathie croissante pour les théories socialistes à partir de 1848 et s’il veut leur donner leur chance sans préjugé ni dogmatisme, ce n’est pas pour tomber dans le dogmatisme opposé. Il prétend soumettre à « un examen impartial » la pertinence des critiques socialistes du mode de production capitaliste tout comme les solutions économiques et politiques concrètes défendues par les auteurs socialistes.
Le livre se présente sous la forme de 4 chapitres, précédés d’une introduction. Dans celle-ci Mill pose de manière très pertinente la nécessité de s’intéresser au socialisme. La démocratie et l’universalisation du vote, dont il juge inéluctable la progression, font que pour la première fois ceux qui ne possèdent rien d’autre que leur force de travail vont peser de façon légale sur les décisions politiques. Ne possédant aucun bien de production ils n’ont a priori aucun intérêt à défendre le système juridico-économique en place, dont l’un des principes est le droit de propriété privée. Mill soutient que rien ne justifie absolument parlant ce droit ; qui n’est pas un droit naturel, à la différence de ce qu’affirmait Locke. Il est donc tout à fait légitime que les socialistes le remettent en question. Si la propriété privée doit être conservée, ce n’est pas au nom de la tradition, ni d’un dogme, ni au nom de l’intérêt privé des possédants, mais d’une analyse rationnelle prenant pour principe le bien-être social total, dans une perspective utilitariste. Mill pose alors une série de questions : ceux qui n’ont rien ont-ils intérêt à défendre la propriété privée ? Un système socialiste de production serait-il plus en accord avec les intérêts de la classe ouvrière ? La différence entre riches et pauvres est-elle nécessaire ou peut-elle être abolie, comme a été abolie la différence entre nobles et roturiers ? Quels sont les mérites des différents types de socialismes, tant du point de vue du fond (qu’est-ce qui est mis en commun ?) que de la forme (socialisme coopérativiste, expérimental et réformiste contre socialisme révolutionnaire, centralisateur et étatiste) ?
La première partie est consacrée à l’énumération des reproches que les socialistes adressent au système de production capitaliste. Mill cite abondamment les œuvres de Louis Blanc, du socialiste anglais Robert Owen et du fouriériste Victor Considerant. A leurs yeux, les principes qui régissent la production et la distribution des richesses dans la société capitaliste engendrent plus de maux que de biens. Ils maintiennent les ouvriers dans une pauvreté dont ils ne peuvent sortir : ne recevant que le strict nécessaire pour survivre, ils ne peuvent épargner. Misère qui ne repose sur aucune forme de justice, bien au contraire. Mill aborde également la question de l’immoralité qui est à la fois à la source de la société capitaliste (égoïsme, matérialisme, avidité) et sa conséquence (oisiveté du riche et tentation du pauvre). Il fait également droit aux critiques économiques : le système reposant sur la propriété privée du capital est au fond peu productif, en raison de son manque d’organisation et des nombreux intermédiaires inutiles qui peuvent s’interposer entre le producteur et le consommateur. Par ailleurs, La surpopulation des classes laborieuses entraine nécessairement baisse des salaires, chômage de masse et crise de subsistance pour la majeure partie de la population. Enfin, le capitalisme concurrentiel est accusé de tendre naturellement vers un monopole, au profit de ceux ayant assez de capital au départ pour vendre à perte et éliminer la concurrence. Ce qui produirait un appauvrissement quasi général et une nouvelle forme de féodalité.
Dans le deuxième chapitre Mill évalue la pertinence de ces critiques. Quelle part du malheur dans la société de son temps vient-elle d’une nécessité naturelle ? Quelle part a-t-elle pour principe l’organisation économique de cette société ? Peut-on corriger certains des défauts de cette dernière sorte tout en restant dans le cadre de la propriété privée ? Mill commence par rétablir certains faits : contrairement à ce qu’écrit Louis Blanc il est empiriquement faux de dire que les salaires baissent ou que la surpopulation engendre chômage et crise de subsistance. Il relève ensuite les mérites de la concurrence, qui parvient à diminuer le coût des produits de consommation. Mill propose alors de mettre en place des lois empêchant que le système concurrentiel ne devienne un monopole tout en restant dans le cadre du système de la propriété privée. Dans la partie peut-être la moins étayée et convaincante du livre, le philosophe utilitariste cherche ensuite à justifier la juste rémunération du capital privé, en ne la distinguant peut-être pas assez, contrairement à ce nous ferions aujourd’hui, de la rémunération du travail de management du capitaliste. Cette rémunération n’est peut-être pas justifiable en soi, mais seulement dans la mesure où le système capitaliste est plus efficient économiquement que le système socialiste ; comparaison que cherche à établir Mill dans le chapitre suivant.
Le troisième chapitre porte en effet sur les difficultés inhérentes au socialisme. Mill établit une distinction entre deux formes de socialismes. D’un côté le socialisme révolutionnaire, qui veut abattre l’économie capitaliste et sa structure politico-juridique sans définir précisément par quoi la remplacer ni chercher à prouver expérimentalement que le socialisme fonctionnerait mieux. Les tenants de ce socialisme – Mill évoque Saint Just et Robespierre – entendent s’approprier de façon révolutionnaire la totalité des moyens de production d’un pays puis d’imposer le socialisme par le haut, ce qui ne peut que produire de la violence. Le deuxième socialisme est réformiste et coopérativiste : en fondant des unités de production et des communautés socialisantes ses théoriciens espèrent démontrer leur efficacité et peu à peu convaincre les citoyens. C’est évidemment ce second socialisme qui a les faveurs de Mill. Comme le premier devra affronter les difficultés du second en plus de celles qui lui sont propres, il commence par étudier les difficultés communes aux deux formes de socialismes. La propriété collective des moyens de production est-elle aussi efficace que le régime de la propriété privée concernant la motivation des entrepreneurs et des ouvriers ? Deuxième problème : se priver du marché pour établir le prix des biens et du travail c’est devoir l’établir politiquement, avec les risques de violence et d’arbitraire que cela suppose. S’il est possible d’imaginer des modalités démocratiques pour le faire (les Fouriéristes ont imaginé des systèmes complexes pour décider de la juste rémunération des différents types de travaux), elles complexifient nécessairement le processus productif et sont sources de conflits. Il remarque également que les individus ne possédant plus rien en propre et dépendant de la collectivité pour leur subsistance pourront moins s’opposer aux décisions de la collectivité, donc perdront en liberté. Leur seul moyen de faire valoir leur point de vue devient alors la lutte politique pour influencer le choix collectif. Mill s’interroge enfin sur le cercle vertueux qui doit s’instaurer entre éducation et socialisme : le socialisme n’est viable que s’il est animé par des gens plus motivés par l’intérêt général que par l’intérêt individuel, mais seul le socialisme pourrait produire dans la population ce genre d’éducation. C’est pourquoi il préfère un socialisme réformiste, qui pourra peu à peu éduquer moralement les individus avant de se généraliser. Alors que le socialisme révolutionnaire risque de mettre dans les mains de personnes immorales le monopole politique et économique qu’il aura constitué. Nous voyons à travers ces deux derniers arguments à quel point Mill a anticipé les risques politiques du socialisme.
Dans un dernier chapitre, intitulé « La notion de propriété privée : variable et non immuable », Mill fait appel à la grande variété des régimes de la propriété, dans le temps comme dans l’espace, pour prouver empiriquement que la propriété privée des moyens de production n’est pas une institution nécessaire mais bien contingente, et donc réformable.
Nous le voyons, le texte de Mill n’a rien perdu de sa pertinence. Bien au contraire, le caractère empiriste et expérimental de sa démarche lui permet de mieux déjouer les pièges du dogmatisme et de l’idéologie que nombre de penseurs et philosophes qui l’ont suivi.
Jean-Baptiste Bertin