Stephen Greenblatt, Quattrocento, éd. Flammarion, lu par Roderick-Pascal Waters
Par Jérôme Jardry le 19 mars 2014, 06:00 - Lien permanent
 Stephen Greenblatt, Quattrocento, éd. Flammarion.
Stephen Greenblatt, Quattrocento, éd. Flammarion.
Stephen Greenblatt, University Professor à Harvard, membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, a obtenu le prix Pulitzer et le National Book Award pour le présent ouvrage, Quattrocento (paru en anglais en 2011). Destiné à un large public, cet essai romancé prend appui sur la découverte en 1417 par Poggio Bracciolini (dit le Pogge) d'un manuscrit complet du De natura rerum de Lucrèce, et en expose le contexte et les implications.
L'objectif essentiel de l'ouvrage excède cependant ce cahier des charges pour spécialistes : il consiste à partager avec jubilation une culture vaste et vivante, exposée avec clarté et simplicité, en brossant un large spectre historique depuis l'Antiquité, riche d'une galerie de personnages et d'épisodes hauts en couleurs. Cependant, l'auteur s'emploie également à exposer de façon personnelle et systématique la nocivité foncière de la religion, de manière hélas bien moins convaincante.
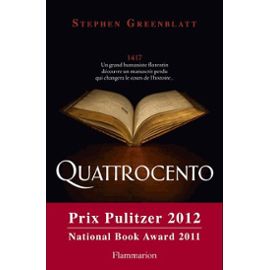 Dans
sa Préface, l'auteur expose de façon émouvante à la fois
sa rencontre universitaire avec le De natura rerum et la corde
sensible qu'a touché en lui cet ouvrage : il grandit en effet
surprotégé par une mère qui pleura sa vie durant une sœur morte
adolescente, et lui offrit le poignant spectacle d'une vie entière
ternie par l'angoisse de la mort. Par ailleurs, il présente au
lecteur combien le De natura rerum, appréhendé du point de
vue de son influence continuée, est inséparable de sa redécouverte
à la Renaissance italienne, période à la fois en sympathie avec
les mentalités antiques disparues, et formidablement ouverte vers un
avenir dont elle est la matrice. Temps de l'humanisme, elle fut aussi
le temps d'un humaniste en particulier, témoin vivant des
différentes tendances et paradoxes du temps : Poggio
Bracciolini, dit le Pogge, qui redécouvrit le précieux manuscrit.
Dans
sa Préface, l'auteur expose de façon émouvante à la fois
sa rencontre universitaire avec le De natura rerum et la corde
sensible qu'a touché en lui cet ouvrage : il grandit en effet
surprotégé par une mère qui pleura sa vie durant une sœur morte
adolescente, et lui offrit le poignant spectacle d'une vie entière
ternie par l'angoisse de la mort. Par ailleurs, il présente au
lecteur combien le De natura rerum, appréhendé du point de
vue de son influence continuée, est inséparable de sa redécouverte
à la Renaissance italienne, période à la fois en sympathie avec
les mentalités antiques disparues, et formidablement ouverte vers un
avenir dont elle est la matrice. Temps de l'humanisme, elle fut aussi
le temps d'un humaniste en particulier, témoin vivant des
différentes tendances et paradoxes du temps : Poggio
Bracciolini, dit le Pogge, qui redécouvrit le précieux manuscrit.
Le chapitre premier, « Un chasseur de manuscrits » le met en scène in medias res, tel un loup solitaire errant en Allemagne méridionale, livré à sa seule passion de chasse aux manuscrits (dont la teneur est décrite et contextualisée) après l'emprisonnement de son employeur le pape Baldassare Cossa, le premier Jean XXIII, lors du Concile de Constance (le Chapitre VII nous mènera à cet épisode en bonne et due forme chronologique). Le long chapitre II, « Le moment de la découverte » commence donc par établir le lien entre la pratique humaniste de la chasse aux manuscrits, et la règle saint Benoît qui, instaurant la « contrainte de lire » et la lectio divina en qualité de remède à l'acédie, fit le lit de la survie du patrimoine livresque de l'Antiquité, tout en engendrant pour les humanistes bibliophiles, tel le Pogge, bien des difficultés matérielles pour accéder à des manuscrits toujours reclus, souvent précieux. Puis, après avoir expliqué avec force détails passionnants la vie, les techniques et les principes directeurs du scriptorium, S. Greenblatt peut mener le lecteur impatient à la découverte du fameux manuscrit.
Mais le chapitre III, « À la recherche de Lucrèce », saisit alors l'occasion d'une présentation en règle de T. Lucretius Carus, du contexte dans lequel il écrivait, et de son obédience épicurienne. Ce chapitre illustre à merveille le maître procédé de S. Greenblatt, qui fait tout le prix de son ouvrage : une pensée de l'occasion érudite, prenant prétexte de préambules nécessaires pour distribuer avec magnanimité une culture riche, variée, jubilatoire, qui fait son miel de toute digression possible pour enchanter le lecteur en le cultivant – engendrant ici des développements aussi précis que passionnants sur : la chronologie des fouilles d'Herculanum et de Pompéi ; le livre, la lecture et les lecteurs à l'époque de Lucrèce ; les milieux intellectuels et l'art d'écrire à leur apogée antique ; sur Épicure et son école, enfin. Le chapitre IV, « Les dents du temps », développe cependant le destin tragique de ceux d'entre ces innombrables volumes qui n'eurent point la chance d'être scellés sous la lave du Vésuve : les parasites du livre, précisément évoqués, sont suivis de près par les partisans du patriarche d'Alexandrie, demeurés tristement célèbres pour la lapidation d'Hypathie d'Alexandrie. En toute logique, le chapitre se termine par une évocation des contradictions fondamentales entre l'épicurisme et la pensée d'un saint Jérôme, d'un Tertullien, d'un Lactance, ou encore d'un saint Pierre Damien et autres tenants de la mortification de la chair.
Le chapitre V, « Naissance et Renaissance », revient au présent de la narration pour décrire le contexte florentin de la naissance et de la formation du jeune Poggio, rapidement partisan de l'humanisme livresque hérité de Pétrarque, en qualité de copiste hors pair et au contact d'individualités de premier ordre, comme Coluccio Salutati ou, surtout, Niccolò Niccoli. Un milieu qu'il quitte à l'automne 1403 pour la Rome de tous les dangers, ainsi que le relate le chapitre VI, « L'officine de mensonges ». D'abord au service du cardinal de Bari, le Pogge, recommandé par Salutati, atteint en moins d'un an le poste tant convoité de clerc apostolique, au service de la vaste administration papale de Boniface IX. Selon un schéma auquel le lecteur est maintenant bien habitué, c'est là l'occasion pour S. Greenblatt de détailler les mœurs retorses et scabreuses de la curie, en s'appuyant sur le De curiæ commodis de Lapo da Castiglionchio et, bien sûr, les Facetiæ et le Contra hypocritas du Pogge, dont la bibliophilie est sans cesse demeurée l'échappatoire. Mais le voilà bientôt secrétaire apostolique de Baldassare Cossa, le provisoire Jean XXIII dont nous entretient le chapitre VII, « La fosse à renards » : régnant sur une Rome à bien des égards décrépie, lui-même rejeton d'une dynastie de pirates originaire de Procida, habile mais mécréant, la curie avait fondé sur lui de vains espoirs de réduction du Grand Schisme d'Occident. Face à cet échec, et soumis au chantage de Sigismond de Hongrie, il accepte de convoquer le concile de Constance – ladite « fosse où l'on piège les renards », dit-il à sa suite (dont fait partie le Pogge) en apercevant sa destination. Il y sera en effet déposé le 29 mai 1415. Le chapitre abonde de détails, tant sur le concile ou la personnalité de Baldassare Cossa, que sur la figure et le supplice de Jan Hus, qui choqua profondément le Pogge, tandis qu'une certaine indolence de l'Allemagne méridionale le surprend et le charme. Devant une expérience si contradictoire et troublante, celui-ci se réfugie de nouveau auprès des livres : ainsi en revient-on, encore et toujours, à la découverte de 1417.
Le chapitre VIII, « De la nature », en vient donc au fait. Disons-le sans ambages : pour ce qui est du noyau même de son sujet – la pensée de Lucrèce – S. Greenblatt est absolument virtuose. Le cœur du chapitre est constitué par une présentation impeccable et limpide en vingt points de la philosophie épicurienne telle que la présente le poète (présentation qui occupe très précisément les pages 204 à 219). L'osmose entre l'essayiste et son sujet est ici totale, et l'intérêt pédagogique de ces pages est, à notre humble avis, de tout premier plan. Le chapitre IX, « Le retour », revient alors aux vicissitudes concrètes du texte : copié par un scribe, il est expédié à Niccolò Niccoli, tandis que le Pogge accepte bientôt le poste de secrétaire d'Henri Beaufort, évêque de Winchester, passant alors quatre années malheureuses en Angleterre, réclamant en vain de Niccoli qu'il lui rende le manuscrit – ce que ce dernier finit par faire, permettant que le De natura rerum circule enfin véritablement. Rentré en Italie, le Pogge peut alors finir sa vie dans une relative prospérité et comblé de fécondes amours, jusqu'à être chancelier de Florence pendant cinq ans. Il meurt dix-huit mois plus tard, le 30 octobre 1459.
Puis, le chapitre X, « Déviations » (dont le titre évoque à la fois le clinamen lucrétien et le titre original anglais de l'ouvrage, The Swerve), nous plonge dans la vie florentine des idées (et non du simple texte) de Lucrèce : c'est l'occasion de bien des évocations, d'abord celle de Jérôme Savonarole en farouche opposant à l'atomisme, conçu comme vecteur d'athéisme, puis celle de Lorenzo Valla mettant en œuvre un « désaveu dialogique » fort ambigu du propos épicurien dans son dialogue Sur le plaisir, d'ailleurs combattu par un Pogge moins épicurien que ne l'aurait peut-être voulu S. Greenblatt. Quoi qu'il en soit, envers et contre tout, la dissémination du texte est en marche, et les éditions ne tarderont pas à se multiplier au siècle suivant, ce qui permet à l'auteur d'examiner deux héritiers aussi divers que Thomas More, au travers de pages claires et précises à propos de L'Utopie, et Giordano Bruno, dans une évocation très vivante (et nécessairement tragique), qui encore une fois atteste d'un réel plaisir de communiquer le savoir. Enfin, le chapitre XI, « Postérité », clôt l'ouvrage en suivant la piste de tout ou partie des thèses du De natura rerum chez Shakespeare, Montaigne et Galilée (pour ce dernier, après avoir évoqué le Concile de Trente), puis chez ses traducteurs, en particulier Lucy Hutcheson (dont la démarche de refus intellectuel permet de discuter les relations potentiellement ambiguës à Lucrèce), ou encore chez Newton et pour finir, chez Jefferson – touche finale patriotique.
L'ouvrage de S. Greenblatt, dont il faut se réjouir qu'il soit copieusement, très précisément et fort régulièrement annoté (quarante pages de notes en fin de volume) et pourvu d'un index des noms propres et titres d’œuvres, fait audacieusement le pari de s'adresser simplement et sérieusement à tout lecteur, même béotien. Il faut reconnaître qu'il y parvient tout à fait, en produisant dans un texte stylistiquement épuré un propos à la fois constamment didactique, aussi lisible que possible et véritablement captivant. Les digressions – l'essentiel de l'ouvrage – sont toujours très instructives et très bien choisies, comme par l'application d'une habitude de communiquer à tout prix ce qu'un honnête homme ne devrait ignorer.
Cependant, ainsi que nous l'annoncions d'emblée, la critique de la religion (thème épicurien par excellence) est l'occasion d'une série de basses manœuvres argumentatives assez désagréables de la part d'un auteur à la carte de visite aussi prestigieuse. Quelques exemples, pêle-mêle : on apprend avec étonnement aux pages 121-123 que le dolorisme chrétien serait purement et simplement réductible à un anti-épicurisme acharné ; page 203, l'auteur insiste sur le fait que Lucrèce critique la religio et non pas la superstition, mais n'oublions pas que le mot grec ici transposé est la δεισιδαιμονία (deisidaimonia) dont traite Épicure, c'est-à-dire bel et bien la superstition religieuse ; au chapitre XI, le procès Galilée est évoqué sans prendre en considération (entre autres) l'affront personnel et effronté que représente l'attribution des thèses papales à Simplicio, l'imbécile du Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ; enfin, peut-on décemment insinuer qu'il existe un lien direct entre le lynchage d'Hypatie et la canonisation de Cyrille d'Alexandrie (page 106) ?
Nonobstant cette part d'ombre parfois envahissante, retenons tout de même que Stephen Greenblatt excelle dans l'art d'enseigner efficacement à tous, même ceux qui savent peu : c'est sa grande force, par exemple dans l'exceptionnel chapitre VIII, et c'est assurément la raison des prix prestigieux qui lui ont été décernés.
Roderick-Pascal Waters