Gérald Hess, Éthiques de la nature, PUF, lu par Ugo Batini
Par Karim Oukaci le 14 novembre 2013, 06:00 - Éthique - Lien permanent
 G. HESS, Éthiques de la nature, « Éthique et philosophie
morale », PUF, Paris, 2013, 422 pages.
G. HESS, Éthiques de la nature, « Éthique et philosophie
morale », PUF, Paris, 2013, 422 pages.
C’est sans détour que Gérald Hess livre dès les premières pages le projet de son ouvrage : il s’agit de dresser « une sorte de cartographie conceptuelle de l’éthique appliquée à la question environnementale. » Ce travail semble d’autant plus nécessaire que ce champ est délaissé en France alors qu’il prospère dans le monde anglo-saxon depuis 1970.
L’auteur cherche donc à expliquer l’objet de cette recherche tout en faisant un état des lieux des questions et des personnalités qui animent ce domaine de nos jours. L’ouvrage, suivant ce double projet, peut donc se lire de deux manières. On peut soit y rechercher une réflexion précise sur les développements éthiques de l’idée de nature et donc se tourner vers les chapitres II, III et V qui constituent une réflexion autonome sur la question et fondent ainsi la base philosophique de cette éthique de la nature ; soit on peut préférer attaquer le problème à partir des auteurs contemporains qui le discutent et, après avoir lu le chapitre IV qui présente rapidement les grands enjeux de la question, examiner toutes ces positions en lisant les chapitres VI à X.
L’introduction reste utile aux deux parcours car elle rappelle bien ce que l’on doit entendre par une éthique de la nature. Celle-ci porte bien sur les conduites humaines à l’égard de la nature. Mais contrairement à « l’éthique appliquée » qui identifie des problèmes et vise des solutions, elle engage en son fondement une réflexion plus vaste sur la conception de l’homme et la place qu’il peut ou doit jouer au sein de la nature. Car plus que d’environnement, c’est bien de la nature au sens large qu’il est question. Celle-ci concerne donc l’éthique animale mais aussi tous les autres éléments qui constituent notre écosystème. Cette réflexion est d’autant plus importante que la crise écologique que nous traversons nous oblige, par la forme inédite qu’elle prend, à interroger le rapport de domination à la nature instauré par notre développement technique. C’est ce retour réflexif qui constitue le fondement de cette nouvelle éthique et qui met bien en lumière le fait que la résolution d’une telle crise passe certes par des positions politiques et économiques fortes mais ne peut faire l’impasse sur la question de la valeur que la nature a aux yeux des hommes. On peut donc délimiter globalement trois axes à cette éthique : la question primordiale des valeurs de la nature, celle de la gestion des ressources naturelles et enfin le problème des risques environnementaux. La réflexion sur la valeur permet de distinguer cinq attitudes morales (théocentrisme, anthropocentrisme, pathocentrisme, biocentrisme, écocentrisme) qui représentent des obligations plus ou moins étendues que l’on adopte en fonction de notre échelle de valeurs par rapport à la nature. La seconde partie de l’ouvrage (chap. VI à X) prendra le temps de traiter chacune des options.
Première partie : introduction générale à l’éthique environnementale (Chap. I à V).
Parce que le mot même de nature est surdéterminé et ne renvoie pas à un objet précis mais à un ensemble de représentations culturellement déterminées, il ne peut être considéré comme un concept mais plutôt comme un métaconcept. Afin de le saisir, le premier chapitre propose donc une histoire de ces représentations en Occident et dégage trois moments dans cette représentation de la nature.
Croisant les analyses de Pierre Hadot et de Karen Gloy, Gérald Hess trouve déjà trois formes de représentation de la nature dans l’Antiquité grecque : une nature-artefact qui répond au modèle technoscientifique, une nature-habitat qui correspond au lieu d’existence de l’humain et qui est donc perçue sous un angle plus phénoménologique et enfin une nature-poiêsis qui fait d’elle un être autonome et qui correspond à une vision génétique de celle-ci. La Renaissance, prise dans le double foyer platonicien et aristotélicien, conjugue les perspectives technoscientifique et génétique et arrivera à faire émerger un nouveau paradigme que l’on peut qualifier d’holistique. Le cosmos est compris comme un grand organisme mais dont l’on peut tirer des effets lorsque l’on connaît les lois qui l’animent. Mais la publication en 1632 des Dialogues sur les deux grands systèmes du Monde de Galilée met fin à cette union et voit advenir le règne du paradigme technoscientifique qui relègue la nature au rang de simple machine. La physique mécaniste devient alors le modèle dominant pour l’appréhender ; et la vie elle-même finira par être réduite à des propriétés physico-chimiques. L’éthique de la nature cherche à briser le monopole d’une vision purement techniciste qui réduit la nature à une simple valeur d’usage afin de prendre en considération la possibilité d’une valeur intrinsèque. C’est sur cette question que la chapitre II s’étend à travers une étude détaillée de la notion de valeur qui débouchera précisément sur la possibilité d’une valeur morale qui obligera l’homme à tenir compte de la nature dans ses actions ou décisions. A partir de cette analyse, l’auteur propose, toujours dans un souci d’exhaustivité, de saisir dans le chapitre suivant quels sont les grands paradigmes éthiques avant de se pencher plus précisément sur les éthiques de la nature. La division du champ en éthique téléologique et éthique déontologique lui permet de balayer à gros traits les différents enjeux et problèmes de chacune des positions. Au-delà de l’utilité de ce chapitre lié à un souci constant de ne rien laisser de côté, on s’interroge assez vite sur sa portée qui en dit à la fois trop et pas assez par rapport au projet de l’ouvrage. Mais fort à propos le chapitre IV revient au plus près de son problème en se demandant ce qui dans la nature peut être moralement pertinent. Les différentes éthiques de la nature peuvent en effet se définir en fonction du degré d’extension de leur souci éthique. On peut facilement identifier plusieurs patients moraux possibles au sein de la nature : l’animal, les plantes, l’espèce ou de façon plus globale l’écosystème voire la biosphère. A partir de là, on peut poser la question de la communauté morale que peut prendre en compte chaque théorie. En fonction du nombre d’éléments que ces théories prennent en compte, il semble se dessiner cinq postures principales qui seront analysées plus dans le détail dans la deuxième partie en se confrontant avec les auteurs qui en font la promotion. Le théocentrisme assoit la position dominante du genre humain sur les autres êtres de la nature à partir du lien privilégié que l’homme entretient avec son créateur. L’anthropocentrisme moral place lui aussi l’homme au centre mais pour des raisons différentes, c’est-à-dire soit en fonction de critères phylogénétiques (comme la simple appartenance à l’espèce) soit selon des critères cognitifs (raison, conscience de soi, etc). Le pathocentrisme se fonde sur le critère de la sensibilité. Il suffit de pouvoir souffrir pour entrer dans la communauté morale ; du coup celle-ci comprend les êtres humains mais aussi d’autres êtres vivants dont le comportement laisse entendre une sensibilité à la souffrance. Le biocentrisme n’est plus du tout anthropocentré puisqu’il suffit pour être considéré moralement d’être un vivant. Enfin l’écocentrisme représente l’élargissement maximal d’une telle communauté. A l’intérieur de chacune de ces conceptions doit se poser la question du poids moral respectif des diverses entités de la communauté morale. Nous verrons par exemple avec Singer que ce n’est pas parce que l’on prend en compte la souffrance que l’homme a autant de valeur qu’un chat. C’est donc par la suite toute une typologie fine de ces différentes propositions que nous livre G. Hess en cherchant à bien mettre en valeur pour chacune les figures majeures qui les animent.
Deuxième partie : typologie des éthiques de la nature.
L’ordre d’exposition des différentes positions se fait naturellement en fonction d’une extension progressive de la communauté morale : anthropocentrismes, pathocentrismes, biocentrismes, écocentrismes naturalistes et enfin les écocentrismes holistes - l’auteur déclinant pour chacun la perspective cognitive et la perspective pragmatique. Nous suivons donc une suite de monographies qui tentent toujours de mettre en valeur le soubassement de ces options éthiques tout en n’évitant pas non plus une certaine mise en relief à travers l’exposition des critiques qui ont pu être faites. Voici le détail des auteurs abordés par position :
Anthropocentrisme : L. Ferry, P. Carruthers, J. Passmore, B. G. Norton, M. Seel
Pathocentrisme : P. Singer, T. Regan, M. Nussbaum
Biocentrisme : A. Schweitzer, P. W. Taylor, R. Attfield
Écocentrisme naturaliste : H. Roston, H. Jonas, E. C. Hargrove
Ecocentrisme holiste : J. B. Callicott, K. M. Meyer-Abich, M. Serres, A. Berque, A. Naess, V. Plumwood
L’exhaustivité que recherche G. Hess est précieuse car elle permet au lecteur profane dans le domaine de se faire une idée de la richesse des diverses positions. On peut cependant regretter que l’importance des auteurs dans ce champ ne soit pas plus signalée ou du moins soulignée par des traitements plus conséquents selon leur importance. Par exemple P. Singer qui a su se positionner peu à peu comme une figure majeure en éthique à travers la question animale reçoit un traitement comparable à L. Ferry (Le Nouvel ordre écologique ayant bénéficié d’un certain retentissement en France).
Nous prendrons en exemple justement le traitement des anthropocentrismes (chap. VI) et des pathocentrismes (chap. VII) afin de mettre à jour le principe des présentations. Il est clair que l’importance accordée aux positions anthropocentrées découle du fait que l’auteur tient à en faire une critique en règle. Cette position constitue un paradigme classique qui repose sur une conception dualiste du rapport humain à la nature. La perspective cognitive tend à justifier cette position en faisant reposer la prééminence de l’homme sur une particularité de la nature humaine (que ce soit sa liberté ou des fonctions plus psychologiques) tandis que l’approche pragmatique, plus originale, en ce sens interroge l’expérience que nous entretenons avec cette nature.
L’anthropocentrisme moral que défend L. Ferry est vite mis de côté car sa dénonciation des nouvelles conceptions écologiques qui tend à en faire des projets déshumanisants voire fascistes repose sur une confusion entre les différentes doctrines qui ne permet pas de prendre réellement au sérieux cette attaque. Il en va tout autrement pour les arguments de L. Schäfer qui ne se limitent pas à une critique des pensées écologistes mais qui cherchent aussi à ouvrir une piste qui permettrait de préserver l’environnement. Pour lui, on peut reprocher aux pensées écologistes d’avoir recours à une conception normative de la nature qui ne peut qu’être problématique, mais aussi de réactiver une finalité immanente en son sein qui semble incompatible avec l’avancée de la science et de la technique. Leur critique se construit en grande partie sur l’héritage philosophique des Lumières et en particulier sur la pensée de Kant qui d’un point de vue anthropologique pense un homme divisé entre sa nature d’être raisonnable et son existence sensible (l’enjeu de la philosophie pratique étant bien évidemment de permettre une soumission de cette dernière partie à la première). L’originalité de la position de Schäfer sur celle de Ferry est de ne pas faire une coupure qui ne se tourne que vers l’idée d’un être raisonnable mais d’argumenter aussi en faveur de notre partie sensible. C’est à partir de là qu’il proposera d’ailleurs une éthique de la nature anthropocentrée. En reprenant des analyses de la Critique de la Faculté de Juger sur l’expérience esthétique de la nature qui peut se penser comme un « symbole du bien moral », il met en avant l’idée d’une force normative d’une esthétique de la nature. On pourrait en effet envisager le devoir de préserver une telle beauté en ce qu’elle a précisément un rapport à la morale. Mais son argument le plus percutant tient plus à une autre piste qui permettrait de développer un devoir de représenter l’environnement en se fiant à notre bien-être corporel. Celui-ci relève de la perfection de la nature animale de l’homme que celui-ci en ayant des devoirs envers lui-même ne peut négliger. Le métabolisme de notre propre corps devient donc un critère pour évaluer les conditions environnementales. Nous ne sommes pas dans une sphère morale au sens propre mais nous pouvons aiguiller notre activité en fonction de ce qui est sain ou nocif. Ce dernier développement ne peut que mettre à mal la volonté de Schäfer de se limiter à un concept neutre de nature d’un point de vue normatif car il est clair qu’elle dépasse de loin le statut de simple indicateur.
Avec P. Carruthers, G. Hess se penchera sur la version plus psychologique de l’anthropocentrisme puisque son refus d’envisager les animaux comme des agents rationnels provient de leur absence d’une réelle conscience réflexive de leurs désirs ou croyances. Ainsi le fait que certains animaux puissent avoir conscience de leur environnement n’est pas suffisant pour que l’on puisse leur témoigner un intérêt moral car ils n’ont pas accès à tout un système de représentations qui leur permet d’avoir des choix et donc de devenir des agents. L’uniformité des comportements au sein d’une espèce est une illustration nette de ce point. Là encore la critique de cette position (qui repose sur les analyses que fait M. Bitbol sur la conscience) permet de bien mettre en valeur ses limites.
C’est en interrogeant précisément les racines culturelles de cet anthropocentrisme que J. Passmore va en proposer une nouvelle version capable de mieux prendre en compte les problèmes écologiques. La controverse avec la médiéviste Lynn White, qui affirme que cette crise écologique s’enracine dans un tournant de la culture occidentale lié au développement des sciences et de la technique à partir du XIe siècle, permet à J. Passmore de mieux mettre en perspective cet anthropocentrisme. S’il est d’accord sur le fait qu’une attitude de prudence est désormais nécessaire face à la nature, il n’accepte pas l’idée que l’on doive tourner en partie le dos à la culture occidentale et propose une lecture plus nuancée de la conception chrétienne de l’homme et de sa relation à la nature. C’est au contraire au sein même de cette tradition qu’il trouve une assise pour développer une conservation de notre environnement. La tradition judéo-chrétienne comprend trois attitudes à l’égard de la nature : la domination, l’intendance et la coopération. Il y a bien un anthropocentrisme qui est revendiqué mais celui-ci n’a pas à se penser uniquement sous l’angle de la domination, même si les autres options se sont révélées appartenir à des traditions minoritaires de l’Occident. Ces possibilités tracent une voie pour l’élaboration d’une nouvelle métaphysique plus soucieuse de la préservation de la nature. Cette dernière doit nous permettre de prendre conscience de notre dépendance à son égard tout en maintenant l’idée que ce que l’homme apporte avec la civilisation fait aussi partie de cette nature. Il n’est donc pas question d’attribuer une valeur morale à la nature mais plutôt d’encadrer les pratiques de l’homme afin qu’il amorce une transition d’une société d’abondance à une société plus sobre mais aussi plus juste pour l’homme comme pour son environnement.
Le constat semble unanime autour de l’idée que l’homme doive repenser
sa place au sein de son milieu mais il existe aussi une alternative pragmatique
pour le faire qui présente l’avantage immédiat de ne pas avoir à se reposer sur
une quelconque métaphysique. La perspective pragmatique se focalise davantage
sur la résolution de problèmes plutôt que sur des principes métaphysiques à
partir desquels on pourrait régler notre action. B. G. Norton et M. Seel
constituent les meilleurs représentants d’une telle tentative au sein de
l’anthropocentrisme.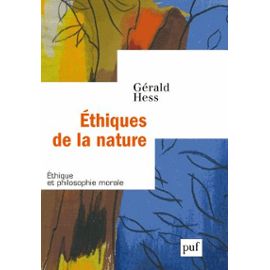
Ainsi pour Norton, la seule chose qui compte c’est d’aborder les problèmes écologiques uniquement dans une perspective pratique. L’essentiel n’est plus de s’accorder sur un fondement commun mais bien plutôt de trouver un consensus autour de nos moyens d’agir. Ici encore, il s’agit de prendre conscience des relations d’interdépendance au sein d’un écosystème et de penser une gestion adaptative de l’environnement. Cela passe nécessairement par une prise de conscience des différentes échelles de temps (le temps de l’expérience, le temps écologique et le temps géologique) et la compréhension de leurs dynamismes au sein d’un espace qui est lui aussi organisé. Cette mise en perspective permet d’atténuer l’anthropocentrisme et d’en présenter une version faible car peu à peu cet homme qui attribue des valeurs prend conscience de l’importance de son milieu et finit par changer sa vision des choses. Norton ne manque pas ainsi de souligner la valeur transformationnelle de la nature, c’est-à-dire justement cet effet qu’elle a sur nous et qui permet de dépasser nos désirs particuliers pour mieux réfléchir ce tout dans lequel nous évoluons. Il faut prendre de la distance par rapport à nos intérêts individuels et être capable de constituer des biens naturels communs qui correspondent à des biens qu’une collectivité souhaite transmettre car ils correspondent à des éléments qu’elle juge important (leur choix se fait selon Norton dans le cadre d’une éthique de la discussion). Il ne faut donc pas se situer sur un court terme en pensant que nous ne savons pas ce que seront les générations futures mais tenter de préserver un socle commun de références naturelles qui constitue des valeurs communes. Il faut donc penser une nouvelle forme d’éthique qui ne se rapporte plus à l’individu mais à une collectivité.
M. Seel développe une des propositions les plus originales, fondée sur une étude approfondie de l’expérience esthétique de la nature. En prenant un point de vue proche d’une description phénoménologique, Seel se détourne de la perception scientifique de cette nature pour la saisir du point de vue humain ; et c’est en ce sens qu’il reste lui aussi anthropocentré. Il perçoit au sein de cette expérience esthétique trois dimensions : la contemplation, la correspondance en laquelle la nature propose des modèles existentiels où le spectateur identifie une nature belle ou laide, enfin une dimension de projection qui fait de cette nature le support de notre imaginaire et un lieu propre de l’art. On saisit bien que, dans une telle optique, si la nature doit être préservée, ce n’est pas à cause de sa valeur intrinsèque mais plutôt pour cette relation esthétique qui la lie au spectateur. Cette nature esthétique apparaît comme une condition importante de l’épanouissement humain (la contemplation permet de suspendre librement sa participation aux affaires humaines ; la relation de correspondance met en avant des représentations du bien-être humain ; et la projection imaginative est au fondement même de l’art). Et c’est pour cette raison-là que nous devons être capables de la préserver. G. Hess souligne alors justement l’affaiblissement de la portée éthique de cette proposition originale, car il est clair qu’ainsi « nous devons de la considération morale non à la nature elle-même, mais au vécu qu’elle induit chez le sujet humain ». On voit mal comment une telle doctrine pourra développer des ressorts assez puissants pour déboucher sur des mesures réelles en faveur de la nature.
En proposant une extension morale en dehors de la sphère proprement humaine, le pathocentricme (chapitre VII) constitue une place non négligeable dans les éthiques de la nature, même si, en se focalisant sur des individus (humains ou non), il se détourne des préoccupations proprement environnementalistes. C’est cette raison qui permet à G. Hess d’en faire un traitement plus rapide en se focalisant sur les grandes figures du mouvement : P. Singer qui propose une perspective pragmatique, T. Regan qui représente une visée plus théorique et M. Nussbaum qui met en place une conception néoaristotélicienne du statut moral de l’animal.
En réactivant l’utilitarisme de Bentham qui avait déjà interrogé la question de la souffrance animale, P. Singer, à partir d’une réflexion sur la considération des intérêts d’une personne, met au jour la nécessité de prendre en considération une partie des animaux. L’égalité de considération vaut pour tous les êtres capables d’éprouver de la douleur, c’est-à-dire pour tous les êtres sensibles. Cela ne signifie pas que toute vie a la même valeur. Mais cela souligne que chacun doit être traité selon ses besoins et en fonction de ses différences spécifiques. Cela doit alors nous amener à revoir de nombreux comportements aussi bien dans le domaine alimentaire que médical. Cette position assez intuitive reste tout de même controversée aussi bien pour les défenseurs du droit animal que pour ses détracteurs. Les uns trouveront que le critère de la souffrance n’est pas simple à appliquer concrètement, quand les autres verront dans la position de Singer une demi-position morale qui se résume pour les animaux à une simple amélioration de leur bien-être sans pouvoir leur conférer véritablement un droit.
C’est une telle position que suit T. Regan dans son ouvrage-clé Le Droit des animaux (récemment traduit en français chez Hermann) qui cherche non pas à encadrer simplement nos pratiques mais bien à poser une valeur morale qui est égale pour tous ceux qui la possèdent, que ce soit un homme ou un animal. Celle-ci permet alors de faire valoir un droit moral qui ne concerne plus seulement les agents moraux mais aussi des patients moraux comme des animaux. Le critère moral nécessaire n’est plus lié à l’intelligence ou la raison mais au simple fait d’être sujet d’une vie ce qui implique que les individus ont une vie émotive, des formes de croyances, des attentes, etc. Les mammifères remplissent ce critère ; ils ont donc une valeur morale et possèdent par là même des droits. Cette exposition est suivie d’une critique bien trop rapide pour être efficace où l’auteur s’interroge sur la réalité d’un accès à la qualité de la vie mentale des animaux reprenant ainsi une critique déjà faite à l’utilitarisme sur la question de la souffrance. L’éthologie permet de répondre en partie à cette interrogation et rend ainsi très vite caduque une telle critique, même si celle-ci permet de passer vers une dernière conception de l’éthique animale avec l’étude de la pensée de M. Nussbaum qui propose de se centrer sur l’épanouissement.
Reconnu pour ses travaux dans le domaine politique, M. Nussbaum insère la question animale dans un édifice plus vaste qui repose sur une forme de néo-aristotélisme. On peut considérer que chaque organisme devrait pouvoir s’épanouir selon les capacités qui sont les siennes. L’exercice de ces capacités permet une forme d’épanouissement qui permet à chaque être de pleinement se réaliser. Dans ce contexte, tous les actes qui entravent un tel épanouissement sont moralement condamnables ; par conséquent, il est possible de faire correspondre à chacune des capacités des formes de droit afin de préserver une telle évolution. Cette approche par les capacités permet plus que les autres conceptions de prendre en compte l’extrême diversité des vies animales et ainsi de promouvoir des droits pour les animaux sans passer par la revendication d’une égalité. Toute la question est alors de se demander pourquoi s’intéresser aux formes sensibles de la vie, car il reste indéniable que le concept d’épanouissement peut s’appliquer aussi au monde végétal. C’est d’ailleurs cette nouvelle extension qu’interrogera le biocentrisme.
L’exhaustivité du travail de G. Hess lui permet de remplir aisément le but qu’il s’était fixé en introduction et de donner une cartographie d’un champ de pensée qui reste malheureusement méconnu en France. Si le livre n’échappe pas aux revers de cette qualité, il nous amène à mieux appréhender la diversité des pensées mais aussi des enjeux qui structurent cette réflexion : en particulier il montre à quel point la question écologique amène à penser à nouveaux frais celle de l’homme et donc fait retour sur un questionnement fondamental de la philosophie. Il permet ainsi de s’orienter vers la solution qui nous semble la plus adéquate en appelant un approfondissement, qui passe nécessairement par une lecture en première main des auteurs évoqués.
Ugo Batini