Gilles Behnam et Philippe Quesne, Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, collection « Philosophie en cours », SCERÉN CNDP-CRDP, 2013, lu par Nicolas Cominotti
Par Cyril Morana le 15 mai 2015, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, Gilles Behnam et Philippe Quesne, collection « Philosophie en cours », SCERÉN CNDP-CRDP
Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, Gilles Behnam et Philippe Quesne, collection « Philosophie en cours », SCERÉN CNDP-CRDP
Gilles Benham et Philippe Quesne donnent une introduction générale à l’œuvre de Walter BENJAMIN dans la collection « Philosophie en cours » dont l’ambition consiste à provoquer des rencontres entre des auteurs et des « notions » ; notamment celles des programmes de Terminale. Sous le beau titre de « Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre », les auteurs proposent deux « parcours » complets et minutieux au sein d’une réflexion dont les entrées sont notoirement multiples et, en apparence, hétérogènes. Le premier parcours est celui de l’« histoire » : Philippe QUESNE y analyse la stratégie « matérialiste » revendiquée par Benjamin. Elle consiste, cela pourrait d’abord paraître incongru, à appliquer à l’histoire le traitement d’ordinaire réservé aux œuvres d’art. Gilles BENHAM prend le relais en renversant le sablier moderne : c’est le parcours de l’Art. C’est au tour des œuvres, d’être mises en histoires comme autant de « rêves » de la modernité que la tâche critique consiste à libérer de leur sens latent.
QUESNE - Derrière l’apparente anarchie des travaux de Benjamin, un point de départ essentiel : la guerre de 14. Que signe en effet cette guerre des gueules cassées, des soldats éparpillés sans sépultures sinon la naissance d’un genre nouveau d’existence ? La vie moderne se déroule sous la mitraille, sous l’incommensurabilité de la technique. Car même loin derrière les tranchées, c’est une destruction de l’« expérience » qui s’opère ; destruction masquée par le double jeu de la propagande et de l’industrie culturelle naissante. La vie moderne pour Benjamin, sera placée sous le signe d’une banqueroute cachée : celle de l’histoire héroïque et dialectique. La tâche de l’historien/philosophe/critique (aucune de ces fonctions ne peut désormais exister de façon tout à fait indépendante) consiste à montrer le désastre en cours et les moyens épars de son escamotage. L’époque moderne est, par exemple, caractérisée par la faillite de la « conscience » comme faculté même idéologique: chacun est propulsé dans un monde où il ne peut mobiliser aucune expérience passée ni non plus en constituer de nouvelles : personne ne peut même délirer le sens de cette époque : chacun délire le sens d’une époque révolue en puisant dans une force « immémoriale ». Sollicitée très au delà de ses capacités d’intégration, dépourvue des schèmes traditionnels qui lui permettraient de conduire l’exercice d’un jugement, la conscience est comme « grêlée ». Sa seule défense, en un sens explicitement freudien, consiste à mobiliser en urgence des « images anciennes » qui occultent le présent vécu pour rendre le présent vivable ; l’opération n’étant elle-même possible qu’au prix d’une plongée dans les nappes profondes de la libido. Et c’est ici une des « chances » du critique, ou pour mieux dire, une de ses tâches. Non pas renverser la conscience et lui donner son contenu contemporain –il n’existe tout simplement pas, mais réveiller la conscience en libérant les puissances immémoriales engagées pour son refoulement. Non pas devenir soi où ça était selon le vœu freudien mais réaligner les chocs et les critiques. Nous savons cette opération possible parce que c’est très exactement ce qui se réalise dans une œuvre d’art. Benjamin n’est ainsi, dans cet exemple, jamais conduit à une critique de la conscience basée sur son manque d’« authenticité » ; cette critique serait vouée à l’échec et même condamnée à un anti-modernisme fascisant. Seules les œuvres sont susceptibles d’être libérées par le travail critique comme les affects coincés peuvent être libérés par l’interprétation analytique. De même que les rêves parlent, en même temps, de la vie toute juste oubliée par le rêveur et des aspirations oubliées de son enfance, les œuvres modernes parlent de l’époque tout juste refoulée et des aspirations oubliées de l’humanité entière. Ce sont les œuvres qu’il faut chercher émanciper, pas les hommes.
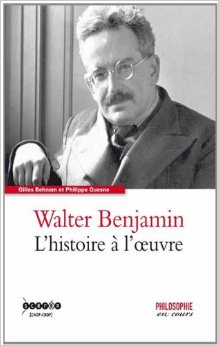 BENHAM - Qu’est-ce alors qu’une œuvre émancipée ? Un futur
possible. C’est à dire, par le jeu d’une dialectique remise en route, également
un passé redevenu possible. La plus ancienne fonction de l’art est, dans les
analyses de Benjamin, aussi celle du langage : reproduire. Émanciper les
œuvres, c’est repartir vers l’origine. Exprimée dans le contexte plus évident
du passage d’une langue à l’autre, l’opération s’appelle
« traduction ». Et la traduction fait signe vers un sens originaire,
toujours en attente, qui suffit à désigner une entente primordiale de
l’« histoire ». Histoire et langage sont ainsi inséparables dans la
théorie critique de Benjamin. Non parce que le langage est historique ou parce
que l’histoire parle. Ce serait manqué ce qui fait l’essence spirituelle de
l’homme. Le langage est le premier moyen par lequel les hommes font advenir des
choses et du temps, reproduisant à l’infini le geste de la création en général.
La critique benjaminienne répond à cette traduction originelle de l’agir en
reportant à nouveau et indéfiniment le sens disponible vers son origine. Ainsi,
en nommant, premier acte de traduction, premier acte de langage, les hommes
déplacent les choses dans le temps, leur livrant des postérités et des commencements.
La tâche du critique consiste à émanciper les œuvres, c'est à dire à
« circuler » dans les strates accumulées du langage, à la recherche
du nom juste. Cela se voit classiquement dans la critique dite
« littéraire » et particulièrement dans l’attention porté par
Benjamin à Proust qui lui-même assume dans l’œuvre des passages critiques vers
d’autres origines. Mais les techniques de la photographie et du cinéma
fournissent également, de façon plus originale, des langages extraordinaires à
traduire. Ces critiques de la technique moderne sont seulement plus
immédiatement menacées de subir le sort réservé au langage en général dans
l’époque « bourgeoise » de l’exploitation des mots et des
œuvres ; elles risquent d’être confisquées. Car ce que l’ère de la
reproductibilité technique (c'est à dire d’une reproduction possible sans
passage, sans décalage qui renvoie à l’origine) rend immédiat, ce n’est, par
exemple, pas seulement l’« exploitation » commerciale des
films : c’est la fin de la traduction. Le cinéma hollywoodien, dans l’œil
de Benjamin, est d’abord l’expression d’une industrie consistant à priver le
spectateur de sa capacité à traduire une œuvre. Et cela parce que le cinéma
cache ce qu’il traduit en se cachant comme traduction. Au moment où le réel
éclate, le cinéma reproduit de la continuité en cachant qu’il importe d’une
zone précédant la modernité. Il peut alors, par exemple, assurer le transfert
de l’aura traditionnelle des œuvres, devenues transcription mécanique d’une
réalité supposée intégralement transposable, vers les « vedettes » du
grand écran. Le cinéma hollywoodien devient ainsi la première usine à charisme
de l’histoire. Il existe bien sûr d’autres formes de cinéma (celui de Dziga
Vertov par exemple) qui « montrent » leur montage et permettent
d’émanciper les œuvres qu’ils produisent en leur donnant la vocation d’un
passage esthétique. Mais ces œuvres, au moment où Benjamin écrit, sont déjà
proches de perdre la bataille des foules rêveuses. Il revient donc au critique,
comme à chaque fois, de jouer une piécette sur ce qui est fragile dans les
œuvres : le détail, l’anecdote, le fortuit. Et d’attendre.
BENHAM - Qu’est-ce alors qu’une œuvre émancipée ? Un futur
possible. C’est à dire, par le jeu d’une dialectique remise en route, également
un passé redevenu possible. La plus ancienne fonction de l’art est, dans les
analyses de Benjamin, aussi celle du langage : reproduire. Émanciper les
œuvres, c’est repartir vers l’origine. Exprimée dans le contexte plus évident
du passage d’une langue à l’autre, l’opération s’appelle
« traduction ». Et la traduction fait signe vers un sens originaire,
toujours en attente, qui suffit à désigner une entente primordiale de
l’« histoire ». Histoire et langage sont ainsi inséparables dans la
théorie critique de Benjamin. Non parce que le langage est historique ou parce
que l’histoire parle. Ce serait manqué ce qui fait l’essence spirituelle de
l’homme. Le langage est le premier moyen par lequel les hommes font advenir des
choses et du temps, reproduisant à l’infini le geste de la création en général.
La critique benjaminienne répond à cette traduction originelle de l’agir en
reportant à nouveau et indéfiniment le sens disponible vers son origine. Ainsi,
en nommant, premier acte de traduction, premier acte de langage, les hommes
déplacent les choses dans le temps, leur livrant des postérités et des commencements.
La tâche du critique consiste à émanciper les œuvres, c'est à dire à
« circuler » dans les strates accumulées du langage, à la recherche
du nom juste. Cela se voit classiquement dans la critique dite
« littéraire » et particulièrement dans l’attention porté par
Benjamin à Proust qui lui-même assume dans l’œuvre des passages critiques vers
d’autres origines. Mais les techniques de la photographie et du cinéma
fournissent également, de façon plus originale, des langages extraordinaires à
traduire. Ces critiques de la technique moderne sont seulement plus
immédiatement menacées de subir le sort réservé au langage en général dans
l’époque « bourgeoise » de l’exploitation des mots et des
œuvres ; elles risquent d’être confisquées. Car ce que l’ère de la
reproductibilité technique (c'est à dire d’une reproduction possible sans
passage, sans décalage qui renvoie à l’origine) rend immédiat, ce n’est, par
exemple, pas seulement l’« exploitation » commerciale des
films : c’est la fin de la traduction. Le cinéma hollywoodien, dans l’œil
de Benjamin, est d’abord l’expression d’une industrie consistant à priver le
spectateur de sa capacité à traduire une œuvre. Et cela parce que le cinéma
cache ce qu’il traduit en se cachant comme traduction. Au moment où le réel
éclate, le cinéma reproduit de la continuité en cachant qu’il importe d’une
zone précédant la modernité. Il peut alors, par exemple, assurer le transfert
de l’aura traditionnelle des œuvres, devenues transcription mécanique d’une
réalité supposée intégralement transposable, vers les « vedettes » du
grand écran. Le cinéma hollywoodien devient ainsi la première usine à charisme
de l’histoire. Il existe bien sûr d’autres formes de cinéma (celui de Dziga
Vertov par exemple) qui « montrent » leur montage et permettent
d’émanciper les œuvres qu’ils produisent en leur donnant la vocation d’un
passage esthétique. Mais ces œuvres, au moment où Benjamin écrit, sont déjà
proches de perdre la bataille des foules rêveuses. Il revient donc au critique,
comme à chaque fois, de jouer une piécette sur ce qui est fragile dans les
œuvres : le détail, l’anecdote, le fortuit. Et d’attendre.
En moins de cent pages, Walter Benjamin, l’histoire à l’œuvre, réussit à exposer les grands modèles classiques à partir desquels travaille Benjamin et qui le rapprochent, de façon rassurante au vu de la difficulté de certains textes, d’une philosophie par « thèses ». Mais le livre parvient aussi à montrer l’écart de méthodes et de pensées qui singularise Benjamin et l’éloigne par nécessité d’une « philosophie » établie une fois pour toutes à l’abri d’une nouvelle « traduction ». L’excellente bibliographie (on regrettera seulement l’absence du grand livre de Françoise Proust, l’histoire à contretemps, le temps historique chez Benjamin) indiquera les moyens de combler l’appétit nécessairement généré par ce beau livre.
Nicolas Cominotti