Huneman, Heams, Lecointre & Silberstein (dir.), Les mondes darwiniens, Éditions Matériologiques 2011, lu par Sylvain Bosselet
Par Baptiste Klockenbring le 30 octobre 2017, 12:00 - Épistémologie - Lien permanent
Philippe Huneman, Thomas Heams, Guillaume Lecointre, Marc Silberstein (dir.), Les mondes darwiniens, Paris, Éditions Matériologiques, 2011, lu par Sylvain Bosselet.
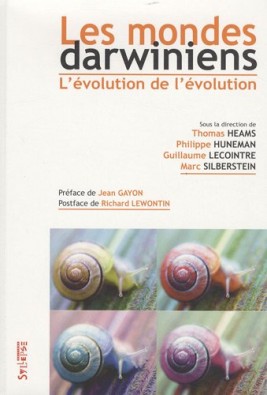
Ce livre est une somme de près de 1600 pages sur le darwinisme contemporain, par cinquante des meilleurs spécialistes francophones. Nous proposons dans cette première recension de résumer l’introduction, la préface et la première partie intitulée « Les notions » (chapitres 1 à 9).
Préface de Jean Gayon
Ce livre porte sur la théorie darwinienne aujourd’hui, dans sa fécondité et ses controverses actives. Il suit deux axes : ses fondements théoriques et l’extension de son application.
Les deux principes de Darwin, « descendance avec modification » et « sélection naturelle », ont été étendus dans leur usage et révisés dans leurs fondements. Leur extension pose le problème de savoir s’ils peuvent sortir de leur cadre initial, qui implique la reproduction. Leur application aux sciences de l’homme ne donne pas encore de résultats avérés, mais plutôt un champ exploratoire, purement philosophique. Au contraire, sur le versant phylogénétique, on est passé d’une intuition à une méthode scientifique.
Introduction, de Thomas Heams, Philippe Huneman, Guillaume Lecointre, Marc Silberstein
Les motifs de ce livre sont nombreux :
La commémoration des 200 ans de la naissance de Darwin et des 150 ans de son livre ;
L’importance unificatrice de sa théorie pour de nombreux domaines de la biologie ;
Le retard français de son assimilation par les sciences humaines, qui tient à l’a priori d’un Homme conçu comme supérieur et distinct ;
Le fait que la Théorie Synthétique de l’Évolution (TSE) semblait complète et achevée, lorsqu’une foule de découvertes sont venues la bousculer ;
La nécessité de clarification face aux contempteurs et déformateurs du darwinisme.
Chapitre 1, Variation, par Thomas Heams
Tout varie chez les vivants. Darwin s’en tenait à ce qu’il voyait (les caractères), il ignorait les lois génétiques (découvertes par Mendel) et les gènes, ces déterminants physiques des variations. Les gènes se situent dans le noyau des cellules, qui contient l’ADN. Les mutations sont des modifications de l’ADN lors de sa transmission. Elles apparaissent quand les enzymes dupliquent l’ADN pour en faire une copie avant division cellulaire. La méiose (lors de la fusion des cellules sexuelles) crée des variations en très grand nombre théorique (222).
La sélection naturelle de Darwin porte sur les caractères (phénotypes) et favorise les génotypes (ensembles de gènes) qui y correspondent. Une copie différente d’un gène est un allèle. La génétique des populations étudie les variations de fréquence allélique.
90% de l’ADN n’est pas codant. Une mutation a souvent un effet négatif sur la valeur adaptative d’une séquence codante, mais quand c’est positif, elle fait évoluer la lignée.
Le couple variation/sélection peut s’appliquer aussi au système immunitaire, au fonctionnement du cerveau, etc.
Chapitre 2, Hérédité, par Thomas Heams
Lamarck stipule « l’hérédité des caractères acquis », approuvée par Darwin. Cette loi fut réfutée par : 1/ la découverte par Weismann de la séparation entre cellules reproductrices et autres cellules du corps ; 2/ les lois de l’hérédité découvertes par Mendel, qui postule des déterminants internes discrets (les gènes).
La génétique des populations naît vers 1930. On crée le concept de « dérive génétique » (modification aléatoire de la fréquence des allèles au cours des générations). Vers 1940, Ernst Mayr établit la TSE (qui unit sélection naturelle et lois génétiques). Dans les années 1950, on découvre le support matériel des gènes, l’ADN, compatible avec les lois de Mendel. On découvre le code génétique, qui relie séquences d’ADN et protéines codées. C’est le début de la biologie moléculaire. L’ADN assure l’unité des êtres vivants et l’histoire de la vie.
Il y a d’autres formes d’hérédité, hors sexualité, dont : 1/ les « transferts horizontaux » directs, notamment entre bactéries (procaryotes) et levures (eucaryotes unicellulaires) ; 2/ l’« hérédité cytoplasmique », où l’ADN est transmis dans la cellule entre ses éléments ; 3/ l’ « hérédité mosaïque » d’un organisme qui vit en symbiose avec des bactéries et autres cellules exogènes, par le lait maternel ou le sang ; 4/ l’ « hérédité épigénétique » (non mendélienne) de certains traits, notamment avec des actions chimiques sur l’ADN.
Chapitre 3, Sélection, par Philippe Huneman
Les deux idées principales de Darwin sont : 1/ descendance avec modification (qui englobe toutes les espèces dans un arbre de vie) 2/ sélection naturelle (qui explique cet arbre et sa forme) : les plus aptes survivent plus longtemps et ont plus de descendants, auxquels ils transmettent leurs traits. La sélection opère en deux étapes selon Darwin : production de la variation héritable puis test de cette variation – d’où ambiguïté de la sélection, qui englobe les deux. Est-elle un mécanisme (la deuxième étape) ou un principe explicatif qui englobe les différents processus ?
Lewontin énonce en 1970 les conditions nécessaires et suffisantes pour que des entités entrent dans un processus de sélection naturelle, avec trois principes : 1/ variation (d’une espèce) 2/ hérédité (de certaines variations) 3/ fitness différentielle (le nombre de descendants diffère en fonction de la valeur adaptative). La rareté des ressources, que Darwin emprunte à Malthus, n’est pas nécessaire.
La sélection naturelle explique plusieurs choses différentes : l’adaptation, la diversité et l’évolution. Il y a différents types de sélection : directionnelle (mutations dans le même sens), stabilisatrice, disruptive (deux traits sont sélectionnés de façon binaire, et pas leurs intermédiaires), fréquence-dépendante (un trait est sélectionné selon sa fréquence relative), sexuelle (pour les choix d’appariement entre sexes). Le type d’objets sur lesquels porte la sélection est controversé : les allèles selon Fisher, des portions intégrées de génotypes selon Wright, des organismes selon Mayr, les gènes (et non les individus) selon Dawkins.
La sélection naturelle demeure problématique : d’un côté, les biologistes accumulent des preuves théoriques (par les mathématiques) et empiriques ; de l’autre, elle suscite les controverses précédentes. Quand ces problèmes seront résolus, sans doute aurons-nous une théorie générale de la sélection naturelle qui embrassera biologie, culture, économie, technologie, chimie, neurologie, etc. Dans des conditions requises, elle pourrait être universelle et s’appliquer à d’autres mondes.
Chapitre 4, Adaptation, par Philippe Grandcolas
Le mécanisme d’héritage avec modification explique la diversité des vivants, mais pas leur ajustement aux conditions de vie. Il faut ajouter la théorie de Darwin et Wallace : l’adaptation consiste dans le maintien par la sélection naturelle d’un trait nouveau. L’adaptation peut être le trait lui-même ou le processus qui l’a produit.
La sélection naturelle est d’intensité variable. Les conditions environnementales sélectives sont comme un tamis, à travers lequel des individus tentent un passage (qualité de leur survie et de leur reproduction). Quand les mailles sont fines, on voit bien (l’intérêt explicatif de) la sélection naturelle, pas dans le cas inverse. Quand les traits évoluent sans grande sélection, c’est une dérive génétique neutre, ce qui ne veut pas dire que la sélection soit inopérante.
Deux disciplines étudient l’adaptation, phylogénétique et biologie des populations, sur deux niveaux d’observation, taxons et populations.
Cuénot apporte (en 1903) le concept de « préadaptation » pour désigner un changement de fonction. Gould propose de dire plutôt « exaptation » pour éviter l’apparence téléologique. Les plumes furent initialement thermorégulatrices ! La maladaptation (ou désaptation) concerne un organisme dont un trait a une action défavorable à la fitness, mais est maintenu, car hérité.
Le concept d’adaptation est indispensable à la biologie de l’évolution, mais il faut notamment éviter les erreurs suivantes : confondre « ad-aptation » (aptitude plus grande) avec progrès (vers la perfection) ; croire que toute fonction a nécessairement une utilité présente, et faire preuve d’un adaptationnisme naïf (explications ad hoc et tautologies) ; tomber dans le finalisme, que Lewontin et Gould ont combattu avec l’exemple de l’apparent finalisme des tympans des arcs conçus pour maintenir un édifice, et qui ont servi à accrocher de grandes fresques : des organismes peuvent détourner la fonction de traits hérités des ancêtres (ce que Darwin savait déjà).
Chapitre 5, Fonction, par Armand de Ricqlès et Jean Gayon
Le terme « fonction » se retrouve à tous les niveaux en biologie. Elle désigne ce qu’une structure fait, mais aussi ce qu’elle est censée faire (sens normatif implicite), par exemple la vision pour un œil, qu’il fonctionne ou non.
Le fonctionnalisme a du succès car il semble expliquer rationnellement tout en donnant « un but » d’apparence théologique, comme les causes finales chez Aristote. Pourtant, la comparaison à la technologie (intentionnelle) du grand horloger n’est pas scientifique. Elle sort du matérialisme méthodologique, qui explique en remontant des effets aux causes (toujours antérieures), conformément à Lucrèce. L’omniprésence des adaptations naturelles semble faire admettre un fonctionnalisme de constat, sans finalisme transcendant. En pratique, les langages fonctionnaliste et finaliste ne sont pas discernables, sachant qu’on explique l’apparente finalité par le hasard des mutations et recombinaisons triées par la sélection naturelle.
Le concept de « système » désigne un ensemble fonctionnel et structuré de sous-structures coorganisées, qu’il faudrait décrire en termes purement physico-chimiques. Il pose un problème de finalisme moindre. Mais cette relation structuro-fonctionnelle est complexe, car elle combine 1/ historicisme et 2/ fonctionnalisme. Le premier est diachronique, et porte sur les populations, espèces et clades. Le second relève d’une causalité synchronique, qui porte sur l’organisme vivant. Rabattre le second sur le premier entraîne un faux finalisme. Mayr distingue biologie évolutionniste (des causes historiques ou médiates) et biologie fonctionnelle (des causes prochaines ou immédiates).
Dans les années 1970, Larry Wright propose une conception non finaliste, avec une théorie étiologique : la fonction d’un trait est l’effet pour lequel il a été sélectionné. Robert Cummins y répond avec une théorie systémique : seuls importent les effets qu’un système est capable de produire. Elle explique des propriétés émergentes par assemblage de structures plus petites (qui n’est pas la raison de leur existence). La première théorie est historique, c’est une biologie des causes ultimes (qui explique la présence du cœur). La seconde est mécaniste et nomologique, c’est une biologie des causes prochaines (qui explique la circulation du sang).
Chapitre 6, Caractère, par Véronique Barriel
Les « caractères », qu’Aristote appelait « parties » et Darwin « organes », servaient à décrire et classer les espèces. Les classifications se basent sur les ressemblances entre caractères, de deux types : homologie (organes ayant les mêmes relations avec les parties voisines, indépendamment de la fonction), et analogie (identité de fonction, non issue d’un même héritage évolutif). Avec l’ordinateur, la systématique phénétique (ou taxinomie numérique) permet de traiter un nombre toujours croissant de caractères morphologiques, anatomiques puis moléculaires par la seule similitude d’un maximum de caractères, pour une classification objective, stable et reproductible.
Les caractères présentent des différences entre organismes, qui sont dites « état du caractère », et servent pour les classifications. Ils n’évoluent pas tous à la même vitesse (évolution en mosaïque). Il y a distinction entre caractères d’une part intrinsèques, propres et essentiels (comme les caractères morphologiques, anatomiques, éthologiques, physiologiques ou moléculaires), et d’autre part extrinsèques (qui doivent leur apparition à un facteur environnemental, écologique, géographique ou géologique, comme des cheveux bruns). Parmi les premiers, on distingue les qualitatifs (discrets, discontinus) et les quantitatifs (continus). Les caractères moléculaires sont discrets.
La reconstruction phylogénétique se fonde sur le principe de partage des caractères dérivés (les synapomorphies) dus à une ascendance commune, maximisant ainsi le signal phylogénétique, l’homologie. Seuls les clades sont retenus, qui contiennent tous les descendants d’une espèce ancestrale. Le caractère (ou l’état) présent chez le morphotype ancestral est dit « plésiomorphe » (primitif), et le caractère dérivé « apomorphe », qui indique les relations de parenté. Le problème est que toute espèce présente une répartition en mosaïque des états primitifs et dérivés.
Chapitre 7, Espèce, par Sarah Samadi et Anouk Barberousse
Linné, Cuvier et Buffon classaient les individus selon deux critères : ressemblance et descendance entre eux. Mais cette vision discontinue entre espèces fut perturbée par Darwin : les espèces changent en continu (de la naissance à la mort) et sont apparentées. L’origine de la diversité devient une question, sans Dieu pour réponse. Il faut chercher des causes matérielles.
Depuis Darwin, on a une représentation en arbre généalogique. Les espèces y sont des branches du réseau généalogique, des lignées évolutives dont les organismes se reproduisent exclusivement entre eux. Cette structure en réseau dépend des processus de tris aléatoire (dérive) et sélectif (sélection naturelle). Richard Lenski a élevé des bactéries qui permettent d’expérimenter cette théorie de l’évolution. Les différenciations d’espèces en découlent. Si la séparation de membres d’une espèce est suffisamment longue, ils ne peuvent plus se reproduire entre eux. La division entre les deux branches est alors irréversible : c’est la « spéciation allopatrique » de Mayr. Les tris sélectif et par dérive tendant à uniformiser une espèce et distinguer deux espèces.
Au XXe, depuis Darwin jusqu’à de Queiroz, il y a trois grands critères d’espèces : 1/ phénétique (taxonomie des caractères morphologiques qui se ressemblent) 2/ biologique (interfécondité) 3/ phylogénétique (détection de l’ascendance commune par caractères dérivés). Les hypothèses qu’on en tire, toujours réfutables, sont envoyées à un système de nomenclature, nommées, et renommées si elles sont changées.
Des millions d’espèces restent à découvrir, mais on n’en décrit que 13 000 par an. Avec l’amélioration des méthodes et des techniques, notamment la mise en commun sur internet des données taxonomiques classiques et génétiques (et l’usage d’un code-barre), il sera possible d’accélérer et d’atteindre un jour l’exhaustivité.
Chapitre 8, Filiation, par Guillaume Lecointre
Darwin emploie le mot « descent », qui a été traduit par « descendance », mais qui signifie aussi bien « ascendance », voire « extraction », « souche » ou « filiation ». Cette dernière remplace à ses yeux la création divine. Il l’illustre avec l’image de l’arbre, qui en même temps explique le processus de diversification des espèces. Ce mot ambigu renvoie parfois à la science des processus (qui cherche des relations de causes à effets et s’appuie sur la sélection naturelle), parfois à celle des patrons (patterns) (qui structure des agencements entre vivants et qui n’a besoin que de la généalogie).
L’homologie est le discours sur les mêmes, qui pose une hypothèse sur la filiation, selon trois paramètres : fonction (similaire ou non), forme ou structure (similaire ou non), position ou ascendance commune (présente ou non). On compare des dizaines ou centaines d’états de caractères de deux taxons, avant de leur proposer une place dans un arbre, le plus parcimonieux possible. Auparavant, on faisait l’erreur finaliste de commencer par poser un plan d’organisation.
À partir de 1950, Willi Hennig a proposé des principes pour construire un arbre, notamment : ne classer qu’un échantillon précis d’espèces entre elles, ne faire un regroupement taxonomique qu’à partir des traits dérivés innovants, comparer ces derniers à un groupe extérieur… La question fondamentale est : qui est plus proche de qui ? Ensuite, on nomme les clades, c’est-à-dire chaque branche et tout ce qui est en aval.
Depuis la découverte des transferts horizontaux de matériel génétique, la métaphore généalogique reste d’actualité, mais certaines parties de l’arbre théorique de la vie ressemblent à un réseau réticulé.
Les naturalistes rencontrent le problème de la disparition des ancêtres, qui les contraint à distinguer « arbre phylogénétique des vivants actuels » et « arbre généalogique du vivant » (théorique et métaphorique). Les espèces ancestrales concrètes (au sens génétique) sont inconnaissables empiriquement, mais les espèces ancestrales abstraites restent indispensables théoriquement.
Chapitre 9, Vie, par Stéphane Tirard
L’auteur cherche les définitions historiques de la vie à travers la question de son origine.
Quand le microscope fut inventé, on a réfléchi à la « génération spontanée » (l’animalisation de la matière). Diderot imagine une molécule inerte, puis vivante, plante, animale, dans une chaîne de transformations. Fin XVIIIe, Buffon parle de « molécules organiques » qui constituent les vivants. Au XIXe, Bernard évoque trois degrés de relation entre le vivant et le cosmos. Pasteur nie la génération spontanée.
Darwin introduit le temps historique dans le vivant et une hypothèse sur l’origine de la vie dans un marre chaude avec de l’électricité. Il rejette la génération spontanée et ne définit pas le vivant. Fin XIXe, les théories de « l’abiogenèse » (formation de la vie) ne sont pas connectées à l’état que devait avoir la Terre, et s’opposent aux théories de « la panspermie » (vie venue de l’espace).
Au XXe, la génétique mendélienne est reliée à l’évolution via la génétique des populations, puis son support l’ADN. Du coup, on repense l’origine de la vie avec ces nouvelles molécules et des conditions plus précises de la Terre. À partir des années 1950, on obtient des synthèses chimiques dans les conditions supposées de la terre primordiale, champ de la chimie prébiotique. C’est une approche réductionniste. En une quinzaine d’années, on a reconstitué trois étapes : synthèse de molécules organiques à partir de minéraux, production de polymères, synthèse de compartiments qui préfigurent les cellules.
En 1986, Walter Gilbert propose l’antécédence de l’ARN sur l’ADN (scénario encore admis). Dans les années 1960, Cairns-Smith propose une succession de systèmes (antérieurs à l’ARN), où les entités se remplacent sans laisser de traces des précédentes. Cette période prébiologique étendrait la validité de l’explication darwinienne au-delà de la vie.
Les chimistes prébiociens pensent aujourd’hui que la vie est universelle dans l’univers. Celle-ci est difficile à définir : on ne connaît son étendue ni spatialement ni temporellement. Mais le manque de définition n’empêche pas la recherche en biologie, et stimule les questions fondamentales sur le vivant.
Commentaire personnel
Cette somme est un travail magistral et sans concessions sur l’état des recherches actuelles en philosophie de la biologie. Elle est aussi précise que complète. Son niveau conceptuel est très élevé, puisqu’elle plonge au cœur des recherches par les meilleurs spécialistes d’un domaine très exigeant. Mais la mise en perspective historique de ces recherches de pointe les rend accessibles aux lecteurs exigeants. Cette somme permet tant aux philosophes qu’aux biologistes d’affûter leurs concepts sur l’évolution, dans le cadre des retombées contemporaines de la théorie darwinienne. Truffée de connaissances techniques, elle offre un panorama indispensable à quiconque souhaite comprendre ou manier philosophiquement les éléments complexes de la biologie évolutionniste fondamentale.
Sylvain Bosselet (09/06/2017).