Marylène Patou-Mathis, Préhistoire de la violence et de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2013, lu par Arnaud Rosset
Par Michel Cardin le 24 janvier 2014, 06:00 - Sociologie - Lien permanent
 Marylène Patou-Mathis, Préhistoire
de la violence et de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2013
Marylène Patou-Mathis, Préhistoire
de la violence et de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2013
Dans cet ouvrage, l’auteure recoupe les données de l’archéologie et de l’anthropologie pour explorer les origines de la guerre et de la violence chez l’homme. Une recherche qui nous entraîne dans les enjeux philosophiques de l’étude de la préhistoire.
In this book, the author collects archeological and anthropological data to explore the origins of war and violence in humans. This research leads us into the philosophical issues of the study of prehistory.
La violence chez l’homme est-elle naturelle ou résulte-t-elle d’une construction sociale ? Et sa forme la plus institutionnalisée, la guerre, a-t-elle toujours existé ou n’est-elle apparue qu’à un certain stade de développement de l’humanité ? A cette double interrogation qui n’a cessé d’animer l’histoire de la philosophie et des sciences humaines, l’auteure de cet ouvrage, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la préhistoire, entend répondre par une approche scientifique conjuguant les apports de l’archéologie et de l’anthropologie. Mais, que le philosophe se rassure, loin de noyer le lecteur sous des avalanches de faits bruts qui prétendraient à eux seuls faire office de démonstration, Marylène Patou-Mathis prend soin de questionner les traces empiriques en les replaçant à chaque fois dans le contexte d’une discussion thématique aux enjeux théoriques à la fois clairs et ambitieux : « L’apparition de l’État a-t-elle favorisé celle de la guerre ? », « la domestication est-elle à l’origine des inégalités ? », « le sens moral a-t-il une base biologique ? », « la violence est-elle inscrite dans nos gènes ? », « L’homme est-il un loup pour l’homme ? », etc. C’est d’ailleurs la grande force didactique de cette enquête que de parvenir à rappeler à chaque fois, dans le cadre de ces axes thématiques, les différentes hypothèses qui ont été proposées au cours de l’histoire de la pensée en sollicitant les interprétations les plus marquantes (de Lucrèce à René Girard, en passant par Hobbes, Rousseau, Marx, Freud, Lévi-Strauss ou Pierre Clastres pour n’en citer que quelques-uns), tout en les confrontant aux données scientifiques les plus récentes (biologie, neuro-sciences, socio-biologie et bien sûr archéologie).Il s’agit donc d’un argumentaire à la fois rigoureux et harmonieux qui fait, au passage, de ce livre, et bien que ce ne soit pas son but, un excellent outil pédagogique pour accompagner certaines notions du programme de terminale en philosophie.
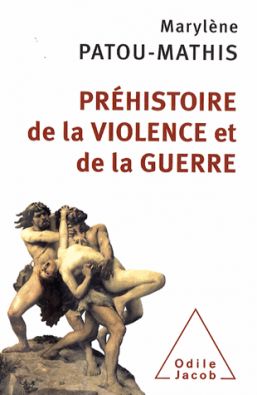
En premier lieu (pp. 23-44), l’auteure donne la parole aux traces archéologiques afin de déterminer, au moins approximativement, le moment où la violence physique et la guerre apparaissent effectivement au sein de l’histoire de l’humanité. Or, il ressort de cet exerciceune conclusion sans ambiguïté : on constate durant le paléolithique des manifestations ponctuelles de violence (notamment à travers l’existence de rites cannibales), mais aucune fouille n’atteste par ailleurs que la pratique de la guerre aurait précédé le néolithique. Ce double constat déterminant exige alors logiquement d’établir les causes et circonstances qui ont pu favoriser la systématisation de la violence et l’institutionnalisation de la guerre durant le néolithique.
C’est l’objet du second moment de l’enquête (pp. 49-127), qui est aussi le plus riche par le nombre de dimensions (économique et sociale, politique, géographique, religieuse, biologique) qu’il aborde. Les principales conclusions auxquelles l’auteure parvient sont les suivantes : tout d’abord, l’institutionnalisation de la guerre ne serait pas directement liée à la compétition pour l’acquisition des ressources ou des territoires, compétition qui, si l’on s’en tient à la convergence des vestiges archéologiques (pp. 49-55), n’a au mieux joué qu’un rôle marginal dans l’apparition des conflits guerriers ; ensuite, la généralisation de la violence ne semble pas non plus pouvoir être ramenée à des facteurs biologiques. À l’inverse, c’est plutôt la solidarité et l’empathie qui paraissent avoir dès le départ été caractéristiques de l’être humain. Sur ce point, l’auteure prend acte à la fois des récentes découvertes en neurosciences (notamment, la mise à jour d’un mécanisme cognitif de communication non verbale permettant d’inhiber la violence) et des traces archéologiques pour affirmer que notre espèce a très tôt manifesté des tendances à la coopération. Exemple évocateur : l’examen de nombreux squelettes d’individus ayant vécu entre - 500 000 et - 300 000 ans (pp. 125-126) atteste des traces de handicaps lourds largement antérieurs à leur décès, ce qui signifie qu’ils n’ont pas pu vivre durant de nombreuses années sans l’aide permanente de leurs semblables. C’est donc plutôt l’entraide qui aurait prévalu chez nos lointains ancêtres, une entraide qui témoignerait de la présence d’émotions telles que l’empathie ou la compassion. Non d’ailleurs qu’il faille nécessairement faire une lecture moraliste d’un tel constat, puisque ces comportements ont peut-être avant tout été les « clés de la réussite évolutive de notre espèce », là où la compétition aurait au contraire constitué une impasse définitive. Dans tous les cas, il semble bien que l’antériorité certaine de ces phénomènes cognitifs et comportementaux sur l’apparition des religions et de la civilisation contredise l’idée selon laquelle de tels phénomènes seraient justement un produit de ces dernières visant à contrer notre violence instinctive.
Mais alors d’où proviennent l’institutionnalisation de la guerre et la généralisation de la violence ? D’après les données archéologiques, c’est le développement de l’économie de production et le bouleversement corrélatif des structures sociales et des croyances qui en seraient les principales causes. À ce niveau, l’auteure ne se risque pas vers une lecture unilatérale, mais privilégie comme explication la conjugaison de différents facteurs (pp. 57-96) : d’un côté, le surplus des biens et l’apparition de la propriété privée ont probablement favorisé l’établissement d’une élite puis d’un système de caste générant une augmentation des conflits intra et intercommunautaires ; de l’autre, l’évolution des structures de parenté au profit de la domination masculine et de la systématisation du patriarcat est certainement liée à de nouveaux rites et cultes (entre autres relatifs à des divinités masculines) valorisant la violence et les activités guerrières.
À l’aune de ces hypothèses qui penchent clairement en faveur d’une violence socialement construite, Marylène Patou-Mathis s’engage alors dans le dernier moment de son enquête (pp. 135-160) pour revenir sur le principal enseignement des données évoquées : loin de l’image du darwinisme social qui affecte trop souvent notre vision des temps primitifs, l’homme préhistorique n’est donc ni le descendant d’un singe tueur (hypothèse développée au début du XXe siècle et longtemps privilégiée) ni un être engagé dans une compétition permanente et sans pitié pour les biens. Sans céder à une vision idyllique et moraliste de notre ancêtre, il est clair qu’il s’avère avoir été largement capable d’empathie comme de solidarité et que, s’il a bien manifesté des formes de violence dès les origines (notamment à travers les rites cannibales), c’est certainement pour conjurer des angoisses générées par les phénomènes naturels plutôt que pour assouvir des pulsions incontrôlables. Fort de cette leçon, il reste alors à comprendre comment a pu s’élaborer le mythe d’une humanité primitive ultra-violente et guerrière. Selon l’auteure (pp. 135-146), cet imaginaire résulte d’une part d’une construction savante des premiers préhistoriens qui, dès la seconde moitié du XIXe siècle, ont systématiquement interprété les traces archéologiques (fossiles, armes, peintures rupestres, etc.) comme des preuves irréfutables de l’existence d’une réalité guerrière et d’autre part d’une construction artistique et culturelle (mode du roman préhistorique, développement des expositions sur les « primitifs ») qui a popularisé et entretenu le folklore d’un âge de pierre bestial et féroce. Une double construction donc, qu’une interprétation plus fouillée des données à disposition nous invite explicitement à remettre en cause.