Ugo Batini, Schopenhauer, Ellipses 2016, lu par Jean Kessler
Par Michel Cardin le 04 juillet 2019, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
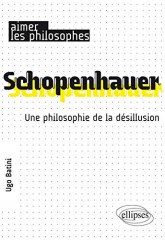 Ugo Batini, Schopenhauer. Une philosophie de la désillusion, Ellipses, avril 2016, collection « Aimer les philosophes » (256 pages). Lu par Jean Kessler.
Ugo Batini, Schopenhauer. Une philosophie de la désillusion, Ellipses, avril 2016, collection « Aimer les philosophes » (256 pages). Lu par Jean Kessler.
Premier d’une nouvelle série intitulée « aimer les philosophes », l’ouvrage d’U. Batini se propose donc de nous faire aimer Schopenhauer. La tâche peut sembler aisée, car autant la cohérence et l’unité des thèmes abordés par l’auteur du Monde comme volonté et représentation, que son style clair, exempt de néologismes et de jargon, font depuis plus d’un siècle de la lecture de ce philosophe (sans doute un des plus lus et des plus influents) un plaisir indéniable.
 La réhabilitation d’une pensée trop aimée
La réhabilitation d’une pensée trop aimée
Nous sommes tous quelque peu schopenhaueriens dès que nous professons un pessimisme radical, que nous cherchons une consolation dans l’art, que nous éprouvons dans l’ennui le dégout de la vie et la vanité de nos entreprises ou que ne voyons dans l’amour qu’une illusion de l’individu manipulé par des pulsions qui le dépassent. Mais les raisons pour lesquelles nous préférons lire La métaphysique de l’amour sexuel plutôt que La doctrine de la science ou la Logique ne sont pas nécessairement des bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons qui font honneur à la profondeur et l’importance d’une pensée. Comme en art, où il faut se méfier de ce qui plaît, il faut se méfier des philosophes qu’on aime, car c’est courir le risque de mal les aimer. Aussi, délaissant cet aspect qu’on dira « facile » et à l’encontre d’une popularité qui risque d’en trahir la portée, l’ouvrage d’U. Batini s’efforce-t-il, d’une certaine manière de défendre la pensée de Schopenhauer contre son propre succès. Malgré sa taille modeste, ce qui est proposé dans ce livre est exigeant : il s’agit de reconstruire, dans sa rigueur et ses apories, une pensée afin de montrer que sa nouveauté radicale et son importance essentielle se situent sur un autre plan que celui auquel on l’a souvent réduit. Pour le dire autrement : l’idée est de prendre au sérieux le titre du maître ouvrage de Schopenhauer, celui qui à la fois condense et déploie son intuition unique et abyssale, et de porter l’attention sur cette pensée tout d’abord en tant qu’elle est une métaphysique, c’est-à-dire un discours qui se propose, ni plus ni moins, de dire ce qu’il en est du monde dans son essence. C’est le statut métaphysique de cette pensée qui le rattache aux grandes problématiques et notamment à la figure omniprésente et incontournable de Kant. C’est lui qui en engendre les tensions et problèmes les plus féconds, nous conduisant ainsi à nous faire aimer ce philosophe non pas pour des formules faciles et les « solutions » qu’il apporte à des problèmes déjà existants, mais à proportion des idées et problèmes nouveaux que soulèvent ses propres propositions. C’est enfin lui qui « rend possible les grandes analyses de la doctrine […] et leur donne leur sérieux » (M. Henry, Généalogie de la psychanalyse, PUF, p. 190).
Une mise en contexte, rappelle d’abord succinctement la biographie intellectuelle de Schopenhauer et les influences qui ont contribué à la formation de sa pensée. Parmi celles-ci, il convient, selon U. Batini, de noter l’influence, non explicitement avouée par Schopenhauer lui-même, de la tradition mystique et notamment de Boehme, qui, par la théorie de la signature, joue un rôle décisif dans l’élaboration de la théorie de la connaissance par analogie qui permet de déduire, de notre expérience du corps propre, l’essence du monde. A l’inverse, la parenté très souvent soulignée par Schopenhauer lui-même avec les Upanishads indique plus, comme l’avait montré déjà R-P Droit dans l’Oubli de l’Inde, une sorte de « récupération » après coup de thèmes s’intégrant à une doctrine déjà constituée, qu’un rôle véritablement constructif.
Le monde, la volonté, la représentation : exégèse d’un titre.
Après cette mise en contexte, l’ouvrage d’U. Batini propose en dix chapitres un parcours en pensée de la philosophie schopenhauerienne. Ce parcours, on l’a déjà suggéré, se donne pour but d’accorder à cette philosophie sa place à un espace rendu à la fois totalement nécessaire et totalement problématique par les analyses kantiennes : l’espace métaphysique. Mais à quelle métaphysique a-t-on à faire ici ? Est-ce un simple refus de l’interdit kantien portant sur la possibilité d’une connaissance de la chose en soi ? Est-ce une façon plus ou moins cohérente de proposer un dépassement de l’expérience, une sorte d’ « intuition intellectuelle » qui ne dirait pas son nom ? Ou bien la thèse centrale de cette métaphysique : le monde est volonté (ou vouloir) ne conduit-elle pas à ce qui en serait au fond le contraire : une « infra-physique » (p. 65), et en tous les cas, à une « autre métaphysique » (ch. 6) ?
Schopenhauer, comme le rappelle U. Batini, semble d’abord se ranger du côté d’une métaphysique classique, c’est-à-dire, pour reprendre les termes mêmes de l’auteur du Monde…, « ce qui a la prétention d’être une connaissance dépassant l’expérience » (Compléments au Monde… cités p. 82). La question est cependant de savoir si le terme « expérience » a le même sens selon que nous parlons de l’expérience interne ou de l’expérience externe. Pour Kant, (Prolégomènes… § 1), les deux formes de l’expérience sont sur un même plan et une métaphysique partant de l’expérience est une contradiction pure et simple. Or c’est précisément sur ce point que Schopenhauer rompt avec l’interdit kantien, en affirmant qu’une métaphysique, c’est-à-dire « une vraie compréhension du monde » peut s’ancrer dans une expérience, l’expérience que nous faisons de notre propre corps, laquelle cependant, c’est là le point qui rattache Schopenhauer à ce courant essentiel de penseurs qui développent une critique de la domination de l’objectivité sur toutes nos conceptions du réel, n’a rien à voir avec l’expérience du monde extérieur. Que le sentiment et la sensation (en termes schopenhaueriens, la « représentation ») soient deux dimensions ontologiques distinctes, cela constitue l’apport décisif de cette pensée, mais aussi son point le plus problématique puisqu’il oblige à articuler ces deux notions clés : volonté et représentation. C’est cet aspect complexe et problématique que ce parcours en pensée s’efforce de mettre au jour, proposant ainsi une sorte d’exégèse du titre, peut-être même d’exégèse du seul « et » de ce titre. Faut-il l’entendre comme un « et aussi » : le monde comme volonté et aussi (ou est aussi) comme représentation ? Ou au contraire comme une opposition, « et non pas » : le monde comme volonté, et non pas comme représentation ?
Abondant d’abord dans ce deuxième sens, U. Batini note qu’il « faut prendre garde à ne pas être trompé par le titre même du Monde » (p. 112) qui semble mettre sur le même plan la volonté et la représentation. La représentation, justement n’est pas le monde, mais ce qui nous le dissimule, son « voile de Maya », son illusion, sa « tromperie » (p. 137). La raison fondamentale en est que la volonté est une et que la représentation est son objectivation dans la multiplicité des phénomènes, laquelle, suivant en cela Kant, est le résultat de leur situation unique dans l’espace et le temps. Ainsi toute la connaissance portant sur les phénomènes, s’appuyant sur la causalité est illusoire, pour autant que ce phénomène lui-même est Schein (apparence) et non Erscheinung (apparaître). Bien avant le Bergson des Données immédiates de la conscience, la longue analyse amorcée dans La quadruple racine du principe de raison suffisante, puis dans le premier chapitre du Monde, pose les bases d’une critique de l’équivalence qui domine notre pensée entre science et (seul) discours (vrai) sur le réel. La science - c’est là un topos classique depuis la critique romantique du caractère abstrait, mécanique, formel du monde élaboré par une physique mathématisée - manque l’essentiel. Celui-ci est à chercher en nous, dans l’intuition, dans une pensée intuitive et organique, apparentée à l’art plus qu’au concept. Mais c’est principalement, on l’a déjà évoqué, l’expérience du corps propre, seul point d’articulation sensible entre la volonté et la représentation, parce que « seul objet que nous puissions connaitre de deux façons » (p. 60), à savoir du dedans, immédiatement, et du dehors, en tant qu’objet, qui sert à Schopenhauer de « sésame métaphysique » (ibid.). Le fait, d’une part, de placer au centre de sa métaphysique l’expérience intérieure que chacun fait de l’immédiateté du vouloir dans chacun de ses gestes (vouloir bouger le bras n’est pas autre chose que le bouger et je ne me représente pas le mouvement avant de le faire), et le fait, d’autre part, d’affirmer l’identité du vouloir en chacun avec le Vouloir unique qui traverse la totalité de ce qui est, constituent le véritable coup de force et « l’originalité de cette pensée » (p. 61). Mais Schopenhauer ne recule-t-il pas ici devant les conséquences de son geste intellectuel qui le conduit à destituer la raison, l’intelligence, la science de leur prétention à nous livrer la vérité ? On peut noter qu’une forme d’incohérence se fait jour dans cet aspect de la pensée de Schopenhauer. Celui-ci, on le sait, professe conjointement un idéalisme subjectif, sorte de constructivisme avant l’heure qui fait du monde « ma représentation » et qu’il emprunte, moyennant un contre-sens volontaire, à la critique kantienne dont il pense tirer l’identification de Schein et d’Erscheinung, et un matérialisme athée où les analyses du monde comme volonté empruntent massivement aux acquis des sciences naturelles, notamment à la physiologie. Plus qu’un emprunt aux théories vitalistes de Cabanis et Bichat, les analyses, qui mènent à la reconduction permanente des idées dans le domaine des affects et du corps - ce que C. Rosset nomme « l’intuition généalogique » -, de même que, par exemple, la mise au jour de l’illusion de l’individualité de l’amour comme manifestation déguisée des pulsions de l’espèce, semblent inviter à une véritable « biologie des passions », ou à une lecture évolutionniste et darwinienne de nos comportements et constructions culturelles. « La base métaphysique est donc toujours assurée et confirmée par les progrès des sciences de son temps » (p. 112), et, osera-t-on ajouter, par celles encore plus flagrantes des sciences actuelles dont la puissance de « désillusion » ne cesse de mettre à mal l’idéalisme humaniste qui fait de l’homme un sujet, une liberté. Suffit-il alors de dire qu’il s’agit « non d’un refus », mais « d’une limitation du domaine de la science » (p. 27) pour lever cette incohérence ? Peut-on vraiment continuer d’affirmer que la science et l’explication causale ne nous livrent rien du réel, qu’il faut les abandonner comme des illusions ? En réalité, à travers la question du statut hésitant de la science, nous sommes renvoyés au principal problème du Monde : celui du statut de la représentation. Le sous-titre de l’ouvrage « une philosophe de la désillusion » nous invite à ne voir en celle-ci que l’illusion dont il faut se défaire pour accéder à l’essence du monde. Mais se réduit-elle à cela ? Est-elle ce qui masque constamment à nos yeux l’absurdité, l’absence de fondement, de raison, d’explication qui en est la vérité ultime ? Ou bien, peut-on aussi en un sens « sauver les phénomènes » ? Affirmer une nécessité de la représentation ? Accorder à ce néant une forme d’être ?
En somme, la représentation a-t-elle un sens ? La philosophie de Schopenhauer est-elle véritablement une philosophie de l’absurde ?
Peu après avoir affirmé le caractère trompeur du titre qui laisse croire que la représentation contiendrait une part de vérité, et mériterait donc une certaine valeur, U. Batini, revenant sur cette affirmation, souligne cependant, à l’inverse, la nécessité de celle-ci. Cette « réhabilitation » (p. 113) de la représentation se fait par le biais d’une critique de la lecture que fait M. Henry de Schopenhauer. Comme d’autres philosophes (C. Rosset, par ex.), mais pour d’autres motifs, M. Henry voit en cette métaphysique une pensée inaboutie, échouant à mener à leur termes les intuitions fulgurantes qui la suscitent, à savoir la récusation radicale de la représentation au profit de l’immanence de la vie et de la subjectivité absolue du corps propre. « La dévalorisation outrancière de la représentation que croit lire M. Henry dans l’œuvre de Schopenhauer est ainsi à nuancer grandement » (p. 113), car « il devient nécessaire de réaffirmer le lien nécessaire qui unit volonté et représentation » (p.115). Il faut donc bien entendre le « et » du titre de cet opus magnum comme un « et aussi ». Il faut également admettre qu’il y a « un sens qui se manifeste à travers la représentation » (p. 121) - laquelle ne serait donc pas seulement Schein, mais finalement aussi Erscheinung. Mais lequel ? N’entre-t-on pas ici en contradiction avec les descriptions « dantesques » (p. 122) qui visent à nous convaincre que ce vouloir-vivre si puissant, au principe de tout ce qui est, ne veut proprement rien, rien que lui-même, de manière irrationnelle, insensée et précisément absurde ? Le monde a-t-il quand même un sens, une raison, un but ?
Ici s’ouvrent des analyses complexes, car denses, qui soulignent à nouveau, si besoin était, combien la pensée de Schopenhauer ne se laisse pas réduire à une doctrine monolithique et trop simple. Une des manières, proposée par U. Batini pour caractériser ce sens de la représentation, est l’idée empruntée par Schopenhauer à la mystique boehmienne d’un « monde qui serait la connaissance de soi de la volonté » et de son prolongement non entièrement assumé (toujours ce constat d’une pensée inaboutie…), mais formulée par son disciple E. von Hartmann, d’un idéalisme objectif faisant de la volonté un Sujet absolu. Dans une perspective qui sera aussi celle de Bergson dans les Deux sources… lorsqu’il écrit « l’homme est la raison d’être de la vie sur notre planète » (éd. « du centenaire », PUF, p. 1192), on comprend ici que c’est en l’homme (du moins en ceux chez qui le besoin métaphysique s’est éveillé) que la Volonté parvient à la connaissance d’elle-même. L’absurdité du vouloir-vivre parvient en lui à sa propre conscience, et cette conscience est la condition pour que le vouloir-vivre d’abord s’affirme, puis se nie. « Pour la première fois [en l’homme] la volonté peut s’affirmer réellement en pleine conscience » (p. 123). S’ouvre alors la possibilité - en un sens ultime, puisqu’elle justifie l’ensemble de cette pensée - d’un salut, d’une rédemption qui reste au fond, classiquement et à l’encontre de la dévalorisation de la représentation, un salut par la connaissance. Mais parce qu’une telle perspective entre en contradiction totale avec le travail de désillusion menée tout au long du Monde concernant une quelconque autonomie de la pensée et de la connaissance par rapport aux affects et à la volonté, il faut supposer que le moment de négation (la volonté s’affirme puis se nie) est le moment de l’auto-négation de la volonté. En d’autres termes, il s’agit de penser une rédemption, un salut compatible avec la fondamentale passivité du sujet qui constitue le cœur de l’entreprise de désillusion schopenhauerienne. La difficulté est alors de penser rigoureusement, c’est-à-dire dans leurs conditions de possibilité, les expériences exhibées par Schopenhauer pour attester de l’existence d’une négation du vouloir-vivre, pour introduire donc une forme de liberté dans l’aveugle pulsion qui fait persévérer tout ce qui est dans son être. On le sait, il s’agit aussi bien de l’expérience esthétique dans laquelle je me rapporte de façon désintéressée à un objet, que de l’expérience morale que constitue la compassion par laquelle je ressens dans mon corps l’universelle souffrance de tout ce qui vit, abolissant ainsi l’égoïsme qui me limite à ne ressentir que ce qui me touche personnellement, ou enfin que de l’ascèse, étrange retournement de la pulsion de vie contre elle-même, désir de mort qui fait du plaisir, cet aiguillon du désir, non pas le but de nos actions, mais cela-même que nous cherchons à fuir. Expériences étranges, encore une fois, puisqu’elles semblent dégager une faille dans le monisme ontologique de la volonté comme essence du monde. Ces trois voies cependant « ne sont en réalité que des étapes vers la libération du vouloir » (p. 132) qui procède finalement, tout de même d’une libération par la connaissance, au sens où ces expériences sont celles d’une « vision », d’une compréhension intuitive (ou extatique, dans la mystique). Cette vision est celle qui découvre l’individu comme ultime illusion et le néant dans lequel celui-ci finit par s’abîmer, comme dernier mot de l’être. Cette vision à la fois réelle (si on accepte la réalité de l’expérience mystique) et impossible pour autant que notre corps nous assigne irréductiblement à une existence individualisée, caractérisée par son ipséité, cette vision et ce salut donc contradictoires font du dernier mot du Monde : nichts, rien, l’unique conclusion possible d’une pensée qui ne peut plus penser ni dire ce à quoi elle a abouti. Parvenu « au bord du monde » (p. 131), nous sommes aussi arrivés au bout du langage et de la philosophie et l’auto-négation du vouloir se réalise dans l’auto-négation de la pensée.
L’ouvrage d’U. Batini se clôt par parcours en texte et un bref vocabulaire permettant de clarifier l’usage particulier et récurrent de certains concepts dans cette philosophie, qui - c’est à quoi l’auteur a voulu rendre justice - est certes beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre l’image qu’on s’en fait souvent.
Jean Kessler (08/07/2016)